lundi, 29 septembre 2025
29092025
Me voici à Paris, invité à assurer la première séance du séminaire « Ecrire et traduire au féminin » à l’ITEM. Grand honneur, et stress équivalent. À l’origine, j’avais évoqué avec ma collègue Claire Riffard la mine de tapuscrits et documents inédits que j’avais pu découvrir et consulter dans les archives personnelles de Patrice Nganang, mais comme Ananda Devi m’a aussi confié quelques documents permettant d’éclairer son travail d’auto-traduction dans l’édition indienne (en anglais) de Pagli, j’ai proposé d’intervenir sur ce sujet, conforme au thème du séminaire. Nous verrons plus tard pour l’impressionnante masse de documents dont je dispose pour Patrice Nganang (et dont je me servirai déjà pour ma communication d’après-demain à Jaén).
Attablé dans un café, car mon train arrivait très tôt (le séminaire n’a lieu que cet après-midi), je relis mes notes, j’ajoute des pattes-de-mouche, et je relis aussi Deux malles et une marmite. Le chapitre 3 de cet essai sublime, qui pourrait – avec l’immense corpus d’Ananda – lui valoir le Nobel (mais il faudrait qu’il soit traduit), me frappe soudain pour un tout autre objectif : au second semestre, je vais donner un nouveau cours, cinq séances de deux heures, au sein du module d’ouverture « Grands Textes », ouvert à l’ensemble des L1 de la faculté Lettres & Langues.
Bien entendu, j’ai eu bien du mal à restreindre mon choix à cinq « grandes » œuvres de la littérature africaine et antillaise, et, comme je compte proposer une critique du concept même de patrimonialisation (les fameux « grands textes »), il n’y aura pas mieux que d’ouvrir la première séance avec une lecture du chapitre 3 de Deux malles et une marmite.
Confirmation, encore et toujours, que tout se tient et que tout se rejoint ; j’ai appris la semaine dernière, en faisant des recherches pour cette conférence, que zwenn – le mot qui, en créole mauricien, signifie rencontre – vient du verbe français joindre. En créole martiniquais et haïtien, c’est jwenn, d’ailleurs. Il y a là une cristallisation lexicale de l’idée même de comparatisme.
Autre exemple, plus tôt ce matin : relisant, dans Pagli, le chapitre où la narratrice raconte – et refuse de raconter – le viol subi à l’âge de treize ans, je n’ai pu manquer de noter les analogies avec le chapitre de Beyond the Horizon (d’Amma Darko) sur lequel j’ai travaillé ce week-end en vue de la communication pour Jaén. Tout n’est pas d’un seul tenant, mais, comme l’écrit Ananda Devi, toujours dans Deux malles et une marmite : « Tu n’étais pas leur voix : ils étaient la tienne. » Tout est ici un effet d’échange permanent et d’impossible rééquilibrage.
10:43 Publié dans 2025, Affres extatiques, Autoportraiture, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)


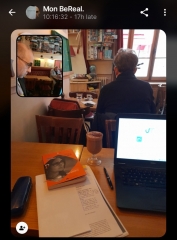
Écrire un commentaire