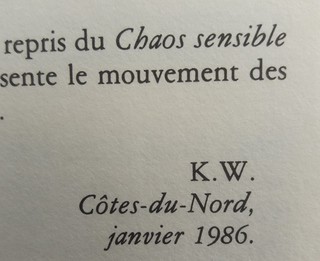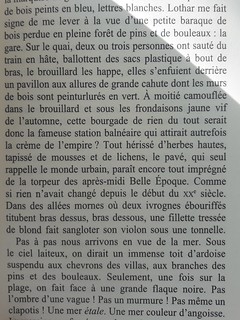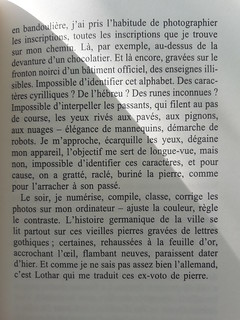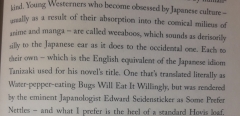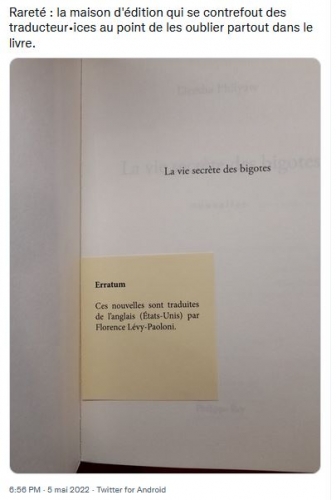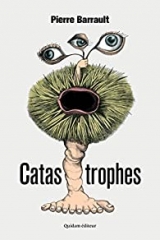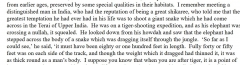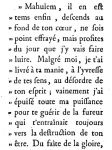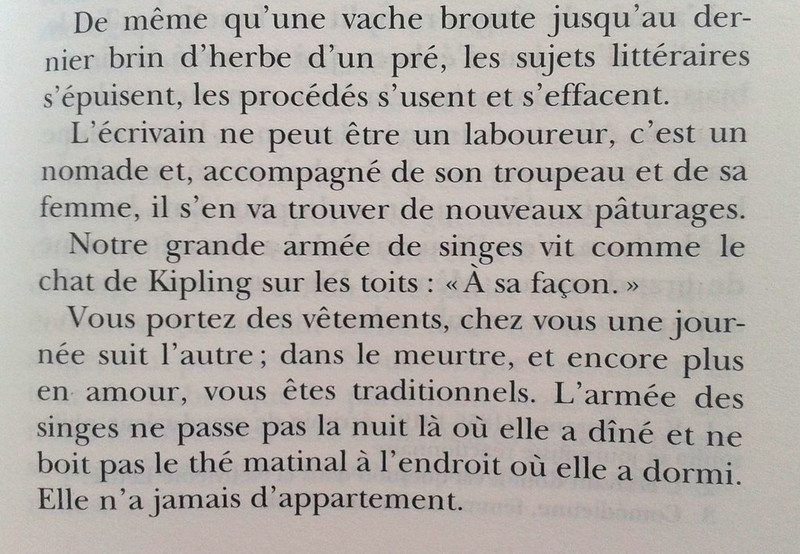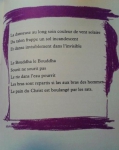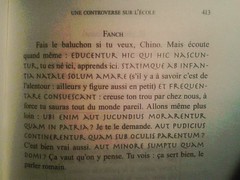dimanche, 05 mai 2024
05052024
Je suis un homme ridicule, qui a deux paires de chaussons identiques, l’une plus usée que l’autre (et tachée de boue) et qui sert pour de brèves incursions dehors, et l’autre pour la maison.
Mais ce n’est pas ça que je voulais écrire. – Ce que je voulais écrire, c’est que je suis un homme ridicule, qui a commencé à lire Praiseworthy d’Alexis Wright il y a trente-deux jours, le mercredi 3 avril 2024, dans le train qui l’emmenait (qui m’emmenait) à l’aéroport de Roissy, et qui a quasiment achevé ce livre ce matin, en se laissant (en me gardant) les douze dernières pages, le tout dernier chapitre, pour plus tard. Bien sûr j’ai lu d’autres livres dans l’intervalle, et ce bien que ce mois n’ait guère été des plus féconds pour la lecture ; par exemple, j’ai lu trois livres de Sindiwe Magona, et ce bien que le nom de cette autrice n’ait guère été plus ou mieux qu’un nom alors que j’embarquais le 3 avril au soir à destination de l’Afrique du Sud. C’est aussi à cela que servent les voyages : voici une « nouvelle » autrice, dont on va découvrir l’œuvre.
Voici la dernière phrase de l’antépénultième chapitre, à la page 706 de l’édition Giramondo (mon exemplaire de papier blanc immaculé désormais grisé façon pelage d’âne), ce croisement improbable ayant plus sa place dans la rubrique Droit de cité de l’autre blog (mais j’assume être ridicule) :
The hauling business stops for no one at a quarter past six in the morning, and a man like Cause knew he could counter bullshit with super bullshit any day of the week as he walked the fields at the slow measured pace of Joshua Bell playing Max Bruch's Scottish Fantasy with the Academy of St Martin in the Fields, and knowing he was nailing it, and would continue working through another hazy day over the ancestral spirit charged ground where the solemn blades of dead grass guessed the next movement in the spirit song of the breeze, and his thoughts never lost the single heartbeat of each donkey in the herd of a thousand he had accumulated across Praiseworthy in the platinum donkey conglomerate transport business.
10:37 Publié dans 2024, Autres gammes, Lect(o)ures, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 07 février 2024
Trois livres de Guy Bennett traduits par Frédéric Forte aux éditions de L'Attente
Trois pour (même pas) le prix d’un ——— On s’est demandé s’il fallait placer la parenthèse du titre entre pour et le ou entre le et prix : car ce que j’ai voulu dire, c’est – comme on le voit avec les codes-barres – c’est que ces livres ont été empruntés à la B.U. (Et ce n'est même pas le titre retenu pour le billet de blog. (Pondre ces billets me prend trop de temps. L’exhaustivité prend trop de temps. Même pour gagner du temps sur les vidéos, ces billets me prennent trop de temps. Et tiens, l’alarme sonore indiquant que la lessive est terminée résonne.))
Ce fut donc, hier et ce matin, la découverte de Guy Bennett, oulipien et américain. Je sens que je vais toujours le confondre avec Guy Davenport. On n’a pas idée de ne pas être francophone et de se prénommer Guy. J’ai lu ces trois petits livres de Guy Bennett car ils ont été traduits (en fait : co-traduits) par Frédéric Forte, qui m’a demandé en ami il y a quelques jours sur Facebook, sans que je sache trop pourquoi (j’ai lu naguère voire jadis son Dire ouf, mais c’était avant le vlog donc je n’en ai jamais parlé).
Ces trois recueils traduits par F.F. (j’écris ces lignes en écoutant les deux premiers albums de Franz Ferdinand) ont chacun leur couleur :

Ce livre – taupe : le plus expérimental, il « détaille les clés théoriques et techniques de la matière textuelle qui le constitue ». Ou : « où cela mène-t-il le lecteur qui cherche à en découdre avec le présent ouvrage ? » (p. 71 [j’aimerais bien savoir quel verbe anglais est ici traduit par en découdre avec])
Œuvres presque accomplies – rouille : le plus profond et le plus jouissif, selon moi. Mais je ne suis pas objectif : la question des livres que j’ai échafaudés et été trop flemmard pour écrire me taraude continuellement. Il y a deux jours, Milène Tournier a commenté sous un des sonnets que je publie ces jours-ci sur Facebook en disant « ils sont incroyables tes sonnets ». J’étais à deux doigts de lui répondre : personne n’en veut. Et je ne l’ai pas fait car ça aurait été faux. En 2016 j’ai autoédité mes 135 sonnets de la décennie précédente sans les avoir jamais proposés à aucun éditeur. Pour en revenir au livre de couleur rouille de Guy Bennett, car c’est censé être le sujet ou l’objet de ce billet, difficile d’en parler, sinon à faire l’inventaire des projets non réalisés et qui me semblent le plus excitants : bokéogrammes, glissandi, Le Projet des ponts, « Mon contenu » (cette idée, je l’ai eue aussi, et on est nombreuxses à l’avoir eue)… Quel est ce sonnet en anglais de la page 41 dont le titre est le premier vers du sonnet en -yx ? Guy Bennett l’a-t-il écrit par anagrammes de chaque vers du sonnet de Mallarmé ? ai-je été inattentif ? Je juxtapose ce qui s’ajoute et se jouxte. Débrouillez-vous.
J’étais parti pour y passer dix minutes, et ça fait la demi-heure sans faire la rue Michel. D’ailleurs, aucun écrivain anglophone, même oulipien, ne se prénomme Michel.
09:52 Publié dans Comme dirait le duc d'Elbeuf, Le Livre des mines, Lect(o)ures, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (2)
samedi, 20 janvier 2024
The Promise
C’est le roman qui a valu à Galgut des torrents d’éloges – il n’est que de voir l’insupportable double rabat qui sert de couverture à cette édition de poche Vintage – et le Booker Prize 2021. Malgré les réserves que j’ai formulées, j’ai nettement préféré The Impostor, et je me dis à présent que c’est The Good Doctor qu’il faudrait lire, et – après en avoir parlé avec mon amie M*, qui est spécialiste des littératures sud-africaines, et de Galgut notamment – les premiers romans, car ce qui me retient (beaucoup) dans l’écriture de Galgut, c’est son côté trop maîtrisé, trop abouti, trop parfait en un sens. Il faudrait que je m’explique de ce « trop parfait ».
C’est donc un très bon roman, sans doute, si on s’en tient aux questions de maîtrise formelle et narrative : les changements de point de vue fréquents s’entrelacent de façon subtile à un point de vue omniscient ; le narrateur omniscient, quoique très discret, donne une forme de tonalité morale mais difficile à interpréter ; les notations ironiques succinctes, qu’il est difficile d’attribuer à tel personnage ou à la voix narrative, participent d’un portrait pessimiste de la société sud-africaine.
Mais… mais… mais…
Plus j’avançais dans la lecture, plus je trouvais les personnages factices, creux. La fameuse promesse du titre, dévoilée d’emblée, sert de fil conducteur – en fait, c’est cousu de fil blanc, jusqu’à sa fonction de décryptage des relations entre Blancs privilégiés de la société d’apartheid et Noirs victimes de ségrégation jusque dans les années 2000-2010. De plus, beaucoup de remarques misogynes émanent de la voix narrative principale (cf description, grossophobe pour tout arranger, de la notaire à la p. 280), sans compter un certain nombre de clichés sexistes qui servent d’astuces narratives (le dernier § sur la ménopause est totalement hallucinant pour un roman publié au 21e siècle – j'ai quasiment hurlé en lisant ça).
À force de vouloir dresser un portrait réaliste, sans fioritures de l'Afrique du Sud, le récit est d'un cynisme qui finit par rejoindre le discours suprémaciste blanc sur l'incompétence des Noirs. C’est ce qui m’avait déjà gêné dans The Impostor. Dans The Promise, les Noirs – catégorie homogène, fourre-tout – restent totalement marginalisés, sans voix dans le récit, et même ceux qui expriment une révolte sont ridiculisés, réduits au traumatisme de la prison, comme si l'argument de la confiscation du pouvoir économique par les Blancs était dérisoire : quand Lukas s’insurge contre la bienveillance paternaliste d’Amor, dans le dernier chapitre, je me suis dit que Galgut allait vraiment proposer ce point de vue à contre-courant du reste du roman… mais non… il choisit de raconter cet échange houleux du point de vue d’Amor, et donc d’en conclure que Lukas se trompe de colère et ne comprend pas qu’Amor est du bon côté.
Comme pour The Impostor, je n’ai pas cherché longtemps mais je m’étonne de ne pas trouver d’articles qui analysent ces traits néo-coloniaux qui usent de stéréotypes raciaux au lieu de les déconstruire.
11:36 Publié dans Affres extatiques, Lect(o)ures, Livres 2024, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 04 janvier 2024
Que faire des classes moyennes ?
 Facebook m'a rappelé que je lisais ce livre il y a sept ans, pendant une surveillance d'examen. Ainsi, je suis allé le reprendre et me suis surpris à en relire de larges extraits, dont le chapitre 4 :
Facebook m'a rappelé que je lisais ce livre il y a sept ans, pendant une surveillance d'examen. Ainsi, je suis allé le reprendre et me suis surpris à en relire de larges extraits, dont le chapitre 4 :
Un facteur éprouvant de la vie est que nous perdurons dans l’existence avec l’idée et la vision que nous avions des choses étant enfant, puis adolescent ; cela demeure. C’est ainsi que la vision qu’on a de l’école aujourd’hui est encore marquée par l’école que nous percevons dans la brume et la sourdine des souvenirs, d’une idée de l’école véhiculée par les générations antérieures (quelquefois les grands-parents) ou le cinéma (Les Quatre Cents Coups), que la blouse grise et les plumes Sergent-Major, même si nous n’avons jamais porté de blouse, même si nous avons toujours écrit au Bic, sont inclus dans notre mémoire au même titre que ce que nous avons réellement vécu. Animés de quelques vestiges piquants, nous voulons qu’ils s’incarnent, y compris au détriment des autres : nos enfants porteront des blouses grises s’ils continuent, écriront à la Sergent-Major s’ils continuent. S’ils continuent quoi ? S’ils continuent à ne pas être conformes à nos désirs, c’est-à-dire s’ils continuent à ne pas être comme dans les souvenirs qu’on croit qu’on a, c’est-à-dire s’ils continuent à être réels, et non fictifs. [S’ils continuent = nous punirons le réel.] Punir le réel, c’est ni plus ni moins ce qui fait tenir les classes moyennes debout. Leur rapport à l’école tient (ou en tout cas tenait) en une phrase : si tu travailles à l’école, tu auras une bonne vie (réduit à partir des années 1980 à : tu auras un emploi) – soit à peu près l’équivalent de : si tu te grattes le coude, tu te moucheras plus vite, ou : si tu mets une grenouille sous la table, tu gagneras au Loto.
(pp. 24-26)
16:19 Publié dans Chèvre, aucun risque, Lect(o)ures, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 01 septembre 2023
01092023
C’était la rentrée au sens le plus strict : réunions d’accueil des trois années de Licence, dont celle de L1 assurée par moi avec ma nouvelle (et temporaire) casquette de responsable de L1, réunion de département, pot d’accueil des nouveaux collègues au décanat…
A* est bien rentré à Rennes hier soir.
Ambiance passablement morose depuis hier, sans aucun ressort ni goût pour la reprise de la part de C* ou moi, mais le redoux (voire réchauffement) devrait améliorer tout cela.
Abandonné la lecture de The Odd Women de George Gissing, après avoir lu Our Village de Mary Russell Mitford en choisissant les chapitres qui me plaisaient le plus.
21:24 Publié dans 2023, Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 21 août 2023
21082023 - Johannesburg
Levé à 5 heures, plus d'une heure avant l'heure des mouettes (c'est nouveau ça, l'heure des mouettes, qui remplace l'heure des éboueurs ou l'heure du livreur de journaux), je finis par avoir envie de café au bout de 50 pages, et je ne comprends ni les gens qui dorment ni pourquoi depuis la page 48 de ce roman qui est une réécriture de Mrs Dalloway j'ai en tête la voix de Tracy Chapman - et sa guitare :
I make a fool of myself
In matters of the hea-a-a-art
06:44 Publié dans 2023, Autoportraiture, Autres gammes, Chèvre, aucun risque, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 15 août 2023
In memoriam Kenneth White (1936-2023)
On vient d'apprendre la mort, il y a quatre jours, de Kenneth White, grand poète et penseur, fondateur de l'Institut International de Géopoétique en 1989, et qui a un peu compté pour moi dans les années 90 (j'ai même été adhérent de l'Institut et correspondu avec K.W.). Il y a un bon moment que je n'avais rien lu de lui, car je trouvais que ses textes et son projet tournaient pas mal en rond, et qu'il y avait un peu trop de spiritualité vaseuse dans les soubassements de son esthétique, mais je vous invite quand même à aller le lire si vous ne connaissez pas du tout.
Il est à noter que, comme il était installé depuis plus d'un demi-siècle en France, il était plus connu de ce côté-ci de la Manche, au point que -- chose rare pour un écrivain anglophone -- l'article que lui consacre la Wikipédia francophone est beaucoup plus détaillé que celui de la Wikipédia anglophone.
Je suis allé dénicher mes 4 numéros des Cahiers de géopoétique, dont je mentirais si je n'admettais pas qu'ils avaient pris la poussière, mais dans lesquels j'ai pris plaisir à me replonger.
Ma sœur m’avait offert, au milieu des années 90, deux recueils de K.W., qu’elle avait fait dédicacer. Les deux volumes, aujourd’hui, vont parfaitement avec le lierre qui souhaite envahir le béton et les trous de mon vieux pantalon noir, signes d’un certain effilochage de la mémoire et du langage poétique, absorbant, lucide autant qu'opacifiant. [Et d'ailleurs, speaking of memory, un échange ultérieur avec Delphine m'a permis de me rappeler qu'elle m'avait offert et fait dédicacer ces recueils il y a trente ans pile, car K.W. faisait le cours d'agrégation sur Lowell à la Sorbonne l'année où elle l'a passée. -- Add. du 16/08]
K.W., poète de l’ouverture et des grands espaces, s’était si bien acclimaté à la Bretagne qu’il signait ses préfaces en précisant qu’il se trouvait dans les « Côtes du Nord » (oui, moi aussi j’ai connu l’époque où le département n’était pas allé pêcher ce ridicule Armor pour l’associer à son nom) et qu’il insérait des vers bretons dans ses poèmes.
15:40 Publié dans 2023, Blême mêmoire, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
15082023
Déjà la mi-aou, selon la vieille chanson agaçante (de Ray Ventura, je crois).
Je m’évertue à continuer la lecture d’Umbrella, que je trouve vraiment ardue : huit jours pour lire la moitié, 200 pages, c’est tout à fait anormal, même si j’ai lu d’autres bricoles en parallèle. Avec Will Self c’est un peu comme avec Faulkner, pour moi : à fond ou pas du tout. Au demeurant, je me demande pourquoi je m’obstine : je lis le roman presque comme des chapitres distincts (alors que, comme Phone, c’est un bloc de texte sans saut de page), tentant de trouver les connexions entre les trois périodes du récit, et en me réjouissant des bonheurs d’écriture. – J’ai soixante bouquins sur la pile de livres à lire ; c’est ridicule d’insister ainsi… et tout autant ridicule de me plonger pour une vingtaine de pages dans l’année 1709 des Mémoires de Saint-Simon comme je l’ai fait hier soir.
07:49 Publié dans 2023, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 31 juillet 2023
31072023
D’Emmanuel Ruben j’avais beaucoup aimé, d’une part, Icecolor et Terminus Schengen, parus au Réalgar, et d’autre part Sur la route du Danube (Payot, 2019), dans lequel il raconte son périple à vélo en remontant le Danube de ses estuaires à ses sources.
D’Emmanuel Ruben je viens de commencer La ligne des glaces, texte un peu antérieur (2013), et ces brefs chapitres aussi impressionnistes qu’imprégnés d’un sentiment géographique du monde me plaisent bien.
17:19 Publié dans 2023, Hors Touraine, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 26 juillet 2023
26072023 - Femmes d’exception dans les Landes
Ma mère a acheté le dernier livre de (en fait, dirigé par) Philippe Soussieux, Femmes d’exception dans les Landes (éditions Kilika, 2023). Signe, un de plus, que l’entreprise de désinvisibilisation des créatrices, ou plus généralement des femmes qui ont eu un rôle majeur au moins à l’échelle régionale, se généralise.
L’ouvrage est imprimé avec soin, richement illustré, et les textes sont globalement de bonne facture, même si on ne comprend jamais trop bien qui sont les auteurices (11 femmes pour 5 hommes) ni à quel titre iels interviennent dans le livre. Certains chapitres sont rédigés avec une neutralité toute encyclopédique, d’autres avec un lyrisme un peu suranné (celui sur Claude Fayet par exemple), ou d’autres encore très subjectifs. On sent la touche et la patte de ce qu’on pourrait nommer l’érudition caractéristique des « historien-nes régionalistes », mais cela rend le livre très vivant, même si ça part un peu dans tous les sens. La majeure partie du livre est consacrée à des chapitres monographiques, et l’autre, plus restreinte mais presque plus intéressante, à une « encyclopédie féminine landaise » répertoriant, dans des notices beaucoup plus succinctes, un nombre plus important de « figures ».
Pour comprendre cette notion de « figures », justement, ce qui est intéressant, c’est la diversité des profils retenus : outre des femmes dont l’importance historique a été notée et approfondie depuis longtemps (Corisande d’Andoins ouvre le bal), le livre invite à découvrir des écrivaines (Christine de Rivoyre et Lise Deharme, bien sûr, mais aussi Henriette Jelinek, Claude Fayet, Valentine Penrose), mais aussi une martyre (Marguerite Rutan), une mystique (Marie Lataste), une conservatrice générale du patrimoine (Bernadette Suau), une peintre (Suzanne Labatut), une « grande bienfaitrice » (Eugénie Desjobert – j’ai enfin compris ce que signifiaient les initiales ED sur le grand pont de Saubusse), une voyante (Madame Fraya), une rescapée du goulag soviétique (Andrée Sentaurens), une aviatrice (Andrée Dupeyron), mais aussi deux sœurs, Cora et Marie Laparcerie, dont l’une fut une grande comédienne et directrice de théâtre, et l’autre chansonnière, journaliste et romancière. De Marie Laparcerie, sa biographe, Ginou Coumailleau, évoque la participation au journal féministe La Fronde dès 1897, mais aussi ses nombreux romans jugés « dangereux » par la presse conservatrice de l’époque, dont un roman au titre pas si transparent que cela, Isabelle et Béatrix, roman du 3e sexe. Je ne suis pas encore allé regarder/écouter la vidéo qu’Azélie Fayolle et Camille Islert viennent de consacrer à l’ouvrage collectif Ecrire à l’encre violette. Littératures lesbiennes en France de 1900 à nos jours, mais voici une autrice (et un texte) qui pourrait bien s’y trouver.
Après un premier parcours – je ne peux me targuer de l’avoir véritablement lu, encore – de cet ouvrage collectif dirigé par Philippe Soussieux, infatigable défricheur et vulgarisateur du patrimoine landaise, j’ai déjà envie d’aller approfondir, en particulier avec les autrices que je ne connaissais pas du tout Valentine Penrose et Marie Laparcerie, et Claude Fayet sans doute également. Parmi les chapitres monographiques, j’ai omis celui que Janine Dupin Capes consacré à Emilie, baronne de Bouglon, qui fut le grand amour ou l’ « Ange blanc » de Barbey d’Aurévilly : en fait, et heureusement, cette propriétaire du château du Prada à Labastide-d’Armagnac mérite de figurer dans l’ouvrage par-delà son association avec Barbey, d’autant que la présence, dans un ouvrage visant à désinvisibiliser des femmes puissantes mais oubliées, de l’auteur des Bas bleus ne laisse pas de paraître quelque peu ironique, sinon contradictoire.
10:52 Publié dans 2023, Hors Touraine, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 24 juillet 2023
24072023 - mais que lisait la grand-mère de Henry James ?
Et nous voici, le lendemain, et je n’ai pas écrit une ligne de plus. Qu’ai-je fait ? eh bien, j’ai glandouillé : lu des articles du Guardian, attendu de voir si le 5e et dernier jour du 4e test-match entre l’Angleterre et l’Australie allait reprendre, avancé dans le livre de Bill Bryson que je lis en parallèle du dernier Soyinka (expérience assez discontinue), préparé les cadeaux pour ma mère (c’est son anniversaire aujourd’hui – nous le fêterons demain avec elle), vaguement fait la sieste, relu en famille les journaux de voyage écrits par O* puis C* depuis 2014, téléversé sur Flickr les dernières photos et fait un peu de tri dans tout ça, regardé le dernier film de Dupieux à la télé… J’ai aussi préparé ma valise, dans laquelle je n’ai mis que cinq livres, je crois, et pas même celui que je dois commencer à traduire : je sais que je n’y toucherai pas, donc autant assumer les vacances.
 Hier, en regardant les photos du 19 (et donc d'Oxburgh Hall notamment), j’ai voulu vérifier ce qu’était A Small Boy and Others de Henry James, et il s’avère que c’est un de ses deux livres autobiographiques, écrit fort tard (1913, je crois). Mais combien a-t-il écrit ? J’ai l’impression d’avoir lu beaucoup de Henry James, pas loin de dix romans, les journaux de voyage, beaucoup de nouvelles, et je découvre encore des titres inconnus de moi… !
Hier, en regardant les photos du 19 (et donc d'Oxburgh Hall notamment), j’ai voulu vérifier ce qu’était A Small Boy and Others de Henry James, et il s’avère que c’est un de ses deux livres autobiographiques, écrit fort tard (1913, je crois). Mais combien a-t-il écrit ? J’ai l’impression d’avoir lu beaucoup de Henry James, pas loin de dix romans, les journaux de voyage, beaucoup de nouvelles, et je découvre encore des titres inconnus de moi… !
J’ai lu le premier chapitre de ce Small Boy and Others (le titre est vraiment étrange), et quand il parle des goûts littéraires de sa grand-mère, il ne parle que d’autrices dont il dit qu’elles sont oubliées, plus du tout lues. Voici la liste :
What she liked, dear gentle lady of many cares and anxieties, was the "fiction of the day," the novels, at that time promptly pirated, of Mrs. Trollope and Mrs. Gore, of Mrs. Marsh, Mrs. Hubback and the Misses Kavanagh and Aguilar, whose very names are forgotten now, but which used to drive her away to quiet corners whence her figure comes back to me bent forward on a table with the book held out at a distance and a tall single candle placed, apparently not at all to her discomfort, in that age of sparer and braver habits, straight between the page and her eyes.
Ce serait mal me connaître que de penser que je ne suis pas allé vérifier chacune de ces autrices grâce à Wikipédia (oui, j’avoue que je n’ai pas eu le courage de creuser sur la Britannica ni de me connecter à la base Oxford Reference), et j’ai notamment découvert que Mrs Trollope (1779-1863) était bien la mère d’Anthony Trollope (et que nombre de ses livres semblent encore d’un grand intérêt aujourd’hui, à commencer par Jonathan Jefferson Whitlaw, que WP présente comme le premier roman abolitionniste, ce qui me semble étrange) ; que Catherine Hubback (1818-1877), nièce de Jane Austen, a écrit dans l’ombre spectrale de sa tante (qu’elle n’a jamais connue), au point d’écrire son premier roman, The Younger Sister, à partir d’un synopsis de cette dernière et dans un style très imité aussi, autant que je puisse en juger après un survol, d’icelle ; que Grace Aguilar (1816-1847) est surtout connue pour ses poèmes et essais sur la religion et la tradition juives ; que Julia Kavanagh (1824-1877 – tiens, on fêtera le bicentenaire de sa naissance l’année prochaine), romancière irlandaise, a été suffisamment connue de son vivant pour que plusieurs de ses romans soient traduits en français, en allemand, en suédois, en italien, et que la critique contemporaine la redécouvre avec un intérêt prononcé pour les éléments protoféministes de ses romans (le Projet Gutenberg a peu de textes d’elle, et Internet Archive en a beaucoup, mais à chaque fois en 3 volumes dont l’ordre n’est pas indiqué dans la miniature, de sorte que c’est le bazar pour s’y retrouver).
Vous me direz que j’oublie Mrs Gore (Catherine, 1798-1861) et Mrs Marsh (Anne Marsh-Caldwell, 1791-1874 – tiens, on fêtera l’année prochaine le sesquicentennial de sa mort), mais assez pour aujourd’hui. Je noterai seulement qu’il est difficile de savoir si Henry James, hardly the feminist, décourage ici son lectorat de s’intéresser à ces écrivaines en les balayant d’un revers de la main, ou si le seul fait de les avoir énumérées permet à des olibrius dans mon genre de se dire : tiens, et si j’allais creuser un peu tout cela ? Les deux, évidemment.
À l’heure où les questions de canon et de postérité, d’invisibilisation et de marginalisation, occupent, heureusement, le centre des débats (et je recommande notamment la lecture d’Autrices invisibilisées de Julien Marsay ainsi que de suivre le compte Twitter), cette petite recherche m’a une fois encore montré que, même dans les Îles britanniques, qui ont toujours mis au premier plan Jane Austen, Mary Shelley, George Eliot, Elizabeth Gaskell, Christina Rossetti et Elizabeth Barrett Browning, il y a des foultitudes d’écrivaines marginalisées ou invisibilisées, comme l’excellente Mary Elizabeth Braddon dont j’ai lu plusieurs romans ces dernières années, ou encore Rhoda Broughton.
07:38 Publié dans 2023, Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 10 juin 2023
10062023
Il est arrivé quelque chose de rare aujourd’hui. Levé tôt – en fait, à l’heure habituelle du réveil (6 h 40 (depuis toujours, je suis incapable de me lever franchement plus tard le week-end ou en vacances, ou alors il me faut vraiment plusieurs semaines d’accoutumance ou que je me sois couché très tard)) –, ayant laissé Joseph Anton de Rushdie, commencé hier, à l’étage, je suis allé au salon et j’ai repris Glory de NoViolet Bulawayo, roman commencé il y a plus de deux mois et dont j’avais arrêté la lecture après moins de 50 pages (sur 400), déçu voire agacé, et – pour résumer – n’arrivant pas à « entrer dedans ». En général, quand je fais ça, c’est mort ; je peux toujours retenter quelques jours ou quelques semaines plus tard, mais c’est mort ; encore ces derniers temps, j’ai tenté à deux ou trois reprises de recommencer la lecture de King Lopitos et de Toxique (j’en parle dans la vidéo je range mon bureau n° 099) mais il n’y a rien eu à faire.
Vous me voyez venir : rien de tel avec Glory. Après 1 h 30 j’avais poursuivi jusqu’à la page 140, et ce soir j’ai lu la moitié du roman. Non que les défauts qui m’avaient empêché d’« entrer dedans » ne soient pas là, mais ils sont devenus secondaires. Je crois qu’il a fallu ces neuf ou dix semaines pour qu’inconsciemment je digère la déception d’un roman sans rapport avec le cycle de nouvelles We Need New Names que j’avais beaucoup aimé, et surtout pour que je digère le fait que le roman ne cherche absolument pas à faire des personnages animaliers autre chose que des figures anthropomorphiques dans un roman à clé parfaitement transparent sur l’histoire récente du Zimbabwe. Il y a aussi que le chapitre 8, ‘Returnee’, est particulièrement réussi et offre un angle différent avec des personnages différents.
Sinon, une fois qu’on accepte le caractère totalement plaqué – ou gratuit, ou automatique – du transfert de l’histoire humaine sur des personnages d’animaux, la lecture se trouve facilitée. De même, NoViolet Bulawayo (et cela, c’est très différent de son premier livre) procède régulièrement à des répétitions extrêmement longues, sous forme de collier d’anaphores, ou de formules répétées à l’identique ou presque sur une dizaine de lignes ; réflexion faite, je pense que, comme d’autres éléments un peu dérangeants de l’écriture, cela vient d’une tentative de restituer une forme d’oralité très précise et très codifiée – je ne connais pas les traditions orales des récits ndebele, donc c’est seulement une hypothèse.
20:00 Publié dans 2023, Affres extatiques, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 09 juin 2023
09062023
Ce matin j’ai enregistré la vidéo n° 99 (en fait, la 103 ou 104e je crois) de la série je range mon bureau. Comme j’improvise totalement, il y a toujours des moments d’hésitation, des transitions poussives etc. Cette fois-ci, comme je clôturais sur les 2 livres de Rimbaud en traduction, j’ai choisi de lire Les Corbeaux dans chacune des deux traductions. Je n’avais pas le texte de Rimbaud sous les yeux, et m’interromps à un moment pour remarquer que la traduction allemande ne conserve pas l’oxymore : « toi notre céleste oiseau noir ! » - Cela ne faisait pas deux minutes que j’avais arrêté de filmer que le vrai distique de Rimbaud m’est revenu :
Sois donc le crieur du devoir,
Ô notre funèbre* oiseau noir !
Ou comment critiquer une traduction sur la base d’un vers de Rimbaud qu’on a soi-même réécrit. Quelle pitié…
______________________________
* J’ai dû faire une confusion funèbre > funeste > céleste, d’autant que l’aspect « céleste » est mentionné dès le début du poème, avec la rime cieux / délicieux. Il n’empêche…
12:24 Publié dans 2023, Blême mêmoire, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 28 mai 2023
28052023 : the bone people, 1
13:11 Publié dans 2023, Chèvre, aucun risque, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 24 mai 2023
24052023
Seize jours sans écrire dans ces carnets ; ça devient un gag.
À ce stade ça n’a pas de sens d’essayer d’écrire rétrospectivement des billets – peut-être signaler que nous avons fêté ce week-end, en très bonne compagnie, les 50 ans de C., et aussi les 16 ans d’O. Les premiers amis sont arrivés vendredi, et les derniers sont repartis lundi matin (plus de train dimanche au moment où E* a essayé de réserver ses billets).
Depuis quelques années, les arbres ont tellement poussé dans le jardin, surtout pour la haie entre chez G* et C* et chez nous, que plusieurs pruniers poussent quasiment à l’horizontale ; la bande herbeuse sur laquelle A* faisait des allées et venues entre huit et douze ans n’est quasiment plus accessible. L’immense terrasse de béton est désormais toujours au moins à moitié à l’ombre.
Ces jours-ci, je lis Bouts de bois d’Agnès Stienne.
08:17 Publié dans 2023, Autoportraiture, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 07 mai 2023
07052023
En rentrant d’une petite promenade avec C*, je me suis rendu compte qu’un des érables de la haie côté rue Mariotte était désormais immense, tout en longueur, et qu’il rendait plus ou moins inutile, une fois feuillu, l’éclairage du lampadaire qui lui a certainement servi de tuteur. Entre les coronilles et les petits érables, la haie côté rue Mariotte est assez fournie au printemps et en été, malgré les troènes chétifs, nains et dépenaillés.
Ma mère a passé une journée épuisante chez ma grand-mère, qui est moins autonome que jamais.
____________________
J’ai fini de lire You de Nuala Ni Chonchuir, son premier roman. (J'en ai lu deux autres, Miss Emily et Nora, ainsi que trois recueils de nouvelles.)
Quelle écrivaine fine, subtile, émouvante.
Détail presque sans importance, j’ai appris en lisant ce roman une nouvelle expression pour dire rendre dingue en anglais : it drives me baloobas. [Un site Web au moins donne à l’adjectif le sens de défoncé/murgé/démoli.] Je ne l’emploierai pas car vérification faite, elle a des connotations fortement racistes.
Toutefois, l’histoire, méconnue de moi, est intéressante : après l’indépendance du Congo belge, en 1960, le Katanga chercha à faire sécession ; les rebelles katangais, aidés par des mercenaires européens, multipliaient les escarmouches, y compris contre les Lubas (aussi désignés comme « peuple Baluba »), qui décidèrent de s’organiser et de se défendre ; le 8 novembre 1960, un détachement motorisé de soldats irlandais appartenant aux forces de paix de l’ONU (qui ne s’appelaient pas encore les casques bleus) tomba dans une embuscade, car les Lubas, encore sous le coup de plusieurs raids et massacres, les avaient pris pour des mercenaires européens. Dans le combat qui s’ensuivit, 25 Lubas trouvèrent la mort, ainsi que neuf soldats irlandais, dont les deux chefs d’expédition, massacrés au coupe-coupe lors du premier assaut.
L’adjectif, dérivé d’un ethnonyme, est donc employé comme synonyme d’enragé ou de sauvage. La connotation racialisante est donc du côté de l'animalisation et de l'impossibilité de raisonner. Même si on peut comprendre que l’opinion publique irlandaise se soit fortement émue de ce malentendu tragique, il me semble difficile d’employer l’adjectif une fois qu’on connaît l’histoire. En l’espèce, c’est un très bon – et terrible – exemple des conséquences complexes et désastreuses de l’occupation et de l’assujettissement coloniaux. Comme je ne connais pas du tout cet épisode, et que je suis globalement peu au fait des détails de l’histoire du Congo-Léopoldville, donc de cette période, je me suis appuyé sur quelques sources très rapides, mais je ne peux m’empêcher de constater que la WP anglophone comme d’autres sites que j’ai pu consulter se situent totalement du point de vue irlandais, même quand il y a une vraie tentative de comprendre les motivations des Lubas et les raisons du malentendu. Il faudrait aller regarder du côté des historiens congolais, notamment ; sans doute l’historiographie post-coloniale et décoloniale est-elle compliquée à démêler, comme pour la difficile « neutralité » des historien·nes qui traitent de la guerre civile nigériane, même cinquante ans après.
______________
Soir : fin de The Good Place. La saison 4 se termine de manière très classique. Toute la saison 4 a d’ailleurs un côté bouclage de boucle parfois un peu lourd.
Dans le dernier épisode, on aperçoit très furtivement la liste des milliers de tâches que souhaite encore accomplir le personnage de Tahani, et grâce à un arrêt sur image j'ai pu voir qu'elle comptait bel et bien battre le record de Graham Gooch de 456 runs en un seul test-match. Du cricket comme accomplissement culturel et sportif ultime pour le personnage de l'aristocrate anglo-indienne... ;-)
Nous avons des problèmes de connexion à Canal+, surtout le soir, malgré l’achat et l’installation d’un répéteur il y a 8 jours. Apparemment plusieurs forums en ligne font état de problèmes similaires au nôtre : la question des connexions simultanées sur 72 heures est assez abstruse, mais nous pensons avoir compris qu’il y a une histoire de nombre d’appareils connectés au cours des 3 derniers jours.
23:04 Publié dans 2023, Affres extatiques, Lect(o)ures, Tographe, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 29 avril 2023
29042023 (#DMWM)
Ce matin j’ai presque fini de (re)lire Wittgenstein’s Mistress. Mon avis n’a pas varié : c’est une œuvre fondamentale. Par contre je pense que certains aspects plus « problématiques » m’avaient moins frappé lors de ma première lecture.
J’ai très envie de tenir un carnet, non pas de relecture – il est déjà trop tard, à moins de le faire pour une troisième lecture – mais d’analyses, un peu comme j’avais autrefois créé mon premier blog pour accompagner la préparation de mon cours de CAPES et d’agrégation sur The Good Soldier.
Ce carnet pourrait prendre la forme d’un hashtag récurrent sur mon compte Twitter, par exemple et sans originalité : #DMWM. Si j’écrivais, en parallèle du carnet d’analyse, un pastiche – ou fiction dérivative – ce texte pourrait commencer ainsi :
Is it before or after I decided to write a series of analytical texts on Markson’s Wittgenstein’s Mistress that I realized that the first-name Artémise in Nino Ferrer’s famous song Le téléfon must have come from his Italian origins, I cannot fathom.
Though this happened on this very day, on this very Saturday.
Saturday being the day I am writing these lines, and I have decided to write down what I think about Markson’s Wittgenstein’s Mistress.
That phones were never mobile then, and that mainstream technology was mostly cassette decks and typewriters. Back then too.
Now I come to think about it the connection between the first-name Artémise and typewriters is itself unfathomable.
15:41 Publié dans 2023, Ecrit(o)ures, Gertrude oder Wilhelm, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 23 avril 2023
23042023
Réveillé tôt encore, à Cagnotte ; étrangement, le fait de me tenir davantage éloigné de l’actualité, des mille turpitudes et ignominies qui la peuplent, ne diminue pas mon angoisse. Je pensais, avant de me lever et d’allumer cet ordinateur, que je n’avais pas écrit ici depuis trois semaines, et même depuis fin mars. Or, apparemment, cela ne fait « que » dix-huit jours… Cela a beau faire dix-huit ans que je tiens ces carnets, je n’ai toujours pas compris pourquoi il est si difficile de se tenir à la règle d’un billet par jour au moins, ni comment il est si facile de laisser filer les jours sans écrire, comme si de rien n’était.
Pour ce qui est du sommeil, c’est aussi parce que mes journées sont moins chargées et que j’ai commencé à me reposer, que je me lève ainsi, aussi tôt. Malgré le début de « vacances » passé à régler la question des recrutements d’ATER et les services 2023-24, malgré aussi la fatigue du voyage à Saragosse, je me suis reposé, de fait.
Histoire de noter quelque chose d’un peu plus intéressant, avant de me lancer dans l’écriture de billets a posteriori pour ces 18 journées manquantes : ne parvenant toujours pas à « entrer dans » King Lopitos de Vilma Fuentes (et pourtant ça me plaît), j’ai emprunté hier à ma mère son exemplaire de Wittgenstein’s Mistress, livre primordial pour moi, avec lequel je bassine tout le monde depuis pas loin de vingt ans, mais que je n’ai jamais relu ; j’en ai lu, donc, les 30 premières pages hier soir avant de tomber de sommeil, et c’est vraiment aussi génial que dans mon souvenir. Le livre est au programme de l’agrégation pour l’année prochaine, choix qui m’a surpris (favorablement (même s’il n’y a pas de texte post-colonial)).
06:09 Publié dans 2023, Hors Touraine, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 03 avril 2023
03032023
Je me suis traîné toute la journée ; j’ai quand même enregistré une vidéo autour des autrices mauriciennes.
14:10 Publié dans 2023, Affres extatiques, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 25 mars 2023
25032023
Ce matin, j’ai fini de lire L’ange transtibétain de Yoko Tawada, acheté lundi dernier alors que j’ignorais même qu’il y avait (enfin) de nouveaux textes traduits d’elle. La traduction est de mon ancien collègue Bernard Banoun. Je me suis aperçu à cette occasion que cela faisait plus de quinze ans maintenant que j’avais commencé à lire cette écrivaine.
Le titre original est Paul Celan und der chinesische Engel, et le livre a été écrit pendant le premier confinement, en 2020. J’ai appris, en lisant la postface de Sven Keromnes, que le dernier recueil publié par Celan de son vivant, Soleils de fil, qui est au centre des préoccupations du protagoniste (Patrik / le patient), n’a jamais été traduit en entier en français. Moi qui pensais que chaque poème de Celan avait été traduit quatre fois de douze manières différentes, ça me la bâille belle. (Et de me dire que je devrais vraiment faire fi des maisons d’édition et publier en print on demand certaines de mes traductions : je n’ai pas traduit Celan, mais Ausländer et Johanna Wolff, par exemple.)
Le récit de Tawada m’a beaucoup plu, surtout les deux premiers et le dernier chapitres (j’ai eu un peu de mal à suivre certains des enchaînements au milieu), et, alors que j’étais un peu resté sur ma faim avec Histoire de Knut, je suis très heureux de retrouver cette prose complexe, parfois opaque, qui suggère des analogies et des liens étranges et qui interroge malgré tout une certaine réalité humaine. Avant-hier, sur Twitter, je m’étais interrogé sur l’apparition du mot beuchelle, qui désigne un plat typiquement tourangeau ; je me demandais quel pouvait être le plat / mot que Banoun traduisait ainsi. Nicolas Raduget, l’auteur de l’Histoire des vins de l’AOC Touraine, m’a répondu hier qu’en fait ce plat était originaire d’Autriche et que l’étymon de beuchelle serait donc l’allemand Beuschel. C’est ce qu’indique le Wiktionnaire.
11:58 Publié dans 2023, Flèche inversée vers les carnétoiles, Gertrude oder Wilhelm, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 24 mars 2023
24032023
Aujourd’hui ma grand-mère fêtait ses 96 ans. Je l’ai appelée en milieu de matinée, et elle m’a parlé de La Place d’Annie Ernaux, qu’elle a adoré et relu juste après la première lecture, et de la trilogie de Carlos Ruiz Zafon qu’elle lit ; mais elle trouve cela trop long. À propos d’Ernaux, elle a particulièrement aimé le fait que ce soit aussi savamment écrit sans pour autant la moindre emphase ; ma grand-mère est donc plus clairvoyante et meilleure lectrice que tous les birbes du Figaro réunis.
Nous avons aussi parlé de la situation sociale et politique.
Hier j’ai acheté enfin Le Chaos en 14 vers de Pierre Vinclair, anthologie de sonnets en langue anglaise par 14 poètes. Vinclair n’est pas seulement un bon traducteur (et un grand poète), c’est aussi quelqu’un de terriblement intelligent. Très heureux d’y trouver Mary Wroth, Marylin Hacker (qui a traduit Guy Goffette, ce que j’avais étudié lors du colloque consacré à ce poète à Tours) et Joshua Ip.
J’ai passé une bonne partie de la journée à écrire des mails en raison du blocage, et notamment un mail très détaillé afin de répondre aux questions des étudiant-es de Licence, ce afin de « débunker » les rumeurs qui commencent à courir, de stipuler ce qui est déjà certain, et ce qui reste encore imprécis, selon la durée du blocage. En début d’après-midi, j’avais plusieurs rendez-vous en visio, avec une de mes étudiantes de L3 qui se renseigne sur les Masters recherche, avec un étudiant de M1 qui voulait parler de son projet de travail écrit, et aussi avec deux collègues.
Ce lundi, le doyen convoque un Conseil de Faculté exceptionnel.
22:24 Publié dans 2023, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 13 mars 2023
13032023
Le nouveau livre de Pierre Vinclair, une anthologie de sonnets d’une quinzaine d’auteurices différent-es, n’était pas encore à la librairie, de sorte que j’ai dû le commander. Mais je ne suis pas sorti les mains vides.
J’ai notamment acheté le volume récemment paru d’Ariane Dreyfus en NRF/Poésie, Pensées décoloniales de Philippe Colin et Lissell Quiroz (qui va me servir dès ce jeudi pour le séminaire de master) et ce livre de Stéphanie Garzanti, que je n’aurais pas connu sans la chaîne Un grain de lettres de l’excellente Azélie Fayolle.
18:11 Publié dans 2023, Autoportraiture, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 27 février 2023
27022023
Commencé de lire Matrix de Lauren Groff, dont C* lit en parallèle la traduction française par Carine Chichereau. Ce n’est pas souvent qu’on réussit à se coordonner aussi bien dans nos lectures.
Enregistré et publié ce matin une nouvelle vidéo « je rends des livres », autour notamment de la pentalogie Aujourd’hui de Dominique Meens, dont j’ai parlé mais surtout lu des morceaux choisis pendant 35 minutes. Les posts Facebook et Twitter que j’ai publiés afin de donner le lien de cette vidéo n’ont reçu aucun like ; c’est une première.
Il s’agissait de la 47e vidéo de la série, et elle dure 47 minutes. Dans les propos liminaires avant ma lecture d’un extrait d’Alors Carcasse de Mariette Navarro, j’ai employé le concept de figure plutôt que de personnage, et je m’aperçois que si je faisais mon travail sérieusement, j’aurais parlé de l’essai de Xavier Garnier, L’Eclat de la figure. Dans ma lecture du bref récit de Nimrod, Gens de brume, j’ai passé deux minutes à parler d’une phrase que je trouvais particulièrement belle et à laquelle j’ai failli consacrer un billet ici : « L’azur au-dessus des eaux perd sa glaçure. » (Sur un autre plan, je ne sais pas s’il fallait prononcer Silas à l’anglaise, comme dans le titre du roman de George Eliot, ou à la française comme je m’y suis résolu.)
Comme je l’ai fait remarquer à un moment donné, il faudrait que je constitue un index détaillé des auteurices mentionné-es dans l’ensemble de mes vidéos.
14:41 Publié dans 2023, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 25 février 2023
25022023
Levé à 7 h, réveillé peu avant. Je n’aurai pas réussi à recaler un rythme de sommeil différent de celui des semaines de cours, mais après tout, j’y arrive rarement, et cela remonte même à l’enfance et à l’adolescence : tout l’été je me réveillais vers 7 h, parfois 7 h 30 peut-être – tout au plus. – Le chauffage, bruyant dans cette maison (et on n’a rien pu y faire, en quatorze années), se relance à 7 h, donc ce n’est même pas ça.
Je me suis levé avec plusieurs idées de billets pour ce blog, et après avoir envisagé d’écrire un billet en plusieurs parties, je me suis rappelé qu’à l’époque où j’écrivais beaucoup dans ces carnets, au tout début notamment, il n’était pas rare que je publie 4 ou 5 billets par jour, parfois davantage.
On va donc faire comme ça, avec de vrais titres.
* *
*
Je note quand même ici qu’il a pas mal plu hier après-midi (pourvu que ça dure), et que j’ai enfin achevé Phone de Will Self, commencé il y a 3 semaines ½, interrompu par moments, et surtout que je ne lisais que par 5-10 pages pendant toute la semaine du 6 ; or, le bouquin en compte 617, en un seul paragraphe. C’est un roman très complexe, magistralement écrit, d’une ironie mordante, et qui alterne le point de vue (mais pas vraiment le monologue intérieur) de cinq protagonistes, Zack Busner, son petit-fils Ben, l’espion Jonathan De’Ath, le lieutenant Gawain Thomas, mais aussi, plus ponctuellement, la mère de Ben, Camilla/Milla. On sent que Will Self, lassé de voir pléthore de romans polyphoniques dont le narrateur ou la narratrice est explicitement indiqué-e en tête de chapitre, a voulu montrer qu’il saurait écrire un texte polyphonique sans chapitrage ni même retour à la ligne, dans un flux parfois imperceptible : il m’est arrivé de remarquer au bout de deux ou trois pages que le récit avait changé de focalisateur…
Même si le « grand sujet » du roman est la transition technologique des moyens analogiques au tout-numérique (pas seulement pour la téléphonie), le roman problématise et narre, dans sa dernière partie, un épisode de la guerre en Irak, ainsi que le scandale des crimes de guerre de l’armée britannique. Le décalage de départ entre la figure du psychiatre spécialiste des paranoïas mais désormais atteint d’Alzheimer et son petit-fils autiste n’est donc pas le sujet du livre, même si la rupture du soi (de soi ?) est son mode d’expression. Le personnage de Ben reste en grande partie insaisissable, et sert à boucler la boucle, en quelque sorte, entre les 5 personnages, car c’est lui qui s’avère être le dépositaire de la grande valise perdue par De’Ath dit « le Boucher ».
Entre autres raisons de se perdre dans le livre, la langue : mélange des registres, références à des chansons populaires, vocabulaire technique ou rare, argot, néologismes, allitérations, rimes internes – le nombre de fois où je me suis demandé comment traduire ceci ou cela (et où j’ai évité de me mettre à la place du traducteur…)… Je vérifie au moment d’écrire ces lignes, et apparemment les deux premiers volumes de la trilogie (Umbrella et Shark) ont bien été traduits en français, mais pas Phone. Je n’ai lu que ce troisième tome – hasard des bouquinistes de Galway en février dernier (et ça ne pose aucun problème car il ne s’agit pas de récits suivis) – mais ayant lu d’autres livres de Self j’imagine mal que les autres aient été plus faciles. L’explication est peut-être que Parapluie et Requin ont été traduits par Bernard Hœpffner et que personne n’arrive à prendre sa suite. [Il a été question de Hœpffner jeudi dernier lors du séminaire avec Marguerite Capelle et Laurent Vannini. Je me demande si j’ai déjà écrit à son sujet dans ce blog. Par contre j’avais déjà commencé la série de vidéos je range mon bureau quand j’ai lu son livre paru à titre posthume Portrait du traducteur en escroc.]
07:49 Publié dans 2023, Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 24 février 2023
24022023
Rentrés hier après-midi de notre brève virée, 2 jours ½ de vacances afin de passer un peu de temps avec A*, et je viens d’épousseter et de nettoyer les couvertures des vingt volumes de l’édition complète des Mémoires de Saint-Simon que j’ai – enfin, après plus de dix ans à la chercher à des prix pas trop exorbitants (je ne suis pas bibliophile) – dénichée chez l’une des bouquinistes de Becherel, mercredi après-midi, au retour de Saint-Malo. Voici un mètre linéaire que nous ne savons pas trop où ranger, et qui ne sera pas là pour la parade ou « pour quand j’aurai le temps », étant donné que j’ai déjà lu plus de la moitié de ces Mémoires, il y aura bientôt vingt ans, lors de notre emménagement à Tours, dans notre précédente maison, rue Guillaume-Apollinaire. En effet, j’ai gardé quelques années, le temps qu’elle retrouve un logement plus vaste, l’édition à couverture bleue (avec les « manchettes » en regard, ce qui n’est pas le cas de celle-ci) de ma sœur. C’est dans cette édition-là que j’ai lu, autour de 2003-4 – souvent en lisant plus tard dans la nuit que de raison, dans notre grande chambre qui donnait sur un balcon et sur l’allée dallée et gravillonnée –, toutes les années de la fin du règne de Louis XIV et de la Régence.
______________________
En écoute : Irakere – Live (1979)
10:12 Publié dans 2023, Blême mêmoire, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 20 février 2023
20022023
Mes parents sont repartis ce matin, direction Cesson (donc).
C* et O* se sont cassé le nez une troisième fois à l’auto-école, toujours fermée même aux horaires (très théoriques) d’ouverture. Ça risque de se finir dans une autre officine, plus chère certes… mais…
Quasiment fini, en lisant au soleil sur la terrasse, Phone de Will Self que je ne lisais que le soir et donc, ces dix derniers jours, en sauts de puce, cinq pages par ci trois pages par-là en piquant du nez. Hier, j’ai reçu, envoyé par l’auteur avec dédicace, le dernier recueil d’aphorismes, pas tout à fait marksonien quand même, de Paul Lambda : Les icebergs de la mélancolie.
Gel : déconseillerais embâcle.
Gers : Célimène délocalisable.
Colle siglée : calembredaines.
BD : le collégien se caramélise.
Cinémas : groseille décelable.
Mangeoire : belles cicadelles.
Décalcomanies : résille belge.
Clebs : conseillerai démêlage.
Colle : marécages indélébiles.
Adolescence : légalisme libre.
Cingal sec : belle démoralisée.
Clame doléances rééligibles !
17:37 Publié dans 2023, Chèvre, aucun risque, Lect(o)ures, Lézard rame | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 01 février 2023
01022023
Il n’est qu’onze heures et j’ai déjà traité x mails de boulot, animé une réunion d’information pour les L3, fait des tirages de brochures pour un étudiant de L3 qui va présenter notre Licence dans son lycée d’origine (en Bourgogne !), envoyé le programme de la Journée Portes Ouvertes à notre collègue responsable administrative adjointe et enregistré une vidéo de la série je rends des livres (qui est en train de mettre des heures à se téléverser sur YouTube).
Je devais aller récupérer un livre pour O* à la librairie, mais j’attends un appel d’A.W. pour un projet. Et il faut que je sois remonté pour midi à la maison (on my bike – il fait nettement plus doux depuis deux jours donc c’est plus agréable).
10:51 Publié dans 2023, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (3)
vendredi, 27 janvier 2023
27012023
Ce matin, suis allé aux Tanneurs en voiture, car la bise et l’humidité, par 0°, c’était trop pour mes bronches. C’est bien, aussi, de pouvoir choisir. Le cours de traductologie s’est passé normalement, on va dire, mais une fois encore avec 2 des 6 segments que nous n’avons pas eu le temps de voir en cours je vais devoir me fader une ébauche de corrigé écrit pour ces 2-là. Ensuite, petite réunion avec les étudiant-es réorienté-es de LLCER et Double Licence : 4 sur 8 seulement étaient là mais j’espère que ça a permis d’informer, de dédramatiser et de donner des conseils d’organisation.
 L’après-midi, j’étais tellement épuisé que j’ai passé l’après-midi au plumard : pas vraiment dormi, mais j’ai lu presque en entier deux des livres (courts, certes) achetés hier : Funambuler de Shenaz Patel et Sortir au jour d’Amandine Dhée.
L’après-midi, j’étais tellement épuisé que j’ai passé l’après-midi au plumard : pas vraiment dormi, mais j’ai lu presque en entier deux des livres (courts, certes) achetés hier : Funambuler de Shenaz Patel et Sortir au jour d’Amandine Dhée.
Ce n’était pas du tout prévu il y a encore quelques semaines mais je vais aussi passer un semestre en plongée dans les littératures de l’île Maurice. Comme tout ne cesse de résonner avec tout, la page 77 de Funambuler fait tout à fait sens, dans un tout autre sens que celui de l’argument de Patel dans cette sixième « traverse », pour le séminaire que j’enseigne autour de Freshwater le jeudi. Et les pages 94-5, les eussé-je lues plus tôt, auraient magnifiquement servi à la discussion sur le plurilinguisme et les sous-voix lors du séminaire que j’ai animé en novembre pour les M2 ApproDiv.
_________________
En écoute : plusieurs albums des Residents (Third Reich’N’Roll, Commercial album, Mark of the Mole, Fingerprince) – groupe/collectif dont je n’avais jamais entendu parler et que je découvre grâce à E.P., qui allait les écouter à Bourges ce week-end.
Soir : Le photographe de Mauthausen, film de Mar Targarona (2018). Assez classique, mais très fort, surtout dans toute la seconde partie. Plusieurs scènes du film s’appuient sur les vraies photos prises et sauvées par Francesc Boix, et dont les originaux sont reproduits pendant le générique de fin. Boix est mort à 31 ans, à Paris, des suites de la tuberculose contractée au cours de ses 4 années ½ à Mauthausen.
22:25 Publié dans 2023, Lect(o)ures, Tographe, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 22 janvier 2023
22012023 (comme à la parade)
Hier soir nous avons regardé les derniers épisodes (5 et 6) de la mini-série adaptée de la tétralogie de Ford Madox Ford, Parade’s End. Comme je l’ai lue il y a longtemps, il m’est difficile de me rappeler ce qui en a été conservé, atténué ou changé – peu importe, en un sens.
Deux détails linguistiques, toutefois.
Tout d’abord, sur le sens même du mot parade, qui n’est pas tout à fait un faux-ami mais qui présente la difficulté d’être polysémique en français comme en anglais, mais avec des acceptions différentes. On pourrait parler de polysémie dissymétrique, pour distinguer de la polysémie symétrique de grue/crane par exemple : les deux noms désignent, dans les deux langues, le même oiseau, puis par analogie de forme, le même engin de chantier. Dans le roman de Ford, et dans la série, le nom désigne à la fois la revue et le défilé au sens militaire, mais il désigne aussi le code de conduite aristocratique dont Tietjens semble être le dernier à songer devoir s’y conformer.
Une occurrence du premier sens se trouve dans le tome 2, No More Parades : « Very smart it would look on parade, himself standing up straight and tall. » Toutes les occurrences du tome 3, A Man Could Stand Up (dont le titre joue sur cette même amphibologie, avec l’ambiguïté entre le sens temporel et le sens modal de could), relèvent de cette acception.
L’autre acception fondamentale, qui est au cœur d’une des scènes du 6e épisode, peut se colorer d’une tonalité négative : « But, on occasion, he treated her with a pompous courtesy—a parade. » Dans ce sens-là, il s’agit de vouloir paraître, sauver les apparences : le code de conduite est avant tout là – en français – pour la parade. Dans la seule occurrence du terme dans ce sens, à propos du silence de façade entre Valentine et Mrs Duchemin sur les aventures extraconjugales de cette dernière, le nom n’est pas loin du mot mirage, primordial dans l’œuvre de Ford en général.

En tout cas, difficile de trancher entre le « feuilleté de signifiance » du nom en anglais et la valeur poétique de sa répétition. Sans doute la traduction française du roman aura-t-elle choisi la solution la plus simple : ne pas tenir compte des glissements de sens ponctuels et conserver ce même nom, parade.
On s’en avise, je n’ai pas encore devisé du second « détail » linguistique, beaucoup plus ténu heureusement. Il s’agit, toujours dans le dernier épisode, de la métaphore qu’emploie Christopher Tietjens pour expliquer à Valentine les élucubrations de son épouse, ou, mieux que ses élucubrations, sa façon de vouloir tirer la couverture à elle en tenant des propos outranciers et inattendus qui détournent l’attention de ses fautes morales. C’est ainsi que je comprends, dans sa complexité et au regard du reste de l’œuvre, cette expression : she is pulling the strings of the shower-bath. Si on relit l’extrait du tome 2 que j’ai donné plus haut, on voit qu’une des occurrences de l’expression se trouve dans la bouche du général Campion quand il exhorte Tietjens à divorcer. L’expression, qui disqualifie la conduite de Sylvia, s’oppose donc justement à la façade, au respect des bonnes manières, au fait d’agir à la fois – et c’est là toute la beauté du roman et de la situation de torsion dans laquelle se trouve Christopher – en vertu d’un code d’honneur absolu et du qu’en-dira-t-on.
Pour l’expliquer – et un rapide survol du Web montre qu’elle désarçonne beaucoup d’anglophones, Ford Madox Ford ayant le chic pour construire ses personnages autour d’expressions imagées apparemment usuelles mais qu’il forge en fait de toutes pièces – je ne vois pas mieux que de citer in extenso cet autre passage de No More Parades, qui rappelle entre autres que Ford est, tout autant que Mansfield ou Woolf, un maître du monologue intérieur et même du stream of consciousness :
There was nothing to be done. The amazing activities of which Sylvia would be capable were just the thing to send laughter raging like fire through a cachinnating army. She could not, thank God, get into France: to that place. But she could make scandals in the papers that every Tommie read. There was no game of which she was not capable. That sort of pursuit was called ‘pulling the strings of shower-baths’ in her circle of friends. Nothing. Nothing to be done...
L’image la plus proche, en français, pourrait être celle de la douche froide, ou aussi bien celle de l’arrosage tous azimuts (que j’invente, mais j’aime bien, d’autant qu’elle vient renforcer le caractère transgressif, car perçu comme masculin, de la sexualité de Sylvia). En raison des guillemets qui signalent le caractère non usuel de cette expression, le meilleur choix, pour un-e traducteurice, est de calquer : tirer la corde de la douche [?].
_______________________________
En écoute : Quintettes avec contrebasse (Boccherini / Ensemble 415) ; A Winter’s Tale (Tony Hymas Trio, 1992) ; Out Right Now (Maneri/Morris/maneri, 2001) ; Symphonie n° 2 (Brahms / Abbado / Berliner Ph.).
13:54 Publié dans 2023, Lect(o)ures, Tographe, Translatology Snippets, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 21 janvier 2023
21012023
On travaille (un peu), on tousse (beaucoup), on se traîne, on reste calfeutré avec du thé et des bouquins (ça ne soigne rien).
Cette nuit il y a eu une altercation autour d’une heure du matin, dans la rue. Et malgré tout, quinteux et m’étouffant, j’étais levé à 6 h 45.
Le projet autour d’Isabella Blagden est vraiment lancé.
Deux fers au feu ? non, onze ou treize.
Peut-être suis-je influencé par le dernier texte du n° 1 de la revue Papier peint, mauvais drap, ou par les éditions Louise Bottu.
Il y a des baffes qui se perdent (sur mes joues).
16:18 Publié dans 2023, Aphorismes (Ex-exabrupto), Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 14 janvier 2023
14012023
Fini de lire ce matin, au lit, dans la foulée du petit déjeuner fort matinal (7 h 15), le petit roman de Sharon Paul, Le Cantique du rasta, qui a obtenu le Prix Indianocéanie en 2021. C’est très beau, très ramassé, efficace. D’après la 4e de couverture, l’histoire de Nas s’inspire de très près de ce qui est arrivé réellement au chanteur Kaya, que je ne connaissais pas.
Pour l’heure, j’extrais du roman les deux phrases suivantes : « Et puis le petit s’en alla. Il vit des amis, et il s’en alla. » (p. 72)
Ces deux phrases n’ont peut-être l’air de rien, mais elles clôturent un passage d’une page et demie : Mémoire, le vieux musicien rasta, se désole de ne pouvoir aider un jeune chien ravagé par les tiques qui le dévorent ; le petit de ces deux phrases, c’est le chien. Avouez que ça ne se devine pas.
Hier soir, tard, j’avais posté ceci sur Twitter :
Ce matin, j’ai échangé avec un de mes abonnés, qui a commenté ainsi :
A propos de Sharon Paul, est-ce que la situation des autrices et auteurs parfaitement bilingues en anglais et français (Maurice, Ste Lucie, Dominique, pays Cajun…) a été étudiée (souvent trois langues d’ailleurs, contrairement au bilinguisme avec le créole comme en Haïti) ?
À quoi j’ai répondu :
Justement, je me lance dans un projet dont l'objectif est de creuser toutes ces questions-là. Je vais enchaîner avec Priya Hein. J'en ai parlé un peu dans ma vidéo d'hier, autour des livres de Mariam Sheik Fareed et d'Amenah Jahangeer-Chojoo.
__________________________
En écoute : Push the Sky Away (Nick Cave & the Bad Seeds) – mention spéciale pour ‘Water’s Edge’
10:37 Publié dans 2023, Affres extatiques, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 12 janvier 2023
12012023
Matinée passée à recevoir les étudiant-es d’échange et à faire leurs emplois du temps individuels en fonction de leurs profils. Cela fait douze ans que j’assume cette tâche, en sus de la signature des contrats – et du suivi pendant et après la mobilité – des étudiant-es qui partent un semestre ou une année à l’étranger, et je crois que je commence à saturer.
Après-midi : conseil d’U.F.R. totalement ubuesque. Sur trois heures, plus d’une heure et demie a été perdue à cause d’un collègue qui s’enferrait dans un faux problème, et qui s’est certainement mis à dos (au détriment de la filière qu’il dirige) la totalité du Conseil pour un bon moment.
Retour : pas la force d’autre chose que de lire vaguement la presse en écoutant des disques (Sel de Julien Jacob et Continuum d’Avishai Cohen). – J’ai découvert une poète allemande que je ne connaissais pas : Gertrud Kolmar, morte à Auschwitz à l’âge de 49 ans ; j’ai acheté son recueil Mondes traduit et postfacé par Jacques Lajarrige en 2001 chez Seghers – si mon libraire ne conservait pas un fonds digne de ce nom, je n’aurais jamais fait cette découverte.
Voici les derniers vers de Die alte Frau :
Selten
Dämmert wieder aus mattem Blick der schwache, fernvergangene Schein
Eines Sommertages,
Da mein leichtes, rieselndes Kleid durch Schaumkrautwiesen floß.
Und meine Sehnsucht Lerchenjubel in den offenen Himmel warf.
Dans la traduction de Jacques Lajarrige :
Rarement
Dans le regard éteint point de nouveau la faible lueur au loin enfuie
D’un jour d’été,
Où ma robe légère, ruisselante, inondait les champs de cardamine
Et ma mélancolie lançait dans le ciel béant
Des cris d’allégresse d’alouette.
20:00 Publié dans 2023, Lect(o)ures, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 05 janvier 2023
05012023
Journée de menues tâches et petites bricoles aux Tanneurs. Le matin j’ai étrenné le pantalon de K-Way ; heureusement que j’arrive tôt, alors qu’il n’y a pas un chat, car ça me fait une touche pas possible… mais au moins, je n’ai pas eu besoin de changer de pantalon dans mon bureau.
Depuis hier, j’ai un mal de crâne atroce dès que je mange (sauf petit déjeuner (à cause de la mug de café ?)). Ça s’est fini dans le noir total, au retour de la fac, entre 6 et 7, avant de pouvoir préparer le dîner puis me coucher avec le roman de Jamal Mahjoub, The Fugitives, paru en 2021. Depuis plus de dix ans que Mahjoub s’était réinventé une carrière avec ses romans policiers publiés sous le pseudonyme de Parker Bilal, je l’avais un peu oublié. Tout à fait prolifique, il republie donc aussi sous son vrai nom.
J’ai sombré dans le sommeil entre 9 et 10 puis me suis réveillé pour attendre C*, qui est rentrée peu avant minuit du ciné-débat avec Sandrine Rousseau.
Dans la journée, j’avais pu assister à une brève lecture/représentation de l’Antigone que va monter la compagnie La Course folle en 2024 : outre que je suis le travail de la metteuse en scène, Laurence Cordier, depuis plusieurs années, l’actrice qui joue Antigone est une de nos/mes étudiantes. La traduction est celle d'Irène Bonnaud et Malika Hammou. Il s’agissait là d’une restitution – d’une petite demi-heure – des 3 premières journées de vrai travail sur la préparation du spectacle, dans la salle Thélème. Créon est interprété par une comédienne ; la question a été posée par quelqu’un dans le public lors du temps d’échange avec l’équipe, mais il va de soi, pour moi, qu’un personnage dont le rôle est aussi explicitement symbolique du patriarcat n’a pas besoin d’une quelconque conformité « réaliste » ou genrée pour être incarné.
Avant de remonter à la maison sur mon vélo – mais sans le pantalon de K-Way (il ne pleuvait plus (il a fait extrêmement doux encore aujourd’hui, quelle catastrophe)) – j’ai croisé ma collègue U*, qui part bientôt pour les Etats-Unis, pour tout le semestre, et avec qui j’ai discuté, ainsi qu’avec notre collègue M*, avec qui je n’avais pas pu rediscuter depuis sa (belle) soutenance de thèse le 9 décembre dernier.
____________________
En écoute : Hibrido d’Allen Halloween (j’ai replongé à cause d’un échange sur Twitter)
23:05 Publié dans 2023, Lect(o)ures, Pynchoniana | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 27 octobre 2022
27102022
09:20 Publié dans 2022, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 11 octobre 2022
Fouiner / foutoir
Aux pages 104-5 de L’Usage de la photo, livre d’Annie Ernaux co-écrit avec son compagnon de l’année 2003 Marc Marie, et que j’ai lu hier, Marc Marie, justement, écrit ceci, en légende de la photographie dite « des mules blanches ».
Il est donc question, une énième fois, de la façon dont on classe sa bibliothèque personnelle, et du plaisir parfois complexe qu’il y a à fouiner, farfouiller, s’étonner ou se perdre dans le classement d’autrui, quand on n’est pas chez soi.
Chez nous, les livres sont classés peu ou prou selon de grandes catégories pratiques telles que celles ici déplorées par Marc Marie (fiction française, littératures africaines et autres francophones, littératures anglophones, littératures en traduction, littérature africaine de langue anglaise, théâtre, poésie, essais) mais sans réel ordre alphabétique, selon des regroupements qui peuvent allier les ouvrages d’une même maison d’édition (Minuit, Verdier, Dépaysage, P.O.L., Verticales, Aux Forges de Vulcain, Louise Bottu…) ou des pays (Ghana, Nigéria, Kenya, Afrique du Sud par ex. sur les étagères de littérature africaine de langue anglaise), des langues (lusophones, hispanophones, germanophones etc. bien distincts sur les étagères des littératures en traduction).
Bref, c’est un peu le foutoir quand même.
14:52 Publié dans 2022, Autoportraiture, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 20 septembre 2022
20092022
12:55 Publié dans 2022, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 05 mai 2022
05052022
Ce matin, c’était le dernier cours de Littératures postcoloniales et de la diaspora de L3. Impression un peu mitigée car j’ai fait passer un peu à l’abattage les 8 dernières présentations orales (en moyenne, il y en avait plutôt 3 par cours, soit beaucoup de temps pour questions, échanges et reprise), mais c’était le dernier cours avec un groupe d’étudiant-es globalement très vif, très dynamique, assez poil à gratter parfois, mais de façon stimulante. Chose rare, il me tarde presque de corriger leurs copies. C’est aussi une promotion dans laquelle se trouve une demi-douzaine d’excellent-es anglicistes.
Après-midi : conseil d'UFR, dont deux heures perdues à discuter du sexe des anges de l'emménagement partiel sur le site Lesseps à partir de 2025.
Soir : bonne idée, vraiment, d'aller acheter des feuilles quadrillées pour O* juste avant l'heure de la fermeture à la FNAC. Outre que les seules marques vendues là coûtent la peau des nèfles, pas pu résister à acheter deux disques, dont le dernier Oumou Sangaré. / Soir, plus tard : émission de La Grande Librairie avec Annie Ernaux. Pendant l'entretien, je me suis pris à refeuilleter le magnifique Quarto, et à commencer la lecture de La Femme gelée. Quelle écriture exceptionnelle. Deux analogies me sont venues, inattendues, difficiles à assumer ou approfondir totalement : le même creusement à partir des mots que dans les derniers livres de Sarraute ; le même creusement d'un matériau familial / générationnel que les romans de Bergounioux dans les années 80 (mais en beaucoup moins ennuyeux).
22:50 Publié dans 2022, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 28 avril 2022
28042022
Ce soir, très belle lecture d’extraits de Zone blanche, roman paru en 2021 – et que je ne connaissais pas – par son auteur, Jocelyn Bonnerave (également percussionniste ici) et Arthur Gillette, guitariste. C’était la première fois (en dix-neuf ans de vie à Tours) que je mettais les pieds et les oreilles au Bateau ivre. Il faut un début à tout.
J’ai acheté le roman, que J.B. m’a dédicacé alors qu’en général je ne cours pas après les dédicaces, et pense que ce sera peut-être moins bien que la lecture.
On verra.
Cet après-midi, j’ai lu la fin de l’épisode 13 (Nausicaa) et l’épisode 14 (Oxen of the Sun) : Ulysses m’exaspère de plus en plus, en fait. J’en ai fait état lors de mon dernier live Twitch mais là, l’épisode 14 est vraiment du foutage de gueule érudit, à la fois pharamineux dans son écriture et totalement creux dans sa portée.
23:17 Publié dans 2022, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 20 février 2022
20022022
J’avais du travail, et je n’ai pas foutu grand-chose : mauvaise humeur et mauvais moral de n’en avoir pas fait davantage. Dans l’après-midi, j’ai lu (mal) une quinzaine de pages de Ulysses afin d’avoir « de quoi dire » pour le troisième live Twitch de demain soir.
Le soir, j’ai terminé de lire Wunderland de Caitriona Lally, second roman de cette jeune autrice irlandaise, choisi presque par hasard sur les étagères d’Irish fiction de l’immense librairie Kennys Bookshop la semaine dernière : bonne pioche, car c’est à la fois drôle, grinçant et très dérangeant. C’est un roman très juste, je pense, sur ce que ça représente réellement, dans les détails, de vivre avec une personne gravement dépressive et suicidaire. C’est aussi un roman qui, dans la mesure où l’action se déroule à Hambourg, multiplie les jeux translinguistiques entre l’allemand et l’anglais, et dont le personnage masculin principal ne cesse d’imaginer, en anglais, de nouveaux noms collectifs, pas seulement pour les animaux. On l’aura compris, c’est le genre de roman que je lis avec une part de mon attention captée par l’hypothèse de la traduction.
Abyss dominical : gagné 90 à 80 contre O*.
Au fond, je crois que je n’aspire profondément qu’à une chose : la retraite. Mais elle n’arrivera, au mieux, que dans vingt ans.
21:51 Publié dans 2022, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 13 février 2022
13022022 (fantôme)
 Le jour des 77 ans de mon père, et la veille de notre retour en France, je me lance, dans le salon donnant sur le vieux bourg de Salthill, à Galway, à la découverte de Joseph O'Connor - si chaudement et souvent recommandé par sa traductrice Carine Chichereau. Des milliards d'autres fers au feu mais on ne peut pas toujours attendre... Le roman tourne autour de la figure, essentielle, de Molly Allgood / Maire O'Neill, actrice qui a notamment créé le personnage de Pegeen dans The Playboy of the Western World mais qui fut aussi le dernier amour de Synge.
Le jour des 77 ans de mon père, et la veille de notre retour en France, je me lance, dans le salon donnant sur le vieux bourg de Salthill, à Galway, à la découverte de Joseph O'Connor - si chaudement et souvent recommandé par sa traductrice Carine Chichereau. Des milliards d'autres fers au feu mais on ne peut pas toujours attendre... Le roman tourne autour de la figure, essentielle, de Molly Allgood / Maire O'Neill, actrice qui a notamment créé le personnage de Pegeen dans The Playboy of the Western World mais qui fut aussi le dernier amour de Synge.
11:57 Publié dans 2022, Autoportraiture, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 28 janvier 2021
Okay Bergou
Parcouru le n° des Cahiers de l'Herne consacré à Bergounioux.
La plupart des textes font ressortir l'aspect le moins intéressant de l'écrivain, son côté pisse-copie et donneur de leçons qui rit quand il se brûle. J'avais beaucoup aimé lire les différents tomes des Carnets de notes, car voir le travail dans sa continuité est fascinant, et il y a évidemment de vrais bonheurs d'écriture.
Là, dans ce numéro spécial, il y a un texte (inédit ? repris d'une de ses innombrables contributions à des revues ?) de Bergounioux lui-même, sur la génération de 68, et qui est absolument hérissant, ou navrant, de bêtise confite, paradoxalement très Biedermeier : l'embourgeoisement réac des anciens communistes qui fustigent "les jeunes", et qui ne se rendent pas compte que c'est leur participation enthousiaste au productivisme industriel qui a contribué à la catastrophe écologique dans laquelle nous sommes empêtrés (et dont, d'ailleurs, Bergounioux a au moins la décence de ne jamais parler). On a vraiment envie d'écrire "OK boomer" en marge d'une phrase sur deux.
18:29 Publié dans 2021, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 10 janvier 2021
Séances lambrissées
Grande léthargie aujourd'hui. Et dire que je dors très bien ces dernières semaines. Tant mieux, d'ailleurs.
Pas corrigé la moindre copie ce week-end, la honte absolue.
Chaque matin depuis que mes parents m'ont apporté le vélo d'appartement, je fais une séance de 30-40 minutes, en écoutant à chaque fois un des vinyles de la collection installée dans la chambre d'amis. Ce matin, c'était une (longue) face d'un disque de Duke Ellington avec son quindectet (enregistrements de 1954, il faudrait citer tous les musiciens, pas seulement Johnny Hodges (et il faudrait surtout creuser toute l'histoire complexe des orchestres de Duke Ellington)), avec, pour lecture, un article de Paul Zumthor sur l'intertextualité dans les textes médiévaux (il y distingue notamment les modèles "verticaux" des variations "horizontales").
Hier matin, j'avais associé le troisième LP du coffret Eric Dolphy A The Five Spot avec plusieurs lettres de D.H. Lawrence : ce volume de lettres choisies de D.H. Lawrence entre 1923 et 1930, récupéré je ne sais où, traînait à la buanderie, et je m'étais mis à en lire une par ci une par là il y a quelques semaines, au gré des lessives. Lecture très étonnante, pour moi qui n'ai lu, je crois, aucun roman de D.H. Lawrence, seulement des poèmes et des nouvelles. Il y a vraiment des pépites, des réflexions qui en disent long sur la vie intellectuelle dans l'entre-deux-guerres. (J'aurais dû remonter le livre pour noter ici quelques-uns de ces passages.)
Vendredi, j'avais allié mon vieux disque Whomp That Sucker! de Sparks (avec lequel j'ai appris l'anglais (ce raccourci faux est délibéré)) à d'autres lettres de D.H. Lawrence (très congruent).
À la fin de l'automne, vu la météo, j'ai dû interrompre mes virées en vélo dehors, de sorte que le vélo d'appartement tombe bien. Aux beaux jours, il faudra reprendre les excursions, car ça n'a rien à voir, tout de même.
17:53 Publié dans 2021, Jazeur méridional, Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 08 janvier 2021
Polyphonies
Difficile de se tenir à l'écriture quand le reste du travail rend tout cela plus difficile encore. Au moins, j'ai le prétexte, parfois, que le travail m'a empêché d'écrire. Ces jours-ci, je suis accaparé par les signatures de programmes d'études des étudiant-es qui postulent pour un semestre ou une année dans les universités partenaires d'Asie et d'Australie. Est-ce l'effet de l'étouffement ressenti avec les confinements, il n'y a jamais eu autant de candidatures.
J'ai passé une partie d'après-midi à lire, au salon, dans un des deux cabriolets offerts par mes parents, le roman de la romancière tunisienne Hella Feki, Noces de jasmin, paru l'an dernier aux éditions Lattès. Sans l'admirable Ahmed Slama, je n'aurais pas eu vent de ce livre. La structure et le fonctionnement narratif (alternance de 5 narrateurs à la première personne, dont un non-humain (la cellule)) rappelle le roman de Véronique Tadjo autour de la pandémie d'Ebola, En compagnie des hommes.
Il va falloir remettre sur le métier les vidéos.
Il fait un froid mordant. Toute la journée, brume et brouillard.
Depuis hier, j'ai mis en route une séance quotidienne de vélo d'appartement, au sous-sol, dans la chambre d'amis reconvertie depuis août en salon musical, et donc aussi désormais en salle de sport. À chaque séance de vélo correspond l'écoute d'un vinyle, avec pause médiane pour retourner le disque. Ce matin, c'était Africa / Brass de Coltrane, et confirmation que c'est peut-être le seul disque de Coltrane que je trouve ennuyeux, pénible presque.
19:12 Publié dans 2021, Jazeur méridional, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 06 décembre 2020
Jeu littéraire dominical
Ce jeu traîne sur Twitter depuis déjà quelque temps, et quand je me décide à faire ce genre de choses, je ne fais évidemment pas les choses à moitié, et je triche pour ne pas avoir trop à trancher.
Pour tout dire, j'avais même songé à d'autres colonnes / rubriques. Il manque, dans ce tableau, au moins Charlotte Delbo, Ovide, Pouchkine et Thomas Bernhard.
17:57 Publié dans *2020*, Chèvre, aucun risque, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 24 novembre 2020
Farces foutraques
Tenir ce journal chaque jour de l'année 2020 (il y a dû y avoir deux ou trois anicroches, mais enfin...) n'aura pas été tellement difficile. Quand on voit la difficulté que j'éprouve à terminer quelque chose. Je ne me tiens, au fond, qu'à l'informe et l'infini, l'inachevable*. Dès que s'épelle le mot FIN quelque part dans le lointain, c'en est fini de moi.
Bien entendu l'année 2020 porte en elle, dès le principe... portait une feuille de calendrier avec le mot FIN. Mais ce n'est pas pareil : cette fin est inéluctable ; il suffit de se laisser porter.
En lisant le livre de Guillaume Métayer, je me dis que j'aurais pu écrire vingt livres comme celui-là, ne serait-ce qu'au cours des dix dernières années. Voilà, seulement, que je ne l'ai pas fait, et que le conditionnel n'est pas la réalité. Je parle bien de l'essai de Métayer, pas de n'importe quel livre. Diffus, foutraque, ensemble de chapitres simplement reliés par une couverture, mais avec un fil conducteur puissant qui permet de nourrir la réflexion de manière plus continue (comme si c'était le lectorat, réellement, qui faisait le livre), c'est exactement le genre de livre dont je pourrais tirer, sans exagération, vingt volumes en puisant seulement dans mes archives. Quel sens cela aurait-il ? Aucun, certainement, les sujets n'intéressant personne.
Pour en revenir à l'année 2020, il y a une forme d'ironie à ce que ce soit justement cette année étrange, désastreuse, qui me permette d'achever quelque chose. (Il reste 37 jours ; je ne pense pas me porter la poisse en écrivant cela.) Outre la reprise (et l'achèvement ?) du Projet Pinget, que pourrais-je manigancer pour 2021 ?
* La question de l'enthousiasme qui retombe, c'est-à-dire de l'énergie que je peux mettre pendant quelques semaines ou quelques mois à un texte, à une série de vidéos, à un cours, avant que cet enthousiasme ne s'effiloche, est intimement liée, je pense, à l'intérêt très modéré de mes initiatives : j'en veux pour preuve que les personnes avec qui j'échange sur les réseaux sociaux se passionnent toujours quelque temps pour mes vidéos, par exemple, m'en disant le plus grand bien, engageant même un dialogue constructif etc., avant de ne plus jamais intervenir. Tout cela n'a aucune gravité, vu qu'au fur et à mesure je construis tout de même quelque chose, et un fil conducteur se tisse, à défaut de me guider.
16:16 Publié dans *2020*, Ecrit(o)ures, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 19 novembre 2020
Coincé sous un beau préau
J’ai lu le mot Beaupréau dans un livre, donc me voici dans la cour de récréation de mon école primaire, une fois qu’elle a été rénovée, donc quand j’étais en CM2. Sous le préau nous jouons aux billes, selon des règles un peu plus subtiles que celles des gamins d’aujourd’hui, les consoles vidéo les abrutissent. Stéphane Bégu s’exclame que c’est un beau préau, et il se fout de moi.
Il se fout tout le temps de moi, alors dans la cour de récréation de l’année d’avant, en CM1, je lui casse la gueule, ou plus exactement pour la seule fois de ma vie je fous mon poing le plus fort que je peux dans la gueule de quelqu’un, et ce quelqu’un saigne du nez. Ce quelqu’un c’est Stéphane Bégu. On reprend la partie de billes, mais cette fois-ci c’est dans la cour de récréation du collège Ronsard, et mon fils a honte de voir que je joue aux billes alors que j’ai passé depuis plus de trente ans l’âge d’être au collège.
Mais pas celui de jouer aux billes, alors bon.
Sous le préau de mon école primaire nous jouons aux billes, mais Stéphane Bégu désormais a la tête et les cheveux de Yaël Bidon, les jambes d’Olivier Saint-Geours, et il parle intelligemment comme Sébastien Raoulas. Le surveillant du collège Ronsard vient nous dire qu’on n’a rien à faire là, on n’est pas de ce collège, et d’abord où sont nos masques.
Le surveillant, qui est celui des sosies de François Berléand qui ne ressemble pas du tout à François Berléand, a un livre à la main, et ce livre c’est Catastrophes de Pierre Barrault. Sébastien Raoulas me glisse à l’oreille que nous devons nous trouver dans un chapitre inédit du livre de Pierre Barrault. Je lui dis que je ne comprends rien et il m’engueule parce que ce n’est pas parce que nous vivons en 1983 que nous ne devons pas porter notre masque comme la loi nous y oblige en 2020.
Je lui dis de laisser tomber, et la cour se remplit de billes. Le sosie de François Berléand qui ressemble à présent à Stéphane Bégu se casse la gueule en glissant sur les billes. Il saigne du nez. Tant mieux. En plus il va choper le Covid19 car les billes se sont toutes transformées en petits avatars de Covid19. Tant mieux. C’est ce que je me dis même si je me rends compte qu’il saigne du nez mais avec les visages des autres personnages du roman de Pierre Barrault.
D’ailleurs la partie de billes se poursuit au collège Pierre-Barrault et le surveillant n’est autre que Pierre de Ronsard. Il commence à brailler Mignonne, allons voir si la rose. Je lui pète la gueule, mais bien. J’y prends goût, ma parole. Et puis il n’avait qu’à chanter une de ses antistrophes, car j’aurais pu répondre avec l’épode. Et fusionner François Berléand et Yaël Bidon dans le télépode. Nous voulons des personnages non-binaires. Et des pronoms fuyants. Les il des deux paragraphes précédents ne désignent jamais qui ils semblent désigner.
Je m’acharne sur Ronsard ; je lui pète les dents, et je lui colle le seul point-virgule du texte dans l’œil droit.
Claire me dit que ce n’est pas charitable, et pas malin, qu’elle avait besoin de poser des questions à Ronsard pour son cours de demain.
Je lui réponds que son cours est sur Les Contemplations de Hugo.
Ça ne te regarde pas, me dit-elle.
Il n'avait qu'à pas me dire d'arrêter de singer bêtement et sans talent l'écriture de Pierre Barrault.
Mais il ne t'a pas dit ça, me dit Claire.
J’ai l’impression que Claire est en fait la Claire du roman de Pierre Barrault et ça m’effraie car je n’ai pas lu le roman et je ne connais pas tous les couplets de What shall we do with a drunken sailor. Pierre Barrault me dit que ce n’est pas grave, mais je ne l’écoute pas car c’est lui le sosie de François Berléand et si je n’avais pas lu le mot Beaupréau nous n’en serions pas là.
Le narrateur n’avait qu’à passer sa jeunesse à Saint-Genouph, et nous n’en serions pas là.
Sébastien Raoulas me dit que ça se voit que je n’ai pas lu Catastrophes car ce n’est pas un roman, mais des fragments.
Je lui dis qu’il faut qu’il arrête de se contenter de lire les quatrièmes de couverture car c’est bien un roman, et d’ailleurs il y a un début et une fin.
Yaël Bidon hoche la tête.
Et entre le début et la fin il y a les péripéties.
Yaël Bidon hoche la tête. C’est elle qui a pris la photo de l’agent immobilier dans l’appartement, juchée qu’elle était sur l’éléphant de François Delarozière. Elle est prête à faire cours sur Ronsard, mais elle croit que ça veut dire qu’il faut être juchée sur le Ronsard-machine de François Delarozière.
Je reprends mes billes, car il est évident que j’ai pris un des mauvais chemins pour aller à Beaupréau. Sans ça je ne passerais pas mon temps à m’égarer dans la cour de mon école et dans celle du collège Ronsard.
Je sors du collège qui est mon école de quand j’étais en CM2 mais avant qu’elle ne soit construite, j’ouvre Google Maps qui s’ouvre sur la page 142 de Catastrophes et me dirige vers Saint-Genouph. Claire me tend le nez sanguinolent de Stéphane Bégu. Claire chante This Is No Mine Ain House, dont je ne connais pas les couplets non plus mais que je chante en entier.
Au milieu de la rue Puspök, nous nous arrêtons, figés. Plus moyen de nous bouger.
Chut, me dit Claire, Pierre Barrault est en train de se raser, et il suffit d’attendre qu’il ait terminé.
De toute façon, me souffle Sébastien Raoulas, dont je me demande ce qu’il fout dans mon aéroplane blindé, de toute façon c’est un fragment inédit de Catastrophes, nous n’en sortirons jamais.
Et nous n’arriverons jamais à Saint-Genouph non plus.
Désespéré, j’avale une bille pour que Sébastien Raoulas se transforme en Stéphane Bégu et que je puisse lui casser la gueule.
11:28 Publié dans *2020*, Ecrit(o)ures, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 17 novembre 2020
Avec attestation
11:10 Publié dans *2020*, Lect(o)ures, Moments de Tours, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 08 novembre 2020
"80 or 100 feet in length"
13:45 Publié dans *2020*, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 14 octobre 2020
magdaléniennement (de Fourcade à Heaney)
Continuer de lire des textes à la fois beaux (par éclats) et ardus, c'est ma seule technique pour ne pas sombrer dans la sénilité.
Mais cela n'est-il pas un leurre ?
08:30 Publié dans *2020*, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 12 octobre 2020
Avec un monstre lu
Ce matin, c'était un peu la vidéo à handicaps, et je ne parle pas du masque. Contrairement à ce que je dis au début, j'ai d'ailleurs pu la mettre en ligne avant mon premier cours, mais grâce à l'utilisation de WeTransfer et à une petite promenade permettant de trouver davantage de réseau que dans mon bureau (1 gigaoctet, ça bloquait).
Au demeurant, j'avais mal commencé la journée, et je n'ai cessé de me sentir mieux au fur et à mesure qu'elle passait.
17:54 Publié dans *2020*, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 05 octobre 2020
Le monde à écumer (l'arrachée belle)
Après ma lecture du premier livre de Lou Darsan, je me suis retrouvé avec une occasion en or de dire deux mots de Wittgenstein's Mistress, un livre-phare pour moi.
Mais je m'avise avoir dit n'importe quoi : Wittgenstein's Mistress, je l'ai lu sur exemplaire emprunté en B.U., puis réemprunté. Je ne l'ai donc jamais eu en anglais.
19:18 Publié dans *2020*, Blême mêmoire, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 23 septembre 2020
Unissons
Aujourd'hui, dans deux livres que je lis simultanément, il était question de l'insurrection de Mohand Mokrani dans les années 1870, en Kabylie.
Ces deux livres, ce sont ALGER, RUE DES BANANIERS de Béatrice Commengé, et le dernier chapitre de LA FOSSE COMMUNE de Pierre Vinclair.
22:00 Publié dans *2020*, Chèvre, aucun risque, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 16 septembre 2020
Catastrophes
06:15 Publié dans *2020*, Chèvre, aucun risque, Lect(o)ures, Mirlitonneries métaphotographiques | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 11 septembre 2020
Galère aux catastrophes
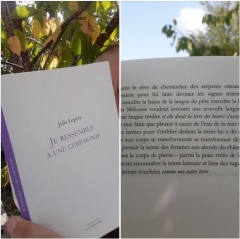
J'ai reçu hier mon lot commandé la semaine dernière aux éditions du Corridor bleu, dont je venais de découvrir le catalogue : un numéro papier de la revue Catastrophes, un roman de Pierre Vinclair (dont l'extraordinaire poème La Sauvagerie m'aura accompagné tout l'été), un beau recueil de la jeune poète Julia Lepère (cf supra) et un recueil de Christine Chia (malheureusement pas en bilingue, j'étais très déçu en voyant ça).
J'essaie d'organiser, comme je le peux, mes deux cours en distanciel, celui d'agrégation interne, et celui pour les étudiant-es d'échange resté-es dans leurs pays respectifs (mais qu'on accueille quand même, on n'en est pas à une contradiction sémantique près).
23:23 Publié dans *2020*, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 29 août 2020
Charbonné
L’érable chétif face à la cuisine a deux grosses feuilles brunes. Il fait frisquet aujourd’hui.
Je poursuis ma lecture de Zoocities, de la philosophe Joëlle Zask : le livre est intéressant, de par son sujet autant que par sa problématique, mais le manque répété de rigueur dans les sources et dans la démonstration m’agace toutes les trois pages.
Encore un achat mobilier aujourd’hui : une bibliothèque d’occasion, au dépôt-vente de Saint-Pierre des Corps. Elle va nous permettre de ranger DVD et divers bouquins de façon plus rationnelle à la buanderie.
Pendant que j’enregistrais, comme on doit le faire chaque semaine, les différentes pièces de hautbois jouées par O*, j’ai feuilleté deux livres qui se trouvent au salon : ma fidèle anthologie des littératures du Moyen-Âge – qui m’a donné envie de lire le Huon de Bordeaux – et un livre d’art L’art belge, entre rêves et réalités, que je n’avais pas ouvert depuis longtemps et dont je retiendrai le nom de Maximilien Luce.
17:40 Publié dans *2020*, BoozArtz, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 21 août 2020
All Along the River
Je ne lis pas énormément, mais avec le roman de Mary Elizabeth Braddon que je suis en train de lire, je retrouve un vrai plaisir de lecture. Il s’intitule All Along the River, date de 1893 ; c’est le troisième que je lis de cette autrice immensément populaire de son vivant, et pas seulement au Royaume-Uni puisque plusieurs de ses romans furent traduits en français l’année suivant leur parution en anglais. C’est très bien écrit, et quoique l’intrigue soit cousue de fil blanc, absolument jouissif dans les descriptions sociales et psychologiques, bourré de stéréotypes de genre subtilement déconstruits.
23:11 Publié dans *2020*, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 11 août 2020
*1108*
C* a reçu en cadeau, de la part de mes parents de ma sœur, le Dictionnaire des créatrices en 3 forts volumes, magnifique somme publiée en 2011 par les éditions Des Femmes et devenue introuvable, sauf d’occasion.
15:51 Publié dans *2020*, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 25 juillet 2020
Se taire ou pas (projets)
Réveillé à 6 h avec la migraine pas passée hier soir. Je n’arrive plus du tout à lire en ce moment. Quoique l’angle sous lequel y est traitée la question de la mémoire de la traite esclavagiste soit très novateur et m’intrigue, le livre de Léonora Miano que j’ai commencé il y a trois jours – Crépuscule du tourment – me tombe des mains, comme tout ce que je tente de lire depuis une quinzaine, il semblerait. J’ai reçu Se taire ou pas, d’Isabelle Flaten, reparu en poche au Réalgar : si je n’arrive pas à le lire non plus, ça va devenir inquiétant.
Je pianote dans la maison vide et endormie, avec quatre bougies à la citronnelle et le reflet de mon visage au-devant du clavier, dans le verre de la table de la salle à manger (qui fait partie des nombreux meubles que nous devons virer d’ici fin août). Et la maison paraissait déjà vide après le nettoyage de février…
Il faut que j’écrive le billet d’hier, et les deux sonnets du jour, à défaut des trois en retard.
07:02 Publié dans *2020*, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (2)
mardi, 07 juillet 2020
"agir non agir"
Première vraie journée d'été, pas franchement caniculaire... toujours ce vent...
Beaucoup lu. Je poursuis la lecture, linéaire, j'y tiens, de La Sauvagerie. Je ne suis pas encore en mesure d'écrire quoi que ce soit au sujet de ce livre dont je ressens très fort qu'il s'agit d'un poème qui va me marquer durablement, devenir un de mes classiques incontournables, toujours remis sur le métier. On peut lire le long méandreux article que vient de lui consacrer Auxeméry (un des 49 co-auteurs du livre, d'ailleurs), mais je pense que le mieux est, à condition d'aimer lire de la poésie, de se procurer le livre de Vinclair.
[Je préfère la recension de Tristan Hordé, qui m'apprend que Vinclair publie simultanément un essai intitulé Agir non agir.]
Avant-hier j'ai commencé la lecture de Comorian Vertigo, qui me plaît moins que les deux autres livres de Nassuf Djailani chroniqués samedi dernier. C'est un roman, mais de bric et de broc, il semble.
Avant-hier j'avais aussi commencé à me plonger dans les deux gros "Quarto" rassemblant les quatre livres de Paul Bénichou ; aujourd'hui, j'ai beaucoup avancé dans Le Sacre de l'écrivain. Même si une partie de la démonstration m'intéresse modérément, en matière d'histoire littéraire, je ne lis pas trop en diagonale car je veux être sûr de ne pas manquer les articulations principales. Or, les pages sur l'illuminisme, sur Senancour ou sur Lamartine sont difficiles à extraire, ou à abstraire.
Soir : Wild At Heart, que je me rappelais mal, et qui est de fait, un petit Lynch. Difficile d'imaginer comment ce film a eu la Palme d'Or. Cage y est excellent, mais tout y est un peu surdéterminé, excessif aussi. Je crois que quelque chose m'échappe.
22:50 Publié dans *2020*, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)
samedi, 04 juillet 2020
Pentes et sentes
Levé tôt, fatigué. Me suis senti un peu comme ci comme ça toute la journée.
En fin de matinée, je suis allé en ville en vélo, pour la première fois. Cela m'a permis de voir qu'il me faudrait 17 minutes si je comptais me rendre l'an prochain au travail en vélo (au lieu de 25 minutes environ à pied et en tramway), et plutôt 25 minutes au retour (j'ai mis pied à terre à mi-côte, avenue de la Tranchée, mais c'est parce que je n'ai pas pris l'habitude de grimper).
Après bien des tergiversations, j'ai aussi fini par enregistrer, en trois temps, la vidéo n° 62 de je range mon bureau. Vu le nombre de livres qui s'étaient accumulés, j'ai été contraint de les expédier, de parler de chacun en trois minutes voire moins, à l'exception des Hommes qui me parlent d'Ananda Devi ; j'ai considérablement abrégé le temps de bavassage en ne lisant que peu d'extraits (Woolf, Devi et Thörn seulement).
Je parle de bavassage, et je parle de tergiversations : en effet, je crois que j'ai fait le tour de ce format, que je n'en vois plus trop l'intérêt. Mon seul problème est que, si je ne fais plus ces vidéos, je ne garderai plus trace, pour moi-même, des livres que je lis, et qui s'empilent sur les étagères. Un ami, avec qui j'ai pris un verre ce midi justement, et qui a acheté plusieurs livres suite à ces chroniques filmées, publie des extraits des livres qu'il lit sur Facebook : moins chronophage que le billet de blog, cette pratique est peut-être ce qu'il me faut désormais.
17:27 Publié dans *2020*, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (5)
lundi, 01 juin 2020
Lect(o)ures
En ce premier jour de juin, je me contente, pour nourrir cette rubrique qui n'a pas connu un seul jour de jachère depuis le 1er janvier, de cette capture d'écran d'un tweet écrit hier matin.
Je m'en veux beaucoup de laisser en plan trois projets qui me tiennent à cœur, mais je manque de temps, et parfois d'énergie, et surtout de motivation dans la durée. Besoin d'être encouragé, peut-être. Au lieu de quoi, comme un idiot qui se disperse, j'ai créé samedi un nouveau compte Twitter dans lequel j'entreprends de transposer en anagrammes la totalité d'un grand roman moderniste.
Le verre d'eau à moitié plein, ce serait de considérer tout ce que j'ai amassé, en blogs et vlog, depuis quinze ans, en le faisant surtout pour moi-même...
10:45 Publié dans *2020*, Chèvre, aucun risque, Ecrit(o)ures, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (10)
vendredi, 29 mai 2020
Traversées des fantoches
Hier, Blanquer, une fois encore à la ramasse et désavoué, a annoncé l'annulation de l'épreuve orale de français, dont le maintien était, de fait, incohérent, vu que, pour l'ensemble des autres épreuves du baccalauréat, il avait été décidé, depuis plus d'un mois, le remplacement des examens par une évaluation au contrôle continu sur les deux premiers trimestres. (De par plusieurs témoignages qui me reviennent, cette dernière décision a d'ailleurs foutu dans la merde mis dans un profond embarras pas mal de lycéens de Terminale qui avaient glandouillé en comptant sur des révisions de dernière minute pour sauver les meubles.) Ce ministre abject, qui impose depuis trois ans une idéologie saumâtre et rance contre tous les avis et contre les experts, est devenu de façon manifeste, depuis trois mois, le fantoche à la fois ridicule et odieux que les gens du milieu savaient déjà être.
Apparemment, si O* (qui est en quatrième) retourne au collège, ce sera un jour par semaine, car le collège ne peut pas s'organiser autrement : c'est ce que Blanquer nomme le “retour à la normale”. Imbécile.

Je vais encore beaucoup me plonger dans des questions de traduction ces jours prochains car j'ai aussi acheté la traduction en Poésie/Gallimard des Sonnets de Pasolini : je crois que c'est l'édition recommandée pour le programme 2021 de l'agrégation de lettres modernes, et je vais pouvoir comparer avec celle des Solitaires intempestifs, que je connais mieux et depuis quelque temps déjà. Et j'ai aussi emprunté à la B.U. (on ne peut pas entrer, on commande à distance et on récupère les livres à l'extérieur, le long de la Loire) plusieurs livres de et sur Maryse Condé, dont la traduction de Traversée de la Mangrove par Richard Philcox : le livre est précédé d'un avant-propos du traducteur qui méritera(it) à lui seul un billet de blog.
.
En écoute : insistence de Jacques Ponzio / Africa Express [album remarquable / je dois écrire dans les jours qui viennent un billet de blog aussi sur les disques d'Africa Express, mais je rappelle ici même qu'il n'y a pas besoin d'attendre que j'en dise bien pour s'y intéresser]
09:02 Publié dans *2020*, Chèvre, aucun risque, Lect(o)ures, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (2)
mercredi, 27 mai 2020
Huysmans
Il n'est pas évident de déterminer ce qu'il faut faire, et dans quel ordre.
Aujourd'hui, j'ai fini de lire Là-bas de Huysmans. Avec ses archaïsmes et ses vitupérations, Huysmans reste malgré tout un romancier vraiment intéressant, même par la façon dont il mêle deux romans qu'il n'a pas écrits à son roman principal en quelque sorte : on sent bien que les pages où Durtal rapporte ce qu'il a lu de Gilles de Rais sont plaquées, et il en va de même des conversations avec le sonneur de cloches de Saint-Sulpice, Carhaix... mais l'ensemble forme malgré tout un ensemble qui n'est pas seulement un assemblage d'aphorismes ou d'observations, d'une manière qui préfigure la structure romanesque des modernistes (Conrad, Ford Madox Ford, Woolf).
Je me suis replongé dans Huysmans à l'automne dernier, à l'occasion de la parution du Pléiade. Je n'avais vraiment lu que les poèmes en prose du Drageoir aux épices (non repris dans le Pléiade) et À rebours, comme tout le monde. Là, j'en suis à "mon" troisième, sans avoir relu À rebours. Je me convaincs que, sans être un très grand, Huysmans doit être lu, et même que ses romans ont beaucoup à nous dire, mutatis mutandis, des tripatouillages idéologiques dans lesquels nous traînassons.
21:04 Publié dans *2020*, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (2)
samedi, 09 mai 2020
Odds and ends
Aujourd'hui, je n'ai pas fait grand chose, ou plus exactement : je n'ai guère bossé.
Comme, d'une part, il faisait beau, et comme, d'autre part, O* a été occupé à faire son travail d'arts plastiques le matin, à jouer à Fifa19 en début d'après-midi (il a été limogé de son poste d'entraîneur du PSG car avec les difficultés à jouer au niveau pro il y a 2-3 semaines quand il a passé ce niveau, il n'a pu terminer "que" 5e du championnat), puis à aider A* à faire la cuisine (quiche aux tomates cerise, velouté de fenouil et enfin chili pour demain), il n'y a eu ni partie de piquet, ni billard, ni ping-pong, et donc j'ai pu beaucoup lire, dehors, donc, malgré quelques agaçantes chignoles voisines autour des 3-4 heures de l'après-midi.
 J'ai fini de lire La statue de sel d'Albert Memmi, son premier roman (1953), que j'avais trouvé dans une boîte à livres je ne sais plus où, et qui s'est d'ailleurs débigoincé en cours de lecture : une fois la prochaine vidéo faite, il ira au recyclage, ce qui est dommage car c'est un très bon livre. En cherchant quelques bricoles hier au sujet de Memmi (dont j'ai lu il y a très longtemps, à Beauvais, Le scorpion) j'ai découvert qu'il était toujours vivant : il fêtera ses cent ans en décembre prochain. Roman en partie autobiographique, mais en partie seulement : on sait que les deux derniers chapitres correspondent en quelque sorte à une vie alternative d'Albert Memmi. Il s'agit d'un Bildungsroman qui suit les étapes d'un jeune Juif tunisois de l'enfance au début de l'âge adulte, après un “séjour” très rude dans un camp de prisonniers, sous le joug nazi. Memmi décrit très bien comment les Juifs d'Afrique du nord, considérés comme des citoyens de seconde zone avant et pendant la guerre, se sentent toujours aussi délaissés, tant par les FFL que par le nouveau gouvernement. Là où le roman se distingue notamment de la vie de Memmi, c'est qu'il s'agit d'un Künstlerroman déceptif : comment Alexandre Mordekhaï Benillouche n'est pas devenu écrivain. Le roman commence d'ailleurs d'une manière qui m'a rappelé le film de Perec Un homme qui dort, vu récemment.
J'ai fini de lire La statue de sel d'Albert Memmi, son premier roman (1953), que j'avais trouvé dans une boîte à livres je ne sais plus où, et qui s'est d'ailleurs débigoincé en cours de lecture : une fois la prochaine vidéo faite, il ira au recyclage, ce qui est dommage car c'est un très bon livre. En cherchant quelques bricoles hier au sujet de Memmi (dont j'ai lu il y a très longtemps, à Beauvais, Le scorpion) j'ai découvert qu'il était toujours vivant : il fêtera ses cent ans en décembre prochain. Roman en partie autobiographique, mais en partie seulement : on sait que les deux derniers chapitres correspondent en quelque sorte à une vie alternative d'Albert Memmi. Il s'agit d'un Bildungsroman qui suit les étapes d'un jeune Juif tunisois de l'enfance au début de l'âge adulte, après un “séjour” très rude dans un camp de prisonniers, sous le joug nazi. Memmi décrit très bien comment les Juifs d'Afrique du nord, considérés comme des citoyens de seconde zone avant et pendant la guerre, se sentent toujours aussi délaissés, tant par les FFL que par le nouveau gouvernement. Là où le roman se distingue notamment de la vie de Memmi, c'est qu'il s'agit d'un Künstlerroman déceptif : comment Alexandre Mordekhaï Benillouche n'est pas devenu écrivain. Le roman commence d'ailleurs d'une manière qui m'a rappelé le film de Perec Un homme qui dort, vu récemment.

[On a side note, lire ce roman a été l'occasion de découvrir une scène des Évangiles qui m'avait échappé, la guérison de l'Hémorroïque.]
♣♣♣♣♣♣♣
 Soir : Chat noir, chat blanc de Kusturica. Nous avions vu ce film, C* et moi, lors de sa sortie, en 1998, à Beauvais, avec une amie de l'époque, Béatrice, perdue de vue avant même que nous ne quittions la Picardie : elle s'était enfoncée dans la dépression, certainement, et avait glissé sans contrecoup possible dans les abonnées absentes. Il y a quelques mois, nous avons revu aussi avec les garçons Le Temps des gitans. La vie est un miracle, que je n'ai jamais vu, nous attend aussi. Chat noir, chat blanc est conforme à mon souvenir : brillant, drôle, emporté, véhément, avec bien entendu ces scènes anthologiques rythmées par des orchestres dans les postures les plus inimaginables. La grande scène du début chez Grga et la scène du convoi ferroviaire (avec le chef de gare pendu à une barrière levée) sont des hommages appuyés mais très réussis à Sergio Leone. Je n'avais pas de réel souvenir des entourloupes mafieuses qui rythment le film, ni du fait que les deux chats du titre sont aussi ceux qui, en folâtrant, ressuscitent les deux vieux. La résurrection et la joie macabre sont deux motifs essentiels du cinéma de Kusturica. La destruction progressive de la maison a un petit côté métafictionnel : regardez, on détruit le décor au fur et à mesure qu'on tourne le film. — Il faudrait revoir Underground aussi ; j'avais beaucoup aimé ce film et n'avais pas trop compris, à l'époque, pourquoi le film était accusé de défendre évidemment le nettoyage ethnique de Milosevic et sa bande...
Soir : Chat noir, chat blanc de Kusturica. Nous avions vu ce film, C* et moi, lors de sa sortie, en 1998, à Beauvais, avec une amie de l'époque, Béatrice, perdue de vue avant même que nous ne quittions la Picardie : elle s'était enfoncée dans la dépression, certainement, et avait glissé sans contrecoup possible dans les abonnées absentes. Il y a quelques mois, nous avons revu aussi avec les garçons Le Temps des gitans. La vie est un miracle, que je n'ai jamais vu, nous attend aussi. Chat noir, chat blanc est conforme à mon souvenir : brillant, drôle, emporté, véhément, avec bien entendu ces scènes anthologiques rythmées par des orchestres dans les postures les plus inimaginables. La grande scène du début chez Grga et la scène du convoi ferroviaire (avec le chef de gare pendu à une barrière levée) sont des hommages appuyés mais très réussis à Sergio Leone. Je n'avais pas de réel souvenir des entourloupes mafieuses qui rythment le film, ni du fait que les deux chats du titre sont aussi ceux qui, en folâtrant, ressuscitent les deux vieux. La résurrection et la joie macabre sont deux motifs essentiels du cinéma de Kusturica. La destruction progressive de la maison a un petit côté métafictionnel : regardez, on détruit le décor au fur et à mesure qu'on tourne le film. — Il faudrait revoir Underground aussi ; j'avais beaucoup aimé ce film et n'avais pas trop compris, à l'époque, pourquoi le film était accusé de défendre évidemment le nettoyage ethnique de Milosevic et sa bande...
 Sinon, j'ai visualisé le rayon de 100 kilomètres autour de notre domicile, afin de voir quelles petites virées (avec pique-nique et masques) nous pouvions envisager : outre le Bioparc de Doué (mais quand les oryctéropes seront visibles, dixit le spécialiste), les châteaux vont commencer à rouvrir leurs portes, sans parler des villages des bords de Loire. Pour les grandes villes, nous avons été amusés de voir qu'Angers et Poitiers — très belles et captivantes — étaient tout juste dans le cercle, de même que Le Mans, alors qu'Orléans — cette cité grisâtre et médiocre — était hors de portée, à quelques kilomètres près.
Sinon, j'ai visualisé le rayon de 100 kilomètres autour de notre domicile, afin de voir quelles petites virées (avec pique-nique et masques) nous pouvions envisager : outre le Bioparc de Doué (mais quand les oryctéropes seront visibles, dixit le spécialiste), les châteaux vont commencer à rouvrir leurs portes, sans parler des villages des bords de Loire. Pour les grandes villes, nous avons été amusés de voir qu'Angers et Poitiers — très belles et captivantes — étaient tout juste dans le cercle, de même que Le Mans, alors qu'Orléans — cette cité grisâtre et médiocre — était hors de portée, à quelques kilomètres près.
23:30 Publié dans *2020*, Blême mêmoire, Lect(o)ures, Tographe | Lien permanent | Commentaires (2)
mardi, 05 mai 2020
Ça travaille (au ciboulot)
Ce matin, le cours d'agrégation sur Gordimer s'est bien passé : c'était une étudiante/collègue qui se chargeait du commentaire de texte. Afin de permettre davantage d'interaction qu'avec Youtube, j'avais créé un “salon” avec Jitsi. J'ai donc pu voir — ce qui change tout — les collègues, dont le seul garçon, qui a eu l'air de s'emmerder tout du long des 2 h 30...
D'ailleurs, j'ai tenté de faire un live streaming de la visioconférence sur YouTube, mais il a dû y avoir un bug car seules les 90 premières minutes ont été enregistrées / archivées. Heureusement que j'avais fait un document avec mes suggestions de plan et d'analyses pour les absentes.
Pour préparer ce texte, je me suis replongé dans De Chirico, et surtout dans The Enigma of Arrival : une envie folle de relire ce livre. Si je me mets à vouloir relire, je ne suis pas sorti de l'auberge... Pendant ce confinement, toutefois, le “placard des livres en souffrance” se vide un peu, mais pas le “confiturier”.
Soirée : The Big Lebowski, vu au cinéma à sa sortie. Même impression qu'il y a 20 ans et quelque : film distrayant, bien joué, mais trop long, pas très bien ficelé, répétitif, trop “second degré”. En fait, ni C* ni moi ne nous rappelions l'intrigue, plutôt l'ambiance seulement. Mention spéciale pour le numéro hallucinant de John Turturro au bowling.
22:27 Publié dans *2020*, Lect(o)ures, Tographe, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 01 mai 2020
Pour ne pas en finir avec les nombres premiers
Hier soir, nous avons regardé un film canadien, Pauvre Georges ! de Claire Devers — pas mal, plutôt allusif malgré quelques lourdeurs de mise en scène — pas du genre à casser des briques. Je me disais ce matin, en y repensant, que c'est exactement le genre d'histoire qui peut donner tout et son contraire, d'un point de vue littéraire : par exemple, la même histoire, peu ou prou, racontée par Nuruddin Farah, d'un côté, et par cette baderne nullissime d'Eric-Emmanuel Schmitt de l'autre.
Consulté, pour l'avoir vue sur Facebook, la liste des 100 livres les plus importants du 21e siècle compulsée par le Guardian. Il s'agit d'un article de 2019 qui a resurgi, je ne sais pourquoi. Comme d'habitude avec ce genre de liste, je fais le décompte des livres traduits, donc histoire de voir ce qui, pour le monde anglophone, représente le monde : 84 livres sur 100 ont été écrits en anglais par des anglophones, pour l'immense majorité d'entre eux/elles britanniques ou nord-américain·es.
Toutefois, j'ai aussi essayé de repérer combien de livres j'avais lu. 14, comme suit, avec mes conseils au collègue avec qui j'ai échangé à ce sujet sur Facebook :
99/ Verre cassé de Mabanckou (aucun intérêt – AM n'a écrit qu'un seul bon livre, Lumières de Pointe-Noire)
95/ les Chroniques de Bob Dylan, intérêt trèèès relatif
75/ Tokarczuk, j'en ai lu plein mais pas celui-là je crois (pb du titre en anglais ?) – je conseille très hautement Les Pérégrins
69/ idem Javier Marias, pas sûr au vu du titre — bien aimé la trilogie Ton visage demain, qui même oxbridgisme et espionnage pendant la Guerre froide
47/ Persepolis, ok
46/ Human Chain, je ne connaissais pas l'existence de ce recueil de Heaney / à suivre
41/ Atonement, un McEwan très dispensable (moins mauvais qu'Amsterdam quand même) — à mon avis, il faut lire deux livres de McEwan: The Cement Garden et Black Dogs, point barre
33/ Fun Home, ok
29/ La mort du père et la suite de l'hexalogie de Knausgaard (j'en suis au tome 3), pas mal mais ça faiblit - le premier est vraiment très dérangeant et fort du coup
21/ Sapiens, m'a pas mal énervé, j'en ai parlé dans une vidéo
17/ The Road, ok
16/ Franzen, c'est comme Foster Wallace, pu finir aucun de ses livres, zzzzzzzzzzzzzzzz
12/ The Plot Against America, pas le meilleur Roth mais bien (je pensais qu'il était plus ancien que ça en revanche)
10/ Adichie, oui, il faut la lire [et plutôt Half of a Yellow Sun qu'Americanah, pour commencer, en effet]
Il faudrait que je compile ma propre liste des livres publiés entre 2001 et 2020 dont je considère que les gens que je connais gagneraient à les lire, ou à les avoir lus. Il n'y en aura pas cent : un nombre premier, peut-être...?
10:01 Publié dans *2020*, Chèvre, aucun risque, Lect(o)ures, Tographe | Lien permanent | Commentaires (4)
jeudi, 30 avril 2020
Bureaux, billards, palindromes
Depuis hier matin, il tombe, par moments, des trombes d'eau. Je plains, malgré l'épais feuillage du néflier qui les protège, les tourterelles, et les autres oiseaux (une nichée de mésanges charbonnières, peut-être, du côté du prunus qui fait face à la haie, dans le lierre touffu ?).
Le 30 avril, j'aurai donc réussi à écrire un billet chaque jour depuis le début de l'année. Des repères. Il y a trois jours, toutefois, j'ai manqué l'occasion de signaler le 4664e billet, pas seulement pour l'amour des palindromes mais parce que ce nombre était le numéro de dossier de mon fils aîné chez l'orthodontiste.
Hier soir, épisodes 7 et 8 de la saison 5 du Bureau des légendes. La série traîne en longueur, tire sur tous les fils déjà abondamment pris et repris lors des saisons précédentes, sans réel renouvellement. Il aurait fallu un peu de courage, une déstabilisation narrative, comme, par exemple, reprendre tout depuis le point de vue d'un seul personnage secondaire (l'informaticien ou le spécialiste de la zone Moyen-Orient, par exemple). Changer de mode narratif, ou de système formel, que sais-je. Là, on s'emmerde gentiment ; ça ronronne.
Depuis deux jours, un jeu littéraire fleurit sur Twitter, avec le hashtag #UnLivreUnePlace.
Le temps se rafraîchit, ce qui est presque habituel pour le tournant d'avril-mai. — Plus personne ne comprend rien aux annonces du gouvernement ou du Ministère de l'Education nationale, mais on a l'impression que plus personne ne cherche à comprendre, qu'on s'habitue à couler à moitié dans un navire au gouvernail arraché, au capitaine absent.
Essayé de comprendre les règles détaillées du jeu de la 8 au billard américain ; je me demande si passer l'agrégation de philosophie n'est pas plus compliqué.
07:50 Publié dans *2020*, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 29 mars 2020
La lecture & le viol
La grasse matinée d'hier (réveillé à 6 h 50, levé à 8 h) n'est qu'un souvenir, d'autant plus que le changement d'heure a eu lieu cette nuit et qu'il est “en fait” 5 h.
Lu ce matin le mail d'une collègue sur la messagerie des anglicistes de l'enseignement supérieur :
The generation gap between me and my students increases every year!! Today they asked me for recommendations about novels. I tried to think of novels that might really grab them. These are students for whom under normal circumstances reading a novel is something you do under duress when you are obliged to by a teacher. Et encore.
Of more recently published novels, I thought Solar Bones by Mike McCormack was just amazing, and that On Earth We're Briefly Gorgeous by Ocean Vuong is now the best American novel (!!). I still think that Dermot Healy's A Goat Song is brilliant. But that's me. I don't know if they would really grab these Millenials. Could anyone recommend novels in English that might really hook very-reluctant-reader Millenials? I kind of feel that the stakes are high because if I could find some novels that they could read on their own with genuine pleasure (and not as a chore) it might turn things around (for some of them). And they could move on from there. I hope this makes sense.
Je lui ai répondu ceci :
I didn't know that Vuong, whose poetry collection I've loved, had written a novel.
Si je n'en étais pas “rendu” à devoir donner un gros coup de collier en avril pour mes deux cours d'agrégation, et à devoir désormais pondre à peu près un quadrilatère par jour si je veux avoir fini d'ici l'été le projet Scarlatti, je me relancerais bien dans un défi quotidien de vidéo ou de traduction.
Dans le mail de la collègue, j'aime bien l'emploi des verbes grab (séduire ?) et hook (harponner ?). De la lecture comme viol(ence), aussi...
06:23 Publié dans *2020*, Ecrit(o)ures, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 10 mars 2020
*1003*
Parmi les très nombreuses choses que je devais organiser pour avril et même pour plus tard, et dont j'ignore si elles pourront avoir lieu, il y a la rencontre avec Corinna Gepner, que j'ai commencé à préparer avec les étudiant-es d'échange mais aussi avec les étudiant-es de M1. Quel dommage de ne pouvoir réellement lancer cela.
Déjà, le 29 janvier dernier, mais pour d'autres raisons (à l'époque, c'était la fermeture du site Tanneurs, pas la crise sanitaire du Covid19), j'ai dû annuler la rencontre avec l'éditeur Benoît Verhille et la directrice de collection Anna Rizzello.
Il y a aussi le tour de France de l'écrivain Charles Yu, vers juin. Je ne vois plus très bien comment articuler cela avec l'année universitaire, qui risque d'être très perturbée. De manière inimaginable, même.
08:19 Publié dans *2020*, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 04 mars 2020
Caloniz Herminia, Cristina
Fini de lire, ce soir dans la salle d'attente du conservatoire, un livre aussi ébouriffant qu'éblouissant, dont je reparlerai prochainement en vidéo, Cristina de Caloniz Herminia, publié aux éditions du Réalgar.
En quatre parties, de 12, 14, 13 et 11 pages respectivement le texte suit les méandres d'une figure / personnalité / personnage / femme de sa “petite enfance” à sa “jeunesse”. Ce poème en prose, ni narratif ni lyrique au sens strict, réussit donc à retravailler le matériau du Bildungsroman d'une façon radicalement singulière.
Très entre autres, il y a, dans ce livre, une attention aux plantes, notamment aux arbres, qui passe certes par le langage (je veux dire : qui est avant tout expressive), mais qui est puissamment évocatrice. Et puis, ce n'est pas si souvent que je lis un livre qui évoque nèfles et néfliers !
*** Brève recension par J.-P. Gavard-Perret ***
* Analyse approfondie de Lionel-Édouard Martin *
20:24 Publié dans *2020*, Chèvre, aucun risque, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 12 février 2020
La renarde et le texte sans boussole
Réveillé à 4 h 20. Levé, car plutôt en forme. Et je me connais : je ne me rendormirai pas.
J'ai écrit hier et avant-hier, dans le projet Scarlatti, une série de textes évoquant la vision subite et fugace du renard (ou de la renarde), jeudi dernier, et, voulant en parler ici aussi, on verra pourquoi, je m'aperçois que je n'en ai pas dit un mot à l'entrée de journal de jeudi dernier. Le mieux est donc que je renvoie au texte n° 93 du projet Scarlatti : de proche en proche, en cliquant sur le 94, puis le 95 etc., vous pourrez lire ce que j'ai eu à en dire, pour le moment. (J'ai quelque crainte, finalement, que ce renard ne vienne faire dériver trop fortement le projet, et d'autre part : le souci de faire trop dériver cette vision elle-même, de trop m'approprier ce moment.)
On verra pourquoi, disais-je. Voici donc.
Hier, j'ai commencé à lire le dernier Savitzkaya : il s'y trouve un couple animal étrange, formé d'un héron et d'une renarde. (Réminiscence de La Fontaine, oui, mais, qui sait, de contes russes... et de Pinget* ?) -- Ce matin, attendant que se relance mon ordinateur de bureau après un de ses désormais banals plantages matinaux, j'ai commencé de lire Eux sur la photo de Hélène Gestern : à la page 28 est évoquée une inscription en alphabet cyrillique dont la traduction serait : "Pour mon renard" (ou "ma renarde").
J'en conclus que le lexème russe pour renard est invariable, ou qu'il n'y a pas de féminin... mais surtout, quelle est cette soudaine irruption, j'allais écrire insurrection, de cet animal dans ma vue vie ? J'en appelle à mes ami-es russisant-es : des conseils bibliographiques au sujet du renard dans la littérature populaire russe ?
* Oui, oui... ce Projet-là, il va falloir le remettre sur le métier.
05:20 Publié dans *2020*, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures, PROJET ▓ PINGET | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 07 février 2020
*0702*
Il y a, à la B.U. de Droit du site Portalis, un petit mètre linéaire (et encore) pour les ouvrages cotés en 800 dans la classification Dewey : une vingtaine d'ouvrages pour la rubrique "Littérature". C'est normal, on est dans une bibliothèque de droit. Pour avoir des dizaines de milliers de livres de littérature, se rendre à la B.U. des Tanneurs.
Ce qui m'amuse, c'est le type d'ouvrages : presque uniquement des livres sur la rhétorique, ou sur la littérature comme art du discours, culture générale.
Ce mètre linéaire résume ce qu'est la littérature selon Blanquer, Philippe et Macron : l'art de la superficialité, de l'embobinage.
Soit le contraire de ce qu'est la littérature, évidemment.
14:24 Publié dans *2020*, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (1)
mardi, 07 janvier 2020
*0701*
Cinquième anniversaire des assassinats à Charlie Hebdo.
J'aurais pu prendre mille fois le temps d'écrire ici plus tôt. Après une nuit horrible (tenu éveillé par des douleurs abdominales puis gastriques avant d'être soulagé par deux Spasfon), journée vasouillarde, avec courbatures et vague-à-l'âme s'arc-boutant sur les flottements du corps*, mais j'aurai quand même corrigé 15 copies de L2 et 20 copies de L3. Ça ne va jamais assez vite, mais bon.
C* a réemprunté au lycée l'édition dans laquelle elle avait lu Martin Eden car je me suis demandé s'il s'agissait d'une traduction intégrale. Il s'agit de la traduction de Claude Cendrée, sans date, et donc reprise en collection Bouquins il y a trente ans. À première vue, rien d'évident, si ce n'est que 270 pages en “Bouquins” contre quasi 500 en Penguin Classics, ça me paraît étrange. Le texte est annoncé comme intégral, ce qui, au vu des pratiques éditoriales sur les textes étrangers jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ne veut pas dire grand chose. Je vois que Folio a confié la retraduction du roman à Jaworski : j'emprunterai celle-là à la B.U. et je comparerai avec quelques coups de sonde.
Cela pourra d'ailleurs me fournir un support de cours pour le cours de traductologie du second semestre.
* J'essaie de faire mon Juliet ou mon Bergounioux, to no avail.
21:27 Publié dans *2020*, Lect(o)ures, Translatology Snippets, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 03 janvier 2020
Pour évoquer Martin Eden
Vers minuit j'ai fini de lire Martin Eden.
C'est un roman important, très beau ; rien d'étonnant, avec la complexité d'un tel personnage, qu'hypothèses et malentendus se soient multipliés. Idéologiquement, déjà, Martin Eden est difficilement situable : c'est un individualiste, certes, mais penche-t-il du côté libertaire ou du côté d'une forme de culte de soi-même qui préfigure le culte du chef fasciste ? Est-ce vraiment le côté que l'on retient le plus souvent de Herbert Spencer (survival of the fittest) qui l'a le plus marqué ? on ne dirait pas... Et puis surtout : un individualiste qui se prétend réaliste pour son oeuvre littéraire ne se sentirait pas ainsi vidé de l'intérieur car le succès l'a dédoublé et aliéné à lui-même. Une fois reconnu et couvert de gloire, rejette-t-il la société par amertume et misanthropie, ou parce que la rupture de ses fiançailles, intervenue quand il crevait la misère, a rompu son grand amour ? En cela, Martin Eden se situe tout autant dans la lignée des grands héros romantiques comme Chatterton, ou des chercheurs d'absolu monomaniaques (Achab ?) ; cela explique, à mon avis, les passions que suscite le personnage. C'est, en un sens, à la fois un roman d'apprentissage et un roman de déprise, à la fois un roman naturaliste qui s'inscrit dans les conventions narratives du 19e siècle et un roman moderniste comme en écrivirent Ford Madox Ford ou Faulkner.
Pour moi, l'essentiel n'est pas dans ce personnage, ni dans une éventuelle discussion féministe ou LGBT (nécessaire et passionnante, pourtant) du roman. L'essentiel est dans la découverte de l'écriture de London, qui est à des années-lumière de ce que j'imaginais par une simple réputation. Les discussions philosophiques qui émaillent le roman, et qui témoignent probablement de l'influence de Dostoïevski, sont ce qu'il y a de moins réussi, mais sinon l'intertextualité est très riche, l'articulation de niveaux de langue extrêmement différents est une réussite totale, et la façon dont London entremêle les références poétiques et l'influence de prosateurs essentiels du 19e siècle (Poe, Kipling, Stevenson, Balzac) donne une réelle profondeur à l'intrigue. Du point de vue du lexique comme de la syntaxe et du rythme narratif, London multiplie les variations. Le seul regret est que le roman soit aussi long, plutôt inutilement : de nombreuses scènes sont triplées, quadruplées, et, quoiqu'on comprenne que ces répétitions ont pour fonction de montrer la difficulté des galères autant que la diversité des expériences du protagoniste, elles s'essoufflent parfois et allongent le récit.
Je n'ai encore lu aucun article de critique ou d'analyse du roman, mais ce qui m'a frappé dès les premières pages est la manière dont London semble insister sur le fait que Martin Eden est capable de visualiser avec une très grande acuité un certain nombre de scènes du passé ou d'un présent alternatif tout en continuant d'échanger avec son entourage comme si de rien n'était. S'agit-il d'hyperesthésie visuelle ? Est-ce là une clé pour comprendre ce que London apporte au genre du Künstlerroman ?
07:39 Publié dans *2020*, Ecrit(o)ures, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 02 janvier 2020
*0201*
Aujourd'hui je dois au moins écluser le second paquet de copies de traduction, finir de corriger les travaux de traductologie déposés par mes L3 sous CELENE. Idéalement, je devrais aussi commencer à taper dans les copies de littérature, mais là, je me connais : si j'ai fait le reste, je serai trop las, et surtout trop content d'avoir un prétexte de ne rien foutre, donc je ne ferai plus rien.
Aussi, je voudrais achever de lire Martin Eden, commencé le 26 décembre. Je traîne sur ce roman, mais aussi, il infuse. J'en ai publié plusieurs extraits sur Twitter au fur et à mesure de ma lecture.
Curieux, ce livre dont je n'avais jamais même entendu parler il y a, quoi, deux ou trois ans, n'a cessé d'apparaître partout : sur les réseaux sociaux, dans l'essai sur les transclasses qu'a lu C* récemment, dans Désherbage de Sophie G. Lucas. Cette lecture me conduit à réviser mon jugement, vague et lointain, ill-informed, au sujet de Jack London : ce n'était pas seulement l'auteur des aventures sauvages, "ce qu'on lit quand on est enfant" selon le vers de Manset.
La B.U. possède, je crois, les volumes de la Library of America contenant l'essentiel de l'oeuvre (prolifique) de London. À creuser.
09:43 Publié dans *2020*, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 30 août 2019
#JeLaLis : Lady Lisle, Braddon et les béances du Web
En 2018, pendant une poignée de semaines, j'ai entrepris de traduire sur Twitter, demi-phrase par demi-phrase, un roman choisi au hasard, ou presque au hasard, sur la seule foi de sa date de publication (1868, soit 150 ans plus tôt) et de son autrice, que je connaissais de nom mais dont je n'avais encore jamais rien lu.
Ce roman, c'était Dead-Sea Fruit de Mary Elizabeth Braddon.
Je n'ai évidemment traduit que quelques chapitres, tout laissé en plan, et même pas fini de lire le livre (car c'était l'idée : traduire comme on lit, en découvrant le texte). Une des raisons de cet abandon, outre mon effroyable caractère velléitaire et butineur, fut la découverte d'une traduction du roman, d'époque.
En juillet dernier, chez un bouquiniste breton, j'ai trouvé l'édition (qui semble être l'édition originale) d'un autre roman d'Elizabeth Braddon, Lady Lisle. J'en ai commencé la lecture il y a deux jours et en parlerai, à ma façon maladroite et confuse, dans une prochaine vidéo de la série je range mon bureau. Curieusement, ce livre ne figure pas dans la liste, pourtant impressionnante, des romans de Braddon répertoriés par Wikipedia.
J'ai eu beau chercher (allez, trois minutes), je n'en trouve pas la date de première publication. En revanche, Lady Lisle a fait l'objet de deux traductions françaises : une peu après sa sortie, probablement, en 1863 (pensez, Braddon n'avait que 28 ans...), due à Charles-Bernard Derosne et réimprimée par Hachette en 2018, et une récente, de 2001, de Madeleine Jodel. Cette traduction a l'air d'ailleurs tout à fait bâclée et mauvaise, si l'on en croit les avis sur Babelio.
Ce qu'il faudrait, c'est que je dégotte un roman de Braddon jamais traduit (ici ?) et que je m'y mette pour de bon. Pour cela, il faudrait que je m'épluche les résultats donnés par le SUDOC, en espérant qu'ils soient (sont ?) exhaustifs.
À première vue, si je souhaite renouveler l'expérience sur Twitter pour le cent-cinquantième anniversaire (quel dommage que le français n'ait pas d'équivalent au beau mot anglais sesquicentennial) d'un livre, je devrais pouvoir me (re)faire la main avec Fenton's Quest (1871), qui ne semble pas avoir été traduit en français.
08:29 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures, Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 23 juin 2019
Mahulem
08:40 Publié dans Comme dirait le duc d'Elbeuf, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 16 juin 2019
Lecteur que je suis
Dans le nouveau livre d'Ali Zamir, Dérangé que je suis, j'ai pu découvrir, entre autres, le nom “vénéfice”, le verbe “chabler” (dans son sens nautique), ainsi que l'expression libertine “la petite oie”.
09:05 Publié dans Affres extatiques, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 14 juin 2019
Lémurie & Malcolm de Chazal
J'achète et lis très irrégulièrement la revue Europe... trop irrégulièrement d'ailleurs, car c'est toujours un enchantement... et je m'aperçois que je l'achète souvent quand le dossier principal est consacré, non à un écrivain que je connais bien, mais à un écrivain que je connais très mal et autour duquel je tournicote depuis pas mal d'années...
Aujourd'hui où il faudrait que j'enregistre enfin la vidéo sur le n° 2 des Lettres de Lémurie et le nouveau très beau roman de Johary Ravaloson, je m'attaque à ce cahier coordonné par Alexander Dickow et qui semble d'une sacrée tenue. Avec un dodo en couverture, comme pour et par les éditions Dodo vole.
Cet été, c'est décidé : je lirai, par et pour moi-même, Malcolm de Chazal.
11:11 Publié dans Affres extatiques, Lect(o)ures, Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 04 avril 2019
L’aide à l’emploi, ou la littérature à l’intestin
Ainsi, je recommande vivement la lecture de ce livre, qui est à la fois fiction et essai de sociologie-paranoïaque-critique. Ce texte en dit plus long sur la situation sociale, politique et économique de la France que pas mal d’essais ou de romans dont on nous rebat les oreilles.
(Vous venez de lire le dernier paragraphe de cette recension. ( Si je le dis, c’est ainsi, wink Rauschenberg.) Ce dernier paragraphe a été écrit par un lapin rouge en résine.)
Si je le dis, c’est ainsi, wink Rauschenberg.) Ce dernier paragraphe a été écrit par un lapin rouge en résine.)
Pierre Barrault publie donc, aux irremplaçables éditions Louise Bottu, son troisième livre. Le protagoniste, Artalbur, est aux prises avec une ville dans laquelle il lui est difficile de se déplacer sereinement, et surtout avec l’Injonction sociale, représentée par son conseiller à l’emploi, Dolenesque.
Interruption n° 1. Dois-je avouer que j’ai failli ne jamais écrire de recension du livre pour la simple raison que je ne parvenais pas à trouver l’anagramme tapie sous ce nom de Dolenesque ? Artalbur, c’est Barrault en chaos ; Cron, c’est Macron passé par l’aphérèse ; Pitre-Garatez l’industriel fabricant de lapins, c’est Pierre Gattaz chamboulé – mais Dolenesque ? not a clue. 
Le livre commence par quatre débuts, ce qui est assez banal, somme toute. Pour son prochain opus, on attend de Pierre Barrault qu’il commence par le milieu.
Interruption n° 2. Qu’il le sache, et qu’il se tienne à barreaux.
Interruption n° 2bis. Ce calembour est affligeant. On ne s’y reprendra plus.
Dans ces quatre débuts, Artalbur narrateur monte à bord de quatre bus différents et se trouve confronté à des situations qui vont du loufoque au cauchemardesque : le bus transformé en abattoir à passagers (p. 11 et 12), comme seuil du récit, suggère au lecteur une assez sombre entrée en matière. La ville où se déroule l’action chaotique du récit est toute de telles « surprises », par exemple un manège de fête foraine rongé par la rouille et dont tous les passagers, après examen, s’avèrent être morts (p. 53).
Ces quatre débuts servent donc d’accroche ou de point d’entrée dans le texte : Artalbur est une figure d’errant appelé sans cesse à des déambulations et des périples inquiétants, où il n’est pas maître des événements. Le livre se structure ensuite autour de 20 chapitres, composés à chaque fois d’un diptyque : le chapitre commence par une « aide à l’emploi », qui est soit parodie (n° 7 ou 9) soit pastiche (n° 4 ou 16) de notice d’utilisation, d’une page, puis se poursuit par un récit de longueur très variable (de 1 à 37 pages) et dont le titre reprend l’objet de référence de la notice (par exemple : Aide à l’emploi n° 17 – Lampe torche / Où il est question d’une lampe torche). Le récit second, dans lequel le mot-clef du titre est mis en évidence en gras, ne reprend pas à proprement parler le récit du chapitre précédent. L’aide à l’emploi se caractérise d’ailleurs par ce refus de trancher entre linéarité et discontinuité.
Cette structure fonctionne donc, pour le lecteur, comme un fil d’Ariane, au sens où ce fil a servi de structure d’écriture à l’auteur, ou comme une marelle sur laquelle on doit se déplacer en suivant les cases dans l’ordre.  Si c’est une marelle, elle suppose qu’en son centre le lecteur fasse demi-tour et revienne sur ses pas : faudra-t-il relire L’aide à l’emploi à l’envers, à rebours ? Ou le demi-tour, le ciel de la marelle, est-il inscrit quelque part au sein du livre ?
Si c’est une marelle, elle suppose qu’en son centre le lecteur fasse demi-tour et revienne sur ses pas : faudra-t-il relire L’aide à l’emploi à l’envers, à rebours ? Ou le demi-tour, le ciel de la marelle, est-il inscrit quelque part au sein du livre ?
Interruption n° 3. Et si c’était ainsi que le livre, en fait, commence par le milieu ? Les quatre débuts sont quatre versions du ciel de la marelle.
Comme dans ses précédents livres, Pierre Barrault glisse régulièrement des allusions à Henri Michaux (p. 85 et p. 88). On pense aussi à Tex Avery (p. 72).
Artalbur n’est pas toujours narrateur. Certains chapitres du livre le narrent à la troisième personne. Même dans les passages, très majoritaires, à la première personne, sa dualité est frappante, dans la mesure où il est toujours capable d’analyser sa situation de l’extérieur, comme dans le cas de ses nombreuses désorientations ou métamorphoses : « Il est étrange que je ne connaisse pas cette partie de la ville. » (p. 110).
Interruption n° 4. [C’est bien que celle-ci soit la quatrième, car il semble que, dans la structure du livre, le chiffre 4 compte beaucoup.] Il n’y a pas longtemps, Pierre Barrault m’a appris qu’il avait été durablement marqué par la traduction de Tutuola par Queneau, L’ivrogne dans la brousse. Ce n’est pas le lieu, ici, de refaire un cours sur Tutuola ni sur l’histoire de cette traduction, mais en tout cas ce lien, que je n’avais pas vu après Tardigrade et Clonck, me paraît maintenant être une grille de lecture indispensable de L’Aide à l’emploi. Le passage du chapitre 8 dans lequel Dolenesque propose à Artalbur un emploi dans « une prestigieuse société de fabrication de statuettes à trois yeux » dont « tous les employés ont aussi trois yeux » (p. 52), ce qui implique que tout employé subisse « une opération chirurgicale aux frais de l’entreprise » (p. 53) convoque évidemment divers mythèmes qui n’ont rien de spécifiquement yorouba. Non. Ce qui est frappant, et ce qui évoque très profondément les récits de Tutuola (peut-être plus encore les derniers (que Barrault pourtant n’a pas lus)), c’est l’enchaînement sans logique ni transition narrative entre ces différents accidents narratifs à consonance fantasmagorique/mythématique.
On l’a dit plus haut, les chapitres sont de longueur inégale. Très inégale.  Or, un des faits récurrents du récit est la conviction qu’Artalbur « a l’intestin trop long » ; l’image même de l’intestin, avec ses replis et ses bourrelets, est celle de l’organe démesuré qui, déplié, serait beaucoup plus long que le corps qui le contient ; le double concept élongation/ raccourcissement, fondamental en rhétorique, et ce depuis Aristote, ne doit pas être négligé.
Or, un des faits récurrents du récit est la conviction qu’Artalbur « a l’intestin trop long » ; l’image même de l’intestin, avec ses replis et ses bourrelets, est celle de l’organe démesuré qui, déplié, serait beaucoup plus long que le corps qui le contient ; le double concept élongation/ raccourcissement, fondamental en rhétorique, et ce depuis Aristote, ne doit pas être négligé.
Quels sont donc les bourrelets que le récit déplie ? Eh bien, sur 4 débuts + 20 notices/récits, les chapitres 8 et 18 occupent, à eux seuls, 60 pages d’un texte qui en compte 146. Ils constituent les moments d’allongement du récit. Dans ces chapitres élongés, le récit lorgne et louvoie du côté des récits d’espionnage, avec les agents doubles (le médecin) ou la cavale. Comme dans les films de David Lynch, que l’écriture de Pierre Barrault m’évoque décidément de plus en plus, ces moments d’allongement sont suivis de moments de précipitation. Un des passages où le récit se précipite, au sens chimique en quelque sorte, se trouve dans le chapitre 19, quasiment à la fin. Il s’agit des pages 148-9.
Interruption n° 5. Je ne les citerai pas. Achetez le livre.
Dans ce long passage entièrement composé de phrases brèves anaphoriques (‘je suis… je fais… je fais…’), les actions et événements semblent sans suite, comme si le montage des événements du récit avait dérapé. On imagine assez aisément le montage de cette double page au cinéma : reprendre des plans vus précédemment, sur 2 ou 3 secondes au maximum à chaque fois, et les monter ensemble sans continuité. D’ailleurs, il n’est pas question d’adapter : ce texte est déjà, entièrement, du cinéma. Après tout, on a quand même le droit d’exiger, en 2019, de lire des livres qui soient pleinement textuels et autre chose que des textes.
09:46 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 27 janvier 2019
Élagages, plongée sous-marine, pendaison
Ce matin, en lisant très lentement — avec une lenteur inhabituelle, pesant presque chaque mot — un poème de Drysalter, “The Count”, je suis parvenu à la dernière strophe, qui m'a aussitôt évoqué un livre lu récemment. Il m'a fallu peut-être trente secondes, qui ont semblé une éternité, pour en retrouver l'auteur, l'intrigue, le ton. Malamud. Puis le titre : God's Grace. Pas retrouvé sur mes étagères : l'ai-je prêté à ma mère ou l'ai-je mal rangé ? Si mon ordinateur avait été allumé, j'aurais pu retrouver la vidéo dans laquelle j'en ai parlé.
Ces vidéos sont bien pratiques, qui me servent de carnet de notes ; il faudrait toutefois que je songe à élaborer un index alphabétique des auteurs, voire des thèmes ou des pays.
Avant ce poème, lu d'une traite, sans m'attarder, le petit livre de Denis Montebello, Comment écrire un livre qui fait du bien, offert par François Bon après tirage au sort d'un de ses services de presse. Dans ce livre, Montebello extrapole autour des élagages, parti de l'idée d'intituler son “feelgood novel” C'est le deuxième copain qui se pend à un arbre que j'ai élagué. Or, après la lecture de trois poèmes de Drysalter (les deux suivants plus prestement), j'ai commencé à lire La bouche pleine de terre de Branimir Šćepanović, que viennent de republier les éditions Tusitala : dès les premières pages, il y est question d'un homme qui cherche à se suicider en se pendant à un arbre.
Il faut que je commence à écrire mon nouveau livre (qui s'intitulera(it) économe).
10:08 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 11 janvier 2019
je range mon bureau ░ 033
14:24 Publié dans Autoportraiture, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (3)
mardi, 20 novembre 2018
James Fenimore Cooper et les caricatures
In a country where the cholera could not escape being caricatured, you will readily imagine that the King has fared no better. The lower part of the face of Louis-Philippe is massive, while his forehead, without being mean, narrows in a way to give the outline a shape not unlike that of a pear. An editor of one of the publications of caricatures being on trial for a libel, in his defence, produced a large pear, in order to illustrate his argument, which ran as follows:—People fancied they saw a resemblance in some one feature of a caricature to a particular thing; this thing, again, might resemble another thing; that thing a third; and thus from one to another, until the face of some distinguished individual might be reached. He put it to the jury whether such forced constructions were safe. "This, gentlemen," he continued, "is a common pear, a fruit well known to all of you. By culling here, and here," using his knife as he spoke, "something like a resemblance to a human face is obtained: by clipping here, again, and shaping there, one gets a face that some may fancy they know; and should I, hereafter, publish an engraving of a pear, why everybody will call it a caricature of a man!" You will understand that, by a dexterous use of the knife, such a general resemblance to the countenance of the King was obtained, that it was instantly recognised. The man was rewarded for his cleverness by an acquittal, and, since that time, by an implied convention, a rude sketch of a pear is understood to allude to the King. The fruit abounds in a manner altogether unusual for the season, and, at this moment, I make little doubt, that some thousands of pears are drawn in chalk, coal, or other substances, on the walls of the capital. During the carnival, masquers appeared as pears, with pears for caps, and carrying pears, and all this with a boldness and point that must go far to convince the King that the extreme license he has affected hitherto to allow, cannot very well accord with his secret intentions to bring France back to a government of coercion. The discrepancies that necessarily exist in the present system will, sooner or later, destroy it.
Little can be said in favour of caricatures. They address themselves to a faculty of the mind that is the farthest removed from reason, and, by consequence, from the right; and it is a prostitution of the term to suppose that they are either cause or effect, as connected with liberty. Such things may certainly have their effect, as means, but every good cause is so much the purer for abstaining from the use of questionable agencies. Au reste, there is really a fatality of feature and expression common to the public men of this country that is a strong provocative to caricature. The revolution and empire appear to have given rise to a state of feeling that has broken out with marked sympathy, in the countenance. The French, as a nation, are far from handsome, though brilliant exceptions exist; and it strikes me that they who appear in public life are just among the ugliest of the whole people.
James Fenimore Cooper. A Residence in France (1836), Letter III.
11:00 Publié dans Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.), WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 26 octobre 2018
Circumnavigations (Pinget)
Comme (comme si) je n'avais pas assez de quoi m'occuper, depuis que je me suis levé à 4 h du matin, avec le corrigé du concours blanc d'agrégation interne, je me suis amusé à chercher sur le SUDOC, et plus globalement ensuite sur Worldcat, quels livres de Pinget sont disponibles en anglais. Sans être allé au bout de la recherche, je pense pouvoir conclure que tout Pinget a été traduit en anglais, principalement chez Red Dust et Dalkey Archive. Beaucoup de textes semblent avoir été traduits depuis sa mort, d'ailleurs ; peut-être, toutefois, est-ce la date de publication qui est trompeuse. Dans les B.U. de France, quatre livres seulement sont disponibles, deux à la Bibliothèque de Versailles-Saint-Quentin, et deux à la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet (dont j'ignorais qu'elle était associée au métacatalogue).
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas dans cette direction-là que va le projet Pinget. Peut-être dans un second temps.
╠╦╩╣
Outre lire quelques pages d'Ornithologie du promeneur vol. 3 (qui me tombe littéralement des mains à chaque tentative), j'ai pris, sur les étagères où elles sont ici consignées, quelques-unes des anthologies dites “scolaires” de textes littéraires que ma mère avait achetées pour ma sœur et moi quand nous étions au lycée. Je ne parle ici que des volumes consacrés aux œuvres du 20e siècle, mais les séries sont complètes, du Moyen-Âge au vingtième. Celle que je nomme « la Magnard » est à Tours (car c'est la seule qui a vraiment compté pour moi et m'a ouvert x horizons), mais il y a ici « le Darcos », le Lagarde & Michard et la Mitterand/Lecherbonnier de chez Nathan.
Ces anthologies sont toujours instructives ; on y piochera un texte auquel on ne songeait pas, comme tout à l'heure je me suis surpris à lire, presque admiratif, un extrait de Malicroix de Bosco ; elles permettent, pour les meilleures d'entre elles, de découvrir des rapprochements qu'on n'avait pas envisagés (mais pour lesquels il faut garder son esprit critique), ainsi de Beckett avec Cioran et Blanchot (oui, je sais, ce n'est pas ébouriffant de nouveauté, mais je n'y avais jamais songé ainsi).
Le Darcos (de très loin le meilleur à l'exclusion de « la Magnard », et dont les auteurs sont Alain Boissinot, Bernard Tartayre et Xavier Darcos, et qui fut publié en 1989 dans la collection Perspectives et confrontations chez Hachette) est le seul à proposer des équilibres qui me paraissent encore pertinents aujourd'hui au regard de l'histoire littéraire. Le Lagarde et Michard, bien sûr, se signale par sa myopie et sa ringardise. Myopie, de consacrer plus de pages au seul Sartre qu'à tout le Nouveau Roman. Ringardise, d'aller égrener des extraits de Déon, Nourissier, Cayrol, Bazin, Ikor, D'Ormesson ou Lainé quand ce même chapitre consacré au Nouveau Roman donne royalement quatre malheureux textes de Butor, Sarraute, Simon et Robbe-Grillet.
Aucune de ces anthologies ne donne de texte de Pinget. Seul le Darcos le cite, mais à titre de note de bas de page (tout comme Claude Ollier, autre écrivain des marges du Nouveau Roman et dont l'œuvre m'est chère, quoique j'en aie une connaissance beaucoup plus fragmentaire) et sans même le rapprocher de Beckett. Le Darcos, au demeurant, donne un long texte du Temps immobile de Claude Mauriac, mais sans doute est-ce sous l'effet du gaullisme mal dissimulé de l'auteur principal (Xavier Darcos n'était pas encore officiellement estampillé RPR en 1989, mais enfin Rome ne s'est pas faite en un jour).
Pas de Pinget, mais son éclatante absence y est intéressante. Le Darcos m'a permis de relire quelques extraits des textes théoriques de Robbe-Grillet et Sarraute (tout cela est à Tours) et de me faire la réflexion déjà ancienne que l'œuvre de Pinget, dont le troisième roman (Le Renard et la boussole) est l'exact contemporain des Gommes, le premier Robbe-Grillet, et du Degré zéro de l'écriture, a souffert de ne pas être explicitement théoricienne, à une époque où journalistes et lecteurs réclamaient, semble-t-il, de l'abstraction, du hors-champ, des propos critiques pour mieux s'expliquer ce que faisaient les textes.
╠╦╩╣
Les réponses théoriques et les apories expérimentales sont, pour Beckett et Pinget, à chercher dans la prose narrative. Butor, Duras, Sarraute et Robbe-Grillet ont compris qu'il fallait (ou ressenti la nécessité d') accompagner leurs textes d'un appareil critique. Pourtant, Butor dit mille fois mieux ce qu'il pratique dans les tomes du Génie du lieu que dans les papiers poussifs de son assommant Répertoire.
08:00 Publié dans Hors Touraine, La Marquise marquée, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 16 octobre 2018
Lancement du projet vidéo autour de Robert Pinget
Dans cette vidéo, j'ai fait deux ou trois choses, et j'en ai dit bien d'autres.
Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'avais l'espoir que ça marche mieux que la très éphémère Retraversée des Rougon-Macquart (projet pas entièrement abandonné au demeurant), parce que, par rapport à mars 2016, je me suis aguerri et je sais de quoi je suis capable/incapable.
Pour ce PROJET ░ PINGET (ainsi est-il sobrement nommé), je ne perdrai pas de temps à faire du montage, et je tournerai les vidéos au fur et à mesure.
Comme je me retiens, dans ce billet ou dans la vidéo ci-dessus, de digresser trop abondamment, il faudra que je consacre sans tarder une vidéo à la façon dont je me suis intéressé à l'œuvre de Pinget, et aux raisons pour lesquelles elle a beaucoup compté pour moi dans mes années de formation.
(J'emploie cette dernière expression avec un brin d'ironie, car je suis convaincu — ou alors : j'espère — qu'on n'a jamais fini de se former, et notamment en créant, par les blogs et les vlogs, des espaces d'échange et de construction du sens.)
12:11 Publié dans Improviser traduire, Lect(o)ures, PROJET ▓ PINGET | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 03 octobre 2018
Toujours walcott
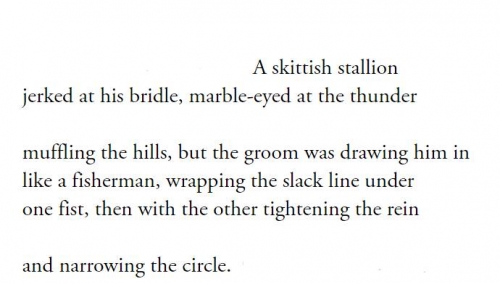
08:20 Publié dans Lect(o)ures, Où sont passées les lumières? | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 13 septembre 2018
Albecker
« Les habitudes meurent difficultueusement. »
Même si ce n'est pas l'usage le plus adéquat/précis de cet adverbe, ça fait plaisir de le rencontrer à la fin d'un chapitre du roman qu'on lit.
(Et dont on parlera dans une prochaine vidéo, il va sans dire.)
21:40 Publié dans Chèvre, aucun risque, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 02 juillet 2018
2 juillet 2018
19:59 Publié dans Affres extatiques, Amazone, été arlequin, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 28 mai 2018
Livres de Philip Roth
Il y a quelques jours, pour saluer Philip Roth dont on venait d'annoncer la mort, ma mère a posté une photographie des exemplaires qu'elle possédait de l'Américain, en précisant qu'elle avait dû m'en prêter quelques-uns.

Elle pourra donc les récupérer.
J'ai beaucoup travaillé sur l'œuvre de Roth entre 2011 et 2013, car j'ai donné le cours d'agrégation sur American Pastoral. Certains des exemplaires que l'on voit ci-contre (on peut agrandir en cliquant sur l'image) sont même bardés de fiches bristol dans lesquelles j'avais pris des notes (trop de notes, même). Il y a aussi, comme toujours avec moi, un certain nombre de livres de Roth que j'ai empruntés à la B.U..
Je peux aussi l'avouer, il y en a un dont j'ai arrêté la lecture à la page 44 : I Married A Communist. Et, parmi ceux que j'avais empruntés alors, un autre que je n'ai jamais pu finir : The Plot Against America.
14:33 Publié dans Blême mêmoire, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (1)
dimanche, 08 avril 2018
Essays of Elia (1823)
Ma mère m'a passé trois livres de l'ancienne collection Everyman's Library, la collection cartonnée dont je possède déjà — toujours grâce à ma mère et à la faveur de je ne sais plus quel désherbage de bibliothèque de lycée — une dizaine de sélections de poètes romantiques anglais.
Ces livres, qui ont dû être l'équivalent, il y a 120 ou 130 ans, du livre de poche dans ce qu'il peut avoir de plus cheap, sont d'une belle qualité éditoriale ; l'impression et le papier sont très agréables.
Là, il y a le volume (marron, réédition de 1905 (?)) des Essays of Elia de Charles Lamb. J'avoue qu'à part ses Tales from Shakespeare, co-écrits avec sa sœur, je ne sais à peu près rien de Lamb. Le hasard fait curieusement les choses, car je me démène ces jours-ci avec Rasselas de Samuel Johnson (qui m'ennuie) et avec Wordsworth, et me trouve donc — en simplifiant beaucoup — en plein dans la charnière entre le premier romantisme et le second romantisme.
Ces Essays of Elia, écrits à partir de 1820 mais rassemblés en volume en 1823, auraient pu être écrits 75 ans plus tôt par Smollett ou Johnson, justement : ils sont tout du côté du 18e siècle. J'en ai lu trois ou quatre cet après-midi, et notamment le stupéfiant “The Praise of Chimney-Sweepers”, que j'ai choisi de lire à cause de l'intertexte blakien : il est ahurissant de voir à quel point Lamb se contrefout, au fond — et d'une façon qui le place aux antipodes de Blake, qui avait montré mille fois plus d'empathie trente ans plus tôt —, de voir ces enfants faire un travail dangereux et destructeur. Tout le mépris de classe, jusque dans des remarques qui frôlent régulièrement la pédophilie, est tellement évident et assumé qu'il faut lire absolument ce texte, qu'on trouve notamment ici. (Je n'ai pas bien élucidé l'histoire de la décoction de sassafras, mais enfin...)
Moins idéologiquement terrible, et plus contemporain, en un sens, ce passage du bref essai sur la Saint-Valentin, dans lequel on voit par ailleurs combien le côté commercial était déjà abusif et moqué :
In these little visual interpretations, no emblem is so common as the heart — that little three-cornered exponent of all our hopes and fears — the bestuck and bleeding heart; it is twisted and tortured into more allegories and affectations than an opera hat. What authority we have in history or mythology for placing the head-quarters and metropolis of God Cupid in this anatomical seat rather than in any other, is not very clear; but we have got it, and it will serve as well as any other. Else we might easily imagine, upon some other system which might have prevailed for any thing which our pathology knows to the contrary, a lover addressing his mistress, in perfect simplicity of feeling, “Madam, my liver and fortune are entirely at your disposal;” or putting a delicate question, “Amanda, have you a midriff to bestow?” But custom has settled these things, and awarded the seat of sentiment to the aforesaid triangle, while its less fortunate neighbours wait at animal and anatomical distance.
(Je clos sur une pirouette : entre Rasselas, la traduction en cours de Dead-Sea Fruit, le Guyana Quartet de Wilson Harris et donc, à présent, les essais de Lamb, je crois que l'aiguille moyenne de mes lectures, sur l'axe du temps, s'était rarement trouvée — ou en tout cas pas récemment — aussi éloignée du jour d'hui.)
22:27 Publié dans Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 15 mars 2018
Soljénitsyne
En lisant qu'un ami vient d'achever la lecture d'un recueil de nouvelles de Soljénitsyne, je m'avise qu'à part Le Pavillon des cancéreux que j'ai lu à 13 ou 14 ans et dont je garde un souvenir très vif — j'avais vraiment adoré ce livre —, je n'ai rien lu de lui, preuve, s'il en fallait, qu'un livre peut compter beaucoup sans qu'on aille pourtant lire les autres du même auteur pendant plus de trente ans, et que je pourrais me botter les fesses et passer à l'acte II avant le centenaire (le 28 novembre prochain). Ça me laisse huit mois et demi.
18:42 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 23 décembre 2017
« Je n’achèterais jamais rien sur amazon »
Billet ici pour pas rentrer dans le lard de quelqu'un que je ne connais pas et qui est sans doute un homme charmant, agréable, tout ce qu'il y a de mieux.
... mais j'en ai assez de lire ça sous la plume de gens qui, souvent, vous font la morale, à vous, les vendus-au-capitalisme, les inconscients-exploiteurs-exploités.
« Moi, je n’achèterai jamais rien sur Amazon. » (Je corrige les fautes de français, au passage.)
Ah, d'accord... mais je voudrais rappeler que, pour nombre d'entre nous, Amazon a permis, il y a quinze ou vingt ans, je ne saurais plus dire, d'accéder enfin à des milliers de livres et de disques qui étaient totalement inaccessibles, soit parce que les disquaires (même à Paris, d'ailleurs), ne connaissaient pas le circuit ou ne voulaient pas s'emmerder (je cite) à faire venir tel disque pour un seul exemplaire, soit parce que le “libraire indépendant” de centre ville n'avait pas les moyens (ou souvent, pas envie) de se diversifier dans les livres en langue étrangère, ou alors que tel éditeur de poésie était vraiment trop confidentiel (je cite toujours).
Je ne dirai pas jusqu'à dire que les libraires ou les disquaires ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis, car c'est faux : Amazon est un attila qui a tout cramé sur son passage... Mais en revanche nous-autres-qui-achetons-sur-Amazon ne sommes pas seulement des irresponsables ou des valets du capitalisme.
Il y en a tellement que je ne pourrais même pas faire la liste des écrivains ou artistes qui me seraient restés inaccessibles sans Amazon — tiens, un seul exemple, les livres de la série Humument de Tom Phillips.
De même pour les réseaux sociaux : sans Facebook ou YouTube, il y a des dizaines de livres d'auteurs africains, ou autres, dont je n'aurais même pas connu l'existence. Là encore, un seul exemple : Nnedi Okorafor. Je remercie Facebook — chaque jour que Nobodaddy ne fait pas — de m'avoir fait connaître Nnedi Okorafor.
Et, pour en revenir à Amazon, en écho à la dernière vidéo de François Bon, sans Amazon et le compte Kindle, je ne pourrais pas lire, dès ce matin, Manikanetish de Naomi Fontaine.
10:52 Publié dans Indignations, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 03 décembre 2017
D'un pont l'autre
Sans 4 3 2 1 de Paul Auster, dont je suis en train d'achever la lecture, je n'aurais peut-être jamais lu ce poème d'Apollinaire, “La jolie rousse”, dernier pourtant des Calligrammes, et alors que — je le vérifie avec la dédicace de mes parents — le Pléiade m'a été offert en 1986 !
Ce poème, vraiment, ne me dit rien.
09:15 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 05 novembre 2017
Momentum gridlock
Il existe donc un essai intitulé Nonsense upon Stilts (celui que je cherchais, indisponible à la BU, indisponible au SUDOC, 119 € sur Amazon) et un autre, qui m'intéresse tout autant en fin de compte, dont le titre est Nonsense on Stilts (indisponible à la BU, indisponible au SUDOC, 1,92 € sur Amazon).
Entre autres maintes conclusions, c'est la première fois, je pense, que je m'aperçois qu'un livre disponible d'occase pour trois fois rien sur Amazon n'est présent dans les collections d'AUCUNE B.U. française.
05:05 Publié dans Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 18 octobre 2017
je range mon bureau #3
19:54 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 02 octobre 2017
Art poétique
11:14 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 27 juin 2017
10 livres (mais 12, en fait)
(à l'instigation de ma sœur)
Un livre qui a été adapté en film : La Rue Cases-Nègres
Un livre qui est dans ta pile de livres en attente et que tu as envie de lire : Les Hommes qui me parlent d'Ananda Devi
Un livre choisi pour la couverture : Multiples d'Adam Thirlwell
Un livre dont le titre ne comporte qu'un seul mot : allez — deux pour le prix d'1 — und beide von Thomas Bernhard : Frost & Korrektur
Un livre qu'on t'a offert : Les Poulpes de Rayond Guérin
Un livre que tu n'as encore jamais lu d'un auteur que tu aimes : Mémoire d'éléphant d'Antonio Lobo Antunes
Un livre recommandé par un(e) ami(e) : L'Adolescent de Dostoïevski dans la traduction d'André Markowicz
Un livre qui se passe pendant la seconde guerre mondiale : Bitter Eden de Tatamkhulu Afrika — mais il est impossible de ne pas citer la trilogie de Charlotte Delbo
Un livre policier ou thriller qui a été un coup de cœur : aucun
Un livre de plus de 500 pages : Collected Poems (1948-1984) de Derek Walcott / ‘le grand incendie de londres’ de Jacques Roubaud
09:15 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 31 mai 2017
Par les gouffres
Ayant terminé récemment le dernier roman paru (et qui est, si j'en crois mes souvenirs, le dernier au sens fort (vu que l'écrivain a annoncé, il y a un ou deux ans, prendre sa retraite)) de Lobo Antunes, Pour celle qui est assise dans le noir à m'attendre, j'ai acheté hier un de ses romans « de jeunesse », Connaissance de l'enfer. En effet, lorsqu'on a appris que Lobo Antunes mettait fin, en quelque sorte, à sa carrière, il y a un ou deux ans, j'avais pris la décision d'en profiter pour lire les premiers, que je n'ai jamais lus. J'avais alors lu Le cul de Judas, absolument magnifique.
Le tout premier, Mémoire d'éléphant, n'était pas à la librairie, raison un peu idiote pour ne pas (re)commencer par celui-là : entre la B.U. et les commandes, rien d'impossible.
Je m'aperçois, très entre autres, que l'article de la WP francophone consacré à Lobo Antunes est fragmentaire et même fautif : N'entre pas si vite dans cette nuit noire est classé à la rubrique Poésie, ce qui n'a pas plus de sens que pour ses dix ou douze derniers romans. C'est, comme ses dix ou douze derniers romans, une fiction en prose constituée de paragraphes suivis non ponctués et organisés en chapitres-phrases d'une vingtaine de pages en moyenne. Il est vrai que je crois me rappeler que c'est celui-ci que Lobo Antunes a sous-titré « Poème », mais cela ne permet pas de le séparer des autres dans une rubrique Poésie.
______________________________________________________
Hier, nous avons fêté nos noces de coquelicot, et, dans dix-huit jours, ce seront les noces d'argent.
08:02 Publié dans Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 17 septembre 2016
Au prisme du Styx
Mieux vaut en rire que de s'en offusquer.
Je découvre aujourd'hui l'existence d'un prix littéraire sobrement nommé Prix du Style. Étonnement, mais pas longtemps : en effet, à l'heure où la très large majorité des prétendus écrivains ne savent plus ce qu'est une phrase, et où tant de critiques nous parlent d'écriture blanche pour des écritures vides (Philippe Claudel, Véronique Ovaldé, j'en passe et des pires), faut-il s'étonner qu'on finisse par consacrer un prix littéraire au style ?
Et donc, qu'est-ce à dire ? Qu'on va juger du style séparément du reste, à la lagarde&michard ? Ou qu'on va décorer une œuvre totalement creuse mais bien écrite ? Cela fleure la décadence à la puissance sept, c'est-à-dire le retour à un tiède passé.
Voilà sans doute, dans un premier temps, ce qu'il y a à en dire, ou à en penser. S'inscrire dans le refus fondamental de ça, la séparation du fond et de la forme, de la syntaxe et du message, gna gna gna.
Puis, tout de même, pris d'un remords, je décide de consulter le site Web dont j'ai donné le lien plus haut — et ceux qui ont cliqué avant de poursuivre la lecture de ce billet ont déjà dû se choper le même fou rire que moi —, et voici ce qu'on peut lire à la une :
Tristante [sic] Banon et Marc Lévy intègrent le jury du Prix du Style
C'est tellement gorafiesque * ou abracadabrantesque que j'en ai fait une capture d'écran. La coquille au prénom, la tournure incorrecte (intégrer un jury ??), la photo totalement old school...
Last, not least, les deux promus : Tristane Banon et Marc Lévy, qu'on cite presque systématiquement (en particulier le second) pour la médiocrité de leur langue... Le nom même de Marc Lévy est devenu, avec ceux de Musso ou de Gavalda, un raccourci pour désigner des récits conformistes et plats. Alors, ce Prix du Style — quoi ? le Prix de la Meilleure Mauvaise Rédaction de Cinquième ?
Mieux vaut s'en gausser que de s'en indigner.
* Après avoir reconsulté la composition du jury, je n'arrive pas à penser que ce puisse être autre chose qu'un canular, ou qu'un fake. Le fondateur et président du jury a publié un livre sur les Schtroumpfs qu'il a ensuite adapté au théâtre des Déchargeurs ???? Come on, give us a break.
08:48 Publié dans Indignations, Lect(o)ures, Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (1)
mercredi, 31 août 2016
Elisa Shua Dusapin :::: Hiver à Sokcho
D’emblée, le nom de l’écrivaine a surpris — en voyant passer ce livre sur le “mur” d’un ami libraire, puis sur les tables de la librairie où j’ai mes habitudes. Cette jeune femme a donc double nom, penchant du côté coréen et du côté français (avec l’énigme possible d’un lien avec le compositeur). D’autre part, je suis souvent attiré par les romans dont le titre contient un toponyme aux sonorités efficaces (Mon double à Malacca, tiens, pour n’en citer qu’un).
Hiver à Sokcho est un récit presque traditionnel, qui rappelle un certain nombre d’histoires, notamment cinématographiques, sur la rencontre timide de deux étrangers dans un lieu “hors circuit”. Il évite totalement les écueils des histoires Orientale/Occidental : bien que Yan Kerrand, au nom plutôt breton, s’identifie apparemment à la Normandie et aux bocages*, et bien que la narratrice multiplie les références à la culture coréenne, culinaire notamment, aucun des deux personnages n'a d'identité nationale assignable ou réductrice.
Dans un style parfois âpre, parfois plus délié, non sans abuser ponctuellement des phrases nominales ou de séries de phrases brèves, Elisa Shua Dusapin tourne autour de ces deux personnages dont l’opacité constitue la trame du roman. Que “le Français” soit un auteur de bande dessinée n’a rien d’un gimmick, tout d’abord parce que cela permet de caractériser cet homme en profondeur, de lui donner une véritable épaisseur de personnage, mais surtout car cela vient en écho à la prose très visuelle d’Elisa Shua Dusapin, une prose qui joue beaucoup sur le trait, sur l’esquisse.
Par-delà les figures que dessine, par exemple, le rapport de la narratrice – et de son entourage – à la cuisine et aux codes culinaires coréens, le roman raconte, en abyme, comment le lecteur même découvre cette jeune femme et ce qu’il lui est loisible de voir en elle.
J’avais senti le changement dans son regard. Au début il ne me voyait pas. Il avait remarqué ma présence comme un serpent se glisse en vous pendant vos rêves, comme un animal de guet. Son regard physique, dur, m’avait pénétrée. Il m’avait fait découvrir quelque chose que j’ignorais, cette part de moi là-bas, à l’autre bout du monde, c’était tout ce que je voulais. Exister sous sa plume, dans son encre, y baigner, qu’il oublie toutes les autres. Il avait dit aimer mon regard. Il l’avait dit.
(Hiver à Sokcho. Zoé, p. 120)
Une jeune écrivaine très prometteuse, à découvrir, puis à suivre.
————————————
* À ce propos, le nom du peintre Claude Monet est orthographié à deux reprises “Monnet” (p. 70). Quand on dit qu'il n'y a plus de relecteurs dans les maisons d'édition...
06:42 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 24 mai 2016
D'un Cingal l'autre ▓ Ma nuit entre tes cils
Il y a quelques années, mon père, se trompant dans mon adresse mail, eut un échange hallucinant avec mon homonyme, un Guillaume Cingal ingénieur à Toulouse. Persuadé que c’était bien moi qui lui faisais une blague en prétendant être quelqu’un d’autre, mon père, qui n’est guère pétri de doutes, avait écrit cette phrase restée dans les annales de la famille : « Je n’ai pas de trou de mémoire : tu es bien mon fils. » Plus récemment, à la Toussaint je dirais, ce même homonyme, pauvre garçon qui doit décidément trouver encombrant son Doppelgänger gascon/tourangeau, m’a écrit pour me dire de rappeler mon adresse électronique précise à mes étudiants, car il y avait encore eu plusieurs erreurs.
 Des Cingal, je n’en ai pas croisé beaucoup, n’ayant jamais vécu en Normandie, bastion originel de la famille. À l’époque du Minitel, je m’étais amusé à faire une recherche dans l’annuaire : un seul Cingal dans les Landes (mes parents), un seul en Gironde (moi), un seul dans les Hauts-de-Seine (ma sœur) etc. En revanche, des dizaines et des dizaines de Cingal dans le Calvados (où je me suis autoportraituré en 2009 à côté du panneau indiquant le lieu-dit, mais aussi avec mes fils devant la maison de mon arrière-grand-mère, à Chicheboville, où j’ai passé plusieurs jours pendant plusieurs étés consécutifs de mon enfance) et la Seine-Maritime.
Des Cingal, je n’en ai pas croisé beaucoup, n’ayant jamais vécu en Normandie, bastion originel de la famille. À l’époque du Minitel, je m’étais amusé à faire une recherche dans l’annuaire : un seul Cingal dans les Landes (mes parents), un seul en Gironde (moi), un seul dans les Hauts-de-Seine (ma sœur) etc. En revanche, des dizaines et des dizaines de Cingal dans le Calvados (où je me suis autoportraituré en 2009 à côté du panneau indiquant le lieu-dit, mais aussi avec mes fils devant la maison de mon arrière-grand-mère, à Chicheboville, où j’ai passé plusieurs jours pendant plusieurs étés consécutifs de mon enfance) et la Seine-Maritime.
Pendant ma thèse, je fréquentais – irrégulièrement (travailler en bibliothèque m’a toujours pesé) — la bibliothèque de l’INALCO, et avais alors découvert l’existence, la coprésence même, dans le vieux fichier aux cartons jaunis, d’un Cingal, Grégory Cingal, dont j’ai découvert tout récemment, à la faveur d’un voyage à la Rochelle, et d’un passage dans l’excellente librairie Calligrammes, qu’il est l’auteur d’un premier livre, Ma nuit entre tes cils, texte qui navigue entre le roman, la chronique et l’autofiction. Autofiction, puisque l’on voit, à la page 60 (comme le département de l’Oise — entre 1997 et 2003, il y avait un seul Cingal dans l’Oise, toujours selon le Minitel), la femme aimée et morte dont le livre dresse, de façon très émouvante, le portrait autant que le tombeau, donner une série de surnoms au narrateur : « grégouille, gregjoli, greg saint-graal ».
Bien sûr, la coïncidence – simple, à condition que ce Grégory Cingal soit le même que celui qui fréquentait l’INALCO – m’a amusé, et je fais partie de ceux qui peuvent lire le passage cité en le rapportant à leur propre expérience patronymique. Combien de fois dans ma vie ai-je dû, après avoir pourtant épelé mon nom convenablement et distinctement, faire rectifier le S inscrit en tête par mon interlocuteur en un C, sans doute du fait qu’en entendant le nom, l’immense majorité songe à un nom en Saint, même sans connaître la ville suisse (devant le panneau d’entrée de laquelle nous fûmes photographiés, en 1983, mon père, ma sœur et moi — mon père cachant le ‘en’ final du St. Gallen germanique) ? Combien de fois, dans mon enfance, ai-je entendu de quolibets sur cigale et cinglé, alors que mes fils me disent n’avoir jamais rien ouï de tel, ce qui ne cesse de m’intriguer : appauvrissement lexical des jeunes générations ou plus grand respect du nom de l’autre dans une société multiculturelle ?
 Après avoir noirci une pleine page de ces considérations oiseuses, je crains, si l’auteur de Ma nuit entre tes cils tombe dessus, qu’il ne s’imagine lui aussi abandonné, son livre – tout à fait émouvant et bien écrit d’ailleurs – relégué dans la marge au profit des élucubrations onomastiques du Cingal tourangeau/gascon. Pour ne pas encourir trop ce reproche, je préfère citer un passage du livre en encourageant ceux de mes lecteurs qui m’ont de temps à autre exhorté à démarcher des éditeurs de reporter leur déception de ne jamais voir mon nom sur une couverture sur ce beau petit texte des éditions Finitude. Réminiscence indirecte du très bel et très drôle essai Comment massacrer efficacement une maison de campagne en dix-huit leçons, ce passage qui décrit escapades et errances dans la campagne vendéenne – la Vendée, département dans lequel je n’ai jamais mis les pieds et où, vérification faite dans les Pages blanches, il n’y a aucun Cingal répertorié – pourra plaire aussi aux rinaldo-camusiens canal historique :
Après avoir noirci une pleine page de ces considérations oiseuses, je crains, si l’auteur de Ma nuit entre tes cils tombe dessus, qu’il ne s’imagine lui aussi abandonné, son livre – tout à fait émouvant et bien écrit d’ailleurs – relégué dans la marge au profit des élucubrations onomastiques du Cingal tourangeau/gascon. Pour ne pas encourir trop ce reproche, je préfère citer un passage du livre en encourageant ceux de mes lecteurs qui m’ont de temps à autre exhorté à démarcher des éditeurs de reporter leur déception de ne jamais voir mon nom sur une couverture sur ce beau petit texte des éditions Finitude. Réminiscence indirecte du très bel et très drôle essai Comment massacrer efficacement une maison de campagne en dix-huit leçons, ce passage qui décrit escapades et errances dans la campagne vendéenne – la Vendée, département dans lequel je n’ai jamais mis les pieds et où, vérification faite dans les Pages blanches, il n’y a aucun Cingal répertorié – pourra plaire aussi aux rinaldo-camusiens canal historique :
Seuls parmi les sentiers de son marais vendéen, à bord de l'antédiluvienne 205 grand-maternelle qui tremblait dès qu’on passait la troisième, stoppant à tout bout de champ la voiture pour s'embrasser, écouter le coassement des crapauds, contempler les écharpes de brume qui s'enroulent aux roseaux. Ou bien pour visiter quelques vieux mas à l'abandon aux murs dépecés par l'herbe folle, comme avalés par le temps, aux portes si étroites qu'on y pénétrait instinctivement de profil, aux cloisons effondrées par le zèle remarquable des pilleurs qui allaient jusqu'à desceller les frontons ouvragés des cheminées de pierre. Beauté poignante de ces ruines si préférable à la vogue de la pierre apparente qui se répandait comme un feu de brousse aux façades des maisons habitées, éradiquant un à un le crépi grisé de son enfance, vogue qui ne la révoltait pas moins que ces meubles anciens relookés au dégoût du jour, au point que je redoutais presque, lorsque nous passions à proximité de l'un de ces braves propriétaires occupé à gratter son mur, qu'elle ne baisse sa vitre pour l’abreuver d'insultes, ou qu'elle descende carrément de voiture pour lui arracher des mains sa maudite ponceuse.
(Grégory Cingal. Ma nuit entre tes cils. Finitude, 2016, pp. 37-8)
10:22 Publié dans Autoportraiture, Lect(o)ures, Pynchoniana, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 27 février 2016
Blousés
“un spécialiste peut se blouser comme un autre homme”
(Gide, Journal, 1933, cité dans le Robert)
Au détour d'une page sur Kafka – que je n'ai pas assez relu depuis que je me suis fait offrir les Sämtliche Werke – Christian Garcin évoque Epépé de Ferenc Karinthy, et c'est un nouveau livre qui s'ajoute à la pile virtuelle.
Dans Labyrinthes et Cie, Garcin évoque aussi son travail de recherches sur la figure de labyrinthe chez Borges et déclare avoir « eu le sentiment d'avoir été proprement blousé, “promené” comme on dit dans le Sud, par un Borges infiniment trop malicieux pour moi » (p. 69).
Là où Garcin voit un méridionalisme (je suppose — je suis, comme on le sait, très réticent à une telle absence de nuance, ayant grandi en trouvant les Provençaux beaucoup plus étranges, dans leur parler et leurs habitudes de pensée, que les “Parisiens”), le Robert parle d'une locution figurée et vieillie : « promener quelqu'un, le mener en bateau, le lanterner ». Et cite le Dictionnaire de l'Académie : “voilà six mois qu'il me promène”.
En ce sens, la promenade prend le sens de déroute organisée, de désorganisation, de dédale interprétatif. (Et de mon remords de ne pas avoir assez lu Kafka depuis 2012 j'en viens au regret de ne pas avoir encore lu Der Spaziergang de Walser.)
J'en termine avec un fait brut, anecdotique : dans l'exemplaire du livre emprunté à la B.U. Se trouvait, outre ma fiche de réservation, une précédente fiche d'emprunt au nom d'Élodie Buttieu (“retour le 29/03/2006”).
13:13 Publié dans Larcins, Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.), Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 21 janvier 2016
Illustre
Il te faudrait, m'écrit Madame de Véhesse, un dessinateur, un illustrateur. — Et d'ajouter : Un dessin par limerick et ça devrait rouler !
(Elle évoquait les Wikimericks, ou les Limericks du martyrologe.)
ll m'arrive de me dire, en effet, qu'on pourrait faire quelques recueils rigolos quoique passablement vains de certaines des rubriques accumulées ici (plus que là, d'ailleurs, où l'activité, quoique intense, est devenue entièrement solitaire (mais pas solaire : saturnienne, presque plutonienne, même)).
Vains, voilà ce qui stoppe net toute velléité.
À quoi bon constituer des vanités.
Déposer ici, jour après jour, ces textes, ce n'est pas pareil. On se dit que c'est comme ça, c'est à peine publié — en général, ça n'attire ni attention ni réactions, ce qui est devenu, au fond, très reposant, très libérateur. Je continue pour moi. Et ça ne m'empêche pas, au contraire, d'écrire de plus en plus.
Aujourd'hui (enfin, il est une heure : hier), je me suis rendu compte, par un quasi hasard, que tout le monde était en train de rater le sesquicentennaire (dit-on ça en français ? en anglais, sesquicentennial est tout à fait banal) de la naissance de Richard Le Gallienne. Qui pense à lui ? à cet écrivain ? pas même moi, qui avais pourtant utilisé un de ses textes lors d'un séminaire de sémiotique, vers 2008. ———— Alors, qu'ai-je écrit sur Facebook ? Pénitence : traduire une page de RLG chaque semaine en 2016. Pourquoi pas ? Il y a plus idiot.
En tout cas, il naquit le 20 janvier 1866.
On a déjà raté sa célébration.
Comme le disait Breton de Saint-Pol Roux, cet illustre appartient à la caste de ceux qui « s'
01:07 Publié dans Ecrit(o)ures, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)
dimanche, 20 décembre 2015
D’une disparition
17 décembre 2015
Voulant chercher quelques nouvelles citations pour prolonger le projet des soixante-et-onze phrases de Farah, je m’aperçois que mon exemplaire de From A Crooked Rib est introuvable. Bon, j’ai dû le prêter, et je ne l’ai jamais récupéré – à racheter.
Ce qui est plutôt amusant, c’est que j’ai deux exemplaires de la traduction du roman par Jacqueline Bardolph (publiée à l’époque, juste après la mort de la grande spécialiste, en collection “Motifs”, à l’instigation de Jean-Pierre Durix) et que je ne parviens pas non plus à remettre la main sur la première traduction, celle de 1987, due à Geneviève Jackson et parue dans la collection “Monde noir”, aux éditions Hatier.
Autre curiosité (plutôt de nature à faire rire jaune, celle-ci), c’est qu’il y a quinze ans, un texte de Farah pouvait sembler mériter une retraduction, alors qu’il est devenu impossible de faire traduire ses derniers romans. Links a été bousillé par une certaine Marie-Odile Fortier-Masek, infoutue de comprendre la plupart des allusions culturelles et encore moins de saisir l’importance de certaines figures (allitérations, effets de symétrie, jeux sur la polysémie des adjectifs) ; depuis, Knots, Crossbones et Hiding in Plain Sight sont dans les limbes.
J’ai aussi, sur mes étagères, 4 exemplaires de Links, et pas mal d’autres doublons nuruddiniens… mais pas trace du tout premier roman.
10:10 Publié dans Lect(o)ures, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 05 novembre 2015
Une histoire de Grace ▓ Nicolas Servissolle ░ Éditions Myriapode
Une histoire de Grace est le premier roman (ou le premier roman publié ?) de Nicolas Servissolle. Il m'a été offert, suite à une rencontre avec l'écrivain qui s'est déroulée à l'excellente librairie Campus, à Dax. Le récit, bref mais d'une grande densité, est précédé, de manière inhabituelle et très in-your-face, d'une préface qui a tout d'un manifeste. Une telle préface, qui proclame – en se réclamant de Bonnefoy et Robbe-Grillet, rien moins – la nécessité de reprendre à nouveaux frais la tâche du nouveau réalisme que portait, sous des “écritures pourtant si différentes qu'elles découragent d'y déceler le moindre indice d'un mouvement esthétique commun”, le Nouveau Roman.
Ayant commencé par cette préface programmatique, le lecteur ne se retrouve donc pas à lire un roman. La préface, tout un programme, a actionné un certain nombre de leviers, suscité aussi quelques attentes. En d'autres termes, on attend de voir ce qui ressort d'une telle ambition.
D'emblée, puis au fil des 8+2 chapitres, le lecteur trouve tel écho de Sarraute (“Cela remue... Cela parle... Vous entendez?”, p. 15), tel clin d'œil à Butor (le je-tu modificatoire), tel dispositif caractéristique de la première manière de Robbe-Grillet (le personnage principal, enquêteur, se révèle être l'objet du récit/rêve par un autre scripteur). Sans la préface, ces éléments eussent certainement sauté aux yeux. De même, le reproche que l'on peut formuler, à savoir que Nicolas Servissolle écrit bien, et, en un sens, trop bien — ce que, par une expression fréquente que je n'aime pas trop employer, l'on nomme parfois se regarder écrire —, est si évident qu'il ne présente, au fond, aucun intérêt : cette mise en scène de l'écriture, cet agacement du lecteur, sont partie prenante de la stratégie d'écriture, et participent de cet essai de “nouveau réalisme”. Ainsi, les nouvelles laissées par la morte (et retrouvées par l'enquêteur dans son appartement au chapitre IV) constituent, plus qu'une mise en abyme du récit, un miroir qui nie toute possibilité d'enchâssement : comme chez Éluard, mais dans une perspective plus nettement lynchéenne, on peut poser la question sans y répondre : « qui de nous deux inventa l'autre ? »
Pour ma part, je préfèrerai toujours un écrivain qui écrit un peu trop bien (ce qui, dans d'autres cas, peut aussi se traduire par un débraillé délibéré, une écriture volontairement gauche) à un écrivain qui n'écrit plus à force de se fondre dans un moule de parlote collective. La double distinction barthésienne opposant, d'une part, l'écrivant à l'écrivain, et, d'autre part, le texte lisible au texte scriptible, ne m'a jamais paru aussi pertinente qu'en ces temps de profusion et de confusion.
De façon voisine, certains trouveront peut-être que l'auteur, nourri de peinture et d'histoire de l'art, a tendance à plaquer – ou, autre métaphore picturale, à diluer (hmmmm, oui, who am I to criticize those who overwrite?) – les références, ou s'agaceront du chapitre VII, dont l'interpolation des événements du récit principal et du dialogue relatif à La Grande Bouffe de Marco Ferreri m'a paru, au contraire, très intelligente et très réussie.
J'ai noté plus haut que le récit était bref (125 pages) mais d'une grande densité. Il m'est donc impossible de signaler tous les jeux d'échos, par exemple entre la Grace du titre et la Grèce... la fixation sur l'épisode d'Ulysse chez Nausicaa ou l'importance de plusieurs traditions philosophiques helléniques, dont la conception sophistique du logos n'est pas la moins importante. C'est au lecteur (à d'autres lecteurs = à ceux qui, je l'espère, liront ce livre après avoir lu ce billet) de tirer son épingle du jeu interprétatif, à refaire, autrement que moi, le parcours dans ce bref texte scriptible (Barthes aurait-il, à l'heure des nouvelles technologies, risqué réinscriptible ?) Il va de soi que les tenants d'un roman dont l'auteur s'interdit toute référence culturelle, toute discussion de questions théoriques sur l'art ou la littérature passeront leur chemin, et sans doute ne sont-ils déjà pas arrivés jusqu'ici dans ce billet. → ;-) comme on écrit.
Dans l'écriture même, m'a frappé l'usage d'une forme de présent de narration qui sert à mélanger les différents plans temporels. Servissolle s'en sert pour décrire, dans un même paragraphe, des événements qui se sont nécessairement déroulés à des moments très différents : appel à la reconstruction des “étapes” par le lecteur ? stratégie visant à rappeler que la distinction entre temps de l'histoire et temps du récit est un leurre quand la lecture se saisit simultanément d'axes censément distincts ? reprise (non décelée par moi) d'un procédé d'écriture (ricardolien ? (je mets ça au pif)) ?
Il y a quelques coquilles, étonnantes, mais, dans l'écriture même, j'aimerais opposer, de façon tout à fait subjective et sans chercher à m'en justifier, deux extraits dans lesquels le recours à un lexique rare produisent des effets opposés.
1. « Elle pleure, t'appelle son étranger, déplore ce qu'elle nomme la routine solite des couples où l'on se rend sourd à l'autre et à soi... » (p. 114)
2. « Haletant, le dos conte la porte, tu sens alors une présence étrange à tes côtés, comme si le passe-muraille de Marcel Aymé, la tête sortant de la cloison, te toisait en silence, sans bouger. Tu as un mouvement de recul. Une carafe d'orignal pend au mur, un trousseau de clés accroché à ses cornes ! Assurément, Grace possède un sens de l'humour bien à elle. » (p. 70)
Dans le premier, préciosité pure. Dans le second, le choix du substantif carafe dans une acception méconnue vient renforcer l'effet de saisissement et de duperie que la référence au passe-muraille aurait rendu, sans cela, plutôt plate.
13:13 Publié dans Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.), Pynchoniana | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 17 mai 2015
Savannah — Un tatou mort avant nous
Le nouveau livre de Jean Rolin est un bref récit de son retour à Savannah, sept ans après y avoir séjourné avec sa femme, Kate, laquelle est morte dans l’intervalle. L’élément structurant de ces allers-retours entre 2014 et 2007, ce sont les films réalisés par Kate, que le narrateur décrit, dont il transcrit certains dialogues et qui lui servent aussi de guide pour repartir, le plus précisément possible, sur les traces du couple d’avant. Rêveries du veuf solitaire, les chapitres proposent une forme de condensé de la poétique de Rolin : attention aux détails incompatibles avec le tourisme, description des friches industrielles, mise en scène (au sens noble – il leur donne la parole) des laissés-pour-compte (je ne sais quelle expression convient le mieux pour l’anglais disenfranchised).
Outre que les chauffeurs de taxi jouent un rôle primordial (de passeurs ?) dans les itinéraires du récit, une figure prend plus d’importance au fur et à mesure qu’elle devient moins menaçante : celle du petit homme au parapluie à « l’allure invariable, mécanique » (p. 40) : Doppelgänger, image de l’errance déraisonnable et systématique, autre forme de passeur ?
Dans un récit qui gravite autour de la figure de Flannery O’Connor – dont je n’ai jamais rien lu, il me semble, et dont le texte a le mérite de donner envie de lire la nouvelle ‘The Lame Shall Enter First’ – et de la visite à sa maison fatale, perdue en forêt, Rolin ne dissimule rien de l’atelier, ainsi quand il avoue que Google Maps est « cette espèce de miracle informatique grâce auquel je viens de retrouver le lieu exact de cet épisode » (p. 37). De même, si fasciné soit-il par les friches et par ce que je tente parfois moi-même de décrire dans mes kleptomanies überurbaines, il n’en déplore pas moins la banlocalisation généralisée (ce que Renaud Camus nomme aussi “le devenir-banlieue du monde”, et dont il fut question dernièrement pour la France) : « on se retrouve dans un paysage de désolation, celui d’un mall démesurément étendu et de ses métastases, dont seules quelques prémices étaient visibles en 2007 » (p. 88). Sans mise en scène macabre, très naturellement pourrait-on dire, le narrateur se livre à une sorte de mime de la mort, de doublement spectral, comme lors de la visite au cimetière sur les traces de l’hypothétique tombeau du père de Kate. À cette occasion, le lecteur comprend que, deuxième vidéaste, Jean Rolin filme également ce deuxième voyage à Savannah :
À Lionell, j’avais prétendu qu’il s’agissait de ma propre famille, ou de quelque chose de ce genre, afin qu’il ne soit pas surpris quand il me verrait sortir de la voiture, comme je le fis, et reproduire scrupuleusement, en les filmant, tous les gestes que Kate avait accomplis dans le même lieu. » (p. 110, c’est moi qui souligne)
En fin de compte, dans un récit tout en strates et traces, où toute figure devient à chaque instant spectre d’un autre ou d’elle-même, le seul cadavre véritablement inscrit (on ne peut dire ni vrai ni réel ici) est celui du tatou mort filmé par Kate en 2007 (pp. 73-6). Ici, c’est aussi d’un langage vivant et imparfait que le récit devient la trace, rendue parfaite et plus froide. En effet, les propos transcrits de Kate sont étranges, car, quoique anglophone, elle s’exprime d’une façon difficilement compréhensible pour le chauffeur :
Nous revenons vers la voiture, Kate dit à Willy : « It was a tattoo, he had so many maggots ! »
Ce mot de tattoo n’évoque rien pour Willy, dans la mesure où en anglais, comme en espagnol, tatou se dit armadillo. (p. 74)
Cette scène montre que ce qui se joue, comme chez Beckett, c’est l’aventure de la langue vivante figée dans la bande, et que le récit tente de reproduire, même de re-présenter. L’erreur sur le mot tattoo peut-elle vraiment venir de l’anglophone Kate ? Rolin ne nous invite-t-il pas au soupçon, ainsi qu’à une lecture dynamique des signes faussés ? Le tatou mort était là avant eux, et donc avant nous, lecteurs, avec ses vers et son magot de mots.
12:41 Publié dans Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.), Questions, parenthèses, omissions, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 03 mai 2015
Ou / où
Beclers.
Je suis en train de lire — en vitesse, franchement — le bref roman de Jacques Gélat, Le traducteur. C'est une véritable déception : le récit n'a rien de surprenant, l'écriture est conventionnelle, le narrateur un cliché de parisianiste sans épaisseur. Tout cela n'a pas beaucoup d'importance, mais deux choses méritent d'être notées ici :
* Comment un écrivain français doté de quelques prétentions intellectuelles peut-il choisir d'enfiler autant de poncifs sur les “dictateurs africains” en 2006 ?
* Même pour un texte aussi bref, il semble que les éditions José Corti aient renoncé à s'associer les services d'un relecteur, ou aient fait ce travail par-dessous la jambe. À deux pages d'intervalle, j'ai trouvé deux fautes, toutes deux graves, la plus ennuyeuse étant la seconde car j'ai failli ne rien comprendre au passage en question :
— « une indignité que je n'aurais pas soupçonné alors » (p. 85)
— « Malheureusement, l'oubli ne se décrète pas. Seul le temps où d'heureux événements jouent en sa faveur. » (p. 86)
Ayant lu ce où comme un où, j'ai relu plusieurs fois, songeant qu'il manquait la principale.
06:54 Publié dans Affres extatiques, Hors Touraine, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)
vendredi, 27 mars 2015
On nettoie / la statue de François
J'ai sprinté pour le bus, et sprinté pour le tram — dix-huit minutes de porte à porte (enfin, sans compter les deux ou trois qu'il me faut pour rallier mon bureau depuis la place Anatole-France). Ce matin, pour un peu, les transports en commun auront failli être aussi rapides que la bagnole.
S'essouffler n'est pas mauvais. (Benjamin Péret ??)
En tout cas, au sortir du bureau de tabac, le député socialiste affichait, je crois, Le Figaro.
Depuis le pont Wilson, sous un soleil resplendissant qui suffit à mettre en verve, aperçu encore trois cormorans, dont un volait en direction du pont, du tramway, de mon livre.
Entre la place et l'Université, me suis arrêté pour photographier Rabelais, à qui deux messieurs affairés refaisaient une beauté de marbre. Celui qui se trouvait en bas (à commander le monte-charge) m'a salué — quelle idée de saisir François reblanchi dans un nuage de buée qui cache l'inscription !
09:31 Publié dans Lect(o)ures, Moments de Tours, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 03 mars 2015
Au bord des fleuves qui vont ▬·▬ le dernier Antunes ?
En quinze chapitres correspondant aux quinze journées d'hospitalisation (21 mars – 4 avril 20007) d'un personnage tantôt nommé Antonio (dans ses souvenirs d'enfance) tantôt M. Antunes (dans son présent d'adulte vieillissant et malade), ce texte plus bref et plus “facile” que les derniers grands livres de son auteur livre l'itinéraire de ce double de l'écrivain vers la mort, avec une inscription finale Exeunt omnes qui suggère la fin d'une œuvre, c'est-à-dire la sortie de tous les personnages, de toutes les voix, l'image de la mort dans le texte.
Par son nom, le cancéreux mourant est le double de l'écrivain, fantôme troublant pour le lecteur qui sait qu'en 2015, lorsque paraît la traduction de ce livre publié en 2010 en portugais, le vrai Antonio Lobo Antunes est toujours en vie. Les quinze chapitres orchestrent magistralement la confusion mentale constante du malade dont la conscience ne cesse d'osciller entre les événements de son hospitalisation et le surgissement (la résurrection) de souvenirs de son enfance et de son adolescence. L'esthétique de Lobo Antunes — qui se fonde depuis bientôt vingt ans sur le mélange des plans, le nivellement des voix, la récurrence obsessionnelle de motifs triviaux — trouve là à s'exprimer dans un sujet à la fois plus simple et plus définitif.
Ainsi, dans le onzième chapitre, les organes tels qu'ils se donnent à lire sur les écrans de la chambre d'hôpital “font des fautes d'orthographe, ils divaguent, l'hypophyse évoque les crépuscules d'automne quand les cigognes s'en vont, le thymus l'envie de revoir l'étrangère blonde, le sang fait allusion à un vélo autour d'un châtaignier et vraiment n'importe quoi ces vélos ces châtaigniers” (p. 167).
Comme toujours, le livre multiplie les hypothèses à la question encore reformulée dans le septième chapitre : “qui est-ce qui persiste à habiter en nous au centre d'on ne sait quoi dont notre vie dépend, combien de questions posons-nous sans rien dire et qui restent sans réponse, aucune différence entre nous et à mon tour moi” (p. 110).
[Très belle traduction, comme toujours, de Dominique Nédellec.]
08:49 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 12 février 2015
Fraudeur (Eugène Savitzkaya)
Fraudeur, le nouveau roman d'Eugène Savitzkaya – qui avait continué à donner de ses nouvelles depuis Fou trop poli, en 2005, mais par sauts et gambades – est, à mon avis, un de ses plus beaux. Le narrateur y suggère à trois reprises la possibilité d'une lecture à haute voix, ce qui m'a conforté dans mon rapport charnel à cette écriture : je ne lis jamais un roman de Savitzkaya sans succomber pendant au moins une dizaine de pages à cette tentation du gueuloir.
Le lecteur familier de cette œuvre singulière y sera en terrain connu, en apparence du moins, car il y retrouve l'attention tout à fait particulière que porte l'écrivain aux goûts, aux saveurs, aux couleurs, à la terre et aux végétaux, à tout ce qui n'est généralement pas écrit, les sécrétions, les évidents secrets du corps ; toutefois, à la suite de vignettes ou d'excursions matérialistes des précédents récits, Savitzkaya substitue un récit orienté dans deux directions opposées. Pris entre le fou (double déjà identifié de l'auteur) et « l'adolescent de quatorze ou quinze ans », le texte reprend, de manière presque opaque, indiscernable, la structure dialogique et éclatée de récits autobiographiques rétrospectifs tels qu'Enfance de Sarraute ou Lambeaux de Charles Juliet.
Dans ce dispositif déjà en partie déceptif, alors que le lecteur se trouve pris dans la remontée vers une identité familiale paternelle slave/ukrainienne, il ne peut manquer de s'attendre à un renforcement croissant du motif de la mère malade dans la chambre empestant les bananes trop mûres ; or, les derniers chapitres de Fraudeur finissent par détourner le récit de son cours rétrospectif, autobiographique, mémoriel pour se concentrer sur la course de l'adolescent, sur sa maraude furtive – laquelle donne, de biais, encore, son titre au roman – qui lui fit, incidemment, à l'à-pic d'un bouleau nommé Sorcière, frôler la mort. La figure de la mère (disparue, comme par un clin d'œil à un autre immense roman de Savitzkaya, La Disparition de maman ?) a déserté le roman.
10:47 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 22 janvier 2015
Bondir hors de ses rêves, ratisser le réel
Tu te souviens quand je t'ai téléphoné
de Chartres ? Abattu et goinfre,
horrible dans mon désir. Tu aimais bondir hors
de tes rêves pour attraper l'écouteur et murmurer, non, non,
tu ne m'as pas réveillé, je me le suis déjà astiqué.
Mais ce n'était pas vrai. Même quand tu dors tu occupes
tout le terrain, les premières lignes.
Six premiers vers et demi d'un poème de Tomaž Šalamun traduit par Zdenka Štimac aux Éditions Franco-Slovènes (Ambre, 2013, p. 15), organisé en tercets enjambés, forme très fréquente dans le recueil, peut-être sous influence de la terza rima (faute de texte slovène en regard, impossible de le déterminer). Toutefois, exemple plus frappant que jamais que, même en traduction, il faut lire la poésie “étrangère”. L'univers de Tomaž Šalamun n'a rien de comparable. Chaque page m'a secoué, depuis que j'ai commencé à le lire, en novembre.
Il y a deux catégories de « lecteurs » qui m'agacent : ceux qui disent qu'on ne peut pas lire de la poésie (ou même des textes d'autres genres) quand on ne connaît pas la langue, et qui se privent, voire voudraient priver les autres d'accéder à une altérité réelle, puisque la bonne traduction consiste à transmettre une altérité réelle, effective, et — en ce sens — elle-même altérante ; et ceux, plus nombreux encore, qui se vanteraient presque de ne jamais lire de littérature contemporaine, en particulier de langue française, comme s'il était entendu que tout est bon pour le panier, alors que leur opinion s'est formée sur deux ou trois articles dénigrateurs sur le tout à l'ego (ou autre formule choc), ou sur la lecture d'un minable récit d'Amélie Nothomb qui leur a donné quitus pour tout jeter aux orties, et que l'opinion de ceux qui prennent, chaque jour, le risque de se confronter à des pans entiers de littérature contemporaine, dans les marges ou pas, se fonde sur une pratique de plusieurs années, décennies, au point d'avoir décelé des territoires entiers dont on pourrait espérer, n'étaient-ce la journalistisation des intellectuels et l'hyperspécialisation des universitaires, qu'ils seront d'ici quelques siècles l'équivalent de ce que sont, pour nous, Montaigne, Saint-Simon, Balzac ou André Breton.
10:14 Publié dans Lect(o)ures, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 30 novembre 2014
Horreur sourde...?
Ce que je veux dire, c’est que retourner sur ses pas, retrouver intacte, préservée, la vie partout ailleurs abolie, n’éveille ni joie ni gratitude mais l’horreur sourde d’être cerné, soudain, de spectres, de descendre, vivant, au tombeau. (Pierre Bergounioux. La mort de Brune, p. 63)
Quoique j’aie bien noté ce contraste entre la vieillerie ambiante de ma ville natale (plus encore peut-être le caractère hors du temps national ou mondial de la vie au village) et certains aspects subits de modernité traversés à Bordeaux ou à Paris, je n’en ai jamais eu cette appréhension tragique, spectrale, qui m’a sans doute sauvé de la mélancolie — je me suis contenté d’épouser les contours de ce que la vie m’offrait, sottement ou joyeusement, mais peut-être aussi ai-je manqué quelque chose, et serai-je vraiment horrifié en le comprenant, trop tard (sur mon lit de mort ?)
11:09 Publié dans Ecrit(o)ures, Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 27 novembre 2014
Violons pour L’Uræus
Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’Alechinsky – lui dont les belles planches pour le Traité des excitants modernes de Balzac m’ont tant ému – ne s’est pas trop foulé pour illustrer (encadrer ? ses traits violets servent en effet de marges aux poèmes de ce bref recueil) L’Uræus de Salah Stétié. Les traits du premier poème sont très dynamiques, avec trois fois rien Alechinsky invente un monde ; et puis après, on a l’impression qu’il s’est désinspiré.
(Ce n'est pas la page que j'ai choisie comme illustration de ce billet. Ici ↓ je reprends le poème dansé/dansant.)
Il a résisté à la tentation de dessiner ou d’évoquer des cobras (l’uræus est, je l’apprends à cette occasion, le cobra femelle (pas une seule occurrence de ce mot dans l’ensemble des textes intégraux mis en ligne sur le site Latin Library (!??))), tout comme Stétié n’explicite guère son titre. Certains poèmes sont très forts, prenants, résonnent. Il y a au moins un choix de préposition que je ne comprends pas :
Des enfants pourtant crient sur un préau d’école
ils vivent tous sur un seul grain de sable
échappé
Le premier sur est-il appelé par le second ?
Beau mot, en tout cas, que préau, peu présent en poésie ni prose. Citons seulement Les Misérables : « La première chose qui le frappa dans ce préau, ce fut une porte du seizième siècle qui y simule une arcade, tout étant tombé autour d'elle. »
10:04 Publié dans BoozArtz, Lect(o)ures, Où sont passées les lumières? | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 20 novembre 2014
Bricoles du jeudi matin
Avant de commencer vraiment la journée de vraie travail (jusqu'ici : allers-retours aux écoles, mails, concert de clarinette de Reicha, bricoles), je note que j'ai bientôt terminé de lire le dernier roman de Romesh Gunesekera, The Prisoner of Paradise, qui me laisse un peu sur ma faim, quoique Gunesekera demeure un extraordinaire styliste et un explorateur hors pair des drames de l'âme humaine. Je vais donc pouvoir commencer de lire les différents livres reçus en cadeau le week-end dernier :
- Anarchy & Old dogs de Colin Cotterill (mon ami et collègue Éric R. a obtient sans aucun doute le prix de l'originalité pour ce choix)
- Lupus de Frederik Peeters
- Terminus radieux de Volodine (j'en suis tout de même à la page 56 — je ne résiste pas au plaisir d'avoir 4 fers au feu simultanément)
- Entre fous de Jean-Luc Coudray
J'ai lu quelques poèmes de l'édition française des poèmes de Carlos Drummond de Andrade. Par ailleurs, notre ami libraire à La Rochelle m'a apporté l'édition française du roman de K. Sello Duiker, La sourde violence des rêves, ce qui m'a rappelé, très entre autres, que j'avais encore laissé en plan les conseils de lecture de Mathilde, qui datent de juin dernier (notamment Ivan Vladislavic et Marlene van Niekerk).
09:40 Publié dans Factotum, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 02 novembre 2014
Nuruddin & Valérie
Lu le dernier Farah pp. 79-159, avant de recevoir pour le thé Valérie, que je n'avais pas vue IRL depuis 2007, et son mari, qui est un gars super. On a regretté de ne pas les avoir invités à dîner, mais nous sommes notoirement des ours. Next time...
Farah & Valérie, donc... Or, quand Valérie a fini par créer un blog, en 2006, un de ses premiers billets porta sur la journée Nuruddin Farah à l'EHESS. C'est ce jour-là que je fis sa connaissance en vrai de vrai.
(Et dans le tout nouveau Farah il y a un personnage qui se prénomme Valerie, sans accent aigu, et qui n'est pas un cadeau. Ça, c'est juste pour la notation de coïncidence antinomique.)
▬▬—▬▬
En bonus : le billet relatif à ce week-end tourangeau.
20:15 Publié dans Affres extatiques, Chèvre, aucun risque, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)
dimanche, 05 octobre 2014
Vrai hasard lexical
Parfois, on parle du faux hasard des rencontres lexicales, l’impression – une fois que l’on a entendu ou lu (ou cru entendre ou lire ?) un mot pour la première fois – de le rencontrer sans cesse dans les semaines, les mois qui suivent. L’hypothèse la plus couramment avancée est qu’en fait la personne qui croit voir un mot pour la première fois l’avait déjà rencontré, mais sans y prendre garde, et que les occurrences ultérieures, si frappantes, sont le fait de cette prise de conscience retardée… d’où l’idée d’un « faux hasard ». (Il ne me semble pas qu’il y ait eu d’étude sur cette question. J’imagine que certains écrivains – Sarraute ? Leiris ? – ont pu en parler.)
Lundi ou mardi dernier, je tombai, par hasard, dans le Robert culturel, sur un haut de page où se trouvait le mot épreinte, et fus étonné de constater que le seul sens que je connusse de ce mot (les épreintes sont les excréments des loutres) n’y figurait pas, mais que la seule acception retenue par les auteurs du dictionnaire était un sens médical inconnu de moi. Or, le lendemain, ou le surlendemain, à la page 71 du Libera : « Ce qu’elle n’avait pas dit c’est qu’elle avait écourté son action de grâce pour une épreinte irrépressible, son affection congénitale lui jouant des tours… »
Il me semble qu’il y a là un vrai hasard, principalement du fait que ce mot est tout à fait rare (j’ai eu l’occasion de vérifier auprès de trois ou quatre proches que personne ne le connaissait, même dans son sens zoologique) : ainsi, tomber dessus dans le dictionnaire un jour ou deux avant de lire une des rares pages de prose française où il est employé, c’est un hasard. Ce qui me turlupine, c’est la chose suivante : si j’avais lu – comme il eût été possible, et même comme cela eût dû être – Le Libera il y a vingt ans, ou tout simplement il y a six mois, quand je l’ai finalement acheté, aurais-je été intrigué par ce sens médical, ou aurais-je conclu sans vérifier que Pinget faisait là une métaphore ? Dans cette seconde hypothèse, je n’aurais pas manqué de comparer cette analogie entre une figure (la Crottard) et une loutre avec les noms d’autres personnages (Loeillère, Lorpailleur, Latirail). Indépendamment de mes propres tergiversations et insuffisances lexicales, la question reste posée : Pinget emploie-t-il ce terme pour suggérer que ce que l’on entend, à ce moment-là, c’est la voix du pharmacien Verveine, ou, connaissant la signification zoologique, suggère-t-il un jeu onomastique ? [Plus loin dans le roman, la famille Ducreux boit à plusieurs gourdes : loutre → l’outre → la gourde / Le signifiant loutre suggère aussi l’outrance, l’autre (donc l’apocryphe et la hantise, thèmes éminemment pingetiens).]
08:38 Publié dans Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 02 octobre 2014
Le Libera
........ sans compter la luzerne et la vipérine et le silène enflé qui fait de si jolis pets quand on tape dessus ............
À l'exception peut-être d'un inédit qui m'avait laissé de marbre, je n'avais pas relu Pinget – un de mes modèles (mentors ? Maîtres ?) depuis une bonne quinzaine d'années. Le Libera, un des premiers livres de lui aperçus en librairie (librairie d'occasion, rue Sainte-Catherine à Bordeaux (je crois que le premier Pinget que j'aie vu en librairie, c'était à Dax, librairie Campus, en 1990 (Du nerf, je pense (curiosité de ce volume ultra-mince, de ce nom, et la griffe Minuit qui me fascinait)))), j'avais d'abord lu, sur le dos, Le Liberia, inculture religieuse oblige, plus que passion pour l'Afrique.
Plus tard, alors que je lisais par brassées tout ce qu'avait écrit Pinget, ce roman est resté hors champ, peut-être parce que j'avais trouvé un jour, dans une librairie du quartier Montparnasse, un exemplaire à 600 francs (c'était une première édition signée, je pense) ; comme j'ai toujours été assez aganit, et très peu bibliophile, cela, avec le titre et l'initiale erreur de lecture, m'a peut-être tenu éloigné encore de cet opus-ci. J'ai fini par l'acheter il y a quelques mois, en me disant que, si ça se trouve, je n'arriverai plus du tout à lire Pinget, je le connais trop bien, etc.
Or, j'ai commencé la lecture du Libera avant-hier soir, et le texte m'emporte, enrichi d'échos plus récents (Lobo Antunes, mais pas seulement, Claude Mauriac aussi), fort de cette structure de parlerie où chaque détail se transforme et s'altère imperceptiblement à chaque nouveau paragraphe, d'une phrase l'autre, la vérité se trouvant dans le creux de la voix (émanant du creux (Ducreux)) plutôt que dans une impossible véracité.
Dans la sublime postface (texte qui en dit plus long, en quatre pages, sur le roman français du XXème siècle que tout Genette et tant d'autres), Pinget rapproche sa démarche – ici – de L'Inquisitoire, qui constitue certainement un des monuments d'une œuvre monumentale.
.
12:12 Publié dans La Marquise marquée, Lect(o)ures, Pynchoniana | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 05 avril 2014
Descente des médiums (Quintane)
Entre Aristote qui propose la lecture organique, et mon enfance qui, pelucheuse, se complut à taquiner les acariens en bouquinant sur une descente de lit, le dernier livre de Nathalie Quintane est plus titillant que jamais. Descente de médiums, dont le titre parodie ou poursuit le célèbre texte de Breton (Entrée des médiums), est, dans la foulée des précédents livres de Quintane, un bricolage — creusement & accumulation.
Un mot, d’abord, sur l’effet réel de ces livres que je nomme bricolages. Le premier livre de Quintane, Chaussure, je l’ai découvert par hasard, à la médiathèque de Beauvais, en 1998, soit un an après sa sortie, et je l’ai lu soit dans mon salon à la moquette berbère (on vivait en appartement), soit dans les rues, souliers crevés, paletot pas mieux. Écriture titillante, qui agace, stimule, Quintane est du côté de la composition. L’effet réel de ses compositions (qui sont, tout autant, et largement, des juxtapositions) est d’irriter, de pousser à la marche. Je n’ai jamais réussi à poursuivre la lecture sans poursuivre mon ombre, ou, pourrais-je dire, me mettre en branle, me déplacer. Par exemple, ce déplacement signifie que, pour la troisième fois, j’aurai lu une bonne partie d’un livre de Quintane au Petit Faucheux. (Hier soir, en l’espèce, les pages 86 à 132. Le croisement Ygranka / Quintane est quasi idéal. J’y reviendrai.) Et donc : dans le hall, dans mon fauteuil d’orchestre, et aussi dans la rue, et même (ce fut le cas pour Tomates) en marchant place Gaston-Paillhou. (Et le faucheux est un insecte qui se déplace curieusement, si je tire sur ce fil vous n’avez pas fini de tirer la tronche.)
Descente des médiums, donc. Le déplacement se fait ici vers le bas : descente. L’accumulation, concept à garder dans un coin de la bobine. Dans le prologue, Quintane explique d’où part ce livre : d’une demande (commande) de l’amie qui lui avait demandé d’écrire Crâne chaud. On voit donc, selon un principe de révolution (qui lorgne du côté de Tomates) ou de palimpseste (Jeanne Darc), mille lecteurs décider d’un même mouvement de descendre dans la rue. Et commence alors l’accumulation de ces vingt-huit chapitres sur les médiums. Plus j’avance dans cette œuvre (l’ensemble des livres, pas ce seul fragment), plus je trouve que la méthode de Quintane est apparentée à celle de Ponge :
1. Il s’agit d’aller voir du côté intérieur de ce qui est extérieur.
2. Il s’agit d’agir par la composition (accumulation).
3. Il s’agit de donner à voir, au moins en partie, la fabrication de l’œuvre (l’œuvre en fabrique).
Ici, peut-être par la collusion des signifiants, le propos de Quintane [propos → Alain relisant Montaigne → Quintane et l’humanisme ? ou alors, si je tire sur un autre fil : rédaction → Robert Walser] rejoint la médiologie de Debray. Mais alors, attention ! assez de name-dropping ! plus un seul nom ! une aspirine ! et vite ! Mais alors : une médiologie drôle, une médiologie foutraque, une médiologie bricolée. [Tout sauf une médiologie ? Soit. Qu’il me soit permis de citer la page 128 : « En 62 on était gaulliste, maintenant on est parapsychologue. »]
Ce que Quintane appelle la radio, c’est l’ouverture aux voix, l’entrée des médiums, ici sous forme de glissement vers le bas, catabase ?? parturition ??? Les pages dans lesquelles elle reprend les propositions de mort de l’auteur (pp. 76-85) sont parmi les plus sidérantes et profondes que j’ai lues sur le sujet ►postuler la mort du lecteur ║appuyer sur la volatilité (gaz/gaze) de l’écriture. Je veux dire par là qu’il vaut mieux donner ces dix petites pages à lire que trois thèses sur le sujet. Ne parlons même pas des narratologues. [Ni aux narratologues, ils sont bien trop occupés à s’écouter eux-mêmes.]
Volatilité. L’auteur gazéifié est donc celui qui s’affirme paradoxalement dans l’accumulation d’hypothèses, de fictions, de jeux (dramatisés), ici quant à la spectralité vocale, l’expérience médiumnique, avec quelques solides fantômes en rayon (Christine de Pizan, Fitzgerald, Hugo, William James). La radio (voix) se heurte à l’un des points de départ évidents du livre, la photo (les polaroïds du thoughtograph Ted Serios). Cette série de descentes est donc aussi à fouiller, creuser (le noyau est-il sous nos pieds ?) l’extérieur du texte (le son et l’image), de sorte qu’une lecture possible de ce nouveau livre de Quintane est une lecture de l’impossible : impossible de dire la parole médiumnique, impossible de creuser en douceur, impossible de fabriquer durablement en bricolant, impossible de composer en accumulant… Où l'on en revient à l'effacement de la rationalité par la radio, voix intérieures débordant le cadre.
Bref, bref, bref (on n’en finit pas de diluer ce phatique BREF), qu’en ressort-il ? Allez-y voir vous-mêmes, dirai-je, paraphrasant Lautréamont. C’est un peu facile, tout de même. C’est un peu bref, jeune homme. Ce qu’il ressort aussi de Descente des médiums, c’est l’accès, par l’accumulation en écriture, à diverses pistes philosophiques. Le livre n’est ni tout à fait médiologique, ni du tout médiumnique : la parole gazéifiée [et intense ▲ elle pousse encore et toujours aux déplacements (ne vais-je pas aller relire quelques pages le long de l’avenue du Danemark empuantie par la merde de la station d’épuration qui a dû exploser ?)] de Quintane ne descend pas sur le lecteur, qui doit la creuser, plutôt comme une taupe. Or, on le sait : rien de moins évanescent qu’une galerie de taupe ——— rien de moins souterrain, non plus. On bute sur les pages comme sur des taupinières.
Descente immédiate, mind the gap.
Points laissés en suspens : les acariens — berbère — poursuivre mon ombre — le Danemark merdique — la fabrique — parturition [?] — Ted Serios
16:17 Publié dans Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 09 décembre 2013
Rue de Buci
Entre autres ouvrages — mais j'ai du mal à assurer un train assez conséquent en ce moment — je fais mes délices d'un roman de Claude Mauriac, La marquise sortit à cinq heures, le troisième d'une tétralogie intitulée Le Dialogue intérieur. J'ai lu, il y a bientôt (ou plus de ?) vingt ans deux tomes du journal de Claude Mauriac ; il fait, depuis lors, partie de ces écrivains dont je ne cesse de me dire qu'il faudrait que j'y revienne.
Le roman est un collage de paragraphes qui correspondent à des bribes de monologue intérieur émanant d'une quinzaine de personnages, dont le point commun est qu'ils se trouvent tous aux alentours du carrefour de Buci entre cinq et sept heures, un soir d'été. Dans le principe, le texte est très proche d'expérimentations du Nouveau Roman, lorgnant surtout du côté de Butor, mais pas si éloigné que cela, non plus du Perec topographe. L'organisation métonymique en cycles de romans penche du côté d'un autre Claude, que j'aime beaucoup, Claude Ollier.
Dans la forme des discours, l'influence du modernisme anglais (Woolf, sans doute, mais plus encore Ford Madox Ford — Claude Mauriac a-t-il pu lire Ford Madox Ford ?) est très présente, peut-être aussi par le prisme de deux autres écrivains généralement estampillés Nouveau Roman, Nathalie Sarraute et Robert Pinget. [Je ne sais pas si une étude comparée entre la géographie polydiscursive de Mauriac ici et le territoire faulknérien imaginaire de Pinget a été tentée ; toujours est-il qu'elle est tentante. [Je signale beaucoup, dans ce qui précède, quels auteurs ou projets romanesques ce roman m'évoque. C'est un point de départ, évidemment.]]
Aucune étude n'ayant été consacrée à la traduction de l'œuvre de ce Mauriac-ci, je compte me procurer les trois autres volumes de la tétralogie susdite, mais aussi les traductions anglaises, autant que faire se peut, afin d'examiner certains points. J'ai déjà en ma possession l'édition anglaise, The Marquise Went Out at Five. Ce sont les points suivants qui me frappent particulièrement, à mi-chemin (et je les note ici, c'est aussi commode) :
- structure du discours et intertextualité avec le modernisme anglais
- parler populaire / traduction des phrases fautives
- le citationnel
- les amplifications du rythme ternaire (cf l'incipit par exemple)
La raison pour laquelle je me résous à poster ces bribes d'un début de chantier ce soir, c'est en raison d'une double coïncidence. ╩╦ Mon épouse a acheté aujourd'hui un album des BB Brunes dont la sixième chanson s'appelle “Rue de Buci” ; elle a attiré mon attention sur le poème de Prévert, que j'avais oublié, pour le dire pudiquement, “La rue de Buci maintenant”, que j'ai donc lu et qui doit relever, versant Mauriac, d'une intertextualité délibérée.
21:51 Publié dans La Marquise marquée, Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 26 mai 2013
Schwitters en vitesse
Hier soir, j'ai lu, en quatrième vitesse (il s'agit d'un texte très bref) et, dois-je l'avouer, tout en faisant semblant de regarder la finale de la Ligue des champions (le football ne m'ntéresse plus du tout, ou alors seulement en regardant les matches avec Oméga ou en écrivant mes foutus distiques), le petit récit de Kurt Schwitters que les éditions Allia viennent de publier en édition bilingue, initiative que je salue — La Loterie du jardin zoologique. J'ai donc pu le lire en allemand (comme Kafka, qui me voit, par la grâce des proses courtes, faire des incursions régulières dans le fort volume de ses œuvres, mais contrairement à Arno Schmidt, que j'aime énormément et dont il va bien falloir que j'achète les romans en allemand, faute d'exemplaires disponibles à la B.U.), tout en regardant la traduction (ce qui m'a évité de devoir chercher Nilpferd, dans lequel seul (est-ce la fatigue ?) je n'aurais pas reconnu l'hippopotame, trop happé peut-être par les valeurs de néant du signifiant nil).
Le texte est très drôle, plus absurde sans doute que nonsensical — toutefois, plus je travaille sur la question du nonsense, moins j'ai le sentiment d'en savoir quelque chose : après tout, le nonsense est ce qui nous fuit, se dérobe à la catégorisation... En particulier, le dénouement est totalement rationnel, raisonnable, logique, même s'il est présenté de façon loufoque. Cela rejoint mon impression déjà ancienne (que ne confirme pas trop le texte donné en post-face (mais en français seulement [??!]) par Allia, Merz et Anti-Dada de Raoul Hausmann), selon laquelle les collages de Schwitters (et tout son Merzisme en quelque sorte) s'expliquent, se conceptualisent beaucoup plus facilement que la poésie d'un Tzara, par exemple, qui est ce que le dadaïsme a donné de plus dur et de plus durable (de plus admirable aussi). Ou est-ce le dadaïsme allemand qui fut d'emblée plus politique, plus adversatif... plus spartakiste ?
06:41 Publié dans BoozArtz, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 22 mai 2013
Les enfances Chino
Ce texte foisonnant, fait de redites, de reprises et d'élucubrations assumées (entre un marquage esthétique hérité du premier surréalisme et un travail formel plus élaboré), creuse, sans craindre prolifération ni prolixité, le motif de la rencontre entre une enfance briochine et de nombreuses œuvres (gravées ou peintes) de Goya. Nombreuses phrases brèves, abus des ruptures. Tel quel, et malgré son côté massif, le “roman” se prête, sans autre tripatouillage qu'un choix, la sélection, à un opéra, ou toute autre mise en voix : jouant sur des registres croisés complexes (populacier, puéril, savant, sportif, médiéval, litanique, latiniste, etc.), le “récit” appelle la scène et l'art lyrique.
Prigent semble tenter, non de circonscrire, mais, au contraire, de laisser déraper (halluciner) la parole du monde minuscule dont il fouille les recoins. Ce monde minuscule (petite communauté bretonne, enfance difficile à « faire parler » (j'en reviens toujours à ce qui est, pour moi, le modèle absolu, Kotik Letaiev (or, je m'avise, en mettant en forme aujourd'hui [22 mai] les notes manuscrites à l'encre rouge [du 13 mai], que Prigent a préfacé l'édition française de Glossolalie))) s'avère colossal parce que la langue doit, a pour tâche de, proliférer.
Pour l'hallucination, bien sûr, Goya se pose là.
Tenter de dire une enfance d'après-guerre et le monde pré-postmoderne au miroir des pointes de Goya, c'est ouvrir sciemment une boîte de Pandore.
D'ailleurs, dans l'adverbe sciemment, le français constitue le savoir sur la faille entre une découpe (qui fait gicler la parole) et le mensonge (qui explose ou cèle). — Explosion-dissimulante et giclure se retrouvent (trop) abondamment dans les (trop) nombreuses explorations scatologiques du texte. La surabondance scatologique ne m'a pas dérangé (ce qui serait accorder trop de poids à son caractère transgressif, devenu tout à fait trivial et inutile), mais elle me semble déséquilibrer le texte, le faire basculer trop souvent ou trop massivement dans le puéril/carnavalesque, aux dépens des autres voix qui travaillent ces enfances au pluriel.
Au cours de ma lecture, j'ai noté, comme à l'accoutumée, plusieurs références à telle ou telle page, pour telle ou telle incursion dans mon Livre des mines, ou d'excursions dans le texte des bords de Loire. J'espère ne pas les laisser décanter trop longtemps, en général cela se traduit par un ensevelissement sans exhumation.
Tout à trac, je dédie, in extremis, la publication de ce billet, en ce jour, à l'écrivain qui fête aujourd'hui son soixantième anniversaire, l'auteur de Sortie d'usine, Paysage fer, Limite, Tumulte et d'Après le livre (pour ne lancer qu'un nombre limité de rails). Après tout, Prigent, dans Les Enfances Chino, multiplie et démultiplie les variations autour du prénom François. Il n'y a pas qu'opportunisme chronologique contingent dans cette mienne dédicace.
vendredi, 03 mai 2013
3040 — « Comprendre »
Neuf fois sur dix, quand une personne inculte se plaint de ne rien comprendre à un objet culturel quelconque — qu’il s’agisse de littérature, de philosophie, de peinture, de musique, de cinéma ou d’art contemporain —, neuf fois sur dix il n’y a, sur le point particulier que cette personne met en avant comme étant hermétique entre tous, rien à comprendre. Ce qu’il y a à comprendre, c’est que ledit point particulier n’est pas à comprendre, justement, mais à aimer, à ressentir, à percevoir dans ses effets. Rien n’est plus difficile à appréhender, quand on n’y est pas préparé par l’éducation, que le défaut, l’absence, la simple présence, la présence par défaut, le défaut de la présence. Or il n’y a pas d’art recevable, ni de littérature bien sûr, ni de haute philosophie je crois bien, qui n’exige, de la part de qui s’y confronte, un consentement préalable à une rupture des enchaînements logiques, à un évanouissement provisoire ou définitif, éminemment jouissif dès lors qu’on s’en accommode, de l’intelligence et de l’intelligible.
(Renaud Camus, Journal 2013, entrée du 23 avril)
08:51 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 20 mars 2013
David : Auburn : Proof
I see whole landscapes — places for the work to go, new techniques, revolutionary possibilities.
(ROBERT, in Proof. NY : Dramatists Play Service, 2001, p. 60)
La semaine dernière, un collègue professeur de mathématiques – que je vois toutes les semaines lors de la séance d'éveil musical d'Oméga, et qui a une accréditation en enseignement théâtral et en anglais – m'a prêté son exemplaire d'une pièce de David Auburn, dramaturge américain dont j'avoue n'avoir jamais entendu parler auparavant.
Proof (c'est le titre de la pièce) tourne autour des figures d'un père et de sa fille, au titre d'un va-et-vient chronologique entre la semaine suivant le décès du père, grand mathématicien, et un moment-clé, quatre années auparavant. Robert, dont la présence (spectrale : ce qui est dissimulé : mise en abyme dramaturgique ?) au cours de la première scène ne cesse ensuite de hanter les conversations, a fait d'importantes découvertes quand il était très jeune, puis a sombré progressivement dans l'inertie, ainsi que dans une forme de folie graphomane. Le principal ressort dramatique de la pièce, c'est la découverte, dans ses papiers, d'une preuve qui est à même de révolutionner les mathématiques, et dont la paternité [j'emploie ce mot à dessein, je ne vais pas tout vous révéler] demeure largement hypothétique, jusqu'au rideau final.
Il va de soi que, dans une pièce de théâtre, on ne s'attend pas à trouver vraiment « des maths ». Toutefois, je suis presque frustré par le fait qu'il n'y ait que quelques allusions, une ou deux répliques détaillant telle ou telle théorie. Il s'agit surtout d'une réflexion sur la création, sur la confluence complexe entre l'inspiration et le travail, entre la flamme intérieure et tout ce qui est susceptible de l'éteindre. Certes, Auburn ne se contente pas de représenter les mathématiciens comme des créateurs en transposant le Van Gogh de Pialat ou, plus près de moi, chronologiquement, le Pierre de Melville. Les personnages sont vraiment des « matheux », brillants de surcroît, et qui parlent de leur travail, de leurs angoisses plutôt particulières. De manière marginale, cela m'a donné envie de relancer un de mes chantiers d'écriture sur principes arithmétiques, les Kyrielles de Kaprekar.
Je n'ai pas encore vérifié si l'œuvre d'Auburn avait été traduite ou jouée en France, mais je note juste, pour le moment, que les modèles d'écriture dramatique se trouvent, de manière évidente, du côté de Tennessee Williams. L'écriture elle-même est belle, à la fois efficace et profonde.
............¨¨¨¨¨.............
Update/ Je ne connaissais pas, jusqu'à la semaine dernière, le nom de mon collègue, mais, comme il l'a écrit sur son exemplaire, et comme je suis un sale petit curieux, j'ai fait une recherche sur Internet... et découvert qu'il a joué en 2001 dans Architruc de Robert Pinget, pièce que j'ai moi-même mise en scène en 1995 ! Les coïncidences ne cessent.
09:08 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 08 mars 2013
Soupault traduit par William Carlos Williams
Si tout à coup nous avions rencontré un être sans vie gisant sur le trottoir, baignant peut-être dans son sang ou appuyé contre un mur, nous nous serions immédiatement arrêtés, et cette nuit aurait été terminée.
(Philippe Soupault, Les dernières nuits de Paris, 1928, I)
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
If all at once we had encountered a lifeless form lying prostrate on the pavement, bathed perhaps in his own blood, or propped against a wall, we should have come immediately to a halt, and that night would have ended.
(Last Nights of Paris - traduction de William Carlos Williams, 1929)
Voici donc une pierre dans le jardin de ceux qui prétendent que les grands écrivains font nécessairement des traducteurs farfelus, et que le culte de la littéralité est une invention récente, post-structuraliste en quelque sorte. Giono traduisant Melville, oui, c'était un peu le grand n'importe quoi. Mais ne pas généraliser.
05:05 Publié dans Lect(o)ures, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (2)
mercredi, 13 février 2013
Balivernes déplorables
Charles Gould assumed that if the appearance of listening to deplorable balderdash must form part of the price he had to pay for being left unmolested, the obligation of uttering balderdash personally was by no means included in the bargain.
(Nostromo, I, 7)
J'ai cru me revoir pendant mes trois années à la direction du département d'anglais, quand je devais rencontrer certains collègues qui se prenaient pour des pontes, ou lors de certaines réunions.
(Philippe Vendrix et Bernard Buron, les rois du "deplorable balderdash")
02:37 Publié dans Autoportraiture, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 11 février 2013
The Great Holiday
Now a holiday has no connection with using a man either by beating or feeding him. When you give a man a holiday you give him back his body and soul. It is quite possible you may be doing him an injury (though he seldom thinks so), but that does not affect the question for those to whom a holiday is holy. Immortality is the great holiday; and a holiday, like the immortality in the old theologies, is a double-edged privilege. But wherever it is genuine it is simply the restoration and completion of the man. If people ever looked at the printed word under their eye, the word "recreation" would be like the word "resurrection," the blast of a trumpet.
A man, being merely useful, is necessarily incomplete, especially if he be a modern man and means by being useful being "utilitarian." A man going into a modern club gives up his hat; a man going into a modern factory gives up his head. He then goes in and works loyally for the old firm to build up the great fabric of commerce (which can be done without a head), but when he has done work he goes to the cloak-room, like the man at the club, and gets his head back again; that is the germ of the holiday. It may be urged that the club man who leaves his hat often goes away with another hat; and perhaps it may be the same with the factory hand who has left his head. A hand that has lost its head may affect the fastidious as a mixed metaphor; but, God pardon us all, what an unmixed truth! We could almost prove the whole ease from the habit of calling human beings merely "hands" while they are working; as if the hand were horribly cut off, like the hand that has offended; as if, while the sinner entered heaven maimed, his unhappy hand still laboured laying up riches for the lords of hell. But to return to the man whom we found waiting for his head in the cloak-room. It may be urged, we say, that he might take the wrong head, like the wrong hat; but here the similarity ceases. For it has been observed by benevolent onlookers at life's drama that the hat taken away by mistake is frequently better than the real hat; whereas the head taken away after the hours of toil is certainly worse: stained with the cobwebs and dust of this dustbin of all the centuries.
G.K. Chesterton. Utopia of Usurers (1917).
17:30 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 31 décembre 2012
Carillons, vrais sauniers
Pour l'intelligence de ce qui va suivre, quelques explications au sujet de la Saunerie sont nécessaires sur ce qu'on appelait la gabelle et les faux-sauniers.
Ce nom de gabelle fut d'abord commun à plusieurs taxes. Plus tard, il fut uniquement appliqué à la taxe du sel, dont le monopole constituait un des plus gros revenus de la monarchie. «Autrefois, dit Boullet, qui nous fournit ces renseignements, le roi avait seul le droit de fabriquer et de vendre le sel, ainsi que d'en fixer le prix. On était, en outre, obligé d'acheter au roi une quantité déterminée de sel, avec défense de revendre ce qu'on avait de trop; de là l'impopularité qui, tant qu'elle dura, s'était attachée à cette taxe inique et vexatoire.
Et il tenait ferme à son monopole, ce bon roi de France, tant et si bien qu'il faisait pendre tout pauvre diable qui se laissait pincer en contrebande de sel. C'était le procédé dont usait la monarchie pour attaquer son monde en concurrence déloyale.
Voilà pourquoi le grand-père de Pancrace, faux-saunier qui était jadis tombé entre les mains des gens du roi, avait été accroché à la maîtresse branche de l'arbre qui abritait la maisonnette où il cachait son sel de contrebande.
En 1800, époque du présent récit, il y avait dix ans déjà que le monstrueux impôt avait été aboli.
Tout en parlant de la mort du grand-père de Pancrace, le policier n'avait pas quitté des yeux la branche qui avait jadis servi de potence à l'infortuné faux-saunier. Que voyait-il?
18:31 Publié dans Lect(o)ures, PaperPestPaste, Pynchoniana | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 22 novembre 2012
Rencontre avec Amit Chaudhuri (site Tanneurs, 22 novembre 2012)
Ce jeudi 22 novembre, le grand écrivain, critique et musicien indien Amit Chaudhuri nous a fait l’honneur de venir à la rencontre des collègues et des étudiants, notamment autour de son dernier roman, The Immortals, dont la traduction vient de paraître aux éditions Aux Forges de Vulcain (Les Immortels).
La rencontre, qui a été filmée in extenso et sera visible sous peu sur le site de l’Université, n’a été possible que grâce à l’entregent efficace de Stephen Romer, distingué poète et collègue éminent, et au travail toujours précieux de Chandani Lokugé, qui ne ménage aucune piste lors de ce semestre de résidence. C’est d’ailleurs à la suite de sa présentation du roman de Chaudhuri le 28 septembre dernier qu’est née l’idée de cette rencontre. Cet événement, qui avait été annoncé sur les réseaux sociaux, dans La Nouvelle République et sur le site Web de Livre Au Centre, a eu lieu dans la salle de conférences du 5ème étage de la Bibliothèque des Arts et Lettres (site Tanneurs). Le public était composé d’une quinzaine de collègues et d’une quarantaine d’étudiants de tous niveaux (surtout L1 et L3, mais aussi quelques étudiants de Master – ceux qui sont censés être le plus motivés…).
Amit Chaudhuri a lu deux extraits de son roman, et répondu à plusieurs questions, sur le personnage de Nirmalya, sur les lieux, sa situation particulière au sein des études « post-coloniales », mais aussi la « révélation théologique » que constitue l’expérience musicale. Grâce à la diffusion d’extraits de son œuvre de musicien classique, mais aussi de morceaux appartenant à son répertoire plus personnel (le double projet not fusion), un échange s’est amorcé autour de la pratique musicale, et du sens qu’il donne à ces approches multiples d’une grande complexité.
Subtile, profonde, émouvante, tout en restant éminemment lisible, l’œuvre d’Amit Chaudhuri demande à être découverte, prise à bras-le-corps. Je chroniquerai prochainement ma lecture des Immortals, ainsi que la traduction fraîchement publiée.
 Lors du déjeuner, à la Deuvalière, j’étais le seul non-écrivain des convives : entre Amit, Stephen (qui est pléiadisé, tout de même) et Chandani (dont je traduis en ce moment plusieurs textes, inédits ou parus chez Penguin), il y avait de quoi être intimidé. Après le repas, j’ai raccompagné Amit à son hôtel, et lui ai montré, au passage, dans le jardin de l’archevêché, le cèdre bicentenaire et l’éléphant empaillé, Fritz, icône tourangelle qui a tellement marqué Chandani qu’elle va peut-être lui consacrer une nouvelle !
Lors du déjeuner, à la Deuvalière, j’étais le seul non-écrivain des convives : entre Amit, Stephen (qui est pléiadisé, tout de même) et Chandani (dont je traduis en ce moment plusieurs textes, inédits ou parus chez Penguin), il y avait de quoi être intimidé. Après le repas, j’ai raccompagné Amit à son hôtel, et lui ai montré, au passage, dans le jardin de l’archevêché, le cèdre bicentenaire et l’éléphant empaillé, Fritz, icône tourangelle qui a tellement marqué Chandani qu’elle va peut-être lui consacrer une nouvelle !
(Photo : Amit Chaudhuri et Stephen Romer, rue des Tanneurs.)
22:10 Publié dans Lect(o)ures, Studium Chandani LOKUGE, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 29 octobre 2012
Le soi-disant poète du taxi, dans la neige barcelonaise
 Il a tout à coup ralenti pendant quelques secondes le rythme de ses questions, mais uniquement pour faire un retour encore plus en force et me dire que l'art avait un peu à voir avec l'acquisition de la quiétude au sein du chaos. La quiétude intrinsèque aussi bien de la prière que de l'œil de l'ouragan, a-t-il rondement conclu. Puis il s'est tu complètement. Un moment poétique digne des applaudissements d'un théâtre bondé parce qu'il m'a permis de me concentrer et de penser à l'œil même de cette tempête de neige qui dévastait Barcelone. Mais il est vrai que je n'ai connu la véritable quiétude que lorsqu'il est enfin descendu du taxi.
Il a tout à coup ralenti pendant quelques secondes le rythme de ses questions, mais uniquement pour faire un retour encore plus en force et me dire que l'art avait un peu à voir avec l'acquisition de la quiétude au sein du chaos. La quiétude intrinsèque aussi bien de la prière que de l'œil de l'ouragan, a-t-il rondement conclu. Puis il s'est tu complètement. Un moment poétique digne des applaudissements d'un théâtre bondé parce qu'il m'a permis de me concentrer et de penser à l'œil même de cette tempête de neige qui dévastait Barcelone. Mais il est vrai que je n'ai connu la véritable quiétude que lorsqu'il est enfin descendu du taxi.
Enrique Vila-Matas. Air de Dylan (traduction A. Gabastou). Bourgois, 2012, p. 305.
13:33 Publié dans BoozArtz, Lect(o)ures, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 16 octobre 2012
Bahala na !
J'ai fini de lire The Match de Romesh Gunesekera. « Presque fini » serait plus juste : je me suis gardé, exprès, les sept ou huit dernières pages pour ce soir. L'écriture de Gunesekera – qui a atteint les plus hauts sommets, selon moi, avec Heaven's Edge, livre absolument magnifique et bousculant – s'est un peu attiédie ici. Tant le protagoniste que son parcours font songer au roman de Jamal Mahjoub, Travelling with Djinns.
 C'est le séjour, dans le cadre de la Chaire Studium, pour un semestre entier, de Chandani Lokugé dans notre Université qui m'a replongé totalement dans le Sri Lanka. La semaine dernière, j'achevais Turtle Nest. Et là, après The Match – parabole historique ? Underworld à la sri lankaise ? roman philippin ? — j'enchaînerai avec Softly As I Leave You, le dernier roman de Chandani. Fin novembre et début décembre, j'organiserai avec elle un atelier de deux ou trois séances consacré à la traduction de certains extraits de ces deux romans. Son dynamisme et son hyperactivité me font bien plaisir, ont dynamité un peu le début d'année, sinon terne ou simplement laborieux, de sorte que je me suis retrouvé propulsé avec le comité d'organisation du festival « Voix d'ici, voix d'ailleurs », ou encore à discuter de Ronsard avec elle pendant un bon bout de temps, sans compter le projet de programme d'hiver à mettre en place chez nous à destination des étudiants australiens non francophones.
C'est le séjour, dans le cadre de la Chaire Studium, pour un semestre entier, de Chandani Lokugé dans notre Université qui m'a replongé totalement dans le Sri Lanka. La semaine dernière, j'achevais Turtle Nest. Et là, après The Match – parabole historique ? Underworld à la sri lankaise ? roman philippin ? — j'enchaînerai avec Softly As I Leave You, le dernier roman de Chandani. Fin novembre et début décembre, j'organiserai avec elle un atelier de deux ou trois séances consacré à la traduction de certains extraits de ces deux romans. Son dynamisme et son hyperactivité me font bien plaisir, ont dynamité un peu le début d'année, sinon terne ou simplement laborieux, de sorte que je me suis retrouvé propulsé avec le comité d'organisation du festival « Voix d'ici, voix d'ailleurs », ou encore à discuter de Ronsard avec elle pendant un bon bout de temps, sans compter le projet de programme d'hiver à mettre en place chez nous à destination des étudiants australiens non francophones.
Turtle Nest est un très beau roman, très équilibré, qui s'inscrit dans une forme de modernisme classique, si j'ose ce qui pourrait sembler un paradoxe, et qui s'achève sur une pointe narrative aussi efficace qu'inattendue. Si j'ai bien compris les allusions de Chandani lors de notre promenade dans les jardins du Prieuré, il s'articule autour d'un symbolisme complexe (animaux, éléments naturels) dont tout ou presque doit m'échapper.
Entre ses diverses tâches au titre de la chaire Studium, Chandani a commencé d'écrire un roman dont l'action se passera, au moins en partie, en Touraine. Après-demain, je vais lui faire découvrir le manoir de La Possonnière ; si nous avons assez de temps, j'essaierai de lui montrer d'autres beaux sites voisins de Couture, quoique le très beau château de Poné n'ouvre au public qu'en été.
Nous verrons. Bahala na. Bahala na kayo ! (The Match, p. 255)
14:03 Publié dans Hors Touraine, Lect(o)ures, Résidence avec Laloux, Studium Chandani LOKUGE, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 22 septembre 2012
Défrichais frayé
La bibliothèque de Queen's devait répondre à mes sollicitations d'archives, je ne défrichais sans doute pas un terrain vierge, mais peu frayé, oui, à l'époque.
(Claude Ollier. Missing. P.O.L., p. 56)
20:44 Publié dans Chèvre, aucun risque, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 12 septembre 2012
L'Année terrible
Sitôt que le char marche, il se met à crier.
Suite à des cheminements plutôt complexes, je me suis replongé, depuis hier, dans L'Année terrible. Toujours eu un faible pour ce recueil, que je n'avais peut-être pas ouvert depuis dix ans, et, à coup sûr, pas réellement lu depuis la fin de mon adolescence. Je suis heureux de voir que les poèmes m'en semblent toujours aussi forts, que la parenté avec les Tragiques me frappe toujours autant, et, pour finir, que je continue de ne pas comprendre du tout l'espèce d'arrière-plan ou de seconde zone dans lequel (laquelle ? mince, ça m'apprendra à me regarder écrire) la poésie de Hugo est rejeté(e?) depuis un gros quart de siècle, voire plus. N'est-il pas possible d'aimer Baudelaire, Verlaine, Mallarmé et Hugo ? je ne vois pas d'incompatibilité, ou alors c'est moi qui suis coupable de ne pas trancher.
je défends
Terrassés ceux que j'ai combattus triomphants
J'ai parcouru aussi la préface qu'Yves Gohin a pondue pour l'édition NRF-Poésie ; elle m'avait agacé jadis, et m'agace encore. Gohin voudrait que, dans le corpus hugolien, L'Année terrible se situe plusieurs tons en-dessous des Contemplations et des Châtiments. Pas d'accord, là encore. C'est la même voix empreinte de douceur et d'abîme, le même souffle puissant, le même travail sur le vers, qui parvient à surprendre encore jusqu'au lecteur blasé de 2012 que je suis devenu. Dans sa structure, c'est un recueil foudroyant. Dans ce qu'il nous dit de la débâcle de 70 et des affres d'une impossible renaissance, il brûle les yeux. Dans son lyrisme même, il est épique.
Ivres, ils vont au gouffre obscur qui les attend.
Je me rappelle que, lorsque j'étais tombé sur ce recueil, aux alentours de 1990, j'avais été surpris : moi qui étais très hugolien (j'avais lu, en Pléiade, la totalité de son théâtre, sans toujours tout comprendre bien sûr, en classe de 4ème, en 1986-7), je ne connaissais même pas l'existence de ce livre, et avais d'abord songé qu'il s'agissait d'un florilège. Il me revient aujourd'hui. Pourtant, il était là, toujours, sur les rayonnages.
Sans cesse, le relisant, je voyais la Libye de 2011, je songeais à la Syrie d'aujourd'hui. Et cette "actualité" du poème a beau n'être souvent qu'un cliché doublé d'une fadaise, elle bouleverse quand on la ressent vraiment.
Ô flot, c'est bien. Descends maintenant. Il le faut.
08:20 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 02 juillet 2012
Les fastes de Gargantua
Qu'à un moment donné drogue et tennis furent fastidieux, et toute cette fin de juin, pourtant, resta sans lecture. Le golf vu comme un jeu de billard sur une table immense, tout en rage anale et bérets à carreaux. [163]Garçon de guinguette, une bière ! on étouffe ici, se désosse, s'assoiffe.
Et dire aussi que quand on défèque, c'est comme si on priait – posture tendre d'amen au monde. [103]
Et les cafards volants, les cafards entre les draps et sur les murs, [45] les cafards que vous hallucinâtes, cafards tisseurs de toile et cafards au fond des placards, obscurs grouillements dans la perte sauvage des moindres repères.
Tu me demandes comment on prononce désosser et tu me demandes ce que veut dire… ce que veut dire quoi, déjà? écoute les trompes, nous réfléchirons plus tard, en posture d'acceptation.
In this dream, which every now and then still recurs, I am standing publicly at the baseline of a gargantuan tennis court. I'm in a competitive match, clearly: there are spectators, officials. The court is about the size of a football field, though, maybe, it seems. It's hard to tell. But mainly the court's complex. The lines that bound and define play are on this court as complex and convoluted as a sculpture of string. There are lines going every which way, and they run oblique or meet and form relationships and boxes and rivers and tributaries and systems inside systems: lines, corners, alleys, and angles deliquesce into a blur at the horizon of the distant net. I stand there tentatively. The whole thing is almost to involved to try to take in all at once. It's simply huge. And it's public. A silent crowd resolve's itself at what may be the court's periphery, dressed in summer's citrus colors, motionless and highly attentive. A battalion of linesmen stand blandly alert in their blazers and safari hats, hands folded over their slacks' flies. High overhead, near what might be a net-post, the umpire, blue-blazered, wired for amplification in his tall high-chair, whispers Play. The crowd is a tableau, motionless and attentive. I twirl my stick in my hand and bounce a fresh yellow ball and try to figure out where in all that mess of lines I'm supposed to direct service. I can make out in the stands' stage-left the white sun-umbrella of the Moms; her height raises the white umbrella above her neighbors; she sits in her small circle of shadow, hair white and legs crossed and a delicate fist upraised and tight in total unconditional support.
The umpire whispers Please Play.
We sort of play. But it's all hypothetical, somehow. Even the 'we' is theory: I never get quite to see the distant opponent, for all the apparatus of the game.
[...]
– the deflated bladder had landed in the Marching Terriers’ sousaphone player’s sousaphone and had been handed over to Joelle after extrication by the lardy tubist, sweaty and dumb under the girl’s Actaeonizingly imploring gaze –
10:18 Publié dans Ecrit(o)ures, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 25 avril 2012
Let The Great World Spin
Le roman le plus récemment lu, assez poussivement en raison du manque de suivi, m’avait été recommandé par une collègue irlandisante, à la Saint-Patrick – ça ne s’invente pas – et avec la promesse que c’était un chef-d’œuvre absolu. Il s’agit du grand roman de Colum McCann, Let The Great World Spin, qui n’a rien d’un chef-d’œuvre. Tout – à commencer par le style, très académique, de McCann – donne une impression de déjà-lu. Rien ne dépasse, en quelque sorte, ce qui est fâcheux pour un texte dont le motif central est l’exploit de Philippe Petit, funambule qui fit tout un numéro d’équilibre, le 7 août 1974, entre les deux tours du World Trade Center, au niveau du 110ème étage. Le croisement de deux époques (les années 60, avec le Viêtnam, et les années 2000) et de deux contrées (l’Irlande et la Nouvelle-Angleterre) s’inscrit dans un récit à plusieurs narrateurs non récursifs. McCann pense tout ce qu’il est bon de penser (sur les minorités, sur la guerre, sur les drogués, sur l’amour), et écrit comme il faut écrire au début du 21ème siècle : d’une manière léchée, classique, tout en empruntant un certain nombre de ressorts aux avant-gardes narratives des années 70-80. L’ensemble est tout à fait middle-brow, et semble préfabriqué pour ces gens qui emportent un Amélie Nothomb sur la plage en se croyant terriblement supérieurs à ceux de leurs voisins qui se servent, pour pare-soleil pendant la sieste, d’un Musso ou d’un Marc Lévy. Entre autres, la façon dont les vies des différents protagonistes/narrateurs se croisent n’a plus rien de surprenant (mais ce jugement vient de quelqu’un qui a trouvé, en le revoyant il y a quelque temps, que Mystery Train de Jarmusch avait très mal vieilli).
Je suis plutôt méchant, et vais m’amender en citant quelques passages particulièrement réussis.
Old domino players sat in the courtyard, playing underneath the flying litter. The sound of the plastic bags was like rifle fire. If you watched the rubbish for a while you would tell the exact shape of the wind. Perhaps in a way it as alluring, like little else around it: whole, bright, slapping curlicues and large figure eights, helixes and whorls and corkscrews. (Bloomsbury, 2009, p. 31)
The men sat rooted like Larkin poems. (p. 33)
She wore a ring on her right hand, twirling it absently. There was a grace and a toughness about her, entwined. (p. 57) – Je pense avoir noté ces phrases car j’écoutais, au moment où je les ai lues, l’album des deux saxophonistes Urs Leimgruber et Evan Parker, dont les titres sont Twine, Twirl et Twist. Je ne minimise jamais ce genre de coïncidence ; elles sont le sel de l’art.
[Blaine] was a dynamo of ambition. Another film, Calypso, had Blaine eating breakfast on the roof of the Clock Tower Building as the clock behind him slowly ticked. On each of the clock hands he had pasted photographs of Vietnam, the second hand holding a burning monk going around and around the face. (p. 123)
Billy recited pages from Finnegans Wake in my ear. The father of fornicationists. He had learned twenty pages by heart. It sounded like a sort of jazz. Later I could hear his voice ringing in my ear. (p. 125)
Enfin, je voulais donner in extenso (déformation professionnelle oblige) un très bon sujet de version, mais n’ai pu copier-coller à partir du site Wattpad. Le passage commence à « The lack of money didn't bother my mother too much. » (pp. 286-8 de l’édition Bloomsbury).
11:01 Publié dans Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 24 avril 2012
Différance des vacances
Ce matin, je me suis réveillé avec cette fatigue et cet interminable rhume d’une quinzaine chevillé au corps, à quoi s’ajoute une quasi-paralysie de l’omoplate gauche. Il n’est pas question de retourner voir le médecin, chez qui j’étais encore hier. Nous semblons revenus à l’ère de Molière, et pas seulement parce que le nouveau Pétain prononça, à Longjumeau, un discours dénué de véritables liens logiques – et voilà pourquoi votre fille est muette.
Dans l’intervalle, sans se laisser abattre, il faut goûter les Images de Debussy. Au salon, j’ai lu plusieurs des pastiches de Bret Harte rassemblés dans un volume intitulé Condensed Novels, et qui, pour ne pas être très élaborés stylistiquement (qu’est-ce qu’un pastiche sans absolu mimétisme ?), sont tout à fait drôles (Kipling, Dickens, Dumas). À l’étage, en aidant Oméga à bâtir sa forteresse en Kapla, j’ai poursuivi ma lecture des poèmes-conférences de David Antin (i never knew what time it was). Ils sont fascinants, et – at times – prodigieusement agaçants.
Il m’est arrivé, en regardant les résultats détaillés des élections dans tel ou tel département, de songer à rouvrir un nouvel album de limericks, pourquoi pas berrichons ou vexinois ?
15:08 Publié dans Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 15 avril 2012
Intermittences : sur quelques phrases d’Anthony Powell
Jeudi soir, tard, j’ai terminé la lecture de The Soldier’s Art, huitième volet de la dodécalogie d’Anthony Powell. Je crois avoir lu les 6 premiers tomes vers 2007-2008, avant de devenir directeur du département d’anglais en tout cas. J’y suis donc revenu, avec la trilogie militaire, dont seul le dernier tome – The Military Philosophers – me reste à découvrir.
J’y suis revenu, avec des sentiments mitigés. La lecture en est tout à fait plaisante, stimulante, même s’il me semble que le travail stylistique s’y émousse. Le côté « Proust de second rayon » est moins présent, ce qui, finalement et sans paradoxe, diminue le charme, voire la qualité d'écriture. On le retrouve toutefois par intermittences. Qu’on en juge :
The potential biographies of those who die young possess the mystic dignity of a headless statue, the poetry of enigmatic passages in an unfinished or mutilated manuscript, unburdened with contrived or banal ending. (The Valley of Bones, p. 197)
Il s’agit plus d’influence proustienne que de décalques jamesiens, comme lors de la description d’un bombardement aérien à l’époque du Blitz :
Out of this resplendent firmament – which, transcendentally speaking, seemed to threaten imminent revelation from on high – slowly descended, like Japanese lanterns at a fête, a score or more of flares released by the raiding planes. Clustered together in twos and threes, they drifted at first aimlessly in the breeze, after a time scarcely losing height, only swaying a little this way and that, metamorphosed into all but stationary lamps, apparently suspended by immensely elongated wires attached to an invisible ceiling. (The Soldier’s Art, p. 11) *
La semaine dernière, je citais un extrait de The Valley of Bones (tome VII, et 1er volet de la trilogie militaire). Sur la même page se trouve, toujours dans la bouche de Dick Umfraville, un jugement général, misogyne et galvaudé sur les femmes (“The answer was always no. Then one day she changed her mind, the way women do.”), ce qui m’a fait sourire. (Stratégie narrative difficile à démêler ici.)
Je n’ai pas vérifié si les douze romans de Powell qui composent ce cycle intitulé A Dance to the Music of Time, et que je lis dans l’édition Heinemann cartonnée que possède la B.U. de Tours, ont été traduits. Il me semble que traduire et publier ces romans maintenant aurait quelque chose de terriblement délicat, ainsi que d’éminemment suranné. Par exemple, toujours dans The Valley of Bones (p. 117) :
We were squadded by a stagey cluster of glengarry-capped staff-sergeants left over from the Matabele campaign, with Harry Lauder accents and eyes like poached eggs.
Comment, dans une traduction, saisir sans l’effriter le mille-feuilles culturel que constitue une seule phrase ?
Un autre passage qui m’a beaucoup amusé, dans The Soldier’s Art cette fois, et notamment en raison d’associations montypythoniennes ** qui relèvent ici de la coïncidence, ou – mieux – du plagiat par anticipation, donnerait, à la traduction, quelque fil à retordre :
‘How went the battle, Derrick ?’ he asked. […] ***
‘Pretty bloody, Eric,’ he said. ‘Pretty bloody. If you want to know about it, read the sit-rep.’
‘I’ve read it, Derrick.’
The assonance of the two colonels’ forenames always imparted a certain whimsicality to their duologues****.
‘Read it again, Eric, read it again. I’d like you to. There are several points I want to bring up later.’
‘Where is it, Derrick?’ (The Soldier’s Art, pp. 35-6)
Dans un registre moins satirique, il me semble important de clore ces quelques remarques éparses en citant un paragraphe où se mêle trois métaphores essentielles du cycle dans son entier – le jeu, la musique, la stratégie militaire :
This was an unexpected trump card for Stevens to play. Moreland, always modest about his own works, showed permissible signs of pleasure at this sudden hearty praise from such an unexpected source. Music was an entirely new line from Stevens, so far as I knew him, until this moment. Obviously it constituted a weapon in his armoury, perhaps a formidable one. He had certainly opened up operations on an extended front since our weeks together at Aldershot. (The Soldier’s Art, p. 135)
* Je dois à la vérité de préciser que j’écris ce billet, recopie ces citations, tout en écoutant un très beau duo d’Evan Parker et Urs Leimgruber, ce qui, par crépitements, démontre assez combien je mets en pratique le principe fondamental d’un de mes maîtres, Isidore Isou, et donc ce procédé – la discrépance – consiste ici à recopier des phrases à l’architecture ample et mesurée tout en étant profondément imbibé de sonorités que même le qualificatif de free ne suffit plus à décrire. Qu’il soit dit, au passage, que ce principe même est au centre d’une série de textes sur l’autre blog (Unissons).
** En l’espèce, que cette séquence animée, toute en nonsense et cochons tirelires, me soit immédiatement venue à l’esprit n’a rien de fortuit : le modèle commun des deux textes (Python & Powell) n’est-il pas le duo Tweedledum&Tweedledee du brave révérend Dodgson ? Ou l'auteur du bref sketch animé (Gilliam lui-même ?) aurait-il lu The Soldier's Art (publié en 1966, soit trois ou quatre ans avant la saison 2 du Flying Circus) ?
*** Le passage que j’omets de citer est tout à fait long, je dois le signaler, et très savoureux. À un universitaire, les deux colonels sont susceptibles d’évoquer quelques infernaux mandarins, par exemple Jean-Jacques Tatin et Elisabeth Gavoille.
**** Toujours j’écoute Evan Parker et Urs Leimgruber. Le terme de duologue leur siérait à merveille. Ce sont à la fois les nymphes de Mallarmé/Debussy et les camelots de la foire. Quelle merveille !
12:12 Publié dans BoozArtz, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 06 avril 2012
L’Œuvre dard
Dans le reportage sur l'incendie de Lunéville, à la télévision, on vit sortir à dos de pompier (il aurait été enchanté) un portrait du maréchal Lyautey (Clemenceau : « Parmi tous mes ministres, il n’y en a qu’un qui ait des couilles au cul, c’est Lyautey – et encore ce ne sont pas les siennes ! ») Mais beaucoup d’œuvres d’art ont péri, sans doute autrement précieuses.
(Renaud Camus. Rannoch Moor. Fayard, 2006, p. 14)
'That was it,' said Umfraville. 'I expect you've heard of a French marshal called Lyautey. Pacified North Africa and all that. Do you know what Lyautey said was the first essential of an officer? Gaiety. That was what Lyautey thought, and he knew his business. His own ideas of gaiety may not have included the charms of the fair sex, but that's another matter. Well, how much gaiety do you find among the palsied crackpots you serve under? Precious little, you can take it from me. It was my intention to master a military career by taking a leaf out of Lyautey's book - not as regards neglecting the ladies, but in other respects.
(Anthony Powell. The Valley of Bones. Heinemann, 1964, p. 152)
10:14 Publié dans Corps, elle absente, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 23 mars 2012
Cock & Bull (Will Self)
Lu il y a déjà deux semaines et demie, dans le train, entre Tours et Bordeaux. En fait, je n’ai lu que le premier des deux récits, Cock : A Novelette. Dans le train, c’était l’idéal, puisque la scène du récit (pas l’histoire, mais l’endroit où elle est racontée et se dénoue – tragicomiquement) est un compartiment de train. Dans la mesure où il s’agit évidemment d’un diptyque, je ne devrais pas rendre ce livre à la B.U. (ah, que deviendrais-je sans la B.U. ? quand je pense aux centaines (peut-être va-t-on jusqu’au millier, en comptant les années oxoniennes et nanterroises) de livres que j’ai lus depuis des années sans les acheter et sans en encombrer mes étagères !) sans avoir également lu Bull : A Farce. Mais si jamais je devais manquer de temps, eh bien, je prends au moins quelques minutes pour noter ici, en vrac (après tout, plus personne ne me lit et je peux mettre le oaï dans mes propres carnets), les bribes manuscrites issues du voyage ferroviaire.
* Le genre de la novelette, inventé par Will Self dans ce qui doit être un geste de titrage parodique, trouve tout son sens dans le sujet de ce récit, l’hermaphrodisme (plus français qu’italien, plus novelette que novella). Autre jeu sur les signifiants : l’épouse de Dan, Carol, est – en tant que narrateur – « the Don ». Outre le côté très « vieille Angleterre » de la dénomination, il y a sans doute un jeu sur le sous-texte mafieux, voire quelque chose à creuser du côté de Cholokhov (dont le pavé a pour titre, en anglais, And Peaceful Flows the Don), ou du boustrophédon Don/Nod (le pays de Nod > refuge et punition de Caïn (l’errance)).
* Le récit consiste en fait en un viol du narrataire (le narrateur est tout autant pro- qu’anta-goniste, hybride aussi en cela). L’antisémitisme de l’hermaphrodite (complexe, ambivalent).
* Le pénis de Carol : « Was it just her imagination, or could she, with her probing digit, actually feel some kind of structure to the frond ; some internal viscosities of its own that suggested that it was not simply a raggle-taggle end of gristle, but something sensate ? » (p. 30)
* Sexualité et quasi-redoublements: «I doubt your ability to endure the trufflings and mufflings beneath the patterned cover. […] He nuzzled and snuffled, little bleatings issued from his lips. » (p. 65)
* La bière mauritanienne: “Black Mambo” (p. 85). (Il semble que ce soit une pure invention de Will Self.)
* Couleurs et allitérations : « Carol did her best to blush, but all it really amounted to was a beige tinge at the edges of her foundation. ‘Oh, oh, that.’ Dan was far better at it, he went puce to the roots. » (p. 102)
* Viol et quasi-redoublement: « Defiled me insofar that as he raped me he screamed and ranted, gibbered and incanted the most awful mish-mash. » (p. 125)
09:59 Publié dans Lect(o)ures, Pynchoniana | Lien permanent | Commentaires (5)
lundi, 19 mars 2012
Chronique de la dérive douce
Jeudi soir, dehors sur la terrasse, j’ai lu – tout en surveillant mon cadet, qui jouait au rugby – la première moitié de Chronique de la dérive douce, le dernier Dany Laferrière, et en tentant d’en traduire en anglais au fur et à mesure, in petto, les strophes. C’est un texte pour lequel, au jugé, une traduction de premier jet prendrait, tout au plus, une vingtaine d’heures. (Je ne cesse de blâmer, sans pouvoir l’empêcher, l’invasion de mes phrases par une foule de circonstants.) Ce dernier roman du Haïtien, je l’ai poursuivi au salon samedi – je crois – puis terminé dans le fauteuil, sur le palier à l’étage, dimanche matin, tout en surveillant encore le cadet, et de sorte qu’au fur et à mesure que je lisais ce livre, je m’élevais dans l’espace. Comme j’ai lu en parallèle, et en alternance, l’églogue hivernale de Renaud Camus, j’ai noté la strophe suivante, à la page 175 :
Je lis tout en buvant
du thé chaud,
soir d’hiver,
le poème où Nelligan écrit
avec une ardeur romantique :
« Ma vitre est un jardin
de givre. »
→ Montréal. L'hiver. Le givre. la citation.
↓ (Lundi. Rayons. Tout le couloir sent le vinaigre blanc.)
15:13 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 04 mars 2012
Brisées dominicales
Entre Orthez et Bordeaux, achevé la lecture du roman de Libar M. Fofana (L'étrange rêve d'une femme inachevée - un texte courageux, dense, acéré et flaubertien dont j'espère avoir le temps et l'occasion de reparler prochainement dans ces pages), puis de Briar Rose, bref récit éclaté (avec variations) par lequel Robert Coover réécrit le conte de la Belle au Bois dormant (j'avais lu, trois jours plus tôt, Snow White de Donald Barthelme - plus déjanté).
Entre Bordeaux et Challais, après m'être restauré au Mitico, un infâme bar PMU, correction des copies en souffrance, puis, entre Challais et Tours, lecture de la moitié du Secret de Caspar Jacobi, acheté d'occasion je ne sais plus quand et qui traînait à Hagetmau depuis je ne sais plus quand non plus. Il n'y a pas à dire, voyager en train est plus enrichissant (surtout quand la ponctualité est de mise et qu'aucun ratage de correspondance n'est au rendez-vous) que la longue litanie des bandes d'arrêt d'urgence et autres ronds-points.
Il reste à préparer un cours. Tours fait grise mine, sous les nuages bas et une brise glaciale, porteuse pourtant du printemps.
Je rêve assis.
18:12 Publié dans Hors Touraine, Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 16 février 2012
Des sonnets romains de Belli
J’ai lu l’été dernier – et ne m’avise qu’aujourd’hui d’en dire quelques mots – un roman d’Anthony Burgess qui s’intitule ABBA ABBA. Il n’y est pas question de l’insupportable groupe scandinave aux mélodies dégoulinantes de nullité, mais de la forme conventionnelle de notation des rimes embrassées dans les quatrains du sonnet dit pétrarquiste. Il se trouve que je me rappelle très mal l’intrigue, les péripéties, etc. Autant dire que ce n’est pas un texte inoubliable. Roman qui brode sur l’improbable rencontre, à Rome, entre Keats et Giuseppte Gioacchino Belli, il vaut surtout pour la découverte du dénommé Belli, donc, auteur d’une œuvre monumentale, une somme de sonnets (2279 si l’on en croit le répertoire exhaustif) en dialecte romain. Savoureux et d’une grande violence, je n’ai pris le temps de les découvrir – par l’intermédiaire d’une édition bilingue qui en propose un florilège et s’intitule Rome, unique objet…– ou Les Sonnets clandestins – que récemment. Or, Burgess propose, dans la deuxième partie de son livre, la traduction anglaise de quelque 71 de ces sonnets aussi truculents que rabelaisiens sur des sujets religieux. L’été dernier, j’avais dû faire des recherches sur Internet, car, en lisant ABBA ABBA, on peut tout à fait s’imaginer que Burgess invente de toutes pièces ce Belli (qu'un des sites qui lui sont consacrés qualifie de "plus grand poète italien de tous les temps", ce qui est de tout de même bien exagéré).
Afin de donner un exemple, j’ai choisi de reproduire ci-après la traduction du sonnet 330 (329 d’après l’édition des Belles Lettres), « La Nunziata ». Il est assez évident que le traducteur français, Francis Darbousset, est beaucoup plus proche de l’original que Burgess, qui a choisi une métrique, une syntaxe et un lexique beaucoup plus « nobles », ou – en tout cas – moins abrupts. Dans ce poème, Burgess restitue très astucieusement, en revanche, le jeu de mots oiselet/sexe. Plus curieux, Burgess respecte le schéma CDECDE des tercets (fidèle en cela au titre même de son livre, qui met l'accent sur les contraintes spécifiques du sonnet italien), alors que Darbousset, lui, est beaucoup plus libre dans le choix des rimes, jusqu’à traduire le concetto final au moyen d’un distique de rimes plates, structure caractéristique du sonnet… shakespearien ! Pour être assez paradoxal d'un point de vue formel, ce choix, comme on le verra, est très efficace.
La Nunziata
Ner mentre che la Verginemmaria
se magnava un piattino de minestra,
l’Angiolo Grabbiello via via
vieniva com’un zasso de bbalestra.
Per un vetro sfasciato de finestra
j’entrò in casa er curiero der Messia;
e co ’na rama immano de gginestra
prima je rescitò ’na Vemmaria.
Poi disse a la Madonna: «Sora spósa,
sete gravida lei senza sapello
pe ppremission de ddio da pascua-rosa».
Lei allora arispose ar Grabbiello:
«Come pò esse mai sta simir cosa
s’io nun zo mmanco cosa sia l’uscello?».
L’Annonciation
Pendant que la Vierge Marie
s’envoyait une assiette de soupe,
l’Ange Gabriel accourait
comme carreau d’arbalète.
Par la vitre cassée d’une fenêtre
le courrier du Messie entra chez elle ;
et lis en main, à sa droite, d’abord
il lui récite un Ave Maria.
Ensuite, il dit à la Madone : « Vous êtes
ma chère dame, enceinte sans le savoir,
par permission de Dieu depuis la Pentecôte. »
Et elle alors à Gabriel de répondre :
« Mais comment diantre ça a pu se faire, dites,
si je sais même pas ce que c’est qu’une bite ? »
Annunciation
You know the day, the month, even the year.
While Mary ate her noonday plate of soup,
The Angel Gabriel, like a heaven-hurled hoop,
Was bowling towards her through the atmosphere.
She watched him crash the window without fear
And enter through the hole in one swift swoop.
A lily in his fist, his wings adroop,
“Ave,” he said, and after that, “Maria.
Rejoice, because the Lord’s eternal love
Has made you pregnant–not by orthodox
Methods, of course. The Pentecostal Dove
Came when you slept and nested in your box.”
“A hen?” she blushed, “for I know nothing of–”
The Angel nodded, knowing she meant cocks.
10:35 Publié dans Lect(o)ures, Sonnets de janvier et d'après | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 15 février 2012
La Folie Baudelaire
Contrairement au Rose Tiepolo, qui m'avait enchanté - peut-être parce que je connaissais moins le sujet - , La Folie Baudelaire, aussi de Calasso, me laisse un peu sur ma faim * . Il me semble que l'équilibre entre éléments biographiques et analyse esthétique est nettement moins réussi, et que Calasso s'embourbe un peu trop dans les premiers, au détriment de la seconde. Cela confirme, si besoin était, que le génie n'existe pas, et les miracles non plus. Il y a des livres réussis, à force de travail... et des livres moins achevés. Cela étant, je n'en suis qu'au tiers ; ça va peut-être se réveiller.
* La Faim, je le signale, est une des figures, un des personnages - même - de Mathématiques congolaises.
10:55 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 06 février 2012
Battre briquet, tracer cercles dans l'air, recouvrir son calme
"Novels," she repeated. "Why do you write novels? You ought to write music. Music, you see"—she shifted her eyes, and became less desirable as her brain began to work, inflicting a certain change upon her face—"music goes straight for things. It says all there is to say at once. With writing it seems to me there's so much"—she paused for an expression, and rubbed her fingers in the earth—"scratching on the matchbox. Most of the time when I was reading Gibbon this afternoon I was horribly, oh infernally, damnably bored!" She gave a shake of laughter, looking at Hewet, who laughed too.
"I shan't lend you books," he remarked.
"Why is it," Rachel continued, "that I can laugh at Mr. Hirst to you, but not to his face? At tea I was completely overwhelmed, not by his ugliness—by his mind." She enclosed a circle in the air with her hands. She realised with a great sense of comfort how easily she could talk to Hewet, those thorns or ragged corners which tear the surface of some relationships being smoothed away.
"So I observed," said Hewet. "That's a thing that never ceases to amaze me." He had recovered his composure to such an extent that he could light and smoke a cigarette, and feeling her ease, became happy and easy himself.
Virginia Woolf. The Voyage Out [1915], Hogarth Press, 1971, ch. XVI, pp. 251-2.
14:19 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 19 janvier 2012
Le Retour des jacamars
Le week-end dernier, sur Facebook, je suis intervenu trois ou quatre fois dans un groupe célébrant la perte du triple A, sous l’identité de Guillume Cingl. Il y eut tout d’abord un lipotexte :
Merci de m'inscrire membre. Je perdis mes * hier soir, en une curieuse surprise. Je compte m'en remettre. Toutefois, toute personne en mesure de me décrire le lieu d'emprisonnement des susdites précieuses voyelles est, d'ores, fort vivement remerciée.
Puis un autre :
De tout temps, l'homme, obsédé de pouvoir, s'est penché sur les questions de sous, de pognon, de flouze, et ce quel que soit le nombre de voyelles dont il dispose, de sorte que les officines qui dispensent des notes, je m'en cogne le coquillon sur le bord du trottoir.
Puis, à rebours, des commentaires qui paraîtront plus ou moins abstrus, abusant de la voyelle autant que de la bouteille :
1. Barbara sans A, c'est comme jacaranda, jacamar, Caracas ou Nathan Zuckerman. Muy complicado.
2. Le Venezuela n'a pas de triple A. Je me demande comment font les jacamars de Caracas.
3. C'est Anastagia, pas Sasha, qui m'a tapé dans l'œil.
(Pour ce dernier, il était question des Miss Bahamas 2011.)
Toutefois, il est question d’autre chose, désormais, ce jeudi. Du jacamar. Encore.
En écrivant ma vanne à deux balles sur les jacamars de Caracas, je ne pensais pas avoir jamais lu de texte où il fût question de cet exotique volatile. Or, en rangeant quelques livres, ce matin, et les feuilletant (ranger représente toujours un moment de retrouvaille, aussi avec d’autres livres sur les étagères – bref, c’est une opération sans fin, d’autant que je finis par ne pas tout ranger, ou par ne pas ranger du tout), je suis tombé sur le poème suivant, à la page 121 des Jeux d’oiseaux dans un ciel vide de Fabienne Raphoz (Héros-Limite, 2011).
Galbuliformes
(Galbulidés)
Les jacamars se nourrissent presque exclusivement d’insectes volants
Tous les jacamars ont le bec acéré
Tous les jacamars portent l’émeraude métallique d’une forêt de nuages après la pluie sauf le Jacamar oreillard qui imite son sol après la pluie le Jacamar à tête pâle le Jacamar tridactyle le Jacamar à gorge blanche qui imitent son ciel avant la pluie le Jacamar brun le Jacamar à longue queue qui imitent sa nuit
Le Jacamar des Andes a l’œil solaire
Le Jacamar oreillard et le Jacamar roux pleurent rouge
Le Jacamar à queue rousse femelle a la queue émeraude
Le Jacamar des Andes est vulnérable
Le Jacamar tridactyle est en danger
Avec ce copié-collé d’un poème intégral (qui est un bref extrait, hahaha), ce billet peut prendre place dans un grand nombre de rubriques, sous-chapitres etc., dont vous trouvez juste ci-dessous la théorie :
mardi, 10 janvier 2012
L'île carcérale, Melun
« Dans la centrale. Melun... La vieille taule. Un couvent recyclé. cette île... En soi elle est déjà mélancolique. Oui, c'est une île. La Seine dort dans son lit. Je vais toujours dans les crépuscules. Du train en arrivant j'ai vu les réverbères s'ouvrir. J'entrais sous terre à Paris, c'était encore le jour, oui, le jour fatigué mais le jour, et là, quand je descendais à Melun, il faisait nuit de puits. »
Dimitri Bortnikov. Repas de morts (Allia, 2011), p. 173.
11:15 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (3)
dimanche, 08 janvier 2012
Bast(ingag)e
Si je m'efforce d'écrire la vérité sur ce que je ressens, alors :
oui, moi aussi, je sens une part de mon corps s'en aller, voguer vers un océan lointain, tout en ayant le cerveau collé au bastingage.
.......
Mais ça ne fait pas de moi un livre à couverture verte emprunté à la B.U..
23:48 Publié dans Ecrit(o)ures, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 05 janvier 2012
Ecorces
Le Jouet enragé de Roberto Arlt est l’un des derniers livres – le dernier roman – que j’ai lu en 2011.
Ecorces de Georges Didi-Huberman est le premier livre que j’aie achevé en 2012. (J’ai commencé L’Aimant de Ramon Sender le jour de la Saint-Sylvestre et ai laissé son protagoniste principal en suspens à Melilla, à trois chapitres de la fin. J’ai commencé Springer’s Progress de David Markson avant-hier et l’ai bientôt fini.)
Ecorces est un livre bref, dans lequel Didi-Huberman raconte, à partir de photographies numériques prises lors de sa visite d’Auschwitz-Birkenau, les points de vue qui se sont imposés à lui au cours de cette « déambulation ». Ce qu’il écrit de la muséification, pour Auschwitz, m’a rappelé, mutatis mutandis, ce que Renaud Camus reproche, à juste titre, aux demeures d’artistes qui se dénaturent entièrement par des ravalements, des aménagements en vue d’être visitables/visitées. Dans le cas d’Auschwitz, cela semble particulièrement douloureux, scandaleux.
Plus subtilement, Didi-Huberman remarque, avant d’élaborer, que seules trois des quatre photos prises en état de danger absolu par l’un des membres du Sonderkommando ont été élevées au rang d’artefact mémoriel par les autorités chargées de la gestion du site de Birkenau. Il a consacré il y a quelques années un essai entier, Images malgré tout, à ces quatre photos ; on ne peut que le suivre quand il écrit que, si la quatrième photographie ne représente rien des opérations de gazage, cette incapacité à représenter témoigne admirablement de la précarité de la situation du photographe : « elle témoigne du danger lui-même, du vital danger de voir ce qui se passait à Birkenau » (p. 49). Pour ce qui est des trois autres images, elles ont été recadrées, simplifiées, ce qui pousse Didi-Huberman à poser la question : « faut-il mentir pour dire la vérité ? » (p. 47)
Ce qu’il écrit, plus tôt, de la « moderne vis cruciforme » (p. 16) apposée sur la pancarte à tête de mort annonce ce qu’il écrit, vers la fin de l’ouvrage, de l’impératif de « voir malgré tout » (p. 61). Si le fil conducteur de ce bref texte d’une grande force est l’écorce de bouleau – arbre qui donne son nom à Birkenau – je n’ai pu m’empêcher de relier cette image de l’écorce-peau à la croûte de neige glacée des Récits de la Kolyma, au bûcheronnage aussi intensif qu’inexpert du Voyage au pays des Ze-Ka ou aux légumes pourris qu’évoquait Charlotte Delbo dans le tome 2 d’Auschwitz et après. Même (surtout ?) lorsqu’il n’y a rien à voir, en apparence, on imagine la matière avec une autre densité.
10:45 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 06 décembre 2011
New vista of troubles
Je dois, sans l’avoir ouvert, rendre Tracks de Robyn Davidson à la bibliothèque. Ouvrant le mince volume au hasard, j’en extrais cette phrase : « The miraculous turn of events opened a whole new vista of troubles for me. » (Vintage, 1995, p. 78)
 J’ai aussi griffonné à la va-vite, par le clavier, mes vers préférés de Tiepolo’s Hound, avant de le rendre. Des fleurs se pâment dans un coin. Patrimony, pareil, et qui devra passer au scanner cet après-midi (comble de l’ironie, livre sur le cancer). Ma récente manie, prise avec l’Année de 398 jours, d’insérer, en petites majuscules (Book Antiqua corps 14), des citations sans rapport est bien pénible.
J’ai aussi griffonné à la va-vite, par le clavier, mes vers préférés de Tiepolo’s Hound, avant de le rendre. Des fleurs se pâment dans un coin. Patrimony, pareil, et qui devra passer au scanner cet après-midi (comble de l’ironie, livre sur le cancer). Ma récente manie, prise avec l’Année de 398 jours, d’insérer, en petites majuscules (Book Antiqua corps 14), des citations sans rapport est bien pénible.
Écrire un éternel fichage décourage la lecture. (Celle là est de moi.) Tes galants mis aux fers. (Pas celle-ci.)
11:11 Publié dans Lect(o)ures, Words Words Words, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 30 septembre 2011
Le spectre et le mourant
(Note écrite le 13 juillet, à Hagetmau)
Le dernier, très court, chapitre d’Indignation apprend au lecteur que le narrateur, qui se présentait comme un spectre, était en fait un mourant qui, sur son lit d’hôpital, se retrouvait, grâce à la morphine, avec la mémoire dopée – d’où son récit. Bien sûr, comme souvent chez Roth, cette révélation finale ne va pas sans poser de nouveaux problèmes narratologico-théologiques, plus complexes encore. Surtout, en substituant un mourant comateux à un spectre, cette fin de roman semblait appeler la lecture que j’ai enchaînée –Malone Dies (je crois avoir lu Malone meurt il y a une éternité – mais je crois aussi ne jamais avoir lu L’Innommable – est-ce possible ?).
Il faudrait réellement qu’un jour :
1. j’achète (au lieu de toujours emprunter tel ou tel volume en bibliothèque) les œuvres complètes de Beckett
2. je me livre sérieusement à l’étude, non du bilinguisme et de l’auto-traduction (cela a été fait vingt fois déjà), mais d’un point précis de comparaison entre le texte français et le texte anglais. (Par exemple, dans Malone Dies, ce pourraient être les substantifs en –lessness ou les comparaisons ou le rythme ternaire.)
Ajout du 29 septembre.
Aujourd'hui, j'ai recopié, dans le fichier Word « Roth », les notes éparses gribouillées lors de ma lecture d'Indignation. Une fois encore, la parenté avec les thèmes constitutifs d'American Pastoral (désir rétrospectif, mais voué à l'échec, de reconstituer ; histoire et récit ; erreur et errements ; incertitude du sens et certitude du désastre) est évidente.
05:55 Publié dans Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 01 septembre 2011
Rectificatifs (= c'est l'écriture)
J'ai passé un moment assis dehors, sur la terrasse, à profiter d'une des dernières soirées, peut-être, de lecture vespérale, entre les 244 étourneaux perchés sur l'immense grue Potain du chantier voisin, la tourterelle sur l'antenne télé et la pie (qui se trouvait, ce soir, dans la gouttière des Huppenoire), et à aller d'un livre à l'autre -- le livre à couverture parme (Max Aub) et le livre à couverture orange (Elsa Morante) -- tout en essayant de rendre hommage, par la pensée, à la chaise défoncée sur laquelle j'étais assis et qui achève de rendre l'âme sous mes fesses : cette chaise, que, comme ses trois congénères, nous avons achetée (très d'occasion, à la Trocante) lors de notre installation dans l'appartement de la rue du 51ème R.I., à Beauvais, pourrait témoigner, avant d'aller à la benne à laquelle je finirai bien par la condamner, de bien des moments de notre vie au cours des quatorze dernières années. Cela mérite sûrement, pour ouvrir le mois de septembre, une double citation.
Il lui semblait voir Venise, comme une mer tranquille, sur laquelle d'énormes anges de marbre marchaient sans toucher l'eau, les pieds nus, avec de longues robes tombantes. *
Ils rectifient. Ils ont des visions. **
Tous les anges, dans leurs robes (étourneaux criards, pies volages), ont des visions, et nous, nous rectifions.
* Elsa Morante. "Le voyage", traduction de Sophie Royère - in Récits oubliés (Verdier, 2009, p. 136)
** Max Aub. Campo del Moro (1963). Traduction de Claude de Frayssinet. Les Fondeurs de brique, 2011, p. 26. [Il s'agit du tome 5 du Labyrinthe magique.]
21:26 Publié dans Blême mêmoire, Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 11 juillet 2011
Pierre, pitance, in-pace
C'était le même édifice en pierre noire ou grise baigné de la même lumière morte où l'on servait la même pitance intemporelle à des jeunes gens transférés de leurs humides oubliettes dans l'in-pace de l'internat.
(Pierre Bergounioux. Le premier mot. Gallimard, 2001, p. 30)
N'ayant pas été logé, pour mon hypokhâgne (ni d'ailleurs par la suite), à l'internat, et n'ayant pas non plus quitté l'âpreté de la Corrèze pour la morne Limoges, je n'ai, de mes années de classe préparatoire, que des souvenirs lumineux, éblouissants aussi de sérénité. J'étais sans doute plus décomplexé, et sans attentes, que P.B. Aussi: j'ai pu avoir des professeurs plus enthousiasmants que lui. Néanmoins, néanmoins… Se peut-il que les lieux comptent plus que tout pour donner le ton d'une année, ou pour infléchir ce que l'on comprend d'un cursus ?
12:44 Publié dans Blême mêmoire, Le Livre des mines, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 13 juin 2011
Lundi de Pentecôte
Après un tourbillon Bergounioux, venu lui-même interrompre un long cycle (à peine ébauché) consacré à Philip Roth, j’ai repris le Voyage au pays des Ze-Ka de Julius Margolin, tout en finissant par me lancer à l’assaut d’Only Revolutions de Mark S. Danielewski qu’E* m’a prêté il y a plus de trois mois, et qui, par son aspect de livre bricolé par un savant fou ayant trouvé le moyen de mixer Finnegans Wake et Gyroscope en y ajoutant une pincée de Tristram Shandy et la levure David Lynch, a tout de même de quoi désarçonner et décourager un qui a un peu beaucoup dix mille autres choses à faire. (Mais ça m’exalte, j’avoue, encore plus que House of Leaves.)
Cependant, C., elle-même tirée à hue et à dia entre tant de tentations, relit Madame Bovary – elle en est ravie, à sa quasi surprise.
Samedi après-midi, j'ai acheté, au Livre, les opus 5 et 6 du Labyrinthe magique (dont les troisième et quatrième tomes, à la couverture jaune, aux éditions des Fondeurs de brique, attendent encore dans mes piles) et une traduction récente de Sergio Chejfec. Il me reste, aujourd'hui, à refaire des recherches (avant de jeter de vieux exemplaires cornés et poussiéreux de Courrier international) pour savoir si Miguel Syjuco a été enfin traduit. [Recherche faite, il s'avère - mais est-ce sûr ? - qu'Ilustrado, publié en français chez Bourgois, est écrit en anglais. En dépit de son titre aux consonances hispaniques, je n'avais donc pas du tout besoin d'attendre toutes ces années pour le lire...!]
12:12 Publié dans Lect(o)ures, Moments de Tours, Pynchoniana | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 24 mai 2011
Les Sept fous
Des Sept fous, la lecture est encore vivement présente à mon esprit. Je croyais l’avoir lu très récemment (j’hésitais entre mars et janvier). Or, je viens de retrouver une mention de ce livre qui date du 1er décembre, et indique clairement qu’il avait déjà été lu. Ce serait donc novembre ! Que le temps, l’année aura filé vite. En tout cas, j’ai eu raison de le garder sous le coude, puisque je prends enfin le temps d’extraire quelques passages de ce récit d’une dérive sectaire. Le patronyme de l’auteur, mort à quarante-deux ans en pleine Seconde Guerre mondiale, pourrait évoquer – avec une ironie sinistre qui ne lui aurait pas déplu – quelque sigle de notre société post-moderne.
« La peine, semblable à ces arbustes dont l’électricité accélère la croissance, grandissait dans les profondeurs de sa poitrine et montait jusqu’à sa gorge. Immobile, il se disait que chaque peine était un hibou qui sautait d’une branche à l’autre de son malheur. »
Roberto Arlt. Les sept fous (1929),
traduction d’Isabelle et Antoine Berman. Belfond, 1981, 2010, p. 50.
« Derrière la vitre de la petite fenêtre allaient et venaient des requins borgnes, furieux parce qu’ils souffraient d’hémorroïdes, et Erdosain jubilait silencieusement, riant du petit rire de l’homme qui ne veut pas qu’on l’entende. » (p. 147)
« À la manière de celui qui tire de son portefeuille l’argent produit par ses divers efforts, Erdosain tirait des alcôves de la maison noire une femme fragmentaire et complète, une femme composée de cent femmes démembrées par cent désirs toujours identiques et toujours ravivés par la présence de femmes dissemblables. » (p. 158)
« Je vais rompre le faible fil qui m’unissait à la charité divine. Je le sens. À partir de demain, je serai un monstre sur la terre… Imaginez-vous un enfant… un fœtus… un fœtus qui aurait la capacité de vivre hors du sein maternel… Il ne grandit jamais… Velu… Petit… sans ongles il marche au milieu des hommes sans être un homme… Sa fragilité horrifie le monde qui l’entoure… Mais il n’est pas de force humaine qui puisse le restituer au ventre perdu. » (pp. 317-8)
09:00 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 01 mai 2011
An (Irish) avant-gardener
Comme j’ai lu Changing Places au cours de la première semaine de vacances pascales, j’en copie ici un extrait, histoire d'en marquer le déroulé au fer vert. (Petit roman de David Lodge, bien écrit, drôle, très vain et passablement daté. Exploration poussive de la multigénéricité.)
En choisissant cet extrait, je pense à mon collègue Stephen (qui m’avait parlé du professeur Zapp lors d’un déjeuner le 1er avril), à Olivier Bab, à Renaud Camus (à son concept de tchernobylisation, notamment), et… à moi, qui suis censé être – aussi – spécialiste de lexicologie et d’humour britannique.
O’Shea is what you might call an avant-gardener. He believes in randomness. His yard is a wilderness of weeds and heaps of coal and broken play equipment and wheelless prams and cabbages, silted-up bird baths and great gloomy trees slowly dying of some unspecified disease. I know how they must feel.
(fin d’une lettre de Morris Zapp à sa femme, Désirée
Changing Places, 30ème réédition Penguin, 1991, p. 128)
21:27 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 28 mars 2011
Omoo, XXXII
Dans l'incipit de Salammbô, Flaubert n'a rien inventé :
The first blood shed, in any regular conflict, was at Mahanar, upon the peninsula of Taraiboo.
12:22 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 14 mars 2011
Sang
" A la suite de disputes au sujet de terres avec des cousines, et pour fuir les commérages, critiques et ragots de la famille, il avait juré de se vider de tout son sang et de s'en transfuser un autre, et de changer son patronyme d'Abad pour celui de Tangarife, qui avait l'air moins juif et plus arabe (menace burlesque qu'il ne mit jamais à exécution). "
(Hector Abad. L'oubli que nous serons, traduction d'Albert Bensoussan.
Gallimard, 2010, p. 90.)
12:24 Publié dans Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 19 février 2011
Notes pour Der Fuchs (26 décembre 2010)
Herta Müller. Le renard était déjà le chasseur.
Traduction de Claire de Oliveira. Paris : Seuil, 1996.
« Depuis qu’on découpe le renard, dit-elle, mes ongles poussent plus vite. » (p. 214) ::: ::: ::: ::: L’écriture de Herta Müller fait alterner raccourcis et épaississements, courts-circuits et analogies développées. Herta Müller a inventé (tout en l’inventant pas : en l’empruntant à tant d’autres et lui donnant une pâte qui n’est pourtant (partant ?) qu’à elle) le texte brut profond – avec une manière de voir le monde, ou de le percevoir, qui m’a rappelé – dans les premiers chapitres – Kotik Letaiev ou certains Savitzkaya :
« Le soleil est loin au-dessus de la ville. Les cannes à pêche projettent des ombres, l’après-midi s’appuie sur leurs ombres. Quand le jour va basculer, pense Adina, quand il va glisser il creusera de grands sillons dans les champs autour de la ville, le maïs se cassera. » (p. 36)
[J’écris ces notes, recopie ces fragments plus d’un mois après avoir lu le roman de Herta Müller, qui est déroutant, non par sa forme mais vraiment par le récit : que raconte-t-il ? que se passe-t-il ? comment passe-t-on de l’univers de l’enfance à celle du travail sous la dictature des Ceaucescu ? qui est qui ? Tout cela est plus déroutant, car présenté de façon moins chorale, moins torrentielle, moins aiguë que dans les grands textes de Lobo Antunes, par exemple. J’écris aussi ces notes, recopie ces fragments un jour ensoleillé d’après-Noël, influencé par la lecture reprise de Dubuffet, face aux sillons des champs glacés dans la campagne, sous un grand soleil de décembre qui rappelle mes lectures, il y a deux ou trois ans ici aussi à Noël, du poète chypriote de langue anglaise dont le nom m’échappe. « Le directeur devrait retenir ce nom puisqu’il a remarqué que le nom de CONSTANTIN n’allait pas au nain. » (p. 101.)]
L’inversion du regard fonctionne comme dans certains films en noir et blanc, que l’on dit d’avant-garde (là, comme jamais, se voient les odeurs, les couleurs) : « Quand Pavel lève la tête, le trottoir tombe du miroir de ses lunettes. Il y a une pastèque écrasée sur les rails du tramway, les moineaux mangent la chair rouge. [… Dans la voiture Pavel rattache sa chaussure, Clara sent ses colchiques. La voiture roule, la rue n’est que poussière, une poubelle brûle. » (p. 61) Tout se lit au ralenti, comme si la récit appelait des gestes mêmes du lecteur une certaine lourdeur. Dans le cadre étrange, quelques détails se muent progressivement en motifs. C’est le cas des peupliers, arbres qui (soit dit en passant) jouent un rôle plus important encore dans La bascule du souffle, non comme éléments du décor mais comme motifs d’étonnement : « Les peupliers sont des couteaux, ils dissimulent leur tranchant et dorment debout. » (p. 160). è « Les peupliers interdisent la chance en hiver, disent les pêcheurs, les peupliers dégarnis dévorent la chance quand ils boivent. » (p. 179)
C’est aussi le cas des coings :
« Il faudrait penser à ne jamais laisser la moitié d’un coing parce qu’elle sèche comme une fourrure, se racornit comme un brin d’herbe. Quand on a mangé tout un coing, quand il est dans l’estomac après avoir été dans la main, dit Adina en direction de ses mains sur la table, on devrait pouvoir ouvrir les yeux et être quelqu’un d’autre. Être quelqu’un qui ne mange jamais de coings. » (p. 120) è « Adina prit un coing et dit : non, tu ne l’as pas lavé, il a de la fourrure sur la peau. » (p. 219)
Cinéma, peinture – tout un art du visage : « Une ride s’échappa des commissures de ses lèvres et lui entailla la joue. » (p. 19)
Les images de soleil brûlant ou glacial rythment les différents épisodes, l’amenuisement de la peau de renard comme une peau de Chardin (la pâte dont Chardin investissait fruits, compotiers, étoffes, préfigura l’art de Herta Müller) : « En août, dans cette ville, il y a des jours où le soleil est un potiron épluché. » (p. 96) Toutes ces notations de couleur, de chaleur, de tonalités complexes n’échappent pas à la subjectivité moralisante (rationalisante ? abstractisante ?) du discours, comme dans une description frappante du drapeau roumain : « Sortant du remblai du stade, une lumière s’échappe vers le ciel comme si la lune s’était perdue. Les Danois, qui c’est ceux-là, les mains des hommes portent le drapeau tricolore, trois raies bien à eux. La pièce rouge famine, la pièce jaune silence, la pièce bleu espion dans le pays coupé du monde. » (p. 187)
10:35 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 16 février 2011
Notes pour Atemschaukel :
Herta MÜLLER. La bascule du souffle. Gallimard, 2010.
Traduction de Claire de Oliveira.
Lors de la libération de la Transylvanie par les Soviétiques, se met en place, sous l’égide et à l’initiative du gouvernement roumain, mais sur demande de l’allié soviétique en conformité avec les accords de Yalta, la déportation de certains Allemands vers des camps de travail en U.R.S.S. Dès les premiers brefs chapitres de La bascule du souffle, Herta Müller présente l’itinéraire de « son » protagoniste comme une sorte de malédiction volontaire. Cette malédiction prend souvent la forme d’hallucinations concrètes :
« Le ciment m’a rendu malade. Pendant des semaines, j’en ai vu partout : dégagé, le ciel était du ciment lissé ; plein de nuages, c’était un gros tas de ciment. La pluie envoyait des fils de ciment rattachant le ciel à la terre. Ma gamelle en fer-blanc moucheté de gris était en ciment. » (p. 41)
L’expérience carcérale porte sur le concret :
« Une pelle en cœur, ça se rode ; ensuite, sa plaque de tôle est bien luisante, avec une soudure semblable à une cicatrice dans la paume – et la pelle entière est une sorte de second équilibre, mais extérieur. » (p. 84)
On songe aux crachats de la Kolyma, que Chalamov décrivait gelant au vol.
Dans un texte aussi profondément écrit, aussi souterrainement pensé, rien d’étonnant à ce que le spectre de la faim croise les fantômes du langage :
« Kapousta, c’est le chou en russe, et celui d’une soupe qui, souvent, n’en contient pas. En dehors du russe et de la soupe, kapousta est un mot composé de deux choses qui n’ont rien de commun, sauf le terme en question. Cap, c’est la tête, en roumain, et Puszta la plaine hongroise. On se dit ça en allemand, et le camp est russe comme la soupe aux choux. On veut faire le malin avec ces trucs insensés, or kapousta, une fois décomposé, ne saurait être un mot de la faim. Les mots de la faim sont une carte géographique dont les pays ont des noms culinaires qu’on dit dans sa tête. » (p. 162)
C’est un peu Kafka, et pas du tout. Dans l’entremêlement des sensations, le langage se fraie un chemin complexe (broussailleux – pourtant, les alentours sont déserts) :
« Mais ce ne sont que les marrons d’Autriche-Hongrie des récits de mon grand-père, ils sentaient le cuir frais. Matelot, il en avait décortiqué dans le port de Pula pour les manger avant de s’embarquer sur le voilier Danube et de faire le tour du monde. Mon absence de mal du pays, c’est donc le mal du pays raconté par mon grand-père qui me sert à surmonter celui que j’ai ici. Bref, quand il m’arrive d’avoir un sentiment, c’est une odeur. Celle du mot marrons ou matelots. Avec le temps, chaque odeur verbale s’annule, comme les haricots de Lommer la Cithare. A force de ne plus pleurer, on peut devenir un monstre. Le petit rien qui m’empêche d’être un monstre – à moins que je n’en sois un depuis longtemps –, c’est tout au plus la phrase Je sais que tu reviendras. » (p. 196)
Comment, avec ce rappel de la phrase lancée par la grand-mère avant le départ du déporté, ne pas songer à la trilogie de Charlotte Delbo – à la dernière page d’Aucun de nous ne reviendra ? Et, comme dans le 3ème tome d’Auschwitz et après (comme et différemment) :
« J’avais remis les pieds à la maison depuis plusieurs mois, et personne ne savait ce que j’avais vu. Personne ne me le demandait. Pour pouvoir raconter quelque chose, il faut d’abord s’en dessaisir. J’étais content qu’on ne me pose pas de questions, mais en secret j’étais vexé. » (p. 277)
Avec un élan sans cesse réprimé, mais lisible (audible), vers le lyrisme, l’écriture de Herta Müller trouve, pour parler de l’ennui (en son sens le plus pénible, le plus dur), des accents répétitifs qui dessinent en elle une continuatrice un peu contradictoire de l’œuvre de Beckett :
« Il y a l’ennui de la neige fraîchement tombée avec la poussière de charbon, celui de la vieille neige avec la poussière de charbon, l’ennui de la vieille neige avec des pelures de patates, et celui de la neige fraîchement tombée sans pelures de patates. L’ennui de la neige pleine de plis de ciment et de taches de goudron, la laine farineuse sur les chiens de garde, et leurs aboiements à la profondeur de tôle ou aux aigus de soprano. » (p. 213)
Les chiens n’aboient pas comme des pelles, même dans cette neige pesante, pénible, qui n’est pas la neige rouge de Pamuk, ni la folie glaciale de Chalamov. Poussière, pelures, plis ; charbon, farine, goudron. Une écriture matérielle, à l’épreuve du gel.
Et, pour la description de l’épuisement, il en va comme de l’ennui. Il a son pendant, la frénésie, qui le précède :
« Nous aimons voir le sang des punaises, parce que c’est le nôtre. Plus il y a de sang, plus nous prenons plaisir à cette opération. Elle fait sortir toute la haine que nous avons en nous. Nous tuons les punaises à coups de brosse, et nous en sommes aussi fiers que si c’étaient des Russes. Puis l’épuisement nous tombe dessus, comme un coup sur la tête. Une fois lasse, la fierté rend triste. Etrillée, elle se rabougrit jusqu’à la fois suivante. » (p. 244)
Excitation, démence, abattement. La leçon de poésie de Herta Müller, en un sens : tout ce qui est ressenti physiquement prend forme d’un déploiement moral.
(Note rédigée le 22 ou le 23 décembre derniers.)
14:44 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 01 décembre 2010
Des confituriers figurés
Mercredi 1er décembre, six heures du matin.
Comme C., mais différemment d’elle, j’ai mon confiturier.
Le confiturier, dans notre maison, n’est pas un meuble servant à stocker les confitures, mais le dépositaire des lectures imminentes ou un peu moins qu’imminentes. La table de chevet de C., de son côté du lit conjugal, est un confiturier dans lequel il est possible d’entreposer, et même de ranger, une petite trentaine de livres. Par habitude, c’est là qu’elle garde les livres qu’elle veut lire dans un futur proche (ou moins proche. Ainsi, jetant un œil par hasard, il y a quelques jours, je me suis aperçu qu’au moins l’un des livres qui s’y trouve (trouvent ?) a été acheté il y a deux ans sans doute, ou à peine moins – or, je voulais le lire : il s’agit de La Symphonie du loup).
Et donc, j’ai moi aussi mon, et même mes confituriers… Il y a tout d’abord l’une des étagères du petit meuble qui sert de discothèque et de partition entre le salon et la salle à manger. Nommons-là Confiturier 2. (Le 1er, le vrai confiturier, celui qui sert de table de chevet à C., est d’évidence premier, et hors compétition.) Il y a aussi les deux petites étagères de ma propre table de chevet, une sorte de meuble d’angle en bois de pin, absolument pas fonctionnelle, mais passons… : nommons cela Confiturier 3. Plus subtil, il y a les micro-piles qui se trouvent sur (ou sous le plateau de) mon bureau. Confiturier 4, of course.
On l’aura compris, mes confituriers sont les lieux où j’entrepose les livres à venir (i), ou en cours de lecture (ii), mais aussi les livres déjà lus mais que je ne veux pas encore ranger dans la bibliothèque (iii), soit que j’en aie besoin pour mon travail (a), soit que je compte écrire une recension à leur sujet (b – ah, ah, j’en ris encore), soit par un scrupule indéfinissable (c). Certains de ces ouvrages sont des emprunts à la Bibliothèque Universitaire ; dans la mesure où j’ai toujours aimé les livres de bibliothèque (à condition qu’ils ne soient pas de poche, et soient dans un bon état) et dispose de conditions d’emprunt assez idéales (20 ouvrages pour 3 mois), il y en a toujours en transit.
Avant de tenter de dresser ici la liste des livres qui se trouvent dans chacun de ces confituriers au sens figuré, je veux dire, à titre d’exemple significatif, que j’ai reçu hier, par la Poste, Summertime, le troisième volet de l’autobiographie de J.M. Coetzee, et que, voulant le lire immédiatement (en dépit des déjà x ouvrages en cours de lecture) je l’ai emporté directement au lit à l’heure du coucher, sans passer par la case confiturier (et sans toucher mes vingt mille balles, il va sans dire). Il est indispensable que j’en commençasse la lecture au plus vite, car C. a commencé à le lire en traduction, et, dans ces cas-là, j’aime bien : i) pouvoir discuter avec elle d’un même livre lu à peu près simultanément ii) ne pas risquer d’être découragé par elle de l’envie de lire un livre (ce qui s’est produit naguère avec Choir d’Eric Chevillard).
Confiturier 2.
- Demeures de l’esprit VI (France III) de Renaud Camus - i
- Collected Poems de John Ashbery (American Library) - ii
- La convocation de Herta Müller - i
- Anglomania - i
- Nils Holgersson de Selma Lägerlof (dans la traduction exhaustive Actes Sud) - iii, c
- Amor & Furor de Günter Brus - iii, b
- L’Histoire des vers qui filent la Soye de Béroalde de Verville - ii
- Le renard était déjà le chasseur de Herta Müller - iii
- Le fil des missangas de Mia Couto - iii, b
- Homesickness de Murray Bail - i
- Steam Pigs de Melissa Lucashenko - i
- Récits 1971-1982 de Thomas Bernhard - i
- Le Secret de Caspar Jacobi d’Alberto Ongaro - i
- The Hours de Michael Cunningham - iii, a
- Der Spaziergang de Robert Walser - i
- Au nord par une montagne, au sud par un lac, à l’ouest par des chemins, à l’est par un cours d’eau de Laszlo Krasznahorkai - i
- Voyage au pays des Ze-Ka de Julius Margolin - i
- Les Inachevés de Reinhard Jirgl - i
- Renégat, roman du temps nerveux de Reinhard Jirgl - i
- Et si les œuvres changeaient d’auteur ? de Pierre Bayard - ii
- Paysage et portrait en pied-de-poule de Thierry Beinstingel - iii, b
- Les sept fous de Roberto Arlt - iii, b
- Sämtliche Werke de Franz Kafka - i (ii)
Il est trop tôt dans la journée pour aller farfouiller dans la bibliothèque ou la chambre à coucher et dresser la liste des ouvrages se situant dans les confituriers 3 et 4.
08:08 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (3)
mardi, 30 novembre 2010
Lectures d'enfance
(Ce billet promet d'être fort long. Or, il s'agira, je pense, d'un vaste copier-coller******. (Je ne sais jamais si, dans la forme substantive, il vaut mieux utiliser un infinitif ou un participe passé. Préoccupations d'un autre âge.))
À la faveur d'un test assez stupide que propose Facebook (Have you read more than 6 of these 100 books?), et que j'ai eu la faiblesse de copier-coller [là, au moins, on est sûr que c'est un infinitif, NDLR] dans mon profil, en ayant soin de mettre en gras les ouvrages que j'ai lus et en italiques ceux que j'ai commencés ou parcourus, je viens d'avoir une conversation très intéressante avec Madame de Véhesse :
GC - Ah ça, Tolkien et C.S. Lewis, faut avouer...
VS - Guillaume, je ne sais pas ce que tu lisais enfant (si en fait, je sais, Char à douze ans, c'est ça?) mais j'ai toujours placé haut la fidélité à ce qu'on a aimé. Penses-en ce que tu veux, je reste persuadée qu'il y a un rapport étroit entre nos rapports à la littérature et ceux à l'enfance.
GC - Valérie, tu te méprends. Je reste extraordinairement fidèle à Topaze, à La guerre des boutons (que je viens de reparcourir à la faveur de sa découverte par mon fils aîné), aux Trois Mousquetaires (mais pas à Monte Cristo, que, justement, je n'ai pas pu lire enfant et ai été incapable de lire adulte), ou à L'Île verte de Pierre Benoît. (Quatre exemples seulement ; j'espère qu'ils achèveront de te convaincre que cette histoire de "Char à dix ans", pour être vraie, ne suffit pas à me résumer.) Ah si, il y a aussi tous les volumes Folio Junior d'anthologies : L'arbre en poésie, La liberté en poésie, etc., dans lesquels j'ai découvert Guillevic, un des grands poètes de ma "formation", entre 18 et 24 ans*******, disons -- et René Char, donc.
J'aurais certainement pu ajouter Mon amie Flicka (et la suite de cette... quoi ? trilogie ?), mais, sur ce coup-là, je ne peux empêcher d'éprouver un peu de honte rétrospective*. Toutefois, à chacun des ouvrages que je viens de citer (Mon amie Flicka inclus), me remontent en mémoire, aux yeux, à l'esprit, les lieux où je les ai lus, les moments, les heures, le détail du grain des pages, la typographie peut-être, le titre de certains chapitres, ou certaines bribes de phrases. Oui, ce que nous lisons dans notre enfance nous structure.
--------------------------------------------------------
Or, je m'aperçois à l'instant (car j'ai passé une heure à recevoir deux étudiants puis une secrétaire entre le début de ce billet et maintenant [10 h 36]) que Madame de Véhesse m'a encore répondu :
VS - Guillaume, on ne va se (re)disputer. Char était une pique un peu en dessous de la ceinture, je le reconnais, mais qui voulait surtout souligner qu'on lit enfant en fonction de ce qu'on trouve autour de soi et de ce qu'on vous donne. C'est la différence entre visiter une forêt vierge avec un guide et la visiter tout seul: on met plus longtemps à s'orienter et à repérer les détails de la flore et la faune.
Lewis : à 7 ans ; Tolkien : à 12, ce qui compte tenu de notre différence d'âge me l'a fait lire bien avant qu'il soit devenu ce qu'il est devenu en France (aux US, c'était le début des jeux de rôle et de donjons et dragons. Je suis très contente d'avoir vu ça naître, comme je suis heureuse d'avoir connu avant/après internet, avant/après les portables, etc.)
Lewis et Tolkien : les deux prêtés par des amis.
Tu avais plus ou moins des guides, pas moi. Très peu de livres à la maison, tout emprunté à l'instinct (et grâce aux extraits donnés en exemple dans mes livres de grammaire : je ne sais pas comment j'aurais fait aujourd'hui avec les exemples qu'ils donnent !)
Curieusement, je ne me rappelle pas du tout m'être disputé avec qui que ce soit (et donc pas non plus avec elle) au sujet de Tolkien. Par ailleurs, je ne crois pas que notre différence d'âge soit bien grande, car j'ai vu apparaître, moi aussi, les jeux de rôles (j'étais adolescent), Internet (à Normale Sup' puis dans la société at large) et les téléphones portables (je n'en possède toujours pas).
De plus, je crois que mon admirable interlocutrice surestime un peu mon entourage. Moi aussi, j'ai découvert bien des auteurs grâce aux manuels de grammaire (Nathalie Sarraute en 3ème, par exemple (mais il est vrai que ma mère lisait certes John Irving mais aussi Robbe-Grillet, ce qui me demeure une énigme)). Il y avait beaucoup de livres à la maison, et je voyais ma mère passer des heures à lire, à la plage ou en vacances, mais aussi parfois dans la vie quotidienne. (Mon père, pas du tout. Il était déjà à fond dans son trip associatif (dans l'écologie et la protection de la nature), qui ne le conduisait pas encore, comme aujourd'hui, à Bali, Bruxelles ou Athènes on a nearly monthly basis, mais déjà à Caupenne, Tartas, Puyol-Cazalet, et surtout fait qu'il n'a pas ouvert un livre (de littérature, disons) depuis 35 ans.)
Les lectures de mon entourage n'ont eu qu'une influence modérée sur moi, en fin de compte. Je veux dire : sur mes goûts d'à présent ; sur la longue sédimentation qui a fini par produire mon goût en matière de littérature à ce jour. Face à la lecture, on est finalement toujours seul**.
----------------------------------------------------------
* De lectures "purement" enfantines, comme les Jojo Lapin d'Enid Blyton, je n'ai absolument pas honte. Alpha n'a pas du tout lu ces livres de la bibliothèque rose à fleurs, mais je me suis surpris, quand ma mère, il y a trois ans, les a remontés d'une armoire du sous-sol pour les mettre dans mon ancienne chambre, à Cagnotte, à les relire, à rechercher tel ou tel passage, vérifier que c'était bien là, dans le premier "roman" jamais lu que j'avais été heurté ou dérouté par les mots pouah et gredin.
** Il y a aussi***, comme moment de cristallisation, mon opération pour une péritonite, à l'âge de quinze ans****, et mon séjour subséquent d'une semaine à l'hôpital puis de deux semaines à la maison, dans l'oisiveté, et, par conséquent, la lecture. Ma grand-mère maternelle m'avait apporté quelques livres, dont L'Eglise verte de Hervé Bazin, et mon camarade, Marc Foglia (qui n'était pas un camarade au sens strict, mais je ne peux entrer ici dans les détails), m'avait apporté La Montagne magique. J'ai été bouleversé par La Montagne magique, que j'ai lu en trois jours, je crois, tandis que je ne pouvais ni me nourrir ni même boire, mais j'ai aussi lu L'Eglise verte. C'est certainement la dernière fois que j'ai lu un livre en me laissant influencer par mon entourage familial*****.
*** Cette note à double astérisque, je l'ajoute après une nouvelle interruption. Je viens de recevoir, pendant une bonne demi-heure, deux étudiantes de l'I.U.T. de journalisme, dont Mlle Géraldine Cornet-Lavau, qui venaient m'interviewer sur la question des enseignements en visioconférence. Le "sujet" passera en janvier dans l'émission Matafac, sur TV Tours.
**** Quinze ans : d'après Renaud Camus, c'est l'âge auquel, en matière de culture, de capacité à se cultiver, tout est joué.
***** L'influence, en soi, n'a rien de péjoratif, n'est pas à proscrire. Je ne cesse d'être influencé. Mais la simple influence ne suffit pas à former le goût.
****** Finalement, la part du copier-coller n'est pas si grande. Et je suis loin d'avoir épuisé le sujet. Sur la question de la fidélité à ses goûts d'enfance, j'aurais, après réflexion, beaucoup plus à dire en matière de musique.
******* Une dernière anecdote : je n'ai jamais pu retrouver, dans aucun des recueils de Guillevic, le premier poème de lui que j'aie lu, grâce à ces anthologies, et que je connais par coeur :
Il se ferait pommier,
Lui, dans l'espace détendu.
Il aurait cette frondaison,
Ces pommes, la patience.
(&c.)
11:59 Publié dans Blême mêmoire, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (5)
vendredi, 26 novembre 2010
Antiprolepse : génie ou plagiaire
The ancient stone steps had been climbed, the wisps of sound had melted away like mist, his new melody, darkly scored in its first lonely manifestation for a muted trombone, had gathered around itself rich orchestral textures of sinuous harmony, then dissonance and whirling variations that spun away into space, never to reappear, and had now drawn itself up in a process of consolidation, like an explosion seen in reverse, funnelling inwards to a geometrical point of stillness; then the muted trombone again, and then, with a hushed crescendo, like a giant drawing breath, the final and colossal restatement of the melody (with one intriguing and as yet unsolved difference) which gathered pace, and erupted into a wave, a racing tsunami of sound reaching an impossible velocity, then rearing up, higher, and when it seemed beyond human capability, higher yet, and at last toppling, breaking and crashing vertiginously down to shatter on the hard safe ground of the home key of C minor.
Amsterdam, V, i
06:55 Publié dans Le Livre des mines, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 24 novembre 2010
Nature sauvage ?
Everyone he knew seemed perfectly happy to get by without wilderness - a country restaurant, Hyde Park in spring, was ail the open space they ever needed. Surely they could not claim to be fully alive. Hot, wet, panting, he strained to heave and lever himself onto a grassy ledge and lay there, cooling his face on the turf while the rain beat upon his back, and cursed his friends for their dullness, their lack of appetite for life. They had let him down. No one knew where he was, and no one cared.
After five minutes of listening to the rain rattling on the fabric of his waterproofs, he got to his feet and climbed on up. Anyway, was the Lake District really a wilderness? So eroded by walkers, with every last insignificant feature labelled and smugly celebrated. It was really nothing more than a gigantic brown gymnasium, and this incline just a set of grassy wall bars. This was a work-out, in the rain. More debilitating thoughts pursued him as he climbed towards the col, but as he gained height and the going became less steep, as the rain ceased and a long fissure in the cloud permitted a tiny consolation of diluted sunlight, it began to happen at last – he began to feel good.
Amsterdam, III, iii
09:19 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 20 novembre 2010
Pourquoi pour moi a des couilles
« J’écris des livres anti-patates : la patate y est contenue. »
(Tomates, p. 88)
Le dernier livre de Nathalie Quintane est peut-être son meilleur. (J’ai une véritable affection pour les textes de Nathalie Quintane – même les ratés comme Cavale*. C’est dire.)
Son titre ? Tomates**.
Le livre parle de plants de tomates (de purin d’orties, aussi), mais, à la faveur d’une métonymie originelle, dérive vers Tarnac et Julien Coupat. C’est ainsi que le livre finit par devenir (aboutit à) une sorte de poème-essai très beau, très drôle aussi, sur l’insurrection qui vient, Auguste Blanqui (le révolutionnaire, pas le boulevard), les émeutes en banlieue… Texte qui allie à une véritable audace formelle (ce qui signifie qu’il n’est pas constitué d’une suite de petites audaces formelles discontinues) une profondeur philosophique à faire pâlir Walter Benjamin (mettons).
Poème-essai ? pourquoi ? [« poème-essai » : ce n’est pas Quintane qui le dit, c’est moi qui l’écris.] La langue de Quintane est poétique ; son rapport au langage est de nature poétique. Pas poésie au sens d’invention stylistique, beauté rythmique etc. : « peut-être qu’un livre se juge aussi aux moments où il refuse de faire galoper le petit cheval » (p. 66) Et ESSAI : par la structure du discours (sauts et gambades) et sa teneur (je donnerai Badiou et tout Minc pour Tomates***).
Cela faisait bien belle lurette (dit le petit cheval) que je n’avais pas lu un texte aussi bref qui donne autant à réfléchir, et à rire ; pour l’alliance du rire et de la profondeur, je recommande sans conteste les deux pages sur les testicules (pp. 96-97 : « la couille est sans pourquoi »).
* Bien sûr, ce n’est pas Cavale qui est raté. C’est ma lecture de Cavale, au moment où je l’ai lu, qui a achoppé, échoué. Enfin, c’est pour moi un livre raté de Nathalie Quintane. Je conseille plutôt : Chaussure et Début. (Pour commencer.)
** Chez P.O.L., paru en septembre 2010. 144 pages, dont peu blanches, 80 francs pour les nostalgiques.
*** Cela ne m’est pas très difficile : je n’ai aucun livre de ces deux Alain(s ?).
14:33 Publié dans Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 13 novembre 2010
De Verville à Walser
Le Moyen de parvenir : commencé lundi soir.
Go down, Moses : commencé mercredi soir.
Le renard était déjà le chasseur (en traduction) : commencé jeudi.
Anglomania : commencé jeudi après-midi.
Der Spaziergang : commencé hier.
Il faudrait que j'écrive, en prime ?!
10:10 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (3)
lundi, 08 novembre 2010
Coup de rabot
"Dans son acariâtre passage l'auto produit l'effet d'un coup de rabot sur la planche de la route d'où les piétons s'épivardent, recroquevillés en boule comme des copeaux, vers les bords et le fossé." (La Randonnée. 1932. Rougerie, 1978, p. 10)
15:15 Publié dans Lect(o)ures, Mots sans lacune, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 07 novembre 2010
Pourquoi lire Dantzig ? (pas inspiré, je n'ai pas trouvé mieux, comme titre)
Longtemps, j'ai hésité à lire Charles Dantzig.
Lorsque son Dictionnaire égoïste l'a propulsé au sommet de la gloire, tant ce qui nous était rapporté de sa vision de la littérature que cette soudaine gloriole me semblaient l'identifier à une sorte de Jean-François Zygel de la littérature, ce qui était, déjà, rédhibitoire. Dans la foulée, l'équipe du Magazine littéraire a sollicité le nouvellement fameux pour écrire les Epilogues de plusieurs dossiers spéciaux ; à chaque fois, j'ai trouvé ce qu'écrivait Dantzig soit totalement plat et rebattu, soit franchement démagogique, confirmant ainsi mon premier préjugé.
Jeudi soir, en zappant avant le match de foot sur W9 (cette précision devrait suffire à convaincre Dantzig, s'il tombe sur cette page, que mon point de vue est celui d'un beauf inculte), je suis tombé sur l'émission littéraire La Grande Librairie. Les invités étaient, notamment, Danièle Sallenave et Charles Dantzig. J'avais déjà entendu parler du dernier essai de Dantzig, Pourquoi lire ? Son argumentaire, tel que l'avaient présenté certains médias en insistant sur le côté provocateur et innovant, consistait à démontrer que lire de la littérature ne sert à rien. Comme il s'agit là d'un argument totalement frelaté à force d'être rebattu depuis un demi-siècle, je n'avais pas eu envie d'y voir de plus près. Or, ce que disait Dantzig jeudi soir (sa conviction, ses gestes mesurés, sa distinction, les exemples qu'il donnait) est allé à l'encontre des préjugés que j'avais accumulés à son égard. (Précision annexe pour les amateurs d'événementiel : j'ai aussi écouté Danièle Sallenave et Stanislas Dehaene, et j'ai raté la première demi-heure du match de foot.)
Vendredi, à Angers, C. a acheté Pourquoi lire ?
Je l'ai lu hier.
Séduit par de nombreux passages, profondément amusé par certaines formules spirituelles et bien trouvées, j'ai passé un moment agréable en compagnie de ces quelque 250 pages. Ce que Dantzig dit de Duras, de Beckett, de la lecture à haute voix, de Stendhal ou des romans de vampires (pour ne citer que quelques exemples) est très fin, très juste aussi. Toutefois, je dois, une fois la nuit passée, constater que ce livre m'a indigné. Va encore pour son côté terriblement superficiel, de bric et de broc : l'absence de structure, la faible cohérence du discours ne sont pas gênantes en soi. Ce qui l'est plus, c'est que Dantzig est très donneur de leçons, d'une manière très adolescente. Or, il est plaisant de recevoir des leçons de quelqu'un qui cite le vers le plus célèbre de Heine (le début de la Lorelei) en l'attribuant à Goethe (p. 31), et ce sans que ni lui ni son éditeur ne se soient aperçus de cet affreux pataquès...!
Tout d'abord, Dantzig a l'art de la généralisation abusive : tout en disant continuellement je, et en faisant ainsi comprendre que ce qu'il dit de la lecture relève de sa propre expérience, il n'en tire pas moins des conclusions générales et tout à fait contestables, sur la lecture annotante par exemple. Inversement, il attribue à la lecture de littérature des propriétés qui ne lui sont pas nécessairement propres : ce qu'il écrit de l'isolement dans lequel se plonge un lecteur, et de l'hébétude, la rupture par rapport au monde qui découle d'un certain temps passé à lire, peut tout à fait se transposer au domaine de l'écoute de musique classique, d'opéras, à l'amateur d'art qui sort d'une galerie ou d'une exposition pas trop bondée, etc.
L'exemple le plus cinglant de cette tendance à la généralisation hyper-abusive est ce que Dantzig dit des universitaires. Selon lui, tous les universitaires sont de stériles frustrés vainement fiers de leurs petits scribouillages ennuyeux que personne n'a envie de lire. Pis même, ils se rendent tous coupables, selon lui, de plagiat et de pillage : ils font travailler leurs étudiants pour mettre ensuite leur nom sur les textes qui ne sont pas d'eux. Bien sûr, comme toute généralisation, celle-ci a son fond de vérité. Avant d'entrer à l'Université, j'avais entendu parler des professeurs qui s'approprient le travail de leurs thésards ; en onze ans, tant comme doctorant que comme enseignant-chercheur, j'ai rencontré en tout et pour tout deux cas de cet ordre, soit une infime minorité, fort heureusement.
Dantzig a sans doute des comptes à régler avec telle ou telle institution, avec tels ou tels universitaires. Qu'il les cite, qu'il attaque de manière précise, et qu'il lâche la grappe à l'immense majorité d'universitaires qui n'écrivent rien, ou dont les recherches sont vraiment bien écrites et intéressantes, ou qui savent pertinemment que les écrivains, contrairement à eux, sont des créateurs. Pour ne prendre que mon exemple, j'ai quasiment arrêté toute forme de recherche (ou de mise en forme de mes recherches sous forme écrite) depuis cinq ans car je suis de plus en plus frappé par le caractère absolument vain des publications universitaires, l'absurdité de tout ce cirque "publish or perish ?", la médiocrité de certains collègues qui, après une habilitation à diriger des recherches aussi creuse que prolifique en pages, deviennent des professeurs imbus de leur petit pré carré ; surtout, j'ai mis un frein à mes recherches car mes doutes concernant ce que je peux avoir encore à dire, de la littérature africaine et de la théorie post-coloniale (mon "domaine"), vont croissant. Ainsi, je partage la plupart des analyses de Dantzig ; ce que je ne comprends pas, c'est sa haine des universitaires. Sans doute n'est-elle pas compréhensible, comme toutes les phobies ou toutes les aversions. Même en admettant que Dantzig puisse avoir des raisons personnelles d'en vouloir à l'Université, et donc qu'il insulte tous les universitaires, quelque chose m'a profondément troublé dans son discours.
En effet, Dantzig consacre deux pages aux raisons qui l'ont poussé à refuser de continuer à lire Céline. (Pages 236-238. C'est une argumentation similaire à celle de Laurent Evrard, telle qu'il m'en avait fait part lors d'une conversation en juillet dernier.) De même, il reproche à Orhan Pamuk d'avoir écrit, au sujet de Maxime du Camp, qu'il était "efféminé mais fiable" (p. 219). Dantzig a tout à fait raison de souligner la contradiction scandaleuse entre un écrivain qui se dit "persécuté par les intégristes" et de tels propos homophobes. En revanche, il fait exactement la même chose quand il décrit les universitaires comme "des mites, bouffies, expirant dans l'ombre" (p. 222). Céline, qu'il cite, traitait les Juifs de termites, dans le contexte et avec les conséquences que l'on sait. Dantzig, lui, crache sur les mites universitaires, les "propriétaires de la littérature", ses Juifs à lui. Peut-être n'est-ce pas entièrement délibéré ; dans ce cas, Dantzig n'est pas un salaud à la Céline, mais une sorte de pilier de comptoir qui écrit, au fil de la plume, tout ce qui lui passe par la tête sans prendre garde.
Voyons ces deux hypothèses. Si c'est un salaud à la Céline, et si je suis son argumentation à propos de Céline, je n'ouvrirai plus aucun de ses livres. Si c'est un post-adolescent qui dit n'importe quoi pour épater la galerie, je ne perdrai plus non plus mon temps à le lire : sur ma table de chevet m'attendent Roberto Arlt, Hans Henny Jahnn, Pessoa, d'autres livres encore de Thierry Beinstingel, Balzac, Ian McEwan, Jonathan Frantzen... de vrais écrivains.
Charles Dantzig. Pourquoi lire ? Paris : Grasset, 2010.
09:59 Publié dans Indignations, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (2)
jeudi, 04 novembre 2010
Prolepse, I : adjectifs toponymiques, avaler la ciguë
His proper business in life was to work, to finish a symphony by finding its lyrical summit. What had oppressed him an hour before was now his solace, and after ten minutes he put out the light and turned on his side: there was always work. He would walk in the Lake District. The magical names were soothing him: Blea Rigg, High Stile, Pavey Ark, Swirl How. He would walk the Langstrath Valley, cross the stream and climb towards Scafell Pike and come home by way of Allen Crags. He knew the circuit well. Striding out, high on the ridge, he would be restored, he would see clearly.
He had swallowed his hemlock, and there'd be no more tormenting fantasies now. This thought too was comfort, so that long before the chemicals had reached his brain, he had drawn his knees towards his chest, and was released. Hard Knott, Ill Bell, Cold Pike, Poor Crag, Poor Molly…
Amsterdam, I, ii
09:55 Publié dans Ex abrupto, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 01 novembre 2010
Le ciment, décidément
Ces derniers jours, j'ai lu plusieurs livres, ou achevé la lecture de plusieurs livres qui avaient été "entamés" simultanément. Dans l'un de ces livres, une famille de quatre enfants devenus brusquement orphelins de père, puis de mère, enterre cette dernière sous une chape de ciment, dans la cave de leur maison. Dans un autre, le ciment tient un rôle important, au point de donner son titre à l'un des premiers chapitres ; dans l'un des courts chapitres décrivant la vie, et surtout la survivance et la mort, dans le camp de concentration soviétique qui est le "décor" (mot inapproprié : le cadre ? pas mieux) du roman, une prisonnière est ensevelie sous un flot de mortier.
Suicide ou accident ?
Le ciment n'est pas si souvent motif central d'un texte littéraire. Il donne son titre au roman d'Ian McEwan, The Cement Garden. Il donne son titre - ainsi que je l'ai dit - à l'un des chapitres du roman de Herta Müller, Atemschaukel. Côté français, je ne vois que le roman de François Bon, Décor ciment, et la chanson de Matthieu Boogaerts. (Moins sinistre.)
15:15 Publié dans Hors Touraine, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (2)
vendredi, 22 octobre 2010
Colons, carons
She would not say of anyone in the world now that they were this or were that. She felt very young; at the same time unspeakably aged. She sliced like a knife through everything; at the same time was outside, looking on.
----------------------------------
He drove past the flagpole with the banging halyard. The wind was banging the halyard against the pole and it made him weak somehow, the repeated meaning of this noise.
13:37 Publié dans Corps, elle absente, Ex abrupto, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)
vendredi, 15 octobre 2010
Merle-pie (Thierry Beinstingel)
Merle-pie
La première fois qu'on voit l'oiseau, passant en rase-mottes au-dessus des rosiers pour disparaître à l'ombre d'un buisson, on a la vision d'une pie en négatif: la tête blanche au lieu d'être noire, mais la même redingote de chef d'orchestre pour le reste des plumes. Les pies, on les connaît cependant. Des effrontées. Pas le genre à passer en coup de vent pour aller se cacher. Plutôt à se poser devant vous, l'œil brillant de colère, le cou déjeté, grattant furieusement le gazon, caquetant, semblant dire : on est chez nous, on vous tolère tout juste. Rien ne les dérange, ni la voiture, ni les mouvements, ni les bruits. La vue du chat les met en rage. Mais ce sont de bonnes gardiennes : pas une fois elles n'auront permis à un corbeau de s'installer dans le jardin. Ce n'est pas négligeable, ils sont nombreux à tourner dans le coin à la recherche d'un nid à occuper, d'un arbre à coloniser. Si on les laisse venir, c'est fini, ils appellent leurs copains, la famille, et ce sont des croassements à n'en plus finir, une ambiance de Toussaint et de pluie incessante à vous foutre le cafard pour le restant de vos jours. Les pies sont hargneuses mais plus discrètes : commérages brefs, chacun chez soi.
On revoit le volatile plus tard, toujours de façon fugitive, éclair blanc et noir d'un vol rapide, vite caché dans le fouillis des branches. C'est un oiseau craintif d'abord. On insiste pour l'observer, mais même l'immobilité derrière la vitre le fait fuir. Et puis il s'habitue au fil des jours et du printemps chantant qui s'avance, fait éclater les bourgeons, pousser les jonquilles et les primevères. Un matin, il reste perché sur un rameau devant la fenêtre, à découvert. On a le temps de l'observer : la tête d'une mouette, toute blanche avec un bec jaune, la redingote de la pie, mais comme trop grande pour lui, l'allure et la dimension d'un merle. L'oiseau ne ressemble à rien de connu. On consulte des livres, Internet. On se rend à la bibliothèque. On fouille dans les encyclopédies. Pie-grièche ? Pinson ? Pic épeiche ? Non, vraiment, il ne ressemble à rien. Et puis on oublie, on passe à autre chose dans la valse des jours.
Un matin, au moment où l'on sort la voiture du garage, le fils dit : il est là, dans les rosiers. Occupé à fouiller la terre de son bec jaune, il ne pense pas à s'enfuir, ou plutôt, comme les autres, il s'est habitué, il sait qu'ici il ne craint rien quand le chat reste à l'intérieur et ce fainéant de matou ne sort plus guère. Vite, l'appareil-photo. Plus tard on envoie les clichés à la Ligue de protection des oiseaux. On me répond deux jours plus tard, à la manière de l'obstétricien qui pénètre dans la chambre de la jeune accouchée : c'est un mâle, un merle ! On me précise qu'il est atteint de leucysme, un défaut de pigmentation dû à une mauvaise synthétisation de la mélanine contenue dans les plumes et qui provoque cet albinisme partiel. Il paraît que c'est assez fréquent chez les turdidés, mais que le spécimen qui hante mon jardin est particulièrement étonnant avec sa répartition homogène, bien marquée et symétrique entre les zones blanches et noires.
On le revoit deux jours plus tard dans le crépuscule propice aux ébats des merles. Il y en a toujours un de perché au faîte d'un toit et qui lance ses trilles incessants dans un ciel épuré des averses de l'après-midi. C'est l'heure tranquille où la pesanteur du travail se laisse choir comme un paquet de linge à laver. On s'accoude à la fenêtre ouverte, désœuvré. Les autres mâles restent au sol, se chamaillent, plastronnent comme de jeunes hommes aux abords d'un bistrot, parlant de foot et de filles. L'albinos est là, sensiblement plus gros que ses frères en livrée noire. Il en impose, roule des mécaniques. À l'ombre des buissons, une merlette couve peut-être ses œufs, futurs petits oisillons en redingote de pie.
(Thierry Beinstingel. Bestiaire domestique. Paris : Fayard, 2009, pp. 159-62)
09:18 Publié dans Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 13 octobre 2010
Portrait of the Artist as Houndstooth

Entrelacements du pied-de-poule : le motif est immanquable, une occupation d'espace. C'est un vertige, la mer élastique qui roule, s'offre, se retire, s'étire en trompe-l'oeil, mailles à l'envers, à l'endroit, en vagues incontournables. Yeux fixés sur la trame pour en percer les secrets : croisillons blancs, crucifix, noirs, pattes velues du tissu, étirements d'araignées sombres, de mouches claires à vinaigre. Eternels recommencements : le dessin pied-de-poule est répétitif, mouvant, en courbes, en ondulations, habité, contenu, nécessaire, superflu, c'est un mirage à force de le fixer, une croyance à force d'illusions.
Thierry Beinstingel. Paysage et portrait en pied-de-poule. Fayard, 2003, pp. 27-8.
06:00 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 19 septembre 2010
Fuzzy sets
Dans notre maison, de plus en plus, les piles de livres sont de plus en plus nombreuses, et de plus en plus anarchiques, disséminées, de plus en plus piles. Entre les livres pour préparer certains cours, les livres que j'achète chaque dimanche dans les réderies (encore, ce matin, à Marmoutier : La Mise en scène en G-F, un Nodier original de 1841, Leçons particulières de Hélène Grimaud... et L'Emigré de Brisbane), ceux achetés au Livre et pas encore lus (le tome 2 du Labyrinthe magique de Max Aub, notamment, m'attend avec d'autres sur une des étagères de ma table de nuit), les lectures croisées et frénétiques de la sélection du Goncourt (dont nous nous contrefoutons habituellement, mais cette année C. fait participer sa classe de 1ère L au Goncourt des lycéens, on joue le jeu), les ouvrages empruntés à la B.U. (par moi) ou à la Bibliothèque municipale (par les enfants (leur emplacement habituel se trouve entre la table basse du salon et le canapé)), et enfin les autres (L'art du contresens de Vincent Eggericx, Nils Holgersson, Sols de Laurent Cohen) qui forment, avec d'autres encore, une pile bizarre et toujours s'agrandissant sur mon bureau (pareille en cela aux tours rouges du dernier roman de Maylis de Kerangal, Naissance d'un pont), plusieurs endroits très localisés mais démultipliés se sont faits piles. Pas la moindre photographie ne peut rendre cela, ni y donner du sens. D'ailleurs, ces piles n'ont pas de sens. Tout juste les ai-je prestement écrites, pour meubler un petit creux de dimanche soir.
21:59 Publié dans Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 09 septembre 2010
Ténèbres à midi
"Des herbes poussent ça et là, et nous avançons en zigzag."
(Ténèbres à midi, p. 112)
Vous sentez le sol se dérober sous vos pieds. Tapis vert, et le pont Wilson, pavoisé multicolore, n'a jamais été aussi prêt de chuter encore sur ses piles.
Après Sols de Laurent Cohen (texte très fort sur lequel il faudrait écrire (voilà bien une rengaine de ces carnets)), j'ai lu le dernier roman de Théo Ananissoh, Ténèbres à midi, avant d'enchaîner sur "le Mathias Enard". Théo Ananissoh est écrivain en résidence à Neuvy-le-Roi, of all places. Notre équipe de recherche va peut-être le rencontrer, lui faire tenir une ou deux conférences d'ici décembre (cela reste à confirmer). J'avais lu Lisahohé lors de sa sortie, en 2005, et avais été frappé par ce ton quelque peu nostalgique, à la Naipaul, et décalé, atypique, dans la production littéraire africaine, essentiellement politisée ou sociale, encore aujourd'hui il faut bien le dire.
Ténèbres à midi est plus fort encore, d'une certaine manière. Il s'agit d'un récit en deux parties : le narrateur, Togolais vivant en Allemagne (et double ambigu de l'auteur), rencontre un conseiller du président avec qui il sympathise le temps d'une soirée parce que, contre toute attente, cet Eric Bamezon, fraîchement rentré d'Europe lui aussi, se confie à lui, et tient des propos pleins d'amertume sur la mauvaise gestion politique d'une Afrique qu'il qualifie de "dégueulasse". Dans la nuit qui suit, Eric Bamezon se suicide, et la deuxième partie consiste, non en une enquête, mais en un approfondissement, par le narrateur, de la figure du suicidé -- notamment lors d'une visite impromptue et magnifiquement décrite à la cour du roi Béhanzin.
Ce bref roman laisse une impression de malaise, car il met les lecteurs européens habitués à lire des textes postcoloniaux face à leurs contradictions en insistant sur le désir de fuite et de migration des Africains, lié à l'incapacité gestionnaire des élites post-coloniales ; le discours impliqué n'est pas loin de redorer le blason de l'époque coloniale, tout en faisant porter la culpabilité principale de l'ère esclavagiste sur les rois africains eux-mêmes... On est donc à cent lieues des discours habituels ou convenus sur la responsabilité de l'Europe, sur les demandes de réparations financières, ou sur les peuples colonisateurs qui ont entravé l'accès à l'indépendance... Selon toute vraisemblance, Théo Ananissoh, à qui demeure la possibilité de se draper derrière le fait que les avis égrénant le roman sont des propositions idéologiques portées par des personnages, n'a pas que des amis dans le milieu littéraire (et au-delà) des expatriés.
Lorsque le narrateur rend visite à la veuve, il demande à voir la bibliothèque d'Eric Bamezon, où deux rayonnages entiers sont consacrés aux oeuvres de Naipaul (cf supra). Pour qui avait déjà lu Lisahohé (cf supra, re), cela n'a rien d'étonnant. Et c'est peut-être dans la volonté affichée, mais pourtant à peine esquissée dans Ténèbres à midi, d'écrire les paysages que l'ombre du grand V.S. Naipaul porte le plus :
Au temps de Guezo ou de Glèlè, il n'y avait pas d'écrivain pour regarder la nature -- les hommes et les paysages ; j'écris donc ce récit avec le désir conscient de suppléer un peu à l'exceptionnelle indigence des ancêtres. (p. 110)
Que penser alors, du point de vue des stratégies narratives et de leur sens, de ce texte qui reste si allusif sur les lieux et les paysages, dans leur chair même ?
Théo Ananissoh. Ténèbres à midi. Paris : Gallimard, "Continents noirs", 2010.
06:43 Publié dans Affres extatiques, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 28 juillet 2010
Boulevards de ceinture, 104
Nous nous consolions, elle et moi, en nous assurant mutuellement qu’il existait encore des fanatiques de Pierre Hamp ou de Jean-José Frappa et qu’un jour, tôt ou tard, les frères Fischer sortiraient du purgatoire.
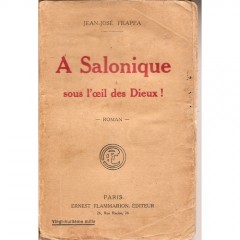
12:23 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)
jeudi, 15 juillet 2010
Grand débordement d'activité, I
[Ferré et Thiéfaine sont les deux chanteurs que je connais qui parlent du Chambertin.]
Arrivée à Hagetmau, divers rangements, ménage etc.
Samedi 10. La Ceinture de jade d’Anatoli Kim. Jackie McLean. Déjeuner sous les arbres.
6 h du soir, course d’Audignon (Deyris) aux arènes de St Sever, aux 9/10 vides (avec Richard). Marty vainqueur, belle prestation du local Plassin, frères Vergonzeanne décidément en déclin. Courtiade use du coudrier sur le cuir des dames. Lalanne pas veinard sur la sans corde. Du beau linge dans le callejon, dont la Zahia des coursayres (Mme Vincent Muiras, il semble). Pointeur débutant archinul, maintes broncas vers la pitrangle.
Soir, petite finale.
Dimanche 11, anniversaire d’A. 10 à table, parents, grands-parents, Mamie J. et V.
Matin, ballons et tronçonneuse. Midi, sangria infecte mais le reste impeccable. Cadeaux en nombre pour A., « yes ! » à chaque coup ! Discussions post-prandiales et vaisselle.
5 h, course de St-Cricq (Dargelos), très moyenne (euphémisme), arènes mi-pleines. Bien placés, presque pas au soleil. Même pointeur gamin nul que la veille, en progrès sauf au moment de la comptabilisation finale individuelle (Lapoudge, 19 écarts globalement convenables, totalement oublié, même derrière Dumecq). Lendresse vainqueur. Frères Deyris suprêmes, surtout J.-F. muselant la sans corde après tumade sur Dumecq. Un tourniquet parfait de Lapoudge, capturé sur vidéo.
Soir, finale lamentable à la télé avec bocadillos et victoire de l’Espagne aux forceps.
Lundi 12. Mrs Dalloway, en bribes, juste le premier tiers (du moins à 6 h 30 du soir, heure à laquelle j’écris ces bribes elles-mêmes). Boogaerts. Pas de course, mais Défis & Champions en DVD à la télé en guise de quatre-heures, avant bonne promenade au Louts. [Crapaud mort gonflé de vermine en plein soleil au milieu du boulodrome. O. n’a pas compris, A. dégoûté.]
Matin, achat de déshumidificateurs car la moisissure a gagné trop de terrain.
« Quelques enduits et je termine. »
Mardi 13. Sur la vieille bécane, toujours (combiné du clavier Fujitsu de 2002 et de l’écran Philips de 2000). Continue Mrs Dalloway. Passage de voitures en trombe sur la route de Monségur. Ratatouille. Saturnin, pour O. (au-delà du ridicule). Acheté le guide vert du Languedoc-Roussillon chez Caldéra. Signe le plus évident, pour moi, de « la grande déculturation », la disparition de guides détaillés, et en particulier des Guides bleus. Regret de ne pas en avoir acheté une pleine fournée quand la collection existait encore, ou de n’en trouver qu’usés, jaunis ou cornés chez les bouquinistes ou les antiquaires.
Furieux de voir le grand cercle où « ils » avaient fait brûler des feuilles et des branches ne pas se remettre de son état calciné – toujours grand pourfendeur in petto (et à haute voix) de l’écobuage. Pas de course aujourd’hui, j’écris ces lignes à onze heures moins dix.
Mrs Dalloway, de Peter Walsh avant midi au dîner de Peter Walsh (‘Bartlett pears’).
Hélicoptères en permanence (avant le 14 juillet ?). Que de remue-ménage aujourd’hui.
Premières idées pour le cours de M1. Different from (/ to, than) → les constructions prépositionnelles après les adjectifs. Autres constructions en from. Utilisations de from dans les textes théoriques (philosophie, littérature, histoire). [Oui, tout juillet dans un seul document.]
7e compagnie, le soir, pour A. – plié de rire à plusieurs endroits. Moins nanard que dans mon lointain souvenir. On a dû pouvoir dire ou écrire, à l’époque, que ça réinventait complètement le comique troupier. Au lit, commencé Underworld, pas longtemps. [La barre d’espace, peu réactive, me fait des blagues, composant des agglutinés.]
Mercredi 14. [Neuf heures et demie.] Poursuivi quelques pages d’Underworld, je ne comprends rien aux règles du baseball donc une partir du tour de force stylistique m’échappe. Cela sent un peu le tour de force, dès le départ. À suivre… Vais lire les 25 pages restantes de Mrs Dalloway.
Désintoxication de café presque totale (juste une petite tasse milieu de matinée). Pas de thé, du tout.
Max Roach & Clifford Brown.
Au lever on a cru au beau, et puis : vent, soleil par intermittences – ça peut donner tout et son contraire.
Après-midi et soirée : Concours de la Corne d’Or à Nogaro. Foule. Belles vaches, sorties festival des sauteurs distrayantes (dont un tout à fait inédit et épatant triple saut périlleux avant et sur la vache par Louis Ansolabéhère), et triomphe de Thomas Marty, tenant du titre et auteur d’un intérieur absolument époustouflant. Le garçon devient meilleur chaque année. Côté trophées, triplé et carton plein de l’Armagnacaise : Barrouillet cordier d’argent ému aux larmes, Ibañeza indétrônable et Baronne vache de l’avenir.
D’où vient la passion et surenchère de Virginia Woolf pour les points-virgule ?
Plus d’hélicos (c’était donc ça).
Jeudi 15. Record de la coiffeuse la plus abrutie & la plus inculte pulvérisé. (Jocelyne, dite « Joss », à Hagetmau.) Avouez que la concurrence est rude…
Continué d’ébrancher des gaules – activité essentielle de ce début d’été – au point de devoir manier le sécateur de la main gauche (triple ampoule à l’index de la main droite (mon père avait raison : « mets des gants de jardinage, Guillaume ! »)).
Pas d’Underworld.
Bassine de 6 kilos de prunes quasi achevée (en 4 jours). Pas besoin de faire des confitures, une famille de quatre estivants suffit amplement à la Cause.
Underworld, 100-122.
14:45 Publié dans Autoportraiture, Hors Touraine, Jazeur méridional, Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 05 juillet 2010
Hôte d'un poids
" Cela faisait longtemps qu'Eibenschütz avait cessé d'écouter. Toutefois, celui lui faisait du bien que quelqu'un parlât à ses côtés. Il éprouvait ce qu'on ressent parfois en entendant la pluie tomber, sans qu'on puisse non plus comprendre son langage. "
Joseph Roth. Les Fausses mesures. Traduction de Brice Germain. Sillage, 2009, p. 124.
[Das falsche Gewicht, 1937]
15:18 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 24 juin 2010
Masse de ta paume...
" Sa figure, je voudrais pouvoir l'épaissir de tout ce qui l'animait sourdement, et que l'oeuvre de Gide, même dans ses parties les plus sincères, ne restitue qu'en secret, à la manière d'un cryptogramme." (Pierre Herbart. A la recherche d'André Gide, p. 12)
" Mais voici Breitbach. Ce qui est curieux, c'est que ce Breitbach est la personne qui, rencontrant par hasard Pierre Vienot dans un train, lui a parlé de l'insuffisance de la traduction de Prinzhorn dont il était en train de lire les épreuves et c'est par Vienot que Gide fut mis en éveil. Cette histoire revient à son point de départ." (Maria Van Rysselberghe. Cahiers de la Petite Dame 1929-1937. In Cahiers André Gide 5. NRF, pp. 86-7)
<<<<<< "He hears a faint halloooo and one or two distant thumps like inflated paper bags being exploded by a fist very far off." (Mouroir, p. 117)
---------> Die Flucht der Stunden machte mich rasen. Unerträglich war mir die Notwendigkeit, sich zu entscheiden; eine Wahl treffen bedeutete mir nicht so sehr auszulesen als: verwerfen, was ich nicht auserlesen hatte. Mit Entsetzen begriff ich die Enge der Stunden und das die Zeit sich nur in einer Richtung erstreckt; eine Linie war sie – wie hätte ich gewünscht, sie sei Raum! -, und so behinderten meine Begierden, die einander nicht ausweichen konnten, sich gegenseitig auf dieser Fährte ohne Breite.
" Qu'est-ce qui me prend ce matin ? Cette brusque envie d'écrire quoi que ce soit dans ce carnet..." (Journal d'André Gide, 7 mai 1937. In Journal 1889-1939, Bibliothèque de la Pléiade, p. 1260)
18:59 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 23 juin 2010
Donne de tes nouvelles
Hier soir, C. me lisait une phrase page de Marcel Bénabou, dans laquelle il est question de l'achat toujours plus compulsif d'ouvrages que l'auteur n'a qu'à peine le temps de compulser et dont il diffère parfois longtemps la lecture. Or, ce livre, elle l'avait acheté il y a quelques semaines, et nous rentrions hier même d'une razzia à la librairie !
De fait, l'étagère du salon où j'entrepose certaines lectures imminentes ou des ouvrages empruntés ne cesse de s'étoffer, et, à la chambre à coucher, les trois étages de ma table de nuit n'y suffisent plus. L'été, se dit-on, n'y suffira pas, d'autant que j'aurai aussi deux articles à écrire, et quatre nouveaux cours à préparer (ça, c'est le bouquet !). Comment, dans de telles circonstances, et avec le reste du travail, reprendre ces carnets en y écrivant des choses, sinon intelligentes, du moins approfondies ?
Dans la frénésie des croisements de lectures – croisements parfois trop hâtifs, feuilletages – j'ai superposé récemment des passages du journal de Gide, des 4 volumes des Cahiers de la Petite Dame et le petit livre de souvenirs de Pierre Herbart, A la recherche d'André Gide. Si je voulais, par surcroît, écrire quelque chose de ces croisements, il me manquerait le peu de temps que je consacre déjà à la lecture. Je devrais sans doute me contenter de recopier à la hâte quelques phrases particulièrement notables de ces différents livres – ce serait déjà ça de pris.
Mais, au poker menteur, toutefois, il n'y a jamais de nouvelle donne.
(Ce qui me rappelle que, hier matin, surveillant au débotté, dans la salle 70, un examen d'une heure, n'ayant ni stylo, ni livre – le rien –, je passai un bon moment à regarder les promeneurs et la Loire et à écrire dans ma tête un poème aux rimes tout à fait extravagantes. Qu'il soit perdu n'a rien de néfaste !)
15:07 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)
mardi, 08 juin 2010
Style et stylisation
Dans la Préface aux Cahiers de la Petite Dame (que je lis grâce à Renaud Camus), signée d'André Malraux, je trouve ceci, qui me fait immanquablement penser à Renaud Camus :
" Il ne s'agit nullement d'écriture-artiste, de tournures inattendues, d'adjectifs percutants : nullement du style de l'écriture, mais de la stylisation de l'oeuvre. " (Maria Van Rysselberghe. Cahiers de la Petite Dame * 1919-1927. In Cahiers André Gide 4. Gallimard, 1973, p. XXII.)
Sauf qu'avec Renaud Camus, you have it both ways : la phrase et l'architecture d'une oeuvre.
21:55 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 06 janvier 2010
Dormir sur la neige, tel un renne
C'est un Philip Roth pas même commencé qui sert à tenir ouvert le livre de Golovanov pour que je puisse recopier la phrase qui suit, et qui m'évoque tant de choses, dans le domaine du rêve, dans les territoires de la linguistique, dans les souvenirs de Norvège (en juillet pourtant), dans les balafres de la banquise, et dans la lignée du long appesantissement poétique autour de l'argile (p. 170) :
Pas un seul morceau de viande qui n'ait sa fonction, pas un seul morceau de peau qui ne soit transformé en niouki recouvrant les tchoums, en toboki (ces hautes cuissardes de fourrure attachées à la ceinture) ou en malitsa, ces longues tuniques en peau de renne avec mitaines et capuchon intégrés qui enveloppe[nt] l'homme en hiver et dans laquelle il peut dormir sur la neige, tel un renne.
(Eloge des voyages insensés, traduction d'Hélène Châtelain. Verdier, 2007, p. 185)
...............
17:30 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)