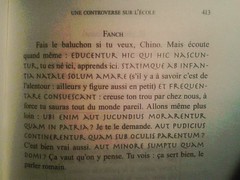samedi, 02 décembre 2023
Au coin court
Moi — levé à 4 h, dois corriger des copies, préparer des corrigés, faire des bricoles administratives.
Also moi — m'informe sur Peter Kurzeck (dont le second tome du grand projet initialement prévu en douze volumes mais arrêté à 8 par la mort, vient d'être traduit par Cécile Wajsbrot) et commence à traduire son troisième, Ein Kirschkern im März :
04:44 Publié dans 2023, Gertrude oder Wilhelm, Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 10 novembre 2022
Soirée de lancement de la résidence de Laurent Vannini
Hier soir, très belle conférence de lancement de résidence de Laurent Vannini, avec Canan Marasligil et Mohamed Mbougar Sarr en conversation autour de la traduction et de l’écriture en langues minorées, mes collègues Anna Krykun, Yekaterina Garcia Markina et Michaela Enderle-Ristori pour l’encadrement du point de vue de la recherche et de l’enseignement, plusieurs « locuteurices » qui ont ouvert le bal avec des lectures de textes et poèmes en diverses langues minoritaires ou régionales ou perçues parfois comme « périphériques » (créole mauricien, puular, galicien, valencien, turc…), et avant un très beau concert ney/guitare/voix de Pelin Başar & Mustafa Caner Sezgin.
Je n’en dis pas davantage : Charlotte Matoussowsky, dont j’ignorais qu’elle se trouvait là mais avec qui j’ai pu échanger deux mots lors du vin d’honneur qui suivait, a extrêmement bien live-tweeté tout cela. J'ajoute seulement le grand bonheur que j'ai eu à entendre MMS saluer et souligner le travail d'Alice Chaudemanche.
Hier soir j’ai donc enfin rencontré Canan, avec qui j’échange depuis pas loin de 7 ans sur les réseaux sociaux, et dont j’admire énormément le travail de créatrice, artiste, traductrice et autrice. Ses interventions étaient passionnantes, et nous regrettons qu’elle doive reprendre le train très tôt ce matin – elle est déjà partie à l’heure où j’écris ces lignes – mais j’ai dans l’idée de la faire revenir pour des ateliers avec des étudiants de L.E.A. (dans le cadre du Laboratoire des traducteurs qu’organise Anna Krykun) et de LLCER.
Ce matin, je vais retrouver Laurent et Mohamed, à qui je vais offrir deux livres, en leur laissant le choix de qui prend quoi. Pourquoi, à votre avis, ces deux livres ? (J'avais un cadeau pour Canan, mais ce sera la prochaine fois.)
Je vais faire dédicacer Terre ceinte, histoire de me distinguer (LOL), mais je me suis avisé en le reparcourant ce matin que la dédicace du premier roman de Mohamed Mbougar Sarr, qui se clôt sur l’évocation de sa grand-mère trop tôt disparue et à qui il aurait voulu traduire son roman en séreer, fait écho, de façon poignante même, aux discussions d’hier, vu qu’il a longtemps et fort bien parlé des conversations qu’il a avec sa mère afin de mieux écrire et mieux traduire en séreer, mais aussi vu que Canan a passé une quinzaine en Turquie en octobre suite à la mort de sa grand-mère, dont elle a dit qu’elle était un de ses liens corporels et intimes les plus profonds avec la langue turque.
08:15 Publié dans 2022, Résidence avec Laloux, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 16 novembre 2020
*1611*
Il y a quelques jours je prophétisai que François Bon franchirait les 6.000 abonné-es YouTube le 16 novembre, et j'ai vu juste.
Dans la vidéo du jour il explore la question de la censure, des nouvelles fonctionnalités de la plate-forme et des signalements pour "contenu inapproprié pour mineurs". Dire que j'ai promis, pour fêter mes 500 abonné-es, quand ça arrivera, de "faire une vidéo à poil"...
Aujourd'hui, à l'Université puis après, pendant plusieurs heures, douleurs gastriques atroces. Toujours l'impression d'être déchiré de toutes parts, puis comme essoré.
19:12 Publié dans *2020*, Flèche inversée vers les carnétoiles, Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 30 août 2019
#JeLaLis : Lady Lisle, Braddon et les béances du Web
En 2018, pendant une poignée de semaines, j'ai entrepris de traduire sur Twitter, demi-phrase par demi-phrase, un roman choisi au hasard, ou presque au hasard, sur la seule foi de sa date de publication (1868, soit 150 ans plus tôt) et de son autrice, que je connaissais de nom mais dont je n'avais encore jamais rien lu.
Ce roman, c'était Dead-Sea Fruit de Mary Elizabeth Braddon.
Je n'ai évidemment traduit que quelques chapitres, tout laissé en plan, et même pas fini de lire le livre (car c'était l'idée : traduire comme on lit, en découvrant le texte). Une des raisons de cet abandon, outre mon effroyable caractère velléitaire et butineur, fut la découverte d'une traduction du roman, d'époque.
En juillet dernier, chez un bouquiniste breton, j'ai trouvé l'édition (qui semble être l'édition originale) d'un autre roman d'Elizabeth Braddon, Lady Lisle. J'en ai commencé la lecture il y a deux jours et en parlerai, à ma façon maladroite et confuse, dans une prochaine vidéo de la série je range mon bureau. Curieusement, ce livre ne figure pas dans la liste, pourtant impressionnante, des romans de Braddon répertoriés par Wikipedia.
J'ai eu beau chercher (allez, trois minutes), je n'en trouve pas la date de première publication. En revanche, Lady Lisle a fait l'objet de deux traductions françaises : une peu après sa sortie, probablement, en 1863 (pensez, Braddon n'avait que 28 ans...), due à Charles-Bernard Derosne et réimprimée par Hachette en 2018, et une récente, de 2001, de Madeleine Jodel. Cette traduction a l'air d'ailleurs tout à fait bâclée et mauvaise, si l'on en croit les avis sur Babelio.
Ce qu'il faudrait, c'est que je dégotte un roman de Braddon jamais traduit (ici ?) et que je m'y mette pour de bon. Pour cela, il faudrait que je m'épluche les résultats donnés par le SUDOC, en espérant qu'ils soient (sont ?) exhaustifs.
À première vue, si je souhaite renouveler l'expérience sur Twitter pour le cent-cinquantième anniversaire (quel dommage que le français n'ait pas d'équivalent au beau mot anglais sesquicentennial) d'un livre, je devrais pouvoir me (re)faire la main avec Fenton's Quest (1871), qui ne semble pas avoir été traduit en français.
08:29 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures, Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 14 juin 2019
Lémurie & Malcolm de Chazal
J'achète et lis très irrégulièrement la revue Europe... trop irrégulièrement d'ailleurs, car c'est toujours un enchantement... et je m'aperçois que je l'achète souvent quand le dossier principal est consacré, non à un écrivain que je connais bien, mais à un écrivain que je connais très mal et autour duquel je tournicote depuis pas mal d'années...
Aujourd'hui où il faudrait que j'enregistre enfin la vidéo sur le n° 2 des Lettres de Lémurie et le nouveau très beau roman de Johary Ravaloson, je m'attaque à ce cahier coordonné par Alexander Dickow et qui semble d'une sacrée tenue. Avec un dodo en couverture, comme pour et par les éditions Dodo vole.
Cet été, c'est décidé : je lirai, par et pour moi-même, Malcolm de Chazal.
11:11 Publié dans Affres extatiques, Lect(o)ures, Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 02 mai 2019
Autoportrait en troll stérile
- Blog, textes de recherche, vers fantaisistes, photographie... : Touraine sereine (4.510 articles)
- Textes expérimentaux, traductions, invention de formes poétiques : Musicien masque de mots (2.945 articles)
- Projet Pinget (en cours — 18 vidéos à ce jour)
- Improvisations et lectures de tous les livres que je lis : je range mon bureau (depuis 2017, 45 vidéos à ce jour)
- Improvisations et lectures des livres empruntés : je rends des livres (depuis 2017, 25 vidéos à ce jour)
- #JeLaLis Gertrude Stein (série commencée le 22 avril 2019, donc seulement 6 vidéos à ce jour)
Ne parlons pas de Twitter et Facebook, qui me servent aussi d'atelier... et ne parlons pas du fait que tout cela n'inclut rien de mon activité professionnelle : plusieurs nouveaux cours à préparer chaque année, entre 2.000 et 2.500 copies par an, travail d'encadrement des étudiant·es d'échange depuis 2011, séminaires de recherche, colloques, articles... En effet, mon enseignement et ma recherche ne portent ni sur la vidéo, ni sur Pinget, ni sur Gertrude Stein, ni sur la poésie, ni sur l'écriture poétique, ni même (en fait) sur la traduction improvisée.
10:56 Publié dans Autoportraiture, Résidence avec Laloux, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 11 décembre 2017
Le vent
Un réverbère arraché est tombé sur le tramway, pont Wilson. Que ce pont a connu de désastres.
Un peu plus loin, m'étant extirpé à grand peine de la ferraille éventrée, je me suis frayé un chemin entre les plaques de chantier et les panneaux publicitaires qui tournoyaient avant de fendre l'air. Quatre piétons autour de moi fauchés. Un est mort sur le coup, je crois.
Maintenant il faudrait que je fasse des miracles ? À d'autres que moi, grimaces !!
07:16 Publié dans Moments de Tours, Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 15 octobre 2017
d'un palimpseste de blues (tercets)
tercets improvisés sur la dernière vidéo bluesy de F.B.
chariots abandonnés
gros blocs de béton tagués
chaque mercredi longés
l'horloge sur l'esplanade
avant chaque nouveau cadrage
de l'aiguille en blues malade
deux étages : c'est la rame
les petits pavés rouges
véhicules et piétons comme accélérés
après le bleu fluo d'un granizado
au médian des rails : les phrases
blues de penser à la retraite
la vitre où défilent secs
immeubles & lignes (vieillir tes os)
à la bottleneck : come on in my kitchen
la fatigue avec Beckett
défile dans la nuit refaite
des mots apparus disparaissent
dans le ciel gris pétrole
le blues est-il un jeu de rôle
à coups de cutter dans la tôle
à l'arrivage : dédicace
& encore des murs
encore des murmures
le poème en vidéo perdure
07:18 Publié dans Ecrit(o)ures, Flèche inversée vers les carnétoiles, Résidence avec Laloux, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 25 mars 2017
3699, ou tout autre nombre
François Bon s'est rendu récemment dans deux villes que je connais bien, l'une pour y avoir longtemps été élève (Dax), l'autre pour y avoir vécu six ans (Beauvais). De la seconde, il a rapporté un film très émouvant. Ce film m'a donné l'idée, au détour d'un commentaire (cf infra), d'écrire, par petites touches, un texte sur Beauvais. Quoi que, dans l'idée de départ, il y ait un rapport avec cette histoire de mêmoire autour de laquelle je tourne depuis plus de dix ans, je refuse en fait de circonscrire le propos : ce sera un texte sur Beauvais. Et surtout, je vais tenter de l'écrire sans le publier au fur et à mesure dans un des blogs.
__________________________________________________
La musique d'Arve Hendriksen est très sinueuse, prenante, défile comme le paysage. Parties de foot, cabanons, nuages lourds et blancs au-dessus des labours... Beauvais, tant de souvenirs... six ans, si peu écrit... si peu écrit dont j'aie gardé de vraies traces, surtout... (Et si j'écrivais un texte genre Trois-mille six-cent quatre-vingt-dix neuf choses que je peux dire de Beauvais ?) Me rappelle comment je prenais le train pour Paris à 5 h 07 le matin en gare de Beauvais — par une distorsion lynchienne tu eusses pu me filmer la nuit dernière. Le cinéma n'existait pas, pas à cet endroit-là, pas que je me souvienne. Donc ton film involontaire, pourquoi ne me captera-t-il pas ? La cathédrale et les galeries nationales de la Tapisserie, tant de souvenirs. “Lieux ingrats”, je ne suis pas forcément d'accord. (En fait, j'adore l'intérieur des Galeries. Énorme émotion de revoir ça dans ton film.) Blues autour du zinc, je n'y traînais pas trop ; les autres festivals, oui ; ville très dynamique ; magnifique médiathèque. Dans la partie accélérée on voit les personnes (personnages) à l'étage de la gare qui s'activent, vibrionnent, « et les mots trop pauvres qu'on [leur] impose comme un masque ».
samedi, 10 décembre 2016
« Quelqu'un a perdu son charme »
Ce matin, après avoir passé l'aspirateur, j'ai dû reprendre Oméga qui, en se faufilant sous l'immense épicéa — on se souviendra longtemps de l'année où j'ai envoyé un SMS « Le sapin est trop petit » et où mon épouse n'a saisi l'antiphrase qu'en débarquant à la maison — a fait tomber des brassées d'aiguilles, ce deux heures à peine avant son frère aîné, qui, dansant pour nous faire rire entre deux plis à la belote (oui, nous avons des débuts d'après-midi très traditionnels !), en a aussi fait tomber.
▓▒░░▒▓▒░▓
Avec ça, et le reste, je n'ai pas commencé à corriger de copies, mais je visionne Coiffeuses, le film que François Bon a fait avec le réalisateur Fabrice Cazeneuve et qu'il vient de mettre en ligne. Ça aussi, notre dialogue, nos polylogues sur la Toile, même par la vidéo : ce matin, j'ai fait ma cinquante-neuvième vidéo de traduction, avec une qualité inférieure, des hésitations à la pelle. En regardant une des séquences dans lesquelles une des apprenties lit le texte qu'elle a écrit pour l'atelier de François, je suis frappé par cette phrase : « Quelqu’un a perdu son charme mais a toujours son charme quelque part. » — Frappé, car je trouve ça très fort, très durassien. Je vérifie le texte, que je n'ai aucun mal à retrouver sur le site de François, et il s'avère que l'antithèse repose, non sur une répétition mais sur une paronomase que je trouve, pour le coup, plus faible : quelqu’un a perdu son charme mais a toujours son arme quelque part.
Les rayons percent, filtrent, et les aiguilles peuvent tomber. Ça fait des semaines que je bloque sur deux sonnets à écrire, et quelques chapitres à relire. J'aimerais m'en moquer.
▓▒░░▒▓▒░▓
C'est vers cette même époque, fin 2006 puis 2007, qu'on a un peu travaillé ensemble, avec François Bon.
Sur des erreurs de perception repose beaucoup, pour moi, le charme de la poésie. On a perdu ce charme en fixant trop à l'écrit. Le passage par la piste audio — ici, par le visionnage — restitue un charme ambivalent. Dans l'image, retenir par exemple ce plan où, tandis que la jeune fille parle du renoncement à sa vulgarité, on voit le couple de dos, main dans la main, marcher le long des panneaux électoraux, avant le rodéo du scooter tout seul devant des portails de garages.
Faut-il aussi me moquer de tout ce que je laisse en plan (ici) ?
▓▒░░▒▓▒░▓
Aiguilles d'épicéa qui tombent : mes cheveux ras qui tombent dans la bassine quand je me tonds la tronche, deux fois par moi, ou les mèches blanches dans cet autre film de François que j'ai découvert ce matin (on partait pour l'Angleterre).
15:37 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles, Moments de Tours, Résidence avec Laloux, Tographe | Lien permanent | Commentaires (1)
dimanche, 13 novembre 2016
De Donald Trump, et des encyclopédies
Je viens de dénicher encore un très bon exemple pour mon cours de documentation sur les encyclopédies, dans lequel je démontre notamment que :
1. la Wikipedia, anglophone mais pas seulement, est un outil d'approfondissement et de connaissance souvent plus fiable que bien des sources “autorisées” *
2. les encyclopédies “classiques” doivent faire l'objet d'un regard aussi critique que ce qui se trouve sur le Web
L'exemple ?
Il s'agit de l'article “Donald Trump” de l'Universalis en ligne (accessible seulement aux abonnés, donc gratuite pour tous nos étudiants via leur ENT).
Cet article en français, dont l'auteur est pourtant un éminent américaniste (vice-président du jury d'agrégation, crois-je savoir), comporte plusieurs énoncés non neutres, plusieurs erreurs rédactionnelles, et surtout des faits non avérés, ou discutables. Par exemple, l'auteur reprend comme une évidence ce que plusieurs instituts de statistique ou politologiques contestent, à savoir que Trump a été élu en parvenant « à mobiliser largement les abstentionnistes de son socle électoral, majoritairement les Blancs non diplômés de l’enseignement supérieur ».
Sur WP, un tel article se verrait immédiatement apposer un ou plusieurs bandeaux d'avertissement : neutralité, nécessité de citer les sources etc. Sur l'Encyclopédie Universalis, le vénérable professeur d'histoire américaine est libre de signer son nom un article contenant plusieurs approximations, et, je le suppose, de dire — comme tant de collègues qui n'ont jamais regardé de près la Wikipedia et son fonctionnement — du mal de Wikipedia !
* Ce que j'essaie de montrer dans ce cours, en expliquant le fonctionnement des bandeaux, le système de recherche dans l'historique, le système de vote collectif pour améliorer ou supprimer des articles, c'est que le fait que tout le monde puisse être auteur ne se fait pas au détriment de la qualité. (Au contraire, même : la WP est actuellement l'outil encyclopédique le plus complet et le mieux écrit, en anglais notamment.)
La majorité de nos collègues en sont restés à l'époque des débuts, vers 2004, où on pouvait écrire n'importe quoi et où ça restait en ligne pendant des semaines. Cela est nettement moins vrai de nos collègues anglophones, qui, depuis très longtemps, participent activement aux portails des domaines dont ils sont spécialistes.
En France, quand apparaît un outil formidable mais bouleversant les codes, on préfère cracher dans la soupe plutôt que de participer à l'améliorer. L'exemple plus frappant, dans cette histoire des rapports de frilosité des élites intellectuelles françaises vis-à-vis du numérique, restera pour moi cette baderne de Fumaroli fustigeant le Projet Gutenberg et Google Books en vantant les mérites de Gallica, qui était, à l'époque, cent fois moins complet et surtout cent fois moins pratique que Gutenberg ou Wikisource. Depuis, d'ailleurs, Gallica s'est considérablement améliorée... en se gutenbergisant.
22:31 Publié dans Chèvre, aucun risque, Indignations, Résidence avec Laloux, WAW | Lien permanent | Commentaires (4)
lundi, 26 septembre 2016
Quelques commentaires au fil de la vue, de la plume, de quoi d'ailleurs.
Déjà, être une casserole, ça me surprend. Je pensais qu'on traînait des casseroles, mais découvrir que François se dit casserole en se coiffant d'une casserole, ça me lave la scarole (pour le dire poliment).
La pézize est un champignon !
La pézize orangée est un champignon ! (Je me suis exclamé ça en entendant “je ne sais pas du tout ce que c'est la pézize”, avec l'odeur des sous-bois qui remonte dans les narines de la mémoire.)
Élisée, pour Reclus, m'intrigue, vu que j'ai lu L'homme des bois en 2015, et que — « il cause toujours, l'inaudible ? » — à Hagetmau on a un énorme volume de la Géographie universelle, que je me suis colleté à ce terme si gênant de francophonie forgé par Onésime, etc. Donc on va lire ce livre de Giraud, sûr.
Puis, tout ce passage du film où l'audible parle à côté de l'image de l'inaudible, c'est drôle et profond, ça frôle la discrépance (oui, celle d'Isou). L'apparition du livre, la réapparition de l'improvisation. Dans la foulée de la présentation du livre de David Le Breton, la citation de mémoire de Baudelaire est impressionnante, le surtitre a tort d'en regretter la non-abstention. Si on enlève le sujet, qu'est-ce qui parle ? Je n'ai jamais lu David Le Breton, mais y a-t-il un lien avec l'anthropologie type Jean-Thierry Maertens (sur l'inscription, l'incision, la masquilinité etc. — oui, je parle donc ici de mes obsessions, je renvoie un écho à la voix audible que j'entends — en notant cela, je marque durablement ce que je veux creuser de ce que cette vidéo palimpseste m'a suggéré).
................................ il y a vraiment un éditeur qui s'appelle Monty-Petons ??? .............
Alors, comme ça je pourrais fractionner mon commentaire pour atteindre directement les 50 commentaires. Non, je ne fais pas ça. Comme pendant qu'il y a deux livres dans la main de François Bon, il y a trois François Bon, démultiplication à l'écran.
[Loti : je n'ai lu que Ramuntcho et je n'ai toujours pas visité sa maison à Rochefort.]
▓▒░░▒ Pour se lancer dans l'édition, ça se lance ! L'oiseau d'orage, c'est un titre magnifique. Voilà, je vais vouloir emprunter La maison du péché et acheter cet Oiseau — François, il ne faut pas faire acheter des livres comme ça, c'est dangereux pour la damnation.
Les Petits traités de Quignard, que je n'ai pas du tout lus (décidément), je me rappelle l'avoir vu les présenter au tout début des années 90 dans une émission de télévision présentée par Bernard Rapp, avec un roman qui s'intitule Albucius.
La pézize orangée est un champignon !
La pézize est un champignon !
Les tricheurs qui ne cliquent que sur la fin, pour le cadeau, tu les repères avec le nombre moyen de minutes par visionnage, c'est ça qui m'a découragé de poursuivre les traductions sans filet en vidéo, car j'avais 15 vues au bout d'une semaine, avec une moyenne de 2 minutes par visionnage pour des vidéos de 11 à 15 minutes.
Donc voilà même avant le tirage au sort j'ai mérité Perrine Rouillon mais je ne triche pas du tout bien entendu.
samedi, 17 septembre 2016
Au prisme du Styx
Mieux vaut en rire que de s'en offusquer.
Je découvre aujourd'hui l'existence d'un prix littéraire sobrement nommé Prix du Style. Étonnement, mais pas longtemps : en effet, à l'heure où la très large majorité des prétendus écrivains ne savent plus ce qu'est une phrase, et où tant de critiques nous parlent d'écriture blanche pour des écritures vides (Philippe Claudel, Véronique Ovaldé, j'en passe et des pires), faut-il s'étonner qu'on finisse par consacrer un prix littéraire au style ?
Et donc, qu'est-ce à dire ? Qu'on va juger du style séparément du reste, à la lagarde&michard ? Ou qu'on va décorer une œuvre totalement creuse mais bien écrite ? Cela fleure la décadence à la puissance sept, c'est-à-dire le retour à un tiède passé.
Voilà sans doute, dans un premier temps, ce qu'il y a à en dire, ou à en penser. S'inscrire dans le refus fondamental de ça, la séparation du fond et de la forme, de la syntaxe et du message, gna gna gna.
Puis, tout de même, pris d'un remords, je décide de consulter le site Web dont j'ai donné le lien plus haut — et ceux qui ont cliqué avant de poursuivre la lecture de ce billet ont déjà dû se choper le même fou rire que moi —, et voici ce qu'on peut lire à la une :
Tristante [sic] Banon et Marc Lévy intègrent le jury du Prix du Style
C'est tellement gorafiesque * ou abracadabrantesque que j'en ai fait une capture d'écran. La coquille au prénom, la tournure incorrecte (intégrer un jury ??), la photo totalement old school...
Last, not least, les deux promus : Tristane Banon et Marc Lévy, qu'on cite presque systématiquement (en particulier le second) pour la médiocrité de leur langue... Le nom même de Marc Lévy est devenu, avec ceux de Musso ou de Gavalda, un raccourci pour désigner des récits conformistes et plats. Alors, ce Prix du Style — quoi ? le Prix de la Meilleure Mauvaise Rédaction de Cinquième ?
Mieux vaut s'en gausser que de s'en indigner.
* Après avoir reconsulté la composition du jury, je n'arrive pas à penser que ce puisse être autre chose qu'un canular, ou qu'un fake. Le fondateur et président du jury a publié un livre sur les Schtroumpfs qu'il a ensuite adapté au théâtre des Déchargeurs ???? Come on, give us a break.
08:48 Publié dans Indignations, Lect(o)ures, Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (1)
dimanche, 28 février 2016
“avec encore des puzzles, et un géranium indifférent”
François Bon a publié aujourd'hui une vidéo, tournée en Auvergne, où il se trouve pour une quinzaine.
Dans cette vidéo, il lit le premier état d'un texte en cours sur les livres perdus ; le film, de neuf minutes, s'intitule Récrire un fichier perdu.
Comme toujours dans son vidéo-journal, il ajoute des surtitres, brèves notations expliquant ce que l'on voit à l'image, ou commentaires subjectifs. Ici, le caractère discrépant m'a particulièrement frappé. Sans doute y suis-je très attentif car la rencontre du concept de discrépance, quand j'ai dévoré les œuvres théâtrales et théoriques d'Isidore Isou, en 1995, m'a durablement marqué.
Ce qui me frappe, c'est qu'il devient difficile — au fur et à mesure que François Bon filme les pièces du gîte, tel ou tel objet insolite, telle porte ouvrant sur le vide, et qu'il y ajoute ses lapidaires légendes — de se concentrer sur le texte qu'il lit, pourtant essai sur un sujet qui m'intéresse. L'esprit n'est pas seulement partagé, divisé entre l'image et le son, qui sont en décalage (discrépance), mais aussi entre la forme de l'essai lu (prose théorique) et les légendes, qui s'apparentent souvent à des sortes de haïkus en vers libres. Le mien, d'esprit, a fini, au premier visionnage, par n'être plus happé que par le gîte et les notations en légende.
Heureusement, on peut relancer la vidéo...
Deux autres éléments, plus personnels, peuvent expliquer ma distraction :
- souvenirs (excellents) de notre séjour dans le Cantal, à Pâques 2014, dans le château de Jussac
- quand je regarde les vidéos de François (toutes), je me retrouve vite à tenter la traduction simultanée des légendes... ce qui n'est pas gênant quand le vlog ne propose que les images animées et les légendes [Je vais sans doute donner prochainement un extrait d'une des vidéos de François à traduire dans la partie “improvisation” de mon cours de thème de troisième année.]
▓▒░░▒▓▓▒░ Plusieurs fois, depuis un an et demi j'ai tenté de faire des billets de vlog, mais, outre que je ne prends pas le temps de travailler tout ça dans WMM, ma connexion est si lente qu'une mise en ligne sur youTube prend deux plombes pour un fichier de 8 minutes. ▓▒░░▒▓▓▒░
mardi, 05 janvier 2016
La boucloucle va boucler
Un moment comme tant d'autres.
Ce matin, dans le tramway, je lis la très belle nouvelle de Christian Garcin, “Les muets” (dans La neige gelée ne permettait que de tout petits pas). J'ai décidé de découvrir Christian Garcin suite à une vidéo enthousiaste de François Bon. Presque simultanément, notre ami lillois — à qui nous avons rendu visite début mai — nous envoie ses vœux électroniques. Or, la nouvelle se passe à Lille, se nourrit de la ville.
Plus tard, je lis, sur Facebook, la belle chronique d'André Markowicz sur la neige tombée dans la nuit du 3 janvier à Petersbourg. Comme cela me fait penser au célèbre “Souvenir de la nuit du 4”, je cherche, comme ça, au hasard, une traduction anglaise.
Après avoir trouvé une paraphrase d'une étonnante platitude, je trouve, sur Wikisource, une magnifique traduction. Elle est de Toru Dutt... Toru Dutt, je la connais, sous un autre versant, grâce au travail de Chandani Lokugé, autre écrivaine que j'ai pu côtoyer — comme André Markowicz et François Bon — lors de son séjour de travail à l'université de Tours.
lundi, 03 novembre 2014
La Toussaint (+ 2)
Le lundi 6 octobre, je n'avais pas voulu m'encombrer de l'ordinateur portable, et le 13 j'avais dû emmener Oméga chez le médecin en lieu et place de l'habituelle séance au Conservatoire entre 5 et 7, de sorte que mon chronotope a pu donner l'impression de battre de l'aile.
Ce soir, toujours pas d'ordinateur, mais deux bouquins, quelques feuilles de papier dans ma serviette rouge griffée Université, et surtout cet ahurissant changement climatique qui nous a fait passer en deux jours à peine de l'été (ou à peine moins (dans les Landes, en tout cas, et à Pau jeudi, c'était l'été)) à une impression d'hiver. Rue Jules-Simon, puis rue Colbert, la pluie froide, 13 degrés au thermomètre mais l'épiderme comme saisi par le frimas — le matin, j'avais commencé à traduire le poème de Cynthia Atkins, “Goodbye to Winter”, avec les étudiants de L3, quel étonnant contraste, d'une équinoxe à l'autre mais début novembre, bizarre décalage.
Après avoir traîné mes guêtres dans un bistrot minable de la rue Colbert (trop de bruit malgré le peu de monde et piètre éclairage), j'ai dû constater que la pluie avait redoublé (des trombes ininterrompues jusqu'à maintenant, j'écris ces lignes à presque dix heures du soir) et qu'il ne me serait pas possible de commencer le tournage des vidéos du projet “boîtes à lettres”. Vers six heures, j'ai regagné la noire calèche, m'y suis posé, ai poursuivi la lecture de Hiding in Plain Sight, et décidé qu'après tout, lire le passage que j'avais choisi (l'incipit) de La Toussaint là, dans la bagnole, avec la pluie battant contre la vitre et les phares des autos qui descendent la rue Jules-Simon, ce n'était pas mal. Les boîtes jaunes attendront.
Après la lecture à haute voix, j'ai tracé les bouts de phrases suivants au feutre fin vert sur une demi-feuille, dans l'idée qu'ils me serviraient à composer ce billet. Et puis en fin de compte je les livre tels quels, au feutre vert numérique :
la pluie ininterrompue
le café presque désert mais bruyant
l'éclairage partout blafard
photographies
l'ombre grise du cèdre
la ligne blanche du cadre (sombres photographies)
la grisaille des rues et du bitume
le refroidissement subit, mâtiné d'humidité et adossé à la lecture de La Toussaint, donne l'impression d'être passé été → hiver en deux jours seulement
Tout dégouline
Pas eu moyen de tenter le petit film, avec la pluie ininterrompue
dans la Prius, Dionissi de Julien Jacob en voyant défiler l'embouteillage
Sur le chemin du retour, on réécoutait Dionissi, Oméga a lancé qu'il pleuvait des cordes, je lui ai dit que ça collait parfaitement à la guitare sèche.
Le chronotope a repris de la vigueur ce soir. Rideau.
21:52 Publié dans Ce qui m'advient, Résidence avec Laloux, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 01 novembre 2014
Rond-point de la Chaise. Lundi 27 octobre 2014.
J'ai donc fini par me lancer et par proposer un pâle hommage au très beau projet de François Bon, Tours en 80 ronds-points / la littérature se crie dans les ronds-points.
Bien sûr, mon hommage reste cela, donc pas un strict décalque, notamment parce que je n'ai pas le quart du talent de François Bon, et pas le dixième de son énergie.Très entre autres, je ne proposerai pas la plupart de ce qu'il fait, lui, dans son dispositif : pas filmé la circulation depuis le rond-point, pas inhumé de livre, etc.
Cela faisait quelque temps que me trottait dans la tête l'idée d'un petit tournage sur le rond-point de Chalosse, à Hagetmau, ainsi dénommé bien qu'il soit désormais connu sous son autre nom, rond-point de la Chaise. Prenant cette chaise géante comme point d'ancrage, j'avais d'abord songé à lire un extrait de Gargantua, ou, différemment, à lire un extrait d'un des plus grands formats ici présents (Géographie de Reclus, Vie de Saint Louis, ou certains Dumas dans le format relié sous pleine peau qui nous viennent d'on ne sait où).
À ce stade, une précision : la maison de Hagetmau est une demeure de vacances, où nous n'avons ni téléphone ni télévision ni connexion Internet. Nous n'y avons qu'un assemblage hétéroclite de livres, pas mal de laissés-pour-compte, des délaissés, des entassés, odds and ends – de sorte que je n'ai pas, très entre autres, la moindre ligne de Rabelais. Je me suis dit qu'au fond cela faisait partie des contraintes et ai jeté mon dévolu sur un Sarraute resté ici parce que le Pléiade étant à Tours, celui-ci faisait doublon. Et surtout parce que, en fin de compte, me filmer à Hagetmau en train de lire un texte – quel qu'il soit – à haute voix revient à célébrer ce hic et nunc ; constatez-le par vous-mêmes, combien de fois déjà ai-je, ici même, écrit « ici » ?
Donc Ici s'imposait.
Quelques mots sur le rond-point.
Il n'est orné de cette gigantesque chaise que depuis huit ou neuf ans. L'objectif était de célébrer l'activité industrielle qui symbolise la cité de Hagetmau, et qui a employé jusqu'à 1.400 personnes ; ironie, la quasi totalité des usines ont mis depuis la clé sous la porte, faisant même de cette commune d'à peine cinq mille habitants la commune la plus sinistrée de l'ère Sarkozy-Fillon, et celle avec la plus forte augmentation du taux de chômage. À en croire la quantité de maisons à vendre, entre autres signes, la sinistrose n'a pas dit son dernier mot.
L'extrait que j'ai choisi de lire n'est pas seulement un de mes textes préférés de ce volume écrit par Sarraute à presque cent ans (et je songe à ma grand-mère paternelle, qui aura 100 ans, justement, dans douze jours), mais aussi parce que le nom d'Arcimboldo offre ce subtil mélange entre la nature (agricole, fruitière) censée caractériser la Chalosse et la τέχνη, l'œuvre humaine, dont on voit, sur la série de photographies prises autour du (et depuis le) rond-point, qu'elle est ici (et en fait, partout dans les Landes, une des régions de France les plus salopées par le foisonnement des hangars et des panonceaux les plus dégueulasses) omniprésente. On le voit nettement. Ce que j'ai choisi de montrer, aussi, c'est que les déchets vont par deux, qu'il s'agisse de bananes ou de canettes de bière : là encore, nature et τέχνη — je n'ai rien manigancé.
Tandis que, à peine parvenu sur le rond-point lui-même, je posais au sol, près d'un des tapis de galets, la chaise en plastique rouge dont je comptais me servir pour poser l'appareil photographique (on ne fait pas plus amateur que moi), un type, la soixantaine, qui passait sur le rond-point, vitre baissée, m'a lancé ce qui me semble être la quintessence de l'humour gascon : « Eh, faut garder la chaise rouge, là, hein, l'autre elle vaut rien ! » — J'étais parti pour assumer ma lecture à la face du monde (!), ἕξις plutôt qu'ὕϐρις.

...
Ensuite, pendant les presque six minutes de lecture filmée, j'ai constaté qu'il y avait facilement trente poids lourds (ce qui pourrait faire une moyenne de 300 par heure, pas mal pour de prétendues « zones rurales ») mais n'ai pas remarqué qu'on me hélât ou tentât de me déconcentrer. Les champignons, en revanche, sur le tronc près duquel j'avais garé ma voiture, proposèrent un point final provisoire à cet échange entre le siège géant et l'arcimboldo miniature.
(En bonus : les 33 photographies en tous formats sur ma galerie Flickr.)
Ajout du 3 novembre : mon père au pied de la Chaise, l'été dernier, et saisi par ma mère en train de la photographier (la Chaise, pas ma mère (aaaaaaargh)).
vendredi, 17 octobre 2014
Vitrines sur les Joulins
Depuis bientôt dix ans que je tiens, irrégulièrement, ces carnets, j'ai déjà eu l'occasion d'écrire à quel point la place des Joulins m'inspirait, et combien je pourrais en faire, si j'avais le temps d'y traîner plus souvent et plus longtemps mes guêtres, un chronotope tourangeau fondamental. Depuis un mois, j'ai adopté, pour ma pause déjeuner du vendredi, le bistrot qui a remplacé les précédents avatars situés là (dont les Joulins, tout simplement). J'écris « bistrot », mais il s'agit tout à fait d'un café à la française, côté terrasse, et, à l'intérieur, d'un pub au sens le plus cosy et sombre feutré du terme.
Au Kaa, donc, j'expie mes heures de frénésie laborieuse du vendredi matin, et me prépare à mes heures de cours de l'après-midi — au cours desquelles, hier, j'ai tout de même dû préciser, pour la majorité des étudiants de première année, qu'un texte pouvait être “poétique” et évoquer des sujets terre-à-terre, et même des coucheries entre un maître et sa servante...
13:23 Publié dans Ce qui m'advient, Résidence avec Laloux, Sites et lieux d'Indre-et-Loire, Tographe, WAW, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 22 mai 2013
Les enfances Chino
Ce texte foisonnant, fait de redites, de reprises et d'élucubrations assumées (entre un marquage esthétique hérité du premier surréalisme et un travail formel plus élaboré), creuse, sans craindre prolifération ni prolixité, le motif de la rencontre entre une enfance briochine et de nombreuses œuvres (gravées ou peintes) de Goya. Nombreuses phrases brèves, abus des ruptures. Tel quel, et malgré son côté massif, le “roman” se prête, sans autre tripatouillage qu'un choix, la sélection, à un opéra, ou toute autre mise en voix : jouant sur des registres croisés complexes (populacier, puéril, savant, sportif, médiéval, litanique, latiniste, etc.), le “récit” appelle la scène et l'art lyrique.
Prigent semble tenter, non de circonscrire, mais, au contraire, de laisser déraper (halluciner) la parole du monde minuscule dont il fouille les recoins. Ce monde minuscule (petite communauté bretonne, enfance difficile à « faire parler » (j'en reviens toujours à ce qui est, pour moi, le modèle absolu, Kotik Letaiev (or, je m'avise, en mettant en forme aujourd'hui [22 mai] les notes manuscrites à l'encre rouge [du 13 mai], que Prigent a préfacé l'édition française de Glossolalie))) s'avère colossal parce que la langue doit, a pour tâche de, proliférer.
Pour l'hallucination, bien sûr, Goya se pose là.
Tenter de dire une enfance d'après-guerre et le monde pré-postmoderne au miroir des pointes de Goya, c'est ouvrir sciemment une boîte de Pandore.
D'ailleurs, dans l'adverbe sciemment, le français constitue le savoir sur la faille entre une découpe (qui fait gicler la parole) et le mensonge (qui explose ou cèle). — Explosion-dissimulante et giclure se retrouvent (trop) abondamment dans les (trop) nombreuses explorations scatologiques du texte. La surabondance scatologique ne m'a pas dérangé (ce qui serait accorder trop de poids à son caractère transgressif, devenu tout à fait trivial et inutile), mais elle me semble déséquilibrer le texte, le faire basculer trop souvent ou trop massivement dans le puéril/carnavalesque, aux dépens des autres voix qui travaillent ces enfances au pluriel.
Au cours de ma lecture, j'ai noté, comme à l'accoutumée, plusieurs références à telle ou telle page, pour telle ou telle incursion dans mon Livre des mines, ou d'excursions dans le texte des bords de Loire. J'espère ne pas les laisser décanter trop longtemps, en général cela se traduit par un ensevelissement sans exhumation.
Tout à trac, je dédie, in extremis, la publication de ce billet, en ce jour, à l'écrivain qui fête aujourd'hui son soixantième anniversaire, l'auteur de Sortie d'usine, Paysage fer, Limite, Tumulte et d'Après le livre (pour ne lancer qu'un nombre limité de rails). Après tout, Prigent, dans Les Enfances Chino, multiplie et démultiplie les variations autour du prénom François. Il n'y a pas qu'opportunisme chronologique contingent dans cette mienne dédicace.
jeudi, 21 mars 2013
La poésie ferroviaire : Ortlieb, McGuinness, Romer (Tours, 21 mars 2013)
[Notes prises à la volée, l’absence de lien entre les sujets est le fait exclusif du transcripteur.]
 En guise d’accueil et de remerciements aux différents organisateurs qui ont rendu possible cette rencontre entre Stephen Romer, Gilles Ortlieb et Patrick McGuinness – notamment, et comme déjà précédemment, les collègues de la B.U., Alice Lucchese en tête –, Trevor Harris évoque le mot de craft (la poésie comme praxis).
En guise d’accueil et de remerciements aux différents organisateurs qui ont rendu possible cette rencontre entre Stephen Romer, Gilles Ortlieb et Patrick McGuinness – notamment, et comme déjà précédemment, les collègues de la B.U., Alice Lucchese en tête –, Trevor Harris évoque le mot de craft (la poésie comme praxis).
Dans son intervention liminaire, Stephen Romer évoque sa traduction de L’Arrière-pays, notamment la raison du choix de titre anglais (Bonnefoy ne voulait d’aucun des termes proposés, et surtout pas de The Hinterland, trop germanique). Il lit les premières pages de L’Arrière-pays et lance la discussion en présentant les poètes invités du jour, Gilles Ortlieb et Patrick McGuinness, tous deux grands « poètes ferroviaires », dont Stephen dit que leur attention aux lieux de passage, aux espaces apparemment banals, aux fragments entrevus, aux localités abandonnées, relève d’une poétique de l’arrière-pays.
Gilles Ortlieb cite la phrase de Bonnefoy (« pour que l’être se clive et que je sois en exil »). Ce qui se joue, dans l’attention au détail, à l’insignifiant, comme avec l’arrosoir de la Lettre de Lord Chandos de Hofmannstahl, c’est de cheminer sur la crête entre le mouvement et l’immobilité. Pour Patrick McGuinness, la poésie ferroviaire consiste à se demander à quoi ressembleraient les choses si on n’y faisait pas attention ? Depuis Auden, les poèmes ferroviaires sont négatifs en Grande-Bretagne, il n’y a plus de positivisme, alors qu’en Europe, comme les trains fonctionnent bien et arrivent à l’heure, on garde une tradition d’optimisme. Il cite le poème de Donald Davie, ‘In the Stopping Train’, en fait écrit à Tours.
Gilles Ortlieb rappelle que, pour voir, dans un train, il faut être assis dans le sens inverse de la marche, ce qui est vrai de tout regard ; regarder ce qui nous abandonne.
 Un des points communs entre Gilles Ortlieb et Patrick McGuinness est le peintre anglais Thomas Jones, dans son versant de réaliste miniaturiste. Sans concertation, ils ont tous deux consacré une série de poèmes à la même ligne de chemin de fer entre Bruxelles et Bouillon, fascination toponymique notamment. Pour Gilles Ortlieb, les toiles réalistes de Thomas Jones portant sur des détails visibles du quotidien sont porteuses d’une très grande beauté, à l’encontre de tout « spectaculaire ». Patrick McGuinness, qui a aussi écrit deux poèmes sur Jones, raconte avoir rencontré l’œuvre peint de Thomas Jones à la National Gallery of Wales, à Cardiff, et n’avoir pas trouvé grand intérêt aux immenses tableaux épiques sur la fin du monde celte ; en revanche, l’œil moderne, contemporain, est fasciné par les esquisses, les petits tableaux qui n’avaient aucune espèce de valeur pour Jones lui-même.
Un des points communs entre Gilles Ortlieb et Patrick McGuinness est le peintre anglais Thomas Jones, dans son versant de réaliste miniaturiste. Sans concertation, ils ont tous deux consacré une série de poèmes à la même ligne de chemin de fer entre Bruxelles et Bouillon, fascination toponymique notamment. Pour Gilles Ortlieb, les toiles réalistes de Thomas Jones portant sur des détails visibles du quotidien sont porteuses d’une très grande beauté, à l’encontre de tout « spectaculaire ». Patrick McGuinness, qui a aussi écrit deux poèmes sur Jones, raconte avoir rencontré l’œuvre peint de Thomas Jones à la National Gallery of Wales, à Cardiff, et n’avoir pas trouvé grand intérêt aux immenses tableaux épiques sur la fin du monde celte ; en revanche, l’œil moderne, contemporain, est fasciné par les esquisses, les petits tableaux qui n’avaient aucune espèce de valeur pour Jones lui-même.
Depuis plusieurs années, Gilles Ortlieb et Patrick McGuinness se traduisent l’un l’autre.
Patrick McGuinness insiste sur le fait que Rimbaud est, non le poète des départs, mais le poète du retour perpétuel. Il lit son poème sur l’ancienne gare de Bouillon (traduction de Gilles Ortlieb). Stephen Romer lit le texte de Gilles Ortlieb sur Morange (in Tombeau des anges), puis un extrait de L’Arrière-pays. Gilles Ortlieb insiste sur le fait que, du Luxembourg à la Lorraine, en vingt minutes, on passe d’un monde (la finance) à son contraire (la misère, l’abandon). De façon quasiment épigraphique, on voit encore les signes de la vie disparue, remonter des rues qui sont de vrais cimetières de boutiques. Patrick McGuinness fait remarquer que le français a le mot vétusté, qui correspond exactement à l’impression ressentie.  Il évoque aussi le terme high water mark (échelle de crue – Gilles Ortlieb, plus tard, dans une traduction lue, aura choisi « jauge d’inondation », jauge correspondant de fait mieux à mark).
Il évoque aussi le terme high water mark (échelle de crue – Gilles Ortlieb, plus tard, dans une traduction lue, aura choisi « jauge d’inondation », jauge correspondant de fait mieux à mark).
Gilles Ortlieb lit “Neige à Thionville”.
Stephen Romer suggère la formule de Réda, « le désespoir n’existe pas pour un homme qui marche ». Il songe aussi à Sebald. Patrick McGuinness rétorque qu’on peut marcher parce qu’on est désespéré en se disant que le désespoir n’existe pas pour un homme qui marche, mais que le mouvement n’est pas un remède. Gilles Ortlieb pense que cette formule rapproche la poésie plus de l’homme des foules de Poe, mais que la locomotion est quelque chose d’autre. Il trouve que, notamment dans des écrits récents, Bonnefoy est délibérément intimidant. Patrick McGuinness trouve par exemple plus intime – et donc moins intimidant – le chapitre sur les souvenirs d’Arménie. En général, la littérature française perd trop de temps sur les questions d’absence et de présence, alors que l’essentiel se passe entre les deux, entre A et B.
La rencontre s’achève, après quelques questions, par une lecture à deux voix. (Je note un seul vers d’un beau quatrain de Marcel Thiry cité en épigraphe par Gilles Ortlieb dans un de ses poèmes : « la Lorraine accomplit sa tristesse inutile ».)
La rencontre m’a évoqué
- ce qu’Auster dit dans son dernier livre de la marche
- la différence fondamentale entre la vision ferroviaire et la composition en marchant (exercice radicalement différent du corps)
- le rapport entre promenade (au sens de Walser) et graphomanie (Breytenbach aussi est un grand poète du déplacement)
- l’attention (sur un axe Rilke-Guillevic) au regard et à la poésie objectale
- les pages de François Bon dans Tumulte
- enfin, bien entendu (et Patrick McGuinness a confirmé en marge, après la rencontre, son absence totale de goût pour la poésie de Roubaud) le choix tout à fait parallèle, sur un autre rail, des oulipiens (la toute récente Ode à la ligne 29).
18:10 Publié dans Pynchoniana, Résidence avec Laloux, WAW | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 18 mars 2013
Dernière demeure ¦ destination finale
Depuis quelques jours, je me suis plongé dans la poésie de Cynthia Atkins (dont on peut lire des poèmes ici et là - sans oublier son site personnel), et ai même (à peine) commencé à la traduire. Très ému, pour diverses raisons – pas seulement littéraires – par “The Information Age”, un poème qui se trouve au début du recueil Psyche’s Weathers, je viens d’en achever, à l’instant, un premier jet.
Dans ce poème, la première et la deuxième strophe (16 vers chacune) se répondent. Dans l’une, le corps de l’oncle est comparé à une lettre, et la terre où il est inhumé au « trajet de la lettre » ; dans l’autre, ce sont les lettres qui sont comparées à un corps passant de main en main et, dans le texte
strung from house
to house—to its final resting place
Pour l’image de ‘final resting place’, j’hésite entre dernière demeure (euphémisme funèbre qui offre un beau contrepoint à ‘house’, maison) et destination finale (expression plus respectueuse de la métaphore postale). Je me pose aussi des questions de ponctuation : j’aime beaucoup le tiret, et je serais d’avis de le conserver tel quel, d’autant que la virgule – seule alternative ici – est vraiment de nature à “aplatir” la portée du suspens.
16:37 Publié dans Résidence avec Laloux, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 04 décembre 2012
Catherine de Russie
Non, tout de même pas. Oui, quand même.
Oui, je voudrais quand même emporter avec moi cette valise brune et craquelée – à force de m'accompagner dans mes périples minables, elle est défoncée. Défoncée! Moi aussi, je saisis l'occasion de me montrer progressivement plus audacieux, moi aussi je suis défoncé. Cramé, et cramoisi. Je disais ça enfant, cramoisi. C'est, cramoisi, un mot qui plaît aux enfants. Vrai, vraiment ? Ne tarde pas à le savoir. Et ça claque, je suis dans l'allée avec mes camarades, on attend le début du cours de M. Dassé, on attend M. Dassé, c'est curieux hein, la mémoire. Je pense que c'était le lundi matin, je revois cette salle de classe, mais pas le jour ni le numéro de la classe, le bâtiment oui, je sais qu'il n'existe plus, souffle de trombone, souffle de démolition pourtant non, et c'est devant cette même porte qu'on a apporté Maurice deux ans plus tard, qu'on a offert à notre professeur de philo un mouton – broutard, peut-être ?
On avait baptisé le mouton Maurice à cause de Merleau-Ponty.
Oui, quand même.
J'embarque ma valise, je ne suis pas du genre à me laisser emmerder. J'emmerde tous ces pinailleurs, pas du genre à me laisser embringuer dans d'oiseux arguments, fumeuses arguties. Trace mon chemin. Un pas, c'est déjà toute la route.
Souffle, souffle.
Comment – comment – comment, dis-je, peut-on se prénommer Julien-Baptiste ?
Il fait une chaleur épouvantable, un cagnard du diable.
Avant le mouton, avant d'attendre M. Dassé dans l'allée, en seconde, avant tout ça, au collège donc, je suppose, j'avais voyagé – toujours la valise, mais encore très fraîche – en aéroplane blindé. Laissez-moi vous dire que, déjà, j'étais bien loin d'être pété de tunes. Châtain comme les blés, le charme agissant sur personne, regardant les autres s'éclater en scène, et moi en coulisse, à ne pas même ahaner.
Non, pas même. Oui, hein. D'ahan, souffler. Tirer.
Souffle, souffle, je me fous de ta valise, d'ailleurs je vais me plaindre au roi de Prusse, au bleu de Gex, et – volutes démentes, éclats de lampe-torche dans la valise, paupières trouées par la mémoire, envols de cagnards sauvages dans le ciel de toutes les canicules, il reste avec la valise à gravir les trente-neuf marches – à Catherine de Russie.
15:57 Publié dans Jazeur méridional, Résidence avec Laloux, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (3)
mardi, 16 octobre 2012
Bahala na !
J'ai fini de lire The Match de Romesh Gunesekera. « Presque fini » serait plus juste : je me suis gardé, exprès, les sept ou huit dernières pages pour ce soir. L'écriture de Gunesekera – qui a atteint les plus hauts sommets, selon moi, avec Heaven's Edge, livre absolument magnifique et bousculant – s'est un peu attiédie ici. Tant le protagoniste que son parcours font songer au roman de Jamal Mahjoub, Travelling with Djinns.
 C'est le séjour, dans le cadre de la Chaire Studium, pour un semestre entier, de Chandani Lokugé dans notre Université qui m'a replongé totalement dans le Sri Lanka. La semaine dernière, j'achevais Turtle Nest. Et là, après The Match – parabole historique ? Underworld à la sri lankaise ? roman philippin ? — j'enchaînerai avec Softly As I Leave You, le dernier roman de Chandani. Fin novembre et début décembre, j'organiserai avec elle un atelier de deux ou trois séances consacré à la traduction de certains extraits de ces deux romans. Son dynamisme et son hyperactivité me font bien plaisir, ont dynamité un peu le début d'année, sinon terne ou simplement laborieux, de sorte que je me suis retrouvé propulsé avec le comité d'organisation du festival « Voix d'ici, voix d'ailleurs », ou encore à discuter de Ronsard avec elle pendant un bon bout de temps, sans compter le projet de programme d'hiver à mettre en place chez nous à destination des étudiants australiens non francophones.
C'est le séjour, dans le cadre de la Chaire Studium, pour un semestre entier, de Chandani Lokugé dans notre Université qui m'a replongé totalement dans le Sri Lanka. La semaine dernière, j'achevais Turtle Nest. Et là, après The Match – parabole historique ? Underworld à la sri lankaise ? roman philippin ? — j'enchaînerai avec Softly As I Leave You, le dernier roman de Chandani. Fin novembre et début décembre, j'organiserai avec elle un atelier de deux ou trois séances consacré à la traduction de certains extraits de ces deux romans. Son dynamisme et son hyperactivité me font bien plaisir, ont dynamité un peu le début d'année, sinon terne ou simplement laborieux, de sorte que je me suis retrouvé propulsé avec le comité d'organisation du festival « Voix d'ici, voix d'ailleurs », ou encore à discuter de Ronsard avec elle pendant un bon bout de temps, sans compter le projet de programme d'hiver à mettre en place chez nous à destination des étudiants australiens non francophones.
Turtle Nest est un très beau roman, très équilibré, qui s'inscrit dans une forme de modernisme classique, si j'ose ce qui pourrait sembler un paradoxe, et qui s'achève sur une pointe narrative aussi efficace qu'inattendue. Si j'ai bien compris les allusions de Chandani lors de notre promenade dans les jardins du Prieuré, il s'articule autour d'un symbolisme complexe (animaux, éléments naturels) dont tout ou presque doit m'échapper.
Entre ses diverses tâches au titre de la chaire Studium, Chandani a commencé d'écrire un roman dont l'action se passera, au moins en partie, en Touraine. Après-demain, je vais lui faire découvrir le manoir de La Possonnière ; si nous avons assez de temps, j'essaierai de lui montrer d'autres beaux sites voisins de Couture, quoique le très beau château de Poné n'ouvre au public qu'en été.
Nous verrons. Bahala na. Bahala na kayo ! (The Match, p. 255)
14:03 Publié dans Hors Touraine, Lect(o)ures, Résidence avec Laloux, Studium Chandani LOKUGE, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 24 novembre 2007
L'Esthétique de la résistance
"Finalement, j'appartiens bien à la littérature française contemporaine : je fais du surplace."
(François Bon, hier soir au Livre).
Présentation émouvante, avec la lecture de beaux passages de son Bob Dylan. Les anecdotes que François a racontées ensuite ouvraient des chemins digressifs infinis, à grands renforts de phrases interrompues. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu un malentendu, car Martin Arnold lui a bien posé cinq questions, mais François n'avait pas compris qu'un temps, dans la soirée, était réservé aux questions du public. Toutefois, peu importe... il semble que, s'il évoque aussi peu les deux dernières décennies de la comète Dylan, c'est qu'il est moins convaincu par ce versant de l'oeuvre, mais aussi qu'il avait déjà écrit 450 pages et était, de toute manière, en retard pour rendre son manuscrit ! Good enough reasons... point taken !
Au cours de sa présentation, François a dit, avec une lueur de malice dans le regard, qu'il faudrait que quelqu'un écrive un livre intitulé Esthétique de la résistance. Comme il avait fait la même vanne avec le rhizome et le pli un quart d'heure auparavant ("mais c'est Deleuze, non ?" me glissa, déconcerté, mon voisin), j'en ai conclu qu'il y avait effectivement un livre qui se nomme ainsi. Ignare que je suis ! (J'ai pu vérifier cela sur les rayonnages de littérature allemande*, au cours du vin d'honneur qui s'en est suivi.)
Quand faut y aller, faut y aller... (D'autre part, on peut s'interroger, avec François Bon, sur le rire de résistance et la question des droits réservés à l'ère du Web 2.0..)
* Tiens, j'en profite pour écrire ici que je ne suis pas d'accord avec François Bon quand il se moque (gentiment) de Laurent Evrard et Martin Arnold parce que leur librairie est la seule de France où les rubriques ne sont pas signalées au-dessus des rayonnages. Je préfère, moi, être momentanément désorienté, car c'est ainsi que l'on flaire des archipels inattendus. Une librairie n'est pas une bibliothèque. (A bookshop is not a library.)
12:01 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Ligérienne, Littérature
vendredi, 26 octobre 2007
Un oiseau dans / dans la main
Crumb Begging Baghead des Babyshambles : c’est très bien, mais tout à fait un décalque – riffs, rythmes et déconstruction – du premier album des Pink Floyd (époque Syd Barrett), quarante ans après. Curieux, d’ailleurs, comme j’ai laissé aux étudiants de mon séminaire de sémiotique (master 1) la possibilité de choisir, pour le devoir final, le ou les textes et – notamment – de proposer une analyse de paroles de chansons, ils se sont engouffrés dans cette possibilité, et qui de vouloir étudier un texte des Beatles, qui une chanson du Velvet Underground... autrement dit, alors que je m’attendais à ce qu’ils me fassent découvrir des artistes pop récents (« de leur âge », pourrait-on dire vieuxschnockement), ils me servent la soupe qu’écoutaient mes parents quand j’étais au berceau (et même avant).
Au demeurant, ça ne me gêne pas : dans le cadre du séminaire, on aura étudié e.e. cummings, Dana Gioia, Gerard Manley Hopkins, un extrait des Falls de Peter Greenaway, un texte de Richard Le Gallienne, et même un extrait du premier discours officiel de Gordon Brown premier ministre (!), et toujours, jusqu’à présent, avec leur participation enthousiaste et de nombreuses remarques perspicaces, car je crois tenir là une oligarchie très ramassée d’étudiants fins.
Sinon, je découvre avec un an de retard – et en même temps que je lis le Dylan de François Bon – le dernier album du grand Bob, Modern Times (2006), que je trouve excellent. Ce que je vais dire – la raison pour laquelle j’ai ouvert ce troisième paragraphe – rejoint mes éternelles préoccupations de sémiotique. En effet, je constate une fois encore que la bizarrerie de certaines formules désarçonne, déroute au point de passer à l’as pour une majorité d’auditeurs/lecteurs : ainsi, dans la quasi-totalité des versions disponibles sur le Net, les transcripteurs du très mélancolique Ain’t Talkin’ proposent, pour le dernier vers du huitième refrain
Walkin’ with an ache in my heel
alors que Dylan dit, de toute évidence (et ce que confirme la version du site Expecting Rain) :
Walkin’ with a toothache in my heel
Que le marcheur puisse, à ce moment précis, dire – littéralement – qu’il marche avec un mal de dents aux talons, c’est bizarre... mais c’est ce qu’il dit. Dylan, jamais banal, ne dit pas qu’il a mal aux talons, ni qu’il a mal aux talons et aux dents. Je ne sais s’il faut comprendre qu’il a, en marchant, mal aux dents au point d’en ressentir une douleur aux talons, ou que la douleur qui lui monte des talons est semblable aux élancements gingivaux, ou autre chose encore. Mais je sais qu’on ne doit pas banaliser un texte étrange.
18:20 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Ligérienne
vendredi, 06 avril 2007
Ma vie sur un coin de table
Franchement rarement été aussi crevé de ma vie, en plus je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de prendre les photocopies pour l'atelier de demain à la Reprographie. Faudra faire sans, quel innocent ! La force de rien, je colle ici, tout benoîtement, mon ébauche de traduction (inachevée) de My Life in a Stolen Moment de Dylan.
Ma vie sur un coin de table
Duluth c’est une ville du Minnesota qui vit du transport fluvial de minerai
Construite sur une falaise rocheuse au bord du Lac Majeur
J’y suis né – mon père y est né
Ma mère venait d’une région plus au nord le pays du Fer
Le Pays du Fer est une longue traîne de villes minières
De Grand Rapids à Eveleth
Nous avons déménagé pour aller y vivre dans la famille de ma mère
À Hibbing quand j’étais jeune
À Hibbing il y a la plus grande mine de forage du monde
À Hibbing il y a des écoles, des églises, des épiceries – et une prison
Il y a un cinéma et au lycée il y a une équipe de football américain
À Hibbing le vendredi soir il y a des bagnoles trafiquées qui roulent à fond la caisse
À Hibbing il y a des petits bistrots où on joue des polkas
Si on se trouve à un bout de Hibbing on voit parfaitement l’autre côté de la ville
Hibbing c’est une bonne petite ville
J’ai fugué à dix, douze, treize, quinze, quinze ans et demi, mais aussi à dix-sept et dix-huit ans
On m’a chopé on m’a ramené presque à chaque fois
J’y ai écrit ma première chanson, pour ma mère, et ça s’appelait « À ma mère »
J’ai écrit ça quand j’avais dix ans et l’instit m’a mis un 15
J’ai commencé à fumer à onze ans et j’ai arrêté juste le temps de reprendre mon souffle
Je ne revois pas trop chanter mes parents
En tout cas je ne me revois pas échanger des chansons avec eux
Plus tard j’ai étudié à l’Université du Minnesota avec une bourse bidon que je n’ai jamais touchée
J’étais en fac de sciences et je me suis fait recaler car j’avais refusé de voir mourir un lapin
Je me suis fait virer du cours d’anglais pour avoir injurié le professeur dans un devoir
J’ai échoué à l’examen de communication parce que j’appelais tous les jours pour dire que je ne pouvais pas venir
En espagnol j’ai réussi mais ça je le savais d’avance
Je traînais dans un foyer et j’y étais si bien
J’y suis resté jusqu’à ce qu’on me demande de devenir membre
Alors je me suis installé chez deux filles qui venaient du Dakota du Sud
Deux nuits juste dans un F2
J’ai traversé le pont gagné la 14ème Rue et ai emménagé au-dessus d’une librairie qui vendait aussi des hot dogs infects des maillots de basket et des statues de chiens
Je suis tombé amoureux d’une petite actrice qui m’a cogné dans le bide
Et je me suis retrouvé à l’est du Mississippi avec une dizaine de potes dans un squat juste en dessous du pont Washington au sud des Sept Carrefours
Voilà à peu de choses près mes années d’étudiant
Après ça en stop je suis allé à Galveston, dans le Texas, en quatre jours
À chercher un vieux copain dont la mère m’a ouvert la porte
M’a dit il s’est engagé
Le temps qu’elle referme la porte de la cuisine
J’étais déjà en Californie, et presque dans l’Oregon
Dans la forêt je suis tombé sur une serveuse qui m’a pris en stop
Et m’a laissé quelque part dans l’état de Washington
En dansant j’ai quitté la fête des Indiens à Gallup, Nouveau Mexique
Le Carnaval de la Nouvelle Orléans, en Louisiane
Le pouce tendu, tombant de sommeil, le chapeau relevé, la tête bien enlevée
J’errais j’en apprenais des tonnes
Je me faisais ma petite Dépression
Ça m’éclatait de voyager en train de marchandises
Ça me faisait marrer de prendre des gnons
Je touchais quelques dollars à couper de l’herbe
Et quelques cents avec mes chansons
J’ai fait du stop sur la 61, la 51, la 75, la 169, la 37, la 66, la 22
La Gopher Road, la 40 et la HJ Turnpike
On m’a soupçonné de vol à main armé – jeté en prison
On m’a gardé quatre heures en cabane pour une histoire de meurtre
On m’a chopé parce que j’ai une drôle d’allure
Et j’avais rien fait d’ tout ça
Dans tout ça j’ai pris le temps d’apprendre à jouer d’ la guitare
Dans tout ça j’ai pris le temps de commencer à chanter
Dans tout ça j’ai pris le temps de commencer à écrire
Mais jamais j’ai pris le temps de savoir pourquoi
J’ai pris le temps de faire ça – quand on me demande
À moi pourquoi et où j’ai commencé, je secoue la tête j’esquive des yeux et je m’en vais sans dire un mot
Après Shreveport j’ai atterri à Madison, dans le Wisconsin
De Madison on s’est fourrés à cinq dans une petite Pontiac
Et on a filé droit vers le sud direct vers l’est et 24 heures après on était encore sous le tunnel de l’Hudson
On partait dans une tempête de neige on disait adieu de la main aux trois autres, on s’est baladés sur MacDougal St avec cinq dollars en tout – mais on n’était pas pauvres
J’avais ma guitare et mon harmonica
Et lui il avait les fringues de son frère à mettre au clou
Au bout d’une semaine il est reparti à Madison et moi je suis resté
[...]
18:35 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Poésie, Traduction, Ligérienne
jeudi, 05 avril 2007
Traduire Bob Dylan tous azimuts
Pauline, une des étudiantes qui va participer à l'atelier Traduire Bob Dylan après-demain (et qui fit partie des recrues de la première heure !), vient de me signaler qu'elle avait, de son côté, travaillé sur Blowin' in the Wind, Mr Tambourine Man et Subterranean Homesick Blues.
Je me repasse cette dernière, suis plutôt inspiré, me dis que je devrais me pointer aussi samedi avec mon ébauche de traduction de My Life in a stolen moment (Ma vie à la dérobade).
22:29 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : Ligérienne, Traduction, Anglais
Traduire Bob Dylan rue Ronsard
Cela tournait dans ma tête depuis quelque temps. Man of Peace fait partie des chansons de Bob Dylan que j'aimerais bien traduire (même si elle n'est aucunement prévue pour samedi). La question de la traduction des références bibliques me taraude depuis longtemps (et je l'ai croisée souvent), et c'est l'une des raisons de mon intérêt pour ce texte-ci.
Ce matin, marchant dans la rue, j'ai trouvé une traduction "chantable" de la première strophe, que je propose ci-après. Content des rimes internes, très riches, mais c'est le refrain qui cloche (work in progress).
Look out your window, baby, there's a scene you'd like to catch,
The band is playing "Dixie," a man got his hand outstretched.
Could be the Fuhrer / Could be the local priest.
You know sometimes Satan comes as a man of peace.
Regarde un peu par la fenêtre, il s'en passe de belles :
Un orchestre qui joue Dixie et un homme qui fait la quête.
Ce pourrait être Hitler
Ce pourrait être un prêtre.
Satan est adroit, parfois, il prêche la paix (je crois)
17:05 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : Traduction, Poésie
mardi, 03 avril 2007
Bob Dylan ici, approche en plané
Obsession ? Il ne faudrait pas écouter Tweedle Dee & Tweedle Dum pour la dix-huitième fois en trois jours. Il y a tant d'autres chansons de Bob Dylan que je connais mal, ou pas du tout. Celle que je viens de citer est la première du pénultième album, Love & Theft, qui m'avait d'abord surpris, déconcerté, découragé. En fait, après quelques écoutes, c'est un des plus beaux*.
Ce samedi, ce sera - sans que je perçoive tout à fait comment ça va se dérouler - l'atelier "Traduire Bob Dylan" sous la houlette de François Bon. Finalement, il se trouve quasiment une trentaine d'étudiants motivés pour cette journée pourtant placée au pire moment : un samedi, et sur le week-end de Pâques en sus !
François Bon m'a écrit pour préciser que l'essentiel de nos réflexions porterait sur Ballad of a thin man, Desolation Row, Visions of Johanna, mais aussi les 11 épitaphes (que je ne connais pas (honte à moi !)) et My Life in a stolen moment.
Cette semaine, de toute façon, c'est encore, outre le boulot habituel, la panique : organisation des examens, remplacement d'une collègue malade pour trois de ses cours, préparation des partiels, préparation de l'atelier, usw. Du coup, je ne pourrai pas prendre le train fantôme à la B.U. cette après-midi et devrai me contenter de ce que le chauffeur-lecteur François en écrira sur son site.
Bien entendu, il y a aussi la pile de livres toujours plus volumineuse qui menace de s'effondrer sur moi dans mon sommeil, les quatre en train (même pas fantôme) et les dix ou douze lus qui me supplient d'écrire quelque chose à leur sujet ici ou dans mon autre carnétoile, oui, de tirer quelques paragraphes des notes jetées tout à trac sur les brimborions de papier glissés entre leurs pages.
* De Love & Theft, il faudrait dire, surtout, que le déclic est venu quand j'ai entendu les centaines d'échos nappés à Bo Diddley ou Robert Johnson. Du miel de millefleurs. Honeymoon blues, anyone ?
10:45 Publié dans Autres gammes, Lect(o)ures, Résidence avec Laloux, WAW | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : Ligérienne, Musique, Dylan, Littérature
mardi, 13 mars 2007
La littérature est-elle dangereuse ? [5] : Juliet/Beckett & lambeaux de discours direct
******************** Tout va par deux
Voici ce que j’ai noté, en totale anarchie, au cours de la séance, et avant de partir écrire Onze ans après. Ce que j’écris est en Times 10. Ce que j’ai noté de l’intervention de François Bon (que j’ai préféré écouter sans être rivé au clavier cette fois (…)) est en Times12.
Il y a très peu de monde : jour de rentrée ? atelier déplacé du jeudi au lundi ? Moi, j’étais absent aux séances 3 et 4, dont François Bon redit le plus grand bien. (Il nous en a envoyé, dans la nuit, des morceaux choisis.) La salle 80 est hérissée de pieds de chaises, car elles sont toutes renversées, par paquets de deux, sur les tables. On a dû chasser deux pauvres étudiants qui finissaient un devoir (concours blanc ?)
******************** Par maints et par vaux
Oralité, ce qui remonte, ce qui traverse le texte et n’est pas narratif.
J’ai amené Charles Juliet. Montre Rencontres avec Samuel Beckett. Parle de Lambeaux. Dans ce texte restreint sur Beckett…
Le mot du jour est restreint. Est-ce sur, l’écrivain, l’influence du train ? L’entrée dans la langue française se fait, pour Beckett, avec ce vocabulaire restreint. Juliet, passage du silence contraint à l’écriture du silence.
Quatre rencontres. Neuf ans s’écoulent entre la première et la quatrième.
Juliet publie déjà son journal, mais s’interdit de parler de sa rencontre avec Beckett tant que l’écrivain est vivant.
Deux mecs qui ne parlent pas : le dispositif d’écriture de Juliet est intéressant (notation précise des propos de Beckett).
François Bon raconte son dernier voyage en train à Lille, face à un type qui trimbalait des rats dans une cage verte et orange fluo. Il parle aussi d’un vieux cousin mort depuis longtemps, coupures de journaux, notices de médicaments, etc. Dans quel livre a-t-il parlé de ce parent ? Je n’ose demander.
Le rapport du dialogique au narratif est inversé par rapport à la logique ordinaire. Les rencontres sont brèves et la parole rare : c’est cela qui fait exister l’écriture.
Il faut donc raconter une ou plusieurs rencontres importantes avec quelqu’un de marquant (et pas forcément célèbre).
Technique, forme du texte : cf la manière abrupte dont le narrateur de la Recherche entre en rapport dialogique avec une multitude d’interlocuteurs.
Nombreux extraits des Rencontres avec Samuel Beckett.
Poème de Morand sur Proust, ‘Ode à Marcel Proust’, 1915.
******************** La main du diable (Un échec)
Après la présentation de la séance par François Bon, je suis allé dans mon bureau, dont les volets roulants, par un miracle étonnant, étaient restés ouverts, ce qui fait que j’ai écrit le texte Onze ans après, au crépuscule puis dans la suie, face à la passerelle faiblement éclairée. De ce texte, Onze ans après, j’ai livré, illico, à huit heures du soir, la première mouture, puis je suis retourné en salle 80 où ça grattait sec, et me suis remis au texte. Disons-le tout net : la consigne de ce jour m’a profondément embarrassé, car, contrairement à la plupart des fois où je me suis trouvé en situation de contrainte, j’ai mis beaucoup de temps à trouver un sujet. Ensuite, une fois le sujet trouvé, je me suis embarqué dans l’écriture en ne parvenant aucunement à restituer la voix du portraituré rencontré, Hugo A. J’ai raturé, repris, modifié, même écrit un paragraphe encore plus mauvais dont je me suis rendu compte, juste avant la lecture à haute voix, qu’il n’était « insérable » nulle part dans mon texte. J’avais déjà modifié pas mal de choses au texte publié à huit heures du soir, mais pas comme il faudrait : dans le détail et non dans la trame. Alors, pas du tout convaincu, j’ai lu mon texte qui, ça tombe bien, n’a pas convaincu François Bon – même s’il a pris de fort élégantes pincettes pour me le dire. Pour ma part, ce n’est pas tant le côté suranné (« plus France que Proust », a dit F.B.*) qui me gêne que le côté mou de ce texte ; je n’ai pas su trancher, et c’est un texte au mitan, oui, grassouillet. Du coup, ce mardi matin, je prends le parti, après un nouveau toilettage, d’instiller polyphonie pour de bon, avec insertion / injection de phrases hugoliennes.
*Ah oui : François Bon a aussi parlé d'une traduction de Henry James qui aplatirait ou raterait (je ne sais plus) ce qui fait le génie de James. Cela dit, même en mauvaise traduction, je prends la référence à James comme un compliment, vu ma grande frustration face à ce texte dont je ne sais que faire. Dans la discussion qu'il a eue avec une étudiante qui prépare un travail de master 1 sur Danielle Collobert, F.B. a raconté que Jérôme Lindon avait, à l'époque, refusé de publier Meurtres, qui lui paraissait trop directement inspiré de / calqué sur l'écriture de Beckett. Pour ma part, même si le texte de R., une autre étudiante, était très réussi, j'ai trouvé qu'il était trop directement inspiré de / calqué sur l'écriture de Duras. (Ou de François Bon, peut-être ?)
10:20 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : Ligérienne, Littérature, écriture
lundi, 12 mars 2007
Onze ans après
Je l’ai rencontré plusieurs fois, quand j’allais passer quatre ou cinq jours d’affilée à Cambridge, chez cet ami que je perds aussi de vue maintenant. Jean-Pascal m’avait présenté la ribambelle de ses amis, et parmi eux Hugo.
Combien de fois suis-je allé à Cambridge ? On dira trois. À chaque séjour peut-être je voyais Hugo trois ou quatre fois. Et que m’importent ces chiffres ? Je ne sais.
Hugo s’appelait en fait Hugues, mais il semblait régner, autour de son vrai prénom, un parfum d’interdit. Lui, contrairement à nous autres, était lecteur pour une durée de cinq ans, et finissait sa thèse. Il était donc sensiblement plus âgé que nous, et avait plus ou moins claqué la porte au nez des siens, Parisiens. N’avait-il pas choisi le lectorat à Cambridge comme d’autres, il n’y a pas si longtemps, choisissaient de s’embarquer sur un baleinier ou partent pour la légion étrangère ? Si je raconte tout ça, c’est que sa vie paraissait nimbée de tant de demi-secrets, mais sans afféterie.
Étonnamment séduisant, Hugo n’était pas poseur. Ses excentricités verbales et sociales étaient d’une totale sincérité. Un jour, nous discutions, tous les trois, avec Jean-Pascal, à la table crasseuse d’un bar de college, et Hugo, de façon tout à fait caractéristique, s’était assis en dehors du cercle formé, au départ, par la table et les trois chaises. Tout aussi caractéristique, sa façon de nous encourager à reprendre une pinte, à ses frais, une Murphy’s, je dirais, tout en laissant quasi imbue la sienne. Il se contentait d’y tremper les lèvres, discutait avec feu, riait, fronçait les sourcils, parfois les trois à la fois, et, de son profil acéré jamais détendu, nous lançait des phrases si ambiguës qu’elles prenaient valeur de sentences, tout en oubliant consciencieusement de boire. Puis, entre deux paroles enflammées (« C’est une violence » ou « on te verra avec tes frasques »), deux rires, deux froncements, il se levait, comme nous partions, et vidait en deux fois une bonne part de la pinte jusque là délaissée.
Il me semble qu’une autre fois, au début d’une soirée qui fut la plus arrosée de mon existence – avec les conséquences que l’on imagine –, je le vis jouer, avec une élégance rare, au baby-foot. J’ignorais que l’on pût s’adonner à ce jeu, et même s’y donner, d’une façon qui fleure autant le gentleman. Hugo était autant fait pour les envols subits et violents d’imaginations fébriles que pour l’atmosphère feutrée des clubs les plus select.
Il y eut aussi, peut-être la dernière fois que nous nous vîmes, son détachement somptueux dans ce punt infâme que nous avions loué à six et dont seul il se démenait, en rameur expert, piroguier de ces bords presque gallois. Il faisait beau et frais, sur la Cam. Je m’énervais après tout le monde. Mais après lui, impossible.
Ma mémoire persiste à me tendre de curieuses perches et à évoquer une possible rencontre, l’année suivante, ou même celle d’après, à Paris (pour sa soutenance de thèse ?). Pourtant, aucune image, aucun son précis ne me vient de cet épisode pourtant ultérieur, s’il a bien eu lieu. Hugo, à Paris, cela ne se pouvait. Si ça se trouve, c’était Hugues, et ce fantôme imposteur n’aura pas laissé de traces dans ma mémoire vive.
20:00 Publié dans Ecrit(o)ures, Hors Touraine, Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Ligérienne, écriture
La littérature est-elle dangereuse ? [5]
Quelques minutes avant la cinquième séance de l'atelier d'écriture animé par François Bon sur le site Tanneurs, "La littérature est-elle dangereuse ? " (j'ai manqué la troisième séance pour raisons personnelles et la quatrième car j'avais oublié de la noter dans mon agenda, pensant que la fréquence régulière était d'un atelier tous les quinze jours), j'ai réussi, fait rarissime, à me garer du côté impair de la rue des Tanneurs, sans avoir à risquer un périlleux (et limite illégal) demi-tour sur voie au niveau des feux tricolores qui suivent.
Des affiches déchirées, des prospectus, du béton gris. La fac ne donne pas son meilleur visage en ces jours de grand soleil, premières chaleurs dans l'air & premières terrasses à lézards place Plumereau. Quand elle si belle, la lumière adoucit ce qui n'est que médiocre, mais les choses laides, elles, ressortent de manière plus vive, plus poignante.
Ce matin, vers dix heures et demie, en descendant l'escalier le formidable après un cours au quatrième étage, j'ai pu admirer les remous de la Loire sous le soleil doucement incandescent. Durant le cours, j'ai fait remarquer aux étudiants qu'une pie, peut-être la même qui m'avait incité à leur apprendre quelques noms d'oiseaux deux semaines auparavant, faisait son nid pile à notre niveau, à portée de nos regards. Les nids de pie, ces constructions foutraques de grosses brindilles pas même branches, on les voit rarement à niveau, et suffiraient-ils d'ailleurs à suggérer une métaphore malingre et alambiquée de ce carnet de toile ?
To room 80 now !
18:25 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Ligérienne, écriture
vendredi, 09 février 2007
La littérature est-elle dangereuse ? [2] : Photos absentes écrites
Les six textes composant sous les rires les sourires ont été écrits et publiés aussitôt, "bruts de décoffrage", comme le veut un cliché contemporain. Quelques minutes après, vers huit heures, je les ai un peu retouchés, modifiés, à la plume rouge, puis lus devant l'auditoire rassemblé pour l'atelier de François Bon, après avoir écouté, souvent admirativement, les textes des autres participants.
Mon voisin de droite fut l'un des premiers à lire ses textes sur photos (Photos que je n'ai pas faites), et je lui ai parlé, après, à la fin, de Danielle Mémoire. Juste avant le début de l'atelier, nous avions discuté de Cadiot, car j'avais vu son exemplaire de L'art poétic' posé sur la table. Je n'aime pas tellement Cadiot, mais je ne demande qu'à aller y revoir.
Mon voisin de gauche a lu ses textes lui aussi, vers la fin de la séance, pétrifié (m'a-t-il dit après) par le trac, ce nouveau venu depuis quelques mois dans son existence. Ses textes aussi étaient très beaux, et j'espère qu'il les publiera. J'ai aussi entendu sa voix comme jamais auparavant. Je crois avoir reconnu une des photos écrites.
François Bon avait apporté des extraits de L'Image fantôme, de W, de Histoire de Claude Simon (je connais quatre personnes qui l'ont lu en entier, à commencer par moi) et Roubaud.
Jeudi soir, donc. Avant l'atelier, juste avant, Boogaerts (Que vas-tu faire / Moi je vais prendre la mer / Rompons cette atmosphère). Juste après, Rochepinard et Greux, puis les bords de Loire noirs.
21:55 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Ligérienne, Littérature, écriture
jeudi, 08 février 2007
sous les rires les sourires
Laon, 1997
tu es debout tu as froid les mains croisées gants panthère manteau rouge mais sans musique manteau rouge unique et unique dans le manteau rouge sur fond de brouillard ce brouillard picard tu es debout te tiens debout sur le trottoir devant cette porte fortifiée médiévale noyée dans le brouillard et seule aussi Laon ce jour-là noyé dans le froid noyé dans la brume était superbe Laon était superbe et dans la brume nous écumions l’Aisne nous écumions Laon tu souris tu souris à l’objectif ou au photographe ou derrière moi au brouillard tu souris rêveuse au brouillard
Guignecourt, 1998
c’est l’été finissant ou l’automne commençant ai-je jamais su c’est l’été finissant et devant la muraille d’enceinte de l’église de Guignecourt en plan américain te voilà légèrement décentrée légèrement excentrée sur le côté de face souriant souriante te voilà encore face à moi et légèrement excentrée sur la gauche je ne revois pas du tout les vêtements que tu as sur cette photo sur cette photo de côté tu laisses voir la mosaïque émouvante des pierres blanches rouges grises briquettes et encore briquettes à Guignecourt ce jour-là grand soleil c’était l’été finissant
Saint-Pierre du Mont, 1994
nos ombres bien sûr nos ombres s’allongeant par-dessus les parterres les plates bandes du jardin de mes grands-parents nos ombres lointaines fuyantes rien d’évident nos ombres touchant presque le grillage cette photo en noir et blanc m’est revenue tout de suite en repensant à cette série de photos en noir et blanc ce devait être à Noël il faisait doux j’étais près du figuier et j’appuyais sur le déclencheur de mon Minolta cette année-là je faisais le malin à acheter des pellicules en noir et blanc Ilford 400 et j’avais pris plein de photos ce jour-là je faisais le malin et ce doit être ou pas loin ce doit être la première ou pas loin ce doit être la première photo d’ombres ou pas loin ma première photo d’ombres fuyantes ou pas loin
Va savoir où, 2006
pas de gros plan disais-tu et au moment où tu disais pas de gros plan je t’ai attrapée en gros plan en très gros plan on voit ta peau ses aspérités ton nez ses vagues seulement le dessous de tes yeux leurs arpèges
Sousse, 2000
tu te prends un joli fou rire dans le clair-obscur de la nuit d’été tu es immobile immobilisée c’est la veille du mariage tu te prends un sacré fou rire avec tes pieds tes mains peinturlurées ici tatouées au henné c’est sur la terrasse le toit de la maison jamais finie on mangeait à côté du mouton à une table basse entre les étendoirs tu te piques un rien de fou rire assise jambes tendues dans ton pantacourt mains tendues tatouées au henné et à côté de toi la grand-tante de notre ami rigole aussi complice elle te glisse un sourire en coin joue avec ton fou rire et sous les vêtements déjà secs étendus tu ne souris pas ce n’est pas un sourire tu te prends un joli fou rire
Vianden, 1998
nous deux et le roc la montagne nous deux et les monts au fond nous deux si proches souriant complices d’un air à moitié inquiet comme toujours ces touristes comme tous les touristes qu’un autre touriste inconnu propose de prendre en photo pour que l’album ne soit pas une succession de portraits où manque toujours quelqu’un et dans l’album nous deux et le roc nous deux cet été-là souriions de cet air-là toi en chemisier blanc et jeans bleu moi en chemise blanche et jeans bleu deux toiles blanches dans l’album
19:50 Publié dans Ecrit(o)ures, Résidence avec Laloux, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Ligérienne, écriture
mardi, 30 janvier 2007
La littérature est-elle dangereuse ? [1] : Fenêtres
Il serait enfin temps que je copie-colle ici les notes prises sans aucun ordre ni souci d'exhaustivité, tout à trac, en écoutant François Bon présenter l'atelier La Littérature est-elle dangereuse ? jeudi dernier, 25 janvier. L'atelier se tient en salle 80 de 18 h 30 à 21 heures. L'introduction, par François Bon, dure une quarantaine de minutes ; elle est suivie par un temps d'écriture de 50 minutes environ, puis de lectures à voix haute par les différents participants.
J'ai aussi noté quelques bribes de textes, et ai formulé quelques remarques in petto, mais j'essaierai d'y consacrer un billet à part. L'exercice d'écriture sur les fenêtres a donné lieu à une suite de cinq textes déjà publiés, le soir même. Par ailleurs, les étudiants de l'université, mais aussi toutes les personnes un tant soit peu intéressées par les livres ou les bibliothèques, pourront admirer les photographies prises par F.B. lors de sa visite des magasins de la B.U. (officiellement baptisée S.C.D. ou Service Commun de Documentation, mais presque personne n'emploie cette dénomination).
Ci suit donc ma tentative de transcription de la présentation de François Bon. Les (rares) phrases entre crochets et en Times 10 sont de moi, au cours de l'écoute.
Espèces d’espaces
Le dehors, le possible du récit.
Questionnez vos propres textes pour voir ce qu’ils déplacent.
L’écriture ne peut être enseignée de manière raisonnable, technique, contrairement aux autres arts. Ce que l’on peut mettre en commun, ce sont des résistances, des singularités.
Monodique. Essayer de s’appuyer sur un texte donné.
Ecrire sur commande à date fixe : paradoxal mais ça fonctionne.
Je parlerai quarante minutes, puis il y aura un temps d’écriture, environ cinquante minutes. Moi, je reste là ; Guillaume aussi, on fera du blog.
Je ne m’attacherai pas à faire lire tout le monde par principe. La dernière heure sera consacrée à travailler sur vos textes, réimproviser des choses sur les textes. Que demande le texte à la profération, au corps ?
Espèces d’espaces est un fondamental, voyez l’état dans lequel est le livre.
Le père de Perec, qui s’était engagé plutôt que de choisir un second exil, est un des premiers morts de la guerre de 40. Le rapport de Perec à l’écriture a commencé dans les fiches de films faites enfant. Perec adolescent dyslexique, considéré comme handicapé du langage.
À Sfax, il emporte la correspondance de Flaubert et part d’une pile de Madame Express laissés par le précédent propriétaire pour écrire Les Choses. Refusé par ses éditeurs habituels et publié chez Galilée, Espèces d’espaces passe alors inaperçu. De la carte de Lewis Carroll, du Coup de dés de Mallarmé, il travaille sur la forme-page (la surface-page de Mallarmé). Chambre. L’enjeu est de reconstituer son autobiographie. Les lieux où on a dormi sont les lieux où l’on a perdu conscience ; ces abandons, forts d’une vraie rémanence, peuvent permettre de reconstruire un passé. « Le statut des lieux vides » : François Bon évoque sa visite de certains lieux déserts près des magasins de la B.U. le matin même. « La chambre du Golem ». Le seuil de Borgès. Raskolnikov. [Tiens, le lien entre l’an dernier et cette année : Dostoïevski, bien sûr. Comment ne pas y avoir pensé plus tôt ?] « L’inhabitable […] l’architecture du mépris ».
F.B. lit des extraits du Perec. On n’a toujours pas compris ce que je veux vous faire faire, donc j’en profite.
L’épuisement au sens de Perec est une méthode de reconstruction mémorielle.
Lapsus génial de F.B. : les bulldozers décrivent [détruisent] la rue Vilain. [Il aime tenir le livre grand ouvert à l’horizontale très haut face à lui.]
Le rapport d’Olivier Rolin à Perec consistait à décrire toutes les (nombreuses) chambres d’hôtel où il passait. (Suite à l’hôtel Crystal)
Le rapport de Roubaud à Perec se retrouve dans Poésie : (l’appropriation de la ville selon des principes oulipiens).
L’auteur Fayard – « C.P.E. au lycée de la Mer à La Rochelle » – ne sera pas nommé [« mon pote Bozier » (?) : finalement c’est Raymond Bozier] : 37 vues de fenêtres. Dans les 50 minutes d’écriture, j’aimerais que vous me fassiez au moins 3 ou 5 ou 10 brèves instantanées de fenêtres. Techniquement, je voudrais du visuel : ce qui s’organise depuis un cadre. Vous n’entrez pas dans votre travail, vous restez en dehors, en restant à distance de ce que vous voyez par ou à la fenêtre. Essayez de travailler sans aucun verbe au moins pour une de vos fenêtres. Quel rapport au vocabulaire.
Lit l’extrait d’ Espèces d’espaces qui est une énumération d’infinitifs seuls (accumulation de mots).
Prenez aussi une image en mouvement (cadre fixe mais images fugitives : qu’est-ce que ça change à la manière de les écrire). Pare-brise, casque de moto, vitre de bus, baie de train, peu me chaut.
« Des ciels gris de cristal », etc. Les phrases nominales (Rimbaud).
13:53 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, Ligérienne, écriture
jeudi, 25 janvier 2007
Cinq fenêtres de par les temps
Ayant écrit mes textes directement par ordinateur et la batterie s'étant déchargée, j'ai dû me défiler quand François Bon m'a demandé de lire mes textes fenêtres. Les voici donc.
2001, Anachronisme
Beauvais. Assis à lire dehors par une journée ensoleillée de début juin dans la courette minuscule de graviers, saisi le salon et l’échappée vers la cuisine américaine. Grande lampe halogène noire sur l’extrême bord droit, accoudoir vert & multicolore. Écrire par couples et encore écrire. Étagères blanches construites par mon grand-père jadis et reproduction de Munch vue sur le profil des étagères. En balayant toujours vers la gauche. Éteint le téléviseur et rocking-chair camelote replié comme éteint. Au loin ainsi que je l’ai écrit je distinguais le bar élégant, la cuisine américaine, l’escalier qui mène à l’étage, lumineux sous la grande trouée de jour.
2007, Autoroute
C’est la nuit sur l’A10, samedi. Derrière le rideau de larmes que je ne peux retenir et le rideau des averses bourrasques, des poids lourds fugaces que je double, des bornes, ces petits panonceaux repliés prêts à servir en cas de rétrécissement des voies (90 noir cerclé de rouge) et toujours les abats de vent que je vois. Presque toutes les vraies images sont absentes de ce décor fuyant malhonnête carton pâteux. Images du passé, de P. que j’aime, et qui est en train de mourir. C’est la nuit sur l’A10, retour de Bordeaux, après la journée à l’hôpital.
2006, Links
À la table du salon, travaillant, traduisant. Printemps finissant. Fenêtre de la salle à manger. Celle de gauche. Capot de la Clio garée dans la cour. Couvercle jaune de la poubelle (tri sélectif papiers plastiques conserves). Comment ce chat encore est-il là, errant ? Thuya crevé roux, les autres verts, tous cachent la rue.
1993, Apprenti
Dans le cadre étroit, rectangulaire et cerclé de bleu du rétroviseur intérieur, le capot de la voiture de sport jaune garée immobile derrière celle que je pilote maladroitement se rapproche, ne cesse de se rapprocher, et je fixe, dans ce rétroviseur, tantôt le logo de la voiture (une Fiat avec ses quatre traits obliques reconnaissables entre mille) tantôt ses essuie-glaces terriblement tiounés, au lieu de me concentrer sur le petit carré autocollant rouge placé là par le moniteur d’auto-école et dont je m’étonne même que l’examinateur ne l’ait pas ôté, ce tout petit carré rouge dont je sais par cœur qu’il doit m’aider à savoir quand contrebraquer, puisqu’il le faudra pile au moment où il coïncidera avec la vision du trottoir, et que j’oublie. Je m’y reprends, et encore. Vous repasserez.
2007, Aperçu
Marre des fenêtres, vais faire un tour. Toujours aimé Tanneurs désert. Dans le couloir près de mon bureau, un étudiant écrit frénétiquement, assis par terre, as is their wont. J’aperçois la porte ouverte de la salle 34, ce qui m’étonne. L’étudiant griffonne. J’entre dans la salle 34 obscure, et suis frappé de voir qu’à travers la triple fenêtre du fond – triptyque médiéval aux deux panneaux latéraux extraordinairement étroits – m’apparaissent, m’éblouissent, dans une perspective que je n’aurais jamais imaginée, n’enseignant jamais dans cette salle 34 pourtant si proche de mon bureau, une multitude de fenêtres les unes derrière et à côté des autres, et dans la salle éclairée, au fond, on aperçoit, assis au bureau tandis qu’écrivent les étudiants, François Bon, point d’orgue, moderne vedutta de ce triptyque moderne.
21:45 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Ligérienne, écriture, Littérature
F.B., ça continue
Pas de réseau pour mon portable en salle 80, alors j'ai filé jusqu'à mon bureau, juste pour écrire ceci :
C'est la première séance de l'atelier animé par François Bon, et je m'éclate.
(Deuxième phase de l'atelier. Les participants (étudiants) vont où ils veulent pour écrire leurs textes sur fenêtres. D'où ma présence hors de la salle 80, fou échappé.)
Simon has not shown up. Too bad.
19:59 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Ligérienne, écriture
mercredi, 24 janvier 2007
Jeudi 18 janvier / La première bande
Dans l’amphithéâtre Thélème, une cinquantaine de pékins (date très mal choisie : la plupart des étudiants pas du tout là cette semaine d’examens pour salariés seulement, pour ne rien dire des collègues n’habitant pas à Tours) venus écouter François Bon, pour sa « conférence inaugurale », dont on pouvait se douter que, certes inaugurale, elle ne serait en rien une conférence, au sens classique du terme, toutefois. L’an dernier, André Markowicz et Françoise Morvan avaient dialogué, en une sorte de porte-à-faux stylisé très heureux.
Cette année, François Bon, ordinateur relié à des baffles et à ce que, dans mon ignorance totale, je pense être une pédale de guitare électrique, a lu des – onze précisément – extraits de son dernier livre publié, Tumulte, où se retrouvent les textes publiés au jour le jour dans son blog. La plupart avaient eu, comme point de départ, « ces espèces de faits divers » (Bon himself).
Après une présentation élégante et chaleureuse du président de l’Université, Michel Lussault, toujours vestu de noir et écharpé de rouge, François Bon a donc lu cet hendécaèdre de textes, avec des effets d’échos et de soufflé en fond (grâce au dispositif électroacoustique ci-dessus sommairement décrit), et, parfois, une petite présentation du contexte d’écriture, ou des personnages portraiturés.
1. [oublié de noter]
2. accident près de la gare de Saint-Pierre des Corps
3. asile – « En un an, il a perdu des dents » [/// hier, soit quatre jours après la lecture de François Bon, j’ai commencé la lecture de Moravagine]
4. attentat de Londres aux actualités {très beau} « l’onde » / Londres
5. suicide – « Ce sera contre mon gré »
6. exercices sur le rêve – « la paroi du rêve » {sirène des pompiers pendant la dernière phrase et le silence qui la suit}
7. texte du trou aux bruits – « Il n’était plus question de silence nulle part dans les gares. »
8. Présente le fou vagabond tourangeau Quasi et sa langue inventée, son obsession pour le fleuve et le flot des voitures. Parle des photographies, de la topographie des trajets de Quasi. « C’est un des derniers textes du livre et je vous le lirai pas, j’en lis un autre. » {arlésienne, absente de tout bouquet ou point de fuite / le texte sans doute n'est plus en ligne}
9. « une autre tourangelle » – explosion au crématorium
10. le cours sur Rimbaud aux Beaux-Arts – « la poignée de main de Rimbaud », transmise d’écrivain en écrivain, de génération en génération {émouvant}
11. Annonce un texte sur « le 22 h 53 qui autrefois s’arrêtait à Amboise et qui ne s’y arrête plus » – descendu dans la mauvaise ville symétrique {le matin même, François Bon avait sorti de sa sacoche un exemplaire très usagé du Journal de Kafka}
Tandis que je recopie ces notes, mardi vers midi, j’écoute l’album Black Vomit d’Anthony Braxton & Wolf Eyes. (Tumulte aussi, limite multiple.)
02:20 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, écriture, Ligérienne, Jazz
jeudi, 18 janvier 2007
Prise de vue & marteau-piqueur
Après une année 2006 en heurts, du fait aussi que l'essentiel de ce que j'écrivais, publiais etc. trouvait sa place dans l'autre carnétoile, je viens de me décider à créer dans ce carnet-ci (pour la première fois depuis des lustres) une nouvelle catégorie, ou rubrique, consacrée à la résidence de l'écrivain François Bon dans l'université où j'enseigne (François-Rabelais, pour ceux qui ont manqué le début (comme on écrivait dans Télé7Jours quand j'étais gosse etc.)). La catégorie WAW, outre qu'elle déborde, me semble peu appropriée, car ce n'est pas tellement moi qui travaille, mais LUI. Ces considérations liminaires affichées, entrons dans le vif du sujet.
*****
Ce matin, à dix heures et demie, dans la salle 229 – l’une de celles où l’est le plus dérangé par les travaux du nouveau bâtiment * –, avait lieu la première prise de contact (comme je crois qu’on dit) entre François Bon et les équipes pédagogiques (comme je crois qu’on dit).
Invité à l’Université François-Rabelais comme artiste en résidence pour l’année 2006-2007 (et donc, principalement pour le second semestre, qui commence ce janvier), François Bon va animer un certain nombre de projets, ateliers etc.
L’atelier principal fait se rencontrer des lycéens du L.P. Victor-Laloux et des étudiants de master et de doctorat issus de diverses filières de sciences humaines, autour d’un projet de travail lié aux nouveaux espaces urbains (si je ne me plante pas trop). Le deuxième atelier, qui aura lieu sur le site Tanneurs de 18 h 30 à 21 heures un jeudi sur deux (et qui (je le signale à mes étudiants qui me lisent par milliers (Simon, Aurélie, il est interdit de ricaner)) peut compter comme U.E. libre (se renseigner auprès du Service Culturel, à côté du panneau vert de Nico Nu)), s’appelle « La littérature est-elle dangereuse ? », et c’est à celui-là que je compte assister, par curiosité (« toujours malsaine », comme je crois qu’on dit**).
Sinon, cette réunion a été l’occasion de brasser un certain nombre d’autres ébauches de projets. [Ce paragraphe a été retiré à la demande du Service Culturel : Confidentiel Défense] François Bon est très enthousiasmé à l’idée de travailler avec la B.U., le CUEFEE (le centre d’accueil et de formation des étudiants étrangers), le département Arts du spectacle, et même le département d’anglais (more on that later).
*********
[Où le narrateur, sachant que l’impétrant lira peut-être ces lignes, marche un brin sur des œufs.] Le plus important, pour moi, dans cette matinée, c’est que, pour la première fois peut-être de ma brève carrière, j’ai participé à une réunion où, en une heure et demie, plus de travail a été fait qu’en trois heures de certaines commissions. En l’occurrence, je n’avais jamais rencontré François Bon, dont je connais, depuis un certain temps, l’œuvre, et il est pour beaucoup dans ce dynamisme efficace. There’s no nonsense about him, as Charles D. would have it.
J’ai lu plusieurs de ses livres, dont certains me plaisent moins, mais Sortie d’usine, C’était toute une vie et Mécanique sont de très beaux récits, où la voix de l’auteur trouve son grain, son ton juste, entre fêlures et certitudes. Autant dire que je suis très heureux, captivé même, à l’idée de pouvoir faire quelques lieues de chemin avec lui.
Au cours de la réunion, il s’est montré affable, charmant, précis et rigoureux. Il a aussi balancé quelques piques intéressantes et tout à fait légitimes, qu’il m’est évidemment impossible de rapporter sur ce site public. Je l’imagine assez stakhanoviste ou bourreau de travail, et il avait, outre son ordinateur portable, un petit appareil photo numérique que je n’ai pas immédiatement identifié comme tel.
***********************
Pour finir, je ne peux qu’encourager ceux d’entre vous qui ne le connaissent pas à aller découvrir, déjà, son blog, au titre rabelaisien, avant de vous précipiter sur ses livres entiers ou en tiers (et peut-être, si je peux jouir ici de quelque confiance, sur les trois titres cités plus haut en gras). Pour lire et voir les impressions suite au premier atelier straight from the horse’s mouth, c’est aussi sur le blog.
* Mais Martine (: Pelletier, we’re on a first-name basis here, folks) m’a appris que l’inauguration officielle des nouveaux bâtiments devait avoir lieu le 17 mars, jour de la Saint Patrick, ce qui, je le subodore, n’est nullement une coïncidence, mais bien le fruit d’une machination de la section secrète Irish Studies in Tours.
** Ce qui est pénible avec Cingal, ce sont les parenthèses. ***
*** Attends, tu rêves, t’as pas vu les astérisques.
17:17 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Ligérienne, Littérature, écriture