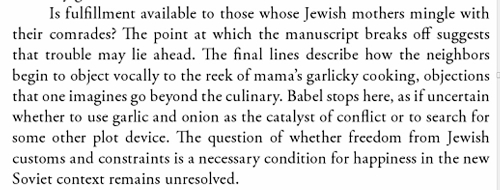jeudi, 03 mars 2016
Banc
C’était merveilleux, ai-je dit, ce banc de poissons que j’ai vu. Je l’ai vu très nettement, tu sais. J’écoutais ce que tu me disais, et je le voyais onduler devant moi. Je crois que c’est parce que tu m’as pris la main.
(Christian Garcin. L’embarquement. Gallimard, 2003, p. 100)
07:27 Publié dans Corps, elle absente, La Marquise marquée, Larcins | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 02 mars 2016
Se dépêtrer
Emmanuel a mis trois quarts d’heure à se dépêtrer de l’habituelle métastase des zones commerciales qui enserrent aujourd’hui toutes les villes, les étouffe sous leurs logos publicitaires comme le gui étouffe les vieux arbres. (“Les muets”, in La neige gelée ne permettait que de tout petits pas, 2005, p. 56)
Ce que je trouve, quand je marche sur les trottoirs fissurés au rouge passé, dans mon quartier d’amère banlieue, ce sont de vieux kleenex — ce que je foule, ce sont parfois des étoffes abîmées — pas grand-chose qui m’embrase (ce qui dans la phrase
de Garcin porte le nom de métastase.
)
18:18 Publié dans Kleptomanies überurbaines, Larcins | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 01 mars 2016
Du dessus
Dans “Cheyennes et Inuits”, la dernière nouvelle du recueil publié par Christian Garcin en 2005, La neige gelée ne permettait que de tout petits pas, le protagoniste rencontre une hermine. Le texte relate d’abord la rencontre du point de vue de l’hermine, en insistant sur la manière dont cet homme est perçu par l’animal : « Elle huma son odeur et la rangea instantanément quelque part au tréfonds de sa mémoire, en compagnie de quelques odeurs inconnues et effrayantes, et d’autres expériences profondes, immédiates, qu’aucun mot ne saurait décrire. » (p. 85)
À la fin de la nouvelle, l’homme parvient à s’imaginer lui-même, comme vu de très haut : « Un grand silence se mit à vibrer très profondément en lui, et il se vit un instant comme du dessus, point minuscule au sein d’un monde immense et nu. » (p. 89)
C’est la confrontation à un autre monde, un monde sauvage radicalement autre, qui lui a permis de se voir ainsi comme du dessus.
08:08 Publié dans Larcins | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 29 février 2016
La biwa
 Dans L'Encre et la couleur, un aveugle dit préférer “les voix bleues” (p. 29).
Dans L'Encre et la couleur, un aveugle dit préférer “les voix bleues” (p. 29).
Dans un écho de la biwa accrochée au mur (Vidas, p. 136), le disciple déclare avoir “compris qu'aucun poète ne peut écrire, aucun musicien jouer de la biwa ou du luth sans l'acceptation de sa propre finitude” (L'Encre et la couleur, p. 37).
13:15 Publié dans Autres gammes, Larcins | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 28 février 2016
Lent clapotis
… au cœur de la nuit, il y avait dans le lent clapotis des eaux noires toutes proches, et le grand silence de la mer qui emplissait tout l’horizon, quelque chose d’à la fois mélancolique et mystérieux qui me plaisait beaucoup. (C. Garcin. “Poisson chinois”, in La neige gelée ne permettait que de tout petits pas, 2005, p. 48)
02:02 Publié dans Larcins | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 27 février 2016
Blousés
“un spécialiste peut se blouser comme un autre homme”
(Gide, Journal, 1933, cité dans le Robert)
Au détour d'une page sur Kafka – que je n'ai pas assez relu depuis que je me suis fait offrir les Sämtliche Werke – Christian Garcin évoque Epépé de Ferenc Karinthy, et c'est un nouveau livre qui s'ajoute à la pile virtuelle.
Dans Labyrinthes et Cie, Garcin évoque aussi son travail de recherches sur la figure de labyrinthe chez Borges et déclare avoir « eu le sentiment d'avoir été proprement blousé, “promené” comme on dit dans le Sud, par un Borges infiniment trop malicieux pour moi » (p. 69).
Là où Garcin voit un méridionalisme (je suppose — je suis, comme on le sait, très réticent à une telle absence de nuance, ayant grandi en trouvant les Provençaux beaucoup plus étranges, dans leur parler et leurs habitudes de pensée, que les “Parisiens”), le Robert parle d'une locution figurée et vieillie : « promener quelqu'un, le mener en bateau, le lanterner ». Et cite le Dictionnaire de l'Académie : “voilà six mois qu'il me promène”.
En ce sens, la promenade prend le sens de déroute organisée, de désorganisation, de dédale interprétatif. (Et de mon remords de ne pas avoir assez lu Kafka depuis 2012 j'en viens au regret de ne pas avoir encore lu Der Spaziergang de Walser.)
J'en termine avec un fait brut, anecdotique : dans l'exemplaire du livre emprunté à la B.U. Se trouvait, outre ma fiche de réservation, une précédente fiche d'emprunt au nom d'Élodie Buttieu (“retour le 29/03/2006”).
13:13 Publié dans Larcins, Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.), Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 26 février 2016
L'autre monde
Itinéraire chinois, 2001. — Comme le buffle, le macaque, “gros mâle très couillu” qui fit intrusion dans la chambre d'hôtel de Christian Garcin au Rajasthan, est le signe de l'autre monde auquel l'écrivain consacra plus tard un de ses meilleurs . Cette contemplation stupéfaite d'une sauvagerie irruptive et spectaculaire se traduit par la répétition du mot monde, son dédoublement, et le recours à la parataxe : « Il rongeait, seul au monde, le dos tourné, je l'observais sans bouger, la nuit allait bientôt s'installer, le monde suivait son cours. » (p. 89)
13:12 Publié dans Larcins | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 25 février 2016
« La fameuse armée d'argile »
En 2001, dans Itinéraire chinois, Garcin revient, dans la septième des “Promenades”, sur sa visite de Xian, muée en récit romanesque l'année précédente dans Le vol du pigeon voyageur. Il cite Borges qui “soulignait une étrange et paradoxale parenté entre Qi Shi Huangdi et William Shakespeare” (p. 73), nomme la gigantesque armée “l'inoffensif point d'orgue d'une paranoïa aiguë”... inoffensif quoique bâtisseurs, architectes et concubines dussent être ensevelis vivants avec l'empereur à sa mort : “Ce furent donc un mort et des milliers de vivants qui habitèrent un temps le tombeau et ses multiples salles souterraines.” (p. 75)
13:11 Publié dans Larcins | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 22 février 2016
Où revenir au vert
Au centre de ces formes insaisissables une tache verte, lumineuse, cristallisait le regard.
(L’autre monde, p. 37)
Nos regards s’étaient mêlés, accrochés, avaient durant quelques secondes que j’aurais voulu ne jamais voir s’achever plongé l’un dans l’autre jusqu’à ce que le renard, ayant vaincu la frayeur qui le paralysait, brusquement fît volte-face et courût vers un sombre taillis, l’éclat roux de son immense queue flottant derrière lui comme la bannière d’une armée victorieuse quittant le champ de bataille.
(L’autre monde, p. 33)
Il faut, pour approfondir le regard, un étendard vert. Mais il faut, pour écrire, être désarmé. Débrouillez-vous avec ça.
10:03 Publié dans Larcins | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 20 février 2016
“comme l'intérieur d'un insecte”
« Je dois dire aussi : l'écriture est l'offrande d'un balbutiement. »
(Marina Tsvetaïeva, d'après C. Garcin, p. 74)
La vingtième des 24 Vidas de Christian Garcin, un de ses premiers livres (1993), s'achève sur l'exécution d'Étienne Dolet, poète et imprimeur — j'avoue n'avoir connu, jusqu'alors, que l'imprimeur. Dans la description du geôlier qui vient chercher Dolet pour le mener à l'échafaud resurgit l'attention particulière de Garcin aux odeurs (comme dans les premières pages de Du bruit dans les arbres, 2002).
L'homme qui vint le chercher était jaunâtre et puant comme l'intérieur d'un insecte. Il ouvrit la porte du cachot, grogna quelques mots, baissa les yeux devant ce regard noir, scrutateur, cette absence de terreur. (p. 127)
Je ne suis “entré” pleinement dans le livre que tard. Ce sont les quatre portraits rassemblés dans la cinquième partie, “Oublis”, qui m'ont vraiment convaincu du projet; jusque là, j'étais réservé, trouvant ces vies brèves trop sommaires, justement, ou alors parfois trop évidemment inventées, comme manquant de variation stylistique, phrases faites au moule. C'est très méchant, et très faux, ce que j'écris, mais je le note quoique j'aie changé d'avis. Ayant commencé en léger décalé la lecture de L'Encre et la couleur (1997), il me semble que la recherche de phrases plus variées, moins rivées au rythme ternaire, risquant l'allongement, est devenue plus centrale au projet de Garcin. (Pour se faire une idée du premier style, abrupt et chantant, de Garcin, cf par exemple la vie brève de Peire Vidal, Vidas 63-67).
Vidas s'achève sur un portrait de Donatello ; le livre de 1997 s'ouvre sur Masaccio. Pour ce qui est de l'allongement, il concerne les chapitres, les “vies” elles-mêmes : alors que les deux livres sont de presque égale longueur, L'Encre et la couleur est constitué de sept chapitres, contre 24 dans Vidas.
Ce que l'on trouve déjà dans Vidas, c'est – outre l'odorat qui s'ouvre un chemin dans l'écriture – la façon qu'a Garcin de développer une phrase à partir des sonorités du mot – ou de l'expression – qui figure à son début, comme, ci-dessous, dans un extrait de la “vie” de Diogène :
Lors des joutes oratoires qu'il aimait provoquer, il avait toujours le dernier mot – soit que ses arguments déroutassent ses adversaires, soit que son outrance les déconcertât. (p. 142)
Parfois, ce travail part d'une anagramme partielle, comme dans la série soir → rosi (où l'on retrouve aussi la réminiscence du “beau ciel d'automne calme et rose” de Baudelaire) :
Contemporains, comme les parfums qu'apportait le vent du soir, et que Salluste, Cicéron ou Martial avaient sentis avant lui, près des mêmes colonnes, des mêmes architraves, sous le même ciel rosissant. (p. 146)
10:09 Publié dans Larcins | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 19 février 2016
Le vol du pigeon voyageur
Tu te laisses porter par les événements plus que tu n'agis sur eux.
(Mariana, à Eugenio — p. 115)
C'est un faux roman policier, dont le récit finit par épouser la forme du fleuve ou du jardin tels qu'ils caractérisent, selon Zhang, la civilisation chinoise (“le jardin piqué, taillé, le trompe-l'œil”, p. 161). Son protagoniste/enquêteur, Eugenio Tramonti, on le sait quand on a lu auparavant les romans ultérieurs de Garcin, qu'il disparaît à son tour, comme Anne-Laure en Chine. Dans les chapitres XIV et XV, Eugenio visite une partie du chantier de fouilles de l'armée des guerriers de Qi Shin Huangdi, “gigantesque puzzle […] en miettes” (p. 103) sur lequel Garcin revient dans son Itinéraire chinois.
Grâce à ce bref roman, j'ai découvert Yosano Akiko.
10:04 Publié dans Larcins | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 17 février 2016
Poétique de Christian Garcin (Esquisse pour une)
Loin du monde le langage se heurte à sa matière propre et se révèle à lui-même, avant de s’oublier. J’écris. Je longe la forêt, parfois pendant très longtemps. Puis j’y entre à petits pas, armé de phrases brèves.
Ce que me dit la fuite éperdue du Cerf courant sous bois peine à franchir mes lèvres.
Il me semble que le moment de cette révélation du langage à lui-même est ce que je cherche dans l’écriture. Lorsque j’écris je cherche l’autre monde.
(L’autre monde, p. 16)
La déclinaison la plus évidente de cette affirmation d’une poétique serait dans l’exploration géographique (tout ce qui, dans l’œuvre de Christian Garcin, est exploration des ailleurs, asiatiques notamment), mais le plus profond est justement dans la langue. Garcin écrit ceci au sujet d’une forêt française, telle que saisie par la pâte du très français Gustave Courbet, dont les initiales viennent inverser celles de Christian Garcin, et le véritable autre monde cherché est celui de la langue, celui qui voit s’inverser les sons pour que de brèves naisse lèvres.
10:01 Publié dans Larcins | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 12 février 2016
Calme brun (sur la toile)
Je crie et pense à ces vieux solitaires empreints de calme brun.
(L’autre monde, p. 8)
Christian Garcin fait parler – en italiques – le cerf du tableau de Courbet.
L’autre monde est un livre capital, qui fait dialoguer l’imaginaire de l’écrivain avec les ombres portées et diffractées, dans la mémoire fallacieuse, d’un tableau où se signe l’Autre.
Il y a dix ans, je crois, quand j’avais déliré, en colloque, sur l’autre part et l’Autre-part (à propos de The Good Soldier), je n’en étais qu’à l’ébauche. On n’a pas vraiment réfléchi (bien que les jeux de langage autour de la capitalisation de l’autre/Autre aient été un des tics les plus productifs de l’ère post-lacanienne) à cette question de la partie et de la partialité dans le rapport à l’autre.
09:54 Publié dans Larcins | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 03 février 2016
Versura
Au bout du sillon, la charrue fait demi-tour. Le mot latin qui désigne l’endroit et le moment où la charrue fait demi-tour est versura, qui a donné vers en français. Le vers du beau langage est lié au monde de la parcelle utilitaire, du champ cultivé, de la raison humaine qui soumet la nature à ses besoins et ses codes. Le monde de la forêt est celui du langage superfétatoire, absent.
(C. Garcin. L’autre monde, p. 12)
La schize charrue / forêt, plus que le souvenir du titre d’un des carnets de Pinget (la métaphore du harnais restera toujours, pour moi, plus sourdement et lourdement opérante), me suggère des pistes du côté de Tutuola (quand la langue cesse d’épouser la norme régulière, là est la rencontre avec la forêt déréglante) ou de Nii Ayikwei Parkes (l’inassignable notre quelque part, entre le monde des codes mis en parcelles et le monde par nous).
09:56 Publié dans Affres extatiques, Larcins | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 01 février 2016
Traîne-buisson
Le Lexique n’est pas mon livre préféré de Christian Garcin. De manière générale, je comprends que les écrivains s’adonnent à l’exercice de l’abécédaire, du répertoire, mais même ceux qui y excellent produisent, au moins selon moi, des ouvrages mineurs. (Pourquoi pas, hein. On ne peut ni ne doit toujours viser ou lire que l’opus magnum).
Je ne compte pas généraliser, de toute façon.
L’objet de cette notule est de signaler une erreur, à l’article traîne-buissons. En effet, Garcin écrit qu’il s’agit de « l’autre nom d’un oiseau extrêmement discret, l’accenteur moucheté » (L’Escampette, 2002, p. 84). Coquille, sans doute : le nom de l’oiseau est bien l’accenteur mouchet. D’autre part, c’est à Buffon que l’on doit le nom plus imagé de traîne-buisson, mais au singulier.
Ça tombe bien – pour lancer enfin peut-être l’Atlas – pour signaler surtout un attachement ancien à ce joli passereau souvent confondu avec la femelle du moineau domestique, quoiqu’il soit plus replet, nerveux – et solitaire.
10:19 Publié dans Larcins | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 31 janvier 2016
Nous remémorer
Nous écrivons et peignons pour nous remémorer ce que nous n’avons pas vécu.
(L’autre monde, p. 38)
Et j’ajouterais : pour identifier ce qui peut échapper à la réalité (inassignable) grâce au souvenir (toujours fixable).
Pour identifier : établir une équivalence.
Tout cela reste diffus et pâle.
(Ce que je nomme la mêmoire.)
09:49 Publié dans Blême mêmoire, Larcins | Lien permanent | Commentaires (2)
mercredi, 27 janvier 2016
L'étrange sérénité des fonds marins
Ce texte de Christian Garcin, publié fin 2014, se présente sous la forme d'un petit format carré glissé dans une pochette en plastique et qui, quand on commence à le lire, se déplie soit comme un livre classique soit en accordéon aboutissant à un octogone, les pages formant un rempart autour du vide. L'éditeur se nomme circa 1924, et à n'en pas douter il y a un véritable choix de proposer autre chose qu'un texte en ligne (ici : un texte crénelé).
Objet sobre et marquant, ce mince volume est porteur d'un texte qui est loin d'être anecdotique. Je l'ai lu une première fois il y a une semaine, et la Mina du texte m'a d'abord évoqué la M'dina de Sardines, puis, une fois ma comprenette désalentie, je me suis rappelé avoir déjà rencontré le nom de Mina Loy, déjà associé à celui d'Arthur Cravan.
Le texte raconte un moment dans la vie de ce bizarre couple, juste avant la disparition de Cravan, en 1918. Garcin s'est inspiré d'une série de photographies faussement anciennes (le rabat les nomme “pictorialistes” et les attribue à un certain Hugo Brehme [j'apprends donc à cette occasion que ce n'est pas par un effet de fausse ancienneté mais bien parce que ces images sont peu ou prou les contemporaines de l'idylle imaginée entre Cravan, ici “Colossus”, et Mina Loy qu'elles semblent anciennes, tant pis, je laisse mon erreur puisque ce crochetage l'affirme : elles ne sont pas faussement anciennes !]) pour raconter comment, au Mexique, Cravan et Mina Loy cherchent une cathédrale rose : d'une part, les photos sont sépia ; d'autre part, comme l'écrit Garcin, au Mexique « de nombreuses cathédrales sont roses : comment trouver la bonne ? ».
De Mina Loy — que, moi aussi, en fin d'adolescence, j'avais provisoirement confondue avec Myrna Loy —, retenons, pour le moment, un poème, Lunar Baedeker qui n'est pas sans échos avec le texte de Garcin.
L'expression citée entre guillemets, « au torse immature de bébés géants », provient d'un poème de Mina Loy, “Property of Pigeons” (dans le texte : the immature torsos / Of their giant infants). Je ne le mets pas en lien, car Google Books est un répertoire particulièrement bordélique et difficile à consulter, mais cela se retrouve facilement — un très beau poème, aux pages 120-1 du recueil posthume The Lost Lunar Baedeker (repris en 2015).
De Cravan, je mets en lien le texte singulier (détestable ? Cravan voulait-il se dépeindre de manière à ce qu'on le trouvât détestable ?) sur André Gide. Je pense que Breton, devenu un poil dogmatique à partir de la fin des années 20, ne devait pas se retrouver totalement dans cette ambivalence opaque.
22:54 Publié dans BoozArtz, Larcins, Le Livre des mines | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 25 janvier 2016
« la peau des pierres »
21 janvier
Dans Pierrier, volume déjà évoqué, ce que je trouve le plus réussi, c’est, justement, la série d’âpres quatrains & tercets qui donne son titre recueil, ainsi que les deux rondeaux qui ferment la marche.
Dans l’ultime tercet de “Pierrier”, on trouve une image — la peau des pierres — qui se transpose fort bien, et avec allitération, en anglais. (J’ai la fâcheuse habitude, en lisant des poèmes brefs, de les traduire en anglais au fur et à mesure.)
L’écriture se lie, se liquéfie, The writing ties itself, liquefies,
creuse sous la peau des pierres, digs under the skin of stones
le cœur tendre des herbes the soft heart of grasses
Il me semble qu’il y a une virgule superflue à la fin du deuxième vers : je comprends le vers 3 comme un C.O.D. de creuse… sinon, ça m’échappe…
Herbes pose un gros problème : grass est généralement singulier (indénombrable, en fait), herbs est le terme culinaire, weeds ne désigne que les mauvaises herbes. Grass au pluriel existe, certes, mais dans un sens plus technique. Heureusement, j’ai trouvé plusieurs occurrences dans un registre légèrement archaïsant.
09:20 Publié dans Larcins, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 23 janvier 2016
Ienisseï (Christian Garcin)
Nous avions laissé le rhombicuboctaèdre déplacer et ranger ses milliers de livres grâce à ses rails aériens. (Ienisseï, p. 79)
Hier soir, j'ai lu ce petit livre qui résonne très fort, Ienisseï, un des plus récents de Christian Garcin.
Il se compose de sept chapitres écrits à partir d'un périple le long du fleuve sibérien, et deux chapitres sur la Biélorussie (“Russie blanche”), l'auteur s'excusant dans un post-scriptum d'avoir, par la structure même de son livre, annexé la Biélorussie à un corpus russe.
Bien qu'il s'agisse de notes de voyage, le fil conducteur de Ienisseï est le sort réservé par les autorités russes aux Pussy Riot, avec mention aussi d'une action des Femen. Une des façons dont le fil se noue est le fait que Nadejda Tolokonnikova « était née et avait grandi à Norilsk, au delà du cercle polaire, près du 70e parallèle nord » (Ienisseï. Verdier, 2014, p. 61). Cela, avec plusieurs remarques sur l'apparente obsession des interlocuteurs russes ou biélorusses de Garcin pour les débats autour du mariage homosexuel en France, fait de Ienisseï un livre ancré dans une certaine actualité autant que dans des lieux. On pourrait dire que ce sont les notes prises par un observateur extraordinairement réceptif et intelligent lors d'un voyage dans une certaine époque.
Les diverses références, comme en passant, aux Pussy Riot, ouvrent souvent les chapitres, au terme d'une longue phrase qui n'en finit pas d'atteindre son estuaire, comme dans le septième chapitre, cité ci-dessus, “Couleur Rouille”. Ces sortes d'introït — j'emploie le mot par maniérisme, et aussi parce que j'ai décidé que 2016 serait, entre autres, l'année des trémas (Ienisseï en arbore un, en sus de ces deux e sans accent) — constituent en quelque sorte la marque chorale du livre. Le troisième chapitre s'ouvre par une citation, sur un paragraphe entier, d'une déclaration de Maria Alekhina.
Il me semble qu'il y a un autre fil conducteur, enclenché — si tant est qu'on puisse enclencher un fil (mais 2016 sera aussi l'année des mixed metaphors, des collocations bancales, au diable toujours faire attention (et donc des anacoluthes)) — avec le premier chapitre, « Ka-pi-ta-lism ! ». Le titre provient de la rencontre avec le gardien du musée de Vorogovo, qui se clôt par l'échange suivant, au sujet des gigantesques et épouvantables incendies de l'été 2012 :
Mais quelle est la cause de tout cela ?
Il se pencha vers nous avec un sourire acide.
— Pe-re-stroï-ka, articula-t-il lentement.
Puis il mima une corde autour de son cou, et fit mine de tirer vers le haut.
— Ka-pi-ta-lism ! conclut-il.
(p. 20)
L'exclamation finale revient très régulièrement sous la plume de Christian Garcin, qui ne tait pourtant aucune des critiques à l'égard du régime soviétique, pour les exactions politiques, bien sûr, mais aussi pour la façon dont la crise des mentalités et de la citoyenneté en Russie lui doit, hélas, beaucoup.
Ienisseï est donc un récit de voyage, un texte (très bien) écrit à partir d'une certaine actualité, mais aussi un livre par lequel j'ai appris bien des choses (et eu envie de prolonger). Il faut dire que je ne connais pas grand chose de la géographie russe, et moins encore de l'histoire des pays pris entre l'Europe et la Russie. Ainsi, le fait que la Biélorussie ait constitué « la majeure partie de ce que l'on appelait autrefois le Grand-Duché de Lituanie, dont la capitale était Vilnius » (p. 83) était tout à fait inconnu de moi ; l'une des guides de Garcin explique ainsi le sentiment de délitement patriotique, étant donné que « [n]os deux capitales, Vilnius et Smolensk, sont à présent à l'étranger » (id.).
Est à creuser, de même, le beau chapitre sur les peuplades de l'est de la Russie, et sur leurs langues. Que Garcin insiste au passage sur le chamanisme youkaguir n'a rien pour surprendre, pour moi qui viens de finir la lecture de son roman La piste mongole. Lorsqu'il raconte un concert donné depuis le navire descendant l'Ienisseï à une trentaine de villageois de Potapovo, il note avec un humour poignant qu'il a « eu le privilège d'approcher, un jour de juillet 2012, environ quinze pour cent de l'intégralité de la population Enetse » (p. 41).
Est à creuser, aussi, l'histoire des massacres allemands en Biélorussie — selon Garcin, « 2 230 000 victimes dans le pays, dont 810 000 Juifs, plus de 200 villes et 9 000 villages détruits, et 433 dont la population a été intégralement anéantie — 433 Oradour-sur-Glane » (p. 87). On n'en sait généralement, en France, et superficiellement, que quelques noms, dont celui de Khatyn. Or, Garcin visite le Mémorial de Khatyn. Dans le village, chaque maison disparue est signalée par une stèle surmontée d'une cloche, et toutes les cloches tintent à des intervalles différents :
Quelques corneilles s'agitent dans les arbres exfoliés. Le froid redouble. Toutes les trente secondes, une cloche retentit, étouffée par la brume qui peu à peu prend possession du lieu. (p. 87)
Sur un registre moins sombre, le livre m'a appris l'existence d'une étrange et immense bibliothèque, la Bibliothèque nationale de Biélorussie, et un mot, rhombicuboctaèdre. (Que le vérificateur d'orthographe ne souligne pas, signalant ainsi sa supériorité lexicographique sur moi.)
07:33 Publié dans Larcins | Lien permanent | Commentaires (2)
jeudi, 21 janvier 2016
... lents bruissements de vent ╬
Alors que je commence à peine l’exploration du continent Garcin, je ressens très fortement un des motifs les plus forts et les plus étranges ( = qui me sont étrangers, a priori) de l’œuvre, ce qui se nomme « houle d’herbes » dans les nouvelles de La neige gelée ne permettait que de tout petits pas, et, dans “D’une bergeronnette et de Tarkovski”, un beau poème de son Pierrier (L’Escampette, 2003), au centre, « lents bruissements de vent ». Au demeurant, ce poème, constitué d’hendécasyllabes alternant avec des alexandrins et des vers de treize syllabes, est un des plus réussis, pour les teintes, dans le ton, par le long mûrissement de l’image finale, concetto d’un sonnet auquel manquerait un vers (trébuchement encore, “préfère l’impair”) :
— images accumulées à l’entour d’un vieux pont
sur le torrent Dourdou qui maculait l’été
de poissons morts incrustés sous nos pieds
08:27 Publié dans Larcins | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 13 janvier 2016
Pschiiit & albatros
Il y a, sur l’autre site, une rubrique Unissons, par laquelle j’essayais (essayai (elle est plus ou moins inactive)) de croiser les formes esthétiques, de faire se croiser des auteurs dissemblables. J’écris ceci en préambule, car, après avoir publié hier deux brefs billets, l’un pour les Larcins, l’autre pour le projet Ferré, celui-ci va, brièvement aussi, juxtaposer les deux.
▓▒░▓▓░▒▒▓
Ce matin, en m’éveillant, le rêve très complexe que je venais de faire s’est aussitôt évanoui, pschiiiiit, un génie de conte oriental qui fait pschiiiiiiit en ne laissant même pas de fumée dans le ciel bleu jaune. Or, hier soir, avant de dormir, j’ai poursuivi ma lecture de La Piste mongole, avec ce Chen rêveur qui commente ses propres rêves et se trouve à se voir dicter ses rêves, à se rendre en rêve dans des lieux qu’il n’a pas choisis (mais que le lecteur a déjà rencontrés dans les deux premières parties du roman et identifie progressivement), de sorte qu’il (Chen-le-maigre, pas le lecteur) pense que quelqu’un d’autre lui dicte son rêve, avec des comparaisons étranges, qui viennent d’un autre, avant que (c’est le chapitre auquel j’ai arrêté ma lecture hier soir, donc autres développements métanarratifs à suivre peut-être) ce même Chen Wanglin avoue être le narrateur qui parle de plusieurs voix, prétend épouser tel ou tel point de vue, chaotiquement, sans logique, « sans se soucier de la cohérence narrative du résultat » (p. 77). La complexité des strates oniriques dans ces chapitres de La Piste mongole sont responsables, je l’écris ici sans me soucier de la congruité de mes propos, de l’évanouissement pschiiiitesque de mon rêve complexe de fin de nuit.
▓▒░▓▓░▒▒▓
Sans transition, Ferré. Lundi après-midi, en route pour la leçon de hautbois de mon fils cadet, nous avons écouté, en voiture, Les Albatros, sorte de chaînon puissant entre la version chantée du célèbre poème de Baudelaire et le Syndrome albatros de Thiéfaine. Nous n’arrivions pas à déterminer si l’instrument qui accompagne les deuxième et quatrième couplets est le cor anglais ou le sax soprano. Ce n’est pas évident à éclaircir à l’oreille, et les informations que l’on peut glaner sur le Web au sujet du groupe Zoo (qui accompagnait ici Ferré) sont maigres. Toutefois, deux éléments me font de plus en plus pencher – j’ai réécouté Les Albatros ce matin au retour du collège – vers le sax soprano : le bouquet final, très cuivré tout de même, et le fait que, dans les autres titres avec le groupe Zoo, il y a plusieurs saxophones, mais jamais de hautbois ou de cor anglais. Incertitude à lever, appel aux plus doués que moi.
08:33 Publié dans Larcins, Par le rameau fleuri | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 12 janvier 2016
Autant de larcins
Il n’y a pas de très nette ou très bonne raison au choix du titre de cette série de textes, Larcins : paronymie du patronyme de Garcin, idée que mes petits textes sont comme des chourades à la dérobée, en lisant un écrivain à peine découvert, glissement vers une homophonie avec mon propre nom (Garcin → cin/Gar → CingaL < lar-cin).
Allons... c'est un beau mot... je ne peux m'y soustraire :
Allez donc ! Ce qu’ici vous perdez de moments
Sont autant de larcins à vos contentements ;
Et ce soir, destiné pour la cérémonie,
Fera voir pleinement si ma haine est finie.
(Cléopâtre, dans Rodogune, acte IV, scène III)
00:04 Publié dans Ecrit(o)ures, Larcins, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 11 janvier 2016
Odeurs
Le bref et très beau récit que Christian Garcin a publié dans la collection Les Flohic, Une odeur de sexe et de jasmin mêlés, met l’accent sur un sens tout à fait prédominant dans son œuvre. Je reparlerai ultérieurement de ce récit, mais l’initiation du jeune homme obsédé par une odeur de femme à tout ce qui constitue fondamentalement cette odeur montre combien le texte cherche aussi à faire glisser les formes visuelles (encres et peintures chinoises des pages de gauche) dans l’univers plus complexe où les sens se combinent.
Itinéraire chinois s’ouvre sur une belle évocation des multiples odeurs des maisons d’alpages (page 10), manière d’ouvrir le bal avant les étapes chinoises : « C’est entendu, partout en Chine, le premier sens convoqué, investi, assiégé, c’est l’odorat. » (L’Escampette, 2001, p. 30, italiques ajoutés). Dans le chapitre consacré à l’Inde et à l’absence d’espace privé, Garcin établit un lien entre « le flou des frontières » et « la sensation d’un amas irrespirable » (p. 86).
Aussi n’est-il pas surprenant de lire, en ouverture du dernier chapitre, juste après une évocation de l’odeur mêlée de beurre rance, de viande fumée et de merde : « Je fermai les yeux. Ça sentait plutôt bon. » (p. 101) — Peut-être faut-il fermer les yeux, parfois au moins, pour mieux apprécier une musique, voire pour distinguer la provenance d’un son… Pour les odeurs, c’est évident. (Mes fils se moquent de moi quand je goûte le vin au restaurant : je ferme toujours les yeux pour le humer, pas pour le goûter. Il m’aura fallu mes fils pour que je prenne conscience que j’étais ridicule (mais je n’ai pas changé mon habitude) et ce texte superbe pour comprendre qu’un bouquet d’odeurs ne s’apprécie que yeux fermés.)
Il n’est pas surprenant non plus, de trouver à la même page du deuxième lexique publié par Garcin, Pris aux mots (L’Escampette, 2006), page 65 donc, œuvre encadrée par odeur et oignon. Je reproduis deux citations données par Garcin pour ces deux entrées :
« Un tas de fumier a parfois de loin l’odeur du musc, et un chien crevé celle des fleurs de sureau. » (Coleridge)
« Isaac Babel disait de son existence qu’elle sentait “l’oignon et la destinée juive”. »
▓▒░░░▒░▒▒▓
De la première, je n’ai pas trouvé trace directement chez Coleridge, mais la citation lui est effectivement abondamment prêtée, notamment par A.P. Russell en 1882, dans ses Library Notes : A dung-hill at a distance, said Coleridge, sometimes smells like musk, and a dead dog like elder-flowers.
Pour la seconde, n’ayant pas beaucoup pratiqué Babel et n’ayant pas la moindre notion de russe, il m’est difficile de trouver mon chemin, mais j’ai tout de même glané ceci sur le Web :
Reading The Complete Works of Isaac Babel is an experience at once horrifying and exhilarating. This large volume is a history of the Russian Revolution and its aftermath, and a monument to the dead and the living. It is full of energy and poetry and slaughter. It smells of war and horses, of onions and herrings, of hunger and blood. It is also a testimony to the stubborn survival of literature. (Margaret Drabble, en 2002 dans le Guardian)
Et mieux encore, ceci, à propos d’une nouvelle inachevée, ‘La Juive’, sous la plume de Carol J. Avins, dans le recueil d’articles rassemblés par Gregory Freydin The Enigma of Isaac Babel (2009) :
(capture d’écran de la page 96 à partir de Google Books)
00:03 Publié dans Larcins | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 06 janvier 2016
Tramway filant dans la bourbe du ciel
Décidément, ça ne va jamais où je veux. Depuis plusieurs jours, je songe à (prépare) trois nouveaux projets d’écriture, l’Atlas, 16 en 16, et une série de textes autour du centenaire de Léo Ferré : j’ai déjà quelques idées, diffuses voire confuses, mais n’ai pas encore écrit la moindre ligne.
Et au bilan me voici ferré (requis) par autre chose, le projet Larcins.
Ce matin, dans le tramway, entre Marne et Mi-Côte, je poursuivais la lecture de L’autre monde de Christian Garcin. Ce n’est pas que le livre soit impossible à résumer, moins encore à recenser — seulement, là n’est pas le projet, voilà tout. Entre Christ-Roi et Tranchée, mon attention a dérivé vers l’écran du smartphone de ma voisine, une adolescente noire aux beaux cheveux tressés, qui passait à toute vitesse sur des quantités de photos sur Instagram : Kardashian, Nabilla, ce genre-là. Tout aussi vite qu’elle les faisait défiler, elle ornait certaines de ces photographies d’un cœur (l’équivalent, je crois comprendre, du “like” sur Facebook). Outre que tout ce que j’entrevis était d’une laideur désolante, cela m’a poussé à regarder plus en détail autour de moi : presque toutes et tous sur leur smartphone, comme cela m’arrive très souvent, à moi aussi, dans le tramway. Plus loin, à l’arrêt Place Choiseul, pareil : devantures mortes sous leurs néons… et pianoteurs isolés, voire en groupes… Étais-je différent, plongé dans mon mince Verdier ?
En ville, il m’a paru, tandis que je contemplais, du tramway filant sur le pont Wilson, la Loire (je fais toujours ça – m’interdis de faire autre chose que de contempler la Loire, le ciel au-dessus de la Loire, les piétons et les cyclistes sur le pont), qu’en ville l’autre monde était celui des citadins qui continuent de regarder autour d’eux, c’est-à-dire aussi de regarder les autres citadins. Je veux dire, les regarder vraiment – pas pour mater ou médire. Prêter attention. Cet autre monde est de plus en plus enfoncé dans la part ténébreuse des existences, dans l’ensauvagement, alors qu’il est seul porteur de lumière ou de civilité. Chamois prêt à s’ensanglanter dans la brume noire. L’eau de la Loire semblait, elle-même, brune, à son actuel étiage bas. Eau brune ou de boue, et non noire ; il faut résister aussi, parfois, à la rime.
Place Anatole-France, j’ai croisé, après être descendu du tram, une jeune fille plus grande que moi. Ce n’est pas souvent : pour que quelqu’un me paraisse évidemment plus grand que moi, il faut qu’il fasse un bon mètre quatre-vingt-dix. Ce matin, rebroussant chemin vers la rue Nationale pour aller acheter mon Charlie Hebdo, j’ai pu vérifier une règle presque intangible : les filles plus grandes que moi sont très souvent en mini-jupe, et elles pourraient passer, à l’aise, leurs deux jambes dans un seul fuseau de mon futal. Cette jeune fille ne pianotait pas sur son smartphone et semblait pressée ; malgré la brièveté de la “rencontre” (trois secondes ?), j’ai eu le temps de trouver à son visage un air à la fois dur et mélancolique. Je doute que ce soit une projection personnelle : ce mélange me semble très insolite.
08:26 Publié dans Larcins | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 05 janvier 2016
La boucloucle va boucler
Un moment comme tant d'autres.
Ce matin, dans le tramway, je lis la très belle nouvelle de Christian Garcin, “Les muets” (dans La neige gelée ne permettait que de tout petits pas). J'ai décidé de découvrir Christian Garcin suite à une vidéo enthousiaste de François Bon. Presque simultanément, notre ami lillois — à qui nous avons rendu visite début mai — nous envoie ses vœux électroniques. Or, la nouvelle se passe à Lille, se nourrit de la ville.
Plus tard, je lis, sur Facebook, la belle chronique d'André Markowicz sur la neige tombée dans la nuit du 3 janvier à Petersbourg. Comme cela me fait penser au célèbre “Souvenir de la nuit du 4”, je cherche, comme ça, au hasard, une traduction anglaise.
Après avoir trouvé une paraphrase d'une étonnante platitude, je trouve, sur Wikisource, une magnifique traduction. Elle est de Toru Dutt... Toru Dutt, je la connais, sous un autre versant, grâce au travail de Chandani Lokugé, autre écrivaine que j'ai pu côtoyer — comme André Markowicz et François Bon — lors de son séjour de travail à l'université de Tours.