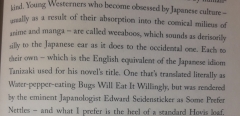dimanche, 03 septembre 2023
03092023 - le littéraire inintéresse
Cette nuit, en rentrant de la garden party de nos amis L* et A*, voyant qu’une ex-collègue (littéraire) avait commenté une de mes publications sur Facebook à propos de rugby en disant, en substance, qu’elle se sentait exclue car ça ne l’intéressait pas et que, parallèlement, mes 5 dernières publications à teneur littéraire depuis jeudi avaient été likées au mieux une fois (jamais par elle), et pas du tout commentées, j’ai affiché ceci :
Ce matin, je vois, sous cette publication, trois « likes », tous de contacts écrivain-es et/ou traductrices, ainsi qu’un commentaire d’un écrivain que j’admire beaucoup, qui m’a envoyé son nouveau texte en avant-première il y a une semaine (mais je lui avais dit que je n’aurais pas le temps tout de suite) et qui écrit : « Je me sens visé. » Je pense que c’est ironique ou facétieux mais je vais devoir lui écrire pour lui expliquer que ce n’était pas du tout la signification du message en question.
Toutefois, cette formule – le littéraire inintéresse – ferait un très bon titre de livre.
Il faudrait en parler avec mon amie E*, qui doit m’envoyer le tapuscrit de son livre (envoyé déjà à 3 éditeurs) depuis des mois, et à coup sûr, après promesse orale claire, depuis lundi.
08:18 Publié dans 2023, La Marquise marquée, Nathantipastoral (Z.), Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 25 avril 2023
25042023
Retour à Tours. Pas beaucoup de courrier. Les six coronilles sont splendides, d’un jaune qui embaume, si je risque la synesthésie.
(Ces cinq derniers mots démontrent pourquoi je n’ai jamais pu écrire de livre : le prof qui fait son malin l’emporte toujours chez moi sur le poète. Et cette parenthèse même, je ne vous dis pas…)
________________________________
We never count our chickens before they are hatched, and we don’t count No.10 Downing Street before it is thatched.
Cette plaisanterie de l'ignoble Thatcher, la traductrice de la VOSTF de The Crown S4E1 a eu du mal à la restituer... mais on ne peut pas lui en vouloir... Quelques suggestions de ma part, all of which are awfully contrived :
(1) On a beau y croire dur comme fer, le 10 Downing Street ne sera à nous que quand s'y sera installée la Dame de Fer.
(2) On connaît bien le vers « Adieu veau, vaches, cochons, couvées... » Moi, je m'en tiens au réel, je m'appelle Margaret, pas Perrette.
(3) On peut toujours tchatcher, mais seuls comptent les faits : pas de tchatche mais Thatcher.
17:36 Publié dans 2023, Nathantipastoral (Z.), Questions, parenthèses, omissions, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 25 février 2023
25022023
Levé à 7 h, réveillé peu avant. Je n’aurai pas réussi à recaler un rythme de sommeil différent de celui des semaines de cours, mais après tout, j’y arrive rarement, et cela remonte même à l’enfance et à l’adolescence : tout l’été je me réveillais vers 7 h, parfois 7 h 30 peut-être – tout au plus. – Le chauffage, bruyant dans cette maison (et on n’a rien pu y faire, en quatorze années), se relance à 7 h, donc ce n’est même pas ça.
Je me suis levé avec plusieurs idées de billets pour ce blog, et après avoir envisagé d’écrire un billet en plusieurs parties, je me suis rappelé qu’à l’époque où j’écrivais beaucoup dans ces carnets, au tout début notamment, il n’était pas rare que je publie 4 ou 5 billets par jour, parfois davantage.
On va donc faire comme ça, avec de vrais titres.
* *
*
Je note quand même ici qu’il a pas mal plu hier après-midi (pourvu que ça dure), et que j’ai enfin achevé Phone de Will Self, commencé il y a 3 semaines ½, interrompu par moments, et surtout que je ne lisais que par 5-10 pages pendant toute la semaine du 6 ; or, le bouquin en compte 617, en un seul paragraphe. C’est un roman très complexe, magistralement écrit, d’une ironie mordante, et qui alterne le point de vue (mais pas vraiment le monologue intérieur) de cinq protagonistes, Zack Busner, son petit-fils Ben, l’espion Jonathan De’Ath, le lieutenant Gawain Thomas, mais aussi, plus ponctuellement, la mère de Ben, Camilla/Milla. On sent que Will Self, lassé de voir pléthore de romans polyphoniques dont le narrateur ou la narratrice est explicitement indiqué-e en tête de chapitre, a voulu montrer qu’il saurait écrire un texte polyphonique sans chapitrage ni même retour à la ligne, dans un flux parfois imperceptible : il m’est arrivé de remarquer au bout de deux ou trois pages que le récit avait changé de focalisateur…
Même si le « grand sujet » du roman est la transition technologique des moyens analogiques au tout-numérique (pas seulement pour la téléphonie), le roman problématise et narre, dans sa dernière partie, un épisode de la guerre en Irak, ainsi que le scandale des crimes de guerre de l’armée britannique. Le décalage de départ entre la figure du psychiatre spécialiste des paranoïas mais désormais atteint d’Alzheimer et son petit-fils autiste n’est donc pas le sujet du livre, même si la rupture du soi (de soi ?) est son mode d’expression. Le personnage de Ben reste en grande partie insaisissable, et sert à boucler la boucle, en quelque sorte, entre les 5 personnages, car c’est lui qui s’avère être le dépositaire de la grande valise perdue par De’Ath dit « le Boucher ».
Entre autres raisons de se perdre dans le livre, la langue : mélange des registres, références à des chansons populaires, vocabulaire technique ou rare, argot, néologismes, allitérations, rimes internes – le nombre de fois où je me suis demandé comment traduire ceci ou cela (et où j’ai évité de me mettre à la place du traducteur…)… Je vérifie au moment d’écrire ces lignes, et apparemment les deux premiers volumes de la trilogie (Umbrella et Shark) ont bien été traduits en français, mais pas Phone. Je n’ai lu que ce troisième tome – hasard des bouquinistes de Galway en février dernier (et ça ne pose aucun problème car il ne s’agit pas de récits suivis) – mais ayant lu d’autres livres de Self j’imagine mal que les autres aient été plus faciles. L’explication est peut-être que Parapluie et Requin ont été traduits par Bernard Hœpffner et que personne n’arrive à prendre sa suite. [Il a été question de Hœpffner jeudi dernier lors du séminaire avec Marguerite Capelle et Laurent Vannini. Je me demande si j’ai déjà écrit à son sujet dans ce blog. Par contre j’avais déjà commencé la série de vidéos je range mon bureau quand j’ai lu son livre paru à titre posthume Portrait du traducteur en escroc.]
07:49 Publié dans 2023, Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 20 janvier 2023
20012023
Il y a cent cinquante ans mourait à Florence une écrivaine dont j’ai découvert l’existence il y a moins de trois semaines – et très indirectement – grâce à ma lecture du roman d’Agiaba Scego, Isa Blagden.
Il n’existe apparemment aucune autobiographie d’elle. Quelques-uns de ses livres peuvent se lire en ligne. Ce cent cinquantenaire est l’occasion de lancer un des projets dont j’ai le secret – à la (re)découverte d’Isa Blagden*. Ce projet me permettra de respecter la contrainte d’1 billet par jour sur l’autre blog sans avoir à me creuser les méninges ou à débiter du Untung-untung de façon quasi machinale.
* Pour l’anagramme (Baal design / Isa Blagden), on a eu chaud, car j’ai hésité avec Big Sandale, Sinbad égal ou Gland baisé.
17:20 Publié dans 2023, Flèche inversée vers les carnétoiles, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 15 janvier 2023
15012023
 Aujourd’hui il fait un grand soleil ; je suis allé à pied à la boulangerie, en photographiant au passage – mal, vite – une partie du terrain vague où se prépare la construction de nombreux logements. J’ai regardé plus en détail et, outre 12 maisons avec leurs « annexes » (?), il doit y avoir 2 blocs de logements sociaux (une centaine en tout), 56 appartements pour étudiants et une soixantaine d’appartements privés. Quand on sait que les écoles et collèges du quartier débordent déjà jusqu’à la gueule…
Aujourd’hui il fait un grand soleil ; je suis allé à pied à la boulangerie, en photographiant au passage – mal, vite – une partie du terrain vague où se prépare la construction de nombreux logements. J’ai regardé plus en détail et, outre 12 maisons avec leurs « annexes » (?), il doit y avoir 2 blocs de logements sociaux (une centaine en tout), 56 appartements pour étudiants et une soixantaine d’appartements privés. Quand on sait que les écoles et collèges du quartier débordent déjà jusqu’à la gueule…
C’est très bien situé : juste en face de la galerie marchande Petite Arche, à deux minutes à pied du bus 2 et de l’arrêt du tramway Marne, et à 15 minutes du Beffroi.
Hier après-midi, j’ai fait quelque chose d’inhabituel : comme j’avais emprunté les trois romans de la trilogie policière Crane & Drake de Parker Bilal, et comme je n’ai ni le temps ni l’envie de les lire, j’ai lu le premier et le dernier chapitre de chacun des romans. C’est une expérience intéressante, d’autant que Jamal Mahjoub (dont Parker Bilal est le pseudonyme) entremêle son style propre aux codifications obligées (ou supposées telles) du genre. Ce qui n’était pas prévu, c’était qu’à cause de l’épigraphe coranique de The Heights, je me retrouve plongé dans la 7e sourate (« Les redans » dans la traduction de Jacques Berque (ce qui a été l’occasion de voir que j’avais déjà pas mal travaillé sur cette sourate, sans doute pendant que j’écrivais ma thèse)), et en particulier à tenter de comprendre pourquoi Berque traduit ce fameux verset 46 (que cite Mahjoub dans une traduction anglaise non créditée) avec une temporalité différente d’autres traductions consultées. Bref, tout ça ne m’a pas emmené très loin, mais j’en ai profité pour reparcourir les dernières sourates, notamment les 62, 63 et 64e (« Il s’est couvert d’une cape » dans la traduction de Berque – quel texte génial). Autre livre emprunté car je l’ai fait acheter à la B.U., le cycle de nouvelles – ou roman composite – d’Imraan Coovadia Tales of the Metric System : j’ai lu le troisième fragment, « Boxing Day 1979 », dont il faudra que je photocopie les 4-5 premières pages pour mon collègue E° qui est spécialiste de musique et lui-même compositeur.

11:44 Publié dans 2023, Kleptomanies überurbaines, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 04 janvier 2023
04012023
Ce midi nous avons « tiré les rois ». O*, dont c’est la fête, a eu la fève. Même depuis qu’on ne triche plus – et ça fait un bail – les garçons ont presque systématiquement la fève.
Le matin à l’université, j’ai récupéré les 7 livres que j’avais fait acheter, dont au moins un que je connais déjà – lu il y a quelques mois même si je n’en ai pas (encore) parlé dans mes vidéos : il s’agit du recueil de nouvelles de Nana Kwame Adjei-Brenyah, Friday Black. Café avec E*, qui m’a demandé combien de livres je lisais par semaine ; il sait très bien que je lis plein de livres à la fois donc il a reformulé sa question en me demandant combien de pages je lisais par jour. Pour répondre correctement à cette question, il faudrait que je compte, grâce aux vidéos (?) le nombre de livres lus dans une année, ce qui permettrait de faire une moyenne. En tout cas, ce qui est sûr c’est que quand je n’ai rien d’autre à faire je peux lire 2 ou 3 livres brefs/moyens par jour (400-500 pages). Cela n’arrive pas souvent.
J’ai entamé notre discussion à la terrasse du café Le Tourangeau en me renversant la quasi-totalité de mon double expresso sur les deux jambes du pantalon (et en m’ébouillantant à moitié). E* a tenté de me dire que le serveur a posé la tasse très près du bord, sur une table branlante qui pis est, mais franchement je sais que ma maladresse est la cause.
Après-midi : correction de copies de L1 (Key concepts). J’aurai appris que la reine Victoria dirigeait le Commonwealth (à moins que ce ne soit les Etats-Unis) et que le Discours sur le colonialisme a été écrit par Jules Ferry. Blague à part, le niveau global est plutôt meilleur que les années précédentes.
Ce soir, j’espère terminer le roman que C* m’avait offert pour mon anniversaire et que j’ai commencé dimanche soir. Il s’agit du troisième roman, le seul traduit en français, d’une romancière italo-somalienne, Agiaba Scego. C’est très bien, même si j’ai noté une énorme bourde de traduction, une confusion entre nigérien et nigérian qui prête à conséquence pour tout un chapitre. C'est dommage, car c'est bien traduit globalement (par Anaïs Bouteille-Bokobza).
En faisant quelques recherches sur le tombeau d’Elizabeth Barrett Browning à Florence – il en est question dans le roman – j’ai découvert l’existence d’une romancière anglophone à moitié indienne, née à Calcutta, et qui a vécu l’essentiel de sa vie d’adulte (et de sa carrière) à Florence, d’où sa proximité avec les Browning et les Trollope : Isa Blagden. On (pourrait) commémore(r) cette année le 150e anniversaire (sesquicentennial (j’adore ce mot)) de sa mort. J’ai envie de lire sa correspondance avec Robert Browning (les lettres du poète à I.B. ont été publiées à titre posthume en… 1923), mais aussi ses romans (Agnes Tremorne par exemple). Il ne semble pas y avoir de biographie consacrée à cette figure méconnue, invisibilisée… seulement des notices biographiques de ci de là.
_______________________
En écoute (notamment) : Le tacot de Jérémiah (Ygranka).
15:36 Publié dans 2023, Moments de Tours, Nathantipastoral (Z.), Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (2)
mardi, 20 novembre 2018
James Fenimore Cooper et les caricatures
In a country where the cholera could not escape being caricatured, you will readily imagine that the King has fared no better. The lower part of the face of Louis-Philippe is massive, while his forehead, without being mean, narrows in a way to give the outline a shape not unlike that of a pear. An editor of one of the publications of caricatures being on trial for a libel, in his defence, produced a large pear, in order to illustrate his argument, which ran as follows:—People fancied they saw a resemblance in some one feature of a caricature to a particular thing; this thing, again, might resemble another thing; that thing a third; and thus from one to another, until the face of some distinguished individual might be reached. He put it to the jury whether such forced constructions were safe. "This, gentlemen," he continued, "is a common pear, a fruit well known to all of you. By culling here, and here," using his knife as he spoke, "something like a resemblance to a human face is obtained: by clipping here, again, and shaping there, one gets a face that some may fancy they know; and should I, hereafter, publish an engraving of a pear, why everybody will call it a caricature of a man!" You will understand that, by a dexterous use of the knife, such a general resemblance to the countenance of the King was obtained, that it was instantly recognised. The man was rewarded for his cleverness by an acquittal, and, since that time, by an implied convention, a rude sketch of a pear is understood to allude to the King. The fruit abounds in a manner altogether unusual for the season, and, at this moment, I make little doubt, that some thousands of pears are drawn in chalk, coal, or other substances, on the walls of the capital. During the carnival, masquers appeared as pears, with pears for caps, and carrying pears, and all this with a boldness and point that must go far to convince the King that the extreme license he has affected hitherto to allow, cannot very well accord with his secret intentions to bring France back to a government of coercion. The discrepancies that necessarily exist in the present system will, sooner or later, destroy it.
Little can be said in favour of caricatures. They address themselves to a faculty of the mind that is the farthest removed from reason, and, by consequence, from the right; and it is a prostitution of the term to suppose that they are either cause or effect, as connected with liberty. Such things may certainly have their effect, as means, but every good cause is so much the purer for abstaining from the use of questionable agencies. Au reste, there is really a fatality of feature and expression common to the public men of this country that is a strong provocative to caricature. The revolution and empire appear to have given rise to a state of feeling that has broken out with marked sympathy, in the countenance. The French, as a nation, are far from handsome, though brilliant exceptions exist; and it strikes me that they who appear in public life are just among the ugliest of the whole people.
James Fenimore Cooper. A Residence in France (1836), Letter III.
11:00 Publié dans Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.), WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 19 octobre 2018
Glottophobie
Les députés macronistes sont donc des gens qui s'accommodent du glyphosate et de tous les pesticides, qui préconisent d'interdire le VTT pendant la période de la chasse, qui préfèrent l'expansion des aéroports à la construction de tramways... mais qui en revanche déposent un projet de loi contre la glottophobie dans les 24 heures qui suivent la polémique sur Mélenchon et la journaliste à accent toulousain...
Au demeurant, comme je l'ai dit à mes étudiant·es, ça m'arrangerait, car je vais pouvoir intenter plusieurs procès chaque semaine à tous ces sympathiques Tourangeaux ou Berrichons, tous persuadés de « ne pas avoir d'accent » (lol), et qui ne trouvent rien d'anormal à se foutre de la tronche de quelqu'un qui parle différemment d'eux.
11:05 Publié dans Aphorismes (Ex-exabrupto), Indignations, Moments de Tours, Mots sans lacune, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 15 septembre 2018
Quasimodo au bout du rouleau
Parmi les emplettes du samedi matin, une bière brune “La Corde raide”.
Rien à faire, j'aurai ça dans la tête toute la journée. (Me suis aperçu que je la connaissais encore par cœur en entier.)
09:30 Publié dans Autres gammes, Moments de Tours, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 28 mai 2018
Livres de Philip Roth
Il y a quelques jours, pour saluer Philip Roth dont on venait d'annoncer la mort, ma mère a posté une photographie des exemplaires qu'elle possédait de l'Américain, en précisant qu'elle avait dû m'en prêter quelques-uns.

Elle pourra donc les récupérer.
J'ai beaucoup travaillé sur l'œuvre de Roth entre 2011 et 2013, car j'ai donné le cours d'agrégation sur American Pastoral. Certains des exemplaires que l'on voit ci-contre (on peut agrandir en cliquant sur l'image) sont même bardés de fiches bristol dans lesquelles j'avais pris des notes (trop de notes, même). Il y a aussi, comme toujours avec moi, un certain nombre de livres de Roth que j'ai empruntés à la B.U..
Je peux aussi l'avouer, il y en a un dont j'ai arrêté la lecture à la page 44 : I Married A Communist. Et, parmi ceux que j'avais empruntés alors, un autre que je n'ai jamais pu finir : The Plot Against America.
14:33 Publié dans Blême mêmoire, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (1)
samedi, 03 février 2018
37 shenanigans
17:06 Publié dans BoozArtz, Nathantipastoral (Z.), Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 25 janvier 2018
66 secondes de lecture, 15 : Kaplan à (1+7x)
Cette lecture, faite à huit heures du matin et illico publiée, j'ai attendu toute la journée avant d'en publier l'écho ici, sur le blog.
Bizarre, de s'être tourné plus vers les vidéos, même pas une solution de facilité.
Mais le carnet vert persiste. Le carnet gris, agonisant, n'a pas toutefois disparu. De temps en temps, le fantasme émerge d'en faire, comme pour les sonnets, un bouquin, un énorme pavé.
Même avec les méandres ou les traversées du désert, ce n'est pas si mal d'avoir tenu déjà douze ans et demi l'aventure du blog. Roubaud, que je lis en ce moment (car en fait & en dépit des apparences je ne lis pas du tout Leslie Kaplan), rappelle l'aphorisme de Gertrude Stein selon laquelle en écrivant chaque jour pendant une demi-heure on débouche sur un bon paquet de pages au bout de 40 ans.
Eh bien, oui, la polygraphie.
D'autres diraient : la logorrhée.
Je n'en ai cure.
Et puis tiens, si je me remettais à écrire des rondels ?
19:01 Publié dans 66 SECONDES DE LECTURE, Nathantipastoral (Z.), WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 02 décembre 2017
Hommage à la mafieuse

16:20 Publié dans BoozArtz, Nathantipastoral (Z.), Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 13 octobre 2016
Dylan & le Nobel. De quelques fausses évidences.
Ainsi, Bob Dylan se voit décerner le Prix Nobel de Littérature 2016.
Je m'attendais à des réactions épidermiques, ronchonnes, réactionnaires dira-t-on, mais pas à ce concert d'avis péremptoires de la part de gens qui, de toute évidence, parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Sur les réseaux sociaux fleurissent les bons mots annonçant la remise du prochain Prix Nobel à C. Jérôme ou Bézu...
Une discussion sur la littérature, et sur la valeur littéraire, doit s'appuyer sur des arguments solides, et, notamment (il paraît délirant d'avoir à le souligner) sur la connaissance de ce dont on parle.
Bob Dylan ne doit pas être “jugé” sur ses seuls textes, mais sur l'ensemble de son œuvre de créateur, qui inclut la performance, la mise en scène de ses chansons et leur musique, évidemment. Déjà, en 1997, pour Dario Fo, j'avais été étonné de tous ces prétendus experts qui jugeaient d'un auteur dramatique sans prendre en compte la dimension théâtrale (le jeu, la performance). Il est décidément bien ironique que l'un soit mort le jour où l'autre reçoit à son tour le Nobel.
On peut donc ergoter, et discuter du mérite supérieur de tel ou tel poète mondial, d'Adonis par exemple, dont le nom, d'ailleurs, est toujours associé à l'argument selon lequel, vu le contexte, “il aurait fallu récompenser un Syrien”. Voilà une belle connaissance de ce qu'est la littérature : le Nobel à un Syrien parce qu'Alep est noyée sous un tapis de bombes... (Adonis mérite, méritait le Nobel, mais pas sur de tels arguments : c'est insulter son œuvre et montrer qu'on ne connaît que son nom.)
Toutefois, il faut juger de l'œuvre de Dylan sur pièces, et, pour ne prendre qu'un exemple, moi qui ai tenté de traduire de très nombreux poètes contemporains de langue anglaise, américains notamment, je peux témoigner que certains textes de Dylan sont plus difficiles à traduire que bien de ceux de poètes dont le nom n'aurait pas fait se lever le moindre sourcil. (Sur Facebook, j'ai écrit, à propos de la complexité et de l'opacité de certains textes de Dylan : René Char, à côté, c'est de la gnognote. J'exagère, mais à peine.)
Donc, il doit y avoir débat, d'autant plus à partir du moment où tant de personnes qui se constituent en autorités littéraires parlent de gag à propos de ce Prix Nobel.
La vraie question, selon moi, est plus large : le Prix Nobel a-t-il valeur de prescription ? Si on répond oui, on aura tôt fait de décrier la remise de ce prix à Bob Dylan en disant que « tout le monde connaît déjà ». Contrer un tel argument est aisé. Ainsi, cédant moi aussi aux jugements péremptoires, j'écris aujourd'hui (et je pense, dans une certaine mesure) que Bob Dylan est un “auteur” (un “poète”) cent fois inférieur à Derek Walcott. Or, Walcott a eu le Nobel il y a plus de vingt ans, et il doit y avoir 200 personnes en France qui le lisent ou l'ont lu. Je grognasserais donc volontiers en disant que Nganang, Ngugi ou Raharimanana auraient mérité le Nobel cent fois davantage que Dylan (ce que je pense), mais la vérité est que ça n'aurait presque rien changé à la vraie popularité effective ( = qui les lit ou les lira) de ces auteurs. On ne peut donc en vouloir aux membres du comité Nobel de choisir sans tenir compte de la popularité ou de l'obscurité d'un auteur, mais sur des questions plus intemporelles de valeur et d'apport à la littérature mondiale.
Il y a un autre point : c'est, à ma connaissance, la première fois qu'un Nobel est décerné à un auteur que beaucoup connaissent directement sans le truchement des traductions. Et donc aussi sans le truchement de l'écrit. Bien sûr, absolument personne ne signale ça dans les premières réactions entendues ou lues ici et là. En revanche, ce qui ressort, c'est que cette décision du Nobel semble illégitime car la littérature, ce sont (ce seraient) des textes. Voilà bien le problème : la littérature n'est pas seulement dans les textes, mais aussi dans leur performance : par exemple, dans le genre dramatique, analyser un texte sans le rattacher à sa théâtralité, c'est un contresens que seuls commettent encore les étudiants de première année.
Si Ngũgĩ wa Thiong'o avait eu le Prix Nobel, je me serais plu à souligner qu'une partie essentielle de son œuvre, ce sont les pièces de théâtre en gĩkũyũ qu'il a créées et montées avec des troupes de paysans analphabètes, et la portée tant esthétique que politique qu'elles ont eue au Kenya.
Nuruddin Farah fait dire à un de ses personnages — dans Sardines — que Coltrane était un immense poète (such a great poet). Or, Farah vient d'une culture où la poésie était entièrement orale, et fameusement complexe d'ailleurs. La poésie orale somalie, extraordinairement codifiée, n'a commencé d'être transcrite que dans les années 60, et tous les Somaliens disent que ces transcriptions n'ont que peu de sens en elles-mêmes. Ainsi, vouloir compartimenter la littérature, mettre d'un côté les poètes et d'autre les paroliers, à ma droite les romanciers à ma gauche les vidéastes etc., n'a plus aucun sens.
Ce qui conserve tout son sens, c'est la discussion de la valeur littéraire. On peut tout à fait démontrer, sur des critères de valeur (mais en poussant vraiment l'analyse), que Dylan ne méritait pas le Nobel. Tout autre argument fleure bon le quant-à-soi et la poussière balayée sous le tapis.
16:11 Publié dans Autres gammes, Nathantipastoral (Z.), Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (3)
mercredi, 29 juin 2016
Ne partons pas fichés
Cinq heures de sommeil, c'est eut-être ma norme, ou ce serait ma norme si je vivais seul — allez savoir.
Hier soir, j'ai essayé – déjà couché – d'écrire un nouveau sonnet en émoticônes, mais certains des symboles refusant de s'afficher dans gmail, la connexion wifi s'interrompant à intervalles aussi réguliers qu'exaspérants, j'en suis quitte pour une ébauche de rien du tout.
Dimanche soir, mon fils aîné m'a traîné à Saint-Avertin, écouter les Innocents et surtout Raphaël (dont il a tous les disques). Plusieurs personnes autour de nous ne connaissaient que “Caravane” et “Ne partons pas fâchés”, et avaient l'air très heureusement surprises du concert.
05:52 Publié dans Ex abrupto, Moments de Tours, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 27 avril 2016
Vélodrome
Ce matin, j'ai écrit sur FB que je comptais consacrer au moins une partie de la journée à la reprise des chantiers d'écriture et aux vidéos.
Ça paraît assez mal engagé, déjà parce que, ce matin, donc, j'ai enregistré une nouvelle vidéo de traduction improvisée, et que le tout — formatage et montage compris — m'a bouffé deux heures. Ce système n'est pas viable, car je ne peux pas consacrer autant de temps à une seule traduction. J'avais pourtant choisi un poème d'une petite vingtaine de lignes, pas trop difficile. Si je l'avais traduit par écrit, à l'ancienne, ça m'aurait peut-être pris une demi-heure, et là, pour présenter et traduire, je me retrouve avec une vidéo de plus de 19 minutes, que je “monte” ensuite afin de couper trois minutes de silences et divers bégaiements, et de rendre la chose moins indigeste pour mes cinq téléspectateurs. Comme avant, le son est médiocre, ma tronche coupée, mon regard totalement à l'ouest.
Maintenant j'ai envie de profiter de ce beau soleil pour aller faire une petite promenade digestive, mais vais d'abord tenter d'écrire deux ou trois textes, histoire de ne pas être complètement déçu de ne pas arriver à la cheville du programme que je m'étais fixé.
Le vert du cognassier est magnifique, le froid cinglant sous le soleil aussi. Mais enfin, tous ces atermoiements, c'est d'un pénible...
13:37 Publié dans Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (1)
samedi, 16 avril 2016
De Ménars au Mali (par les ondes)
Il faudrait quatre vies condensées pour mener les différents projets, pas seulement d'écriture, mais c'est le hasard, aussi, qui trie.
Je ne sais pas trop pourquoi je commence ainsi ce billet ; la phrase d'amorce, sans doute, d'où le reste découle.
Retour arrière, c'est décidément plus difficile que de reprendre des phrases improvisées sur le motif. Toutefois, cela permet de ne pas se tromper et de citer correctement la belle façade classique du château de Ménars, vue depuis la rive sud de la Loire hier ; or, je crois que nous n'étions jamais allés à Chambord par cette levée de la Loire, la D951, étant donné que les panneaux indicateurs font plutôt passer, depuis Blois, par Huisseau. (Quelque chose ne colle pas, là-dedans : nous sommes déjà passés par Saint-Dyé.) *
Au château de Ménars, on l'apprend en visitant le château, ont résidé les parents de la future reine de France, le roi de Pologne Stanislas Leszczynski et son épouse, mais aussi — on l'apprend en consultant la Wikipédia, Madame de Pompadour, puis son frère, Abel-François Poisson de Vandières, bientôt titré marquis de Ménars.
Cette fois-ci, à Chambord, nous avons loué des vélos et nous sommes considérablement embourbés — et emboués —, à la grande joie des garçons qui faisaient exprès de foncer dans les flaques et les ornières avec leurs VTT d'emprunt. Nous n'avons, cela va sans dire, pas vu la queue du moindre animal — quelques oiseaux vus ou entendus, toutefois.
À la boutique, j'avais acheté le journal de résidence d'Arno Bertina, SebecoroChambord, que j'ai lu hier soir, et dont j'avais éventuellement projeté de traduire un ou deux paragraphes in situ, dans la forêt, pour les traductions sans filet. Comme pour la B.N.F. ou le P.Z.P., cela ne s'est pas fait. Il va falloir que je m'aguerrisse ! En revanche, c'est un très beau texte, et comme je n'avais encore jamais rien lu d'Arno Bertina, il m'a donné envie de lire le livre qu'il préparait alors et dont ce journal de résidence est aussi une sorte de chronique d'atelier. Coïncidence — ou pas : plus on cherche des accointances avec le réel et ce qui est beau, moins on peut parler de coïncidences —, il travaillait, pour ce livre (Numéro d'écrou) avec la photographe Anissa Michalon, plus particulièrement de son travail auprès des immigrés maliens de Montreuil et d'une figure, Idriss, qui s'est suicidé en prison en 2005 avant que son corps ne soit rapatrié au Mali.
Mali, photographies : le matin même, avant de partir pour Chambord, j'avais passé près d'une heure à revoir ou découvrir les différentes séries de Malick Sidibé, disparu jeudi. C'est à ce niveau que s'est imposée l'idée d'une coïncidence.
Pour en revenir à SebecoroChambord, sans prétendre en faire le tour, il s'agit d'un texte exigeant, au sens où l'auteur est exigeant avec lui-même, avec son rôle d'écrivain, avec la crainte d'étouffer la littérature sous le témoignage, la tentation d'“éditorialiser entre chaque plan” comme le reproche a pu en être fait à Costa-Gavras (p. 76). On y apprend, en filigrane, plein de choses sur le château et le domaine de Chambord (à titre d'exemple : l'explication de la signification des cordelettes entourant la plupart des F au chiffre de François Ier, pp. 83-4 (l'explication ne se trouve nulle part dans les documents de visite du château)), et on voit aussi comment Bertina, conscient de l'impasse politique d'une telle institutionnalisation de son rôle d'écrivain, affronte la question à bras-le-corps, pour clore sa préface par une formule marquante (« À Chambord, je ne me suis pas rasé, le matin, en m'imaginant roi », p. 9) ou pour affirmer la dissonance de tout projet littéraire : « Chambord est ce concert au fond des bois dans lequel je fais entendre plusieurs canards. Des fausses notes, une bizarrerie harmonique. » (p. 33).
Texte littéraire fort, ce mince journal de résidence l'est aussi par l'envie qu'il donne de lire ou de relire certains textes : plusieurs livres de Bertina lui-même (très malin dans sa manière de suggérer ce qu'est le reste de son œuvre, mais avec une véritable détermination esthétique toutefois), Dieu gît dans les détails de Marie Depussé, The Ginger Man de J.P. Donleavy (depuis quand n'ai-je pas lu une ligne de Donleavy ? pourquoi ai-je toujours tourné autour de ce Ginger Man sans m'en saisir ? a-t-il vraiment été traduit par Homme de gingembre en français ?) — revenir à Chalamov (que cite Anissa Michalon).
* Quand j'ai commencé à organiser mes photographies par albums dans Flickr, j'ai créé un album Loire Indre Vienne Etc. (LIVE), mais c'était après la création de Touraine sereine, et dans Touraine sereine, je n'ai jamais fait ça : soit ça tombe dans les Sites et lieux d'Indre-et-Loire, soit c'est Hors Touraine. C'est idiot, vu que Chambord relève plus, dans l'expérience topographique et visuelle, d'un prolongement, d'une poursuite de la Touraine. Il n'est pas trop tard, me dira-t-on, sauf que ces carnets ont depuis longtemps renoncé à leur ambition première, de chroniquer les pays aux alentours de Tours.
09:35 Publié dans Corps, elle absente, Hors Touraine, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (2)
vendredi, 01 avril 2016
Vieil homme sous un ciel en suspens
Pour célébrer la vingt-sixième vidéo, filmée tard ce soir, je signale l'importance du poète sud-africain Tatamkhulu Afrika (1920-2002).
Ces prochains jours, les publications de traductions improvisées et filmées seront peut-être plus sporadiques.
23:55 Publié dans Nathantipastoral (Z.), Tographe, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 27 février 2016
Blousés
“un spécialiste peut se blouser comme un autre homme”
(Gide, Journal, 1933, cité dans le Robert)
Au détour d'une page sur Kafka – que je n'ai pas assez relu depuis que je me suis fait offrir les Sämtliche Werke – Christian Garcin évoque Epépé de Ferenc Karinthy, et c'est un nouveau livre qui s'ajoute à la pile virtuelle.
Dans Labyrinthes et Cie, Garcin évoque aussi son travail de recherches sur la figure de labyrinthe chez Borges et déclare avoir « eu le sentiment d'avoir été proprement blousé, “promené” comme on dit dans le Sud, par un Borges infiniment trop malicieux pour moi » (p. 69).
Là où Garcin voit un méridionalisme (je suppose — je suis, comme on le sait, très réticent à une telle absence de nuance, ayant grandi en trouvant les Provençaux beaucoup plus étranges, dans leur parler et leurs habitudes de pensée, que les “Parisiens”), le Robert parle d'une locution figurée et vieillie : « promener quelqu'un, le mener en bateau, le lanterner ». Et cite le Dictionnaire de l'Académie : “voilà six mois qu'il me promène”.
En ce sens, la promenade prend le sens de déroute organisée, de désorganisation, de dédale interprétatif. (Et de mon remords de ne pas avoir assez lu Kafka depuis 2012 j'en viens au regret de ne pas avoir encore lu Der Spaziergang de Walser.)
J'en termine avec un fait brut, anecdotique : dans l'exemplaire du livre emprunté à la B.U. Se trouvait, outre ma fiche de réservation, une précédente fiche d'emprunt au nom d'Élodie Buttieu (“retour le 29/03/2006”).
13:13 Publié dans Larcins, Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.), Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 05 novembre 2015
Une histoire de Grace ▓ Nicolas Servissolle ░ Éditions Myriapode
Une histoire de Grace est le premier roman (ou le premier roman publié ?) de Nicolas Servissolle. Il m'a été offert, suite à une rencontre avec l'écrivain qui s'est déroulée à l'excellente librairie Campus, à Dax. Le récit, bref mais d'une grande densité, est précédé, de manière inhabituelle et très in-your-face, d'une préface qui a tout d'un manifeste. Une telle préface, qui proclame – en se réclamant de Bonnefoy et Robbe-Grillet, rien moins – la nécessité de reprendre à nouveaux frais la tâche du nouveau réalisme que portait, sous des “écritures pourtant si différentes qu'elles découragent d'y déceler le moindre indice d'un mouvement esthétique commun”, le Nouveau Roman.
Ayant commencé par cette préface programmatique, le lecteur ne se retrouve donc pas à lire un roman. La préface, tout un programme, a actionné un certain nombre de leviers, suscité aussi quelques attentes. En d'autres termes, on attend de voir ce qui ressort d'une telle ambition.
D'emblée, puis au fil des 8+2 chapitres, le lecteur trouve tel écho de Sarraute (“Cela remue... Cela parle... Vous entendez?”, p. 15), tel clin d'œil à Butor (le je-tu modificatoire), tel dispositif caractéristique de la première manière de Robbe-Grillet (le personnage principal, enquêteur, se révèle être l'objet du récit/rêve par un autre scripteur). Sans la préface, ces éléments eussent certainement sauté aux yeux. De même, le reproche que l'on peut formuler, à savoir que Nicolas Servissolle écrit bien, et, en un sens, trop bien — ce que, par une expression fréquente que je n'aime pas trop employer, l'on nomme parfois se regarder écrire —, est si évident qu'il ne présente, au fond, aucun intérêt : cette mise en scène de l'écriture, cet agacement du lecteur, sont partie prenante de la stratégie d'écriture, et participent de cet essai de “nouveau réalisme”. Ainsi, les nouvelles laissées par la morte (et retrouvées par l'enquêteur dans son appartement au chapitre IV) constituent, plus qu'une mise en abyme du récit, un miroir qui nie toute possibilité d'enchâssement : comme chez Éluard, mais dans une perspective plus nettement lynchéenne, on peut poser la question sans y répondre : « qui de nous deux inventa l'autre ? »
Pour ma part, je préfèrerai toujours un écrivain qui écrit un peu trop bien (ce qui, dans d'autres cas, peut aussi se traduire par un débraillé délibéré, une écriture volontairement gauche) à un écrivain qui n'écrit plus à force de se fondre dans un moule de parlote collective. La double distinction barthésienne opposant, d'une part, l'écrivant à l'écrivain, et, d'autre part, le texte lisible au texte scriptible, ne m'a jamais paru aussi pertinente qu'en ces temps de profusion et de confusion.
De façon voisine, certains trouveront peut-être que l'auteur, nourri de peinture et d'histoire de l'art, a tendance à plaquer – ou, autre métaphore picturale, à diluer (hmmmm, oui, who am I to criticize those who overwrite?) – les références, ou s'agaceront du chapitre VII, dont l'interpolation des événements du récit principal et du dialogue relatif à La Grande Bouffe de Marco Ferreri m'a paru, au contraire, très intelligente et très réussie.
J'ai noté plus haut que le récit était bref (125 pages) mais d'une grande densité. Il m'est donc impossible de signaler tous les jeux d'échos, par exemple entre la Grace du titre et la Grèce... la fixation sur l'épisode d'Ulysse chez Nausicaa ou l'importance de plusieurs traditions philosophiques helléniques, dont la conception sophistique du logos n'est pas la moins importante. C'est au lecteur (à d'autres lecteurs = à ceux qui, je l'espère, liront ce livre après avoir lu ce billet) de tirer son épingle du jeu interprétatif, à refaire, autrement que moi, le parcours dans ce bref texte scriptible (Barthes aurait-il, à l'heure des nouvelles technologies, risqué réinscriptible ?) Il va de soi que les tenants d'un roman dont l'auteur s'interdit toute référence culturelle, toute discussion de questions théoriques sur l'art ou la littérature passeront leur chemin, et sans doute ne sont-ils déjà pas arrivés jusqu'ici dans ce billet. → ;-) comme on écrit.
Dans l'écriture même, m'a frappé l'usage d'une forme de présent de narration qui sert à mélanger les différents plans temporels. Servissolle s'en sert pour décrire, dans un même paragraphe, des événements qui se sont nécessairement déroulés à des moments très différents : appel à la reconstruction des “étapes” par le lecteur ? stratégie visant à rappeler que la distinction entre temps de l'histoire et temps du récit est un leurre quand la lecture se saisit simultanément d'axes censément distincts ? reprise (non décelée par moi) d'un procédé d'écriture (ricardolien ? (je mets ça au pif)) ?
Il y a quelques coquilles, étonnantes, mais, dans l'écriture même, j'aimerais opposer, de façon tout à fait subjective et sans chercher à m'en justifier, deux extraits dans lesquels le recours à un lexique rare produisent des effets opposés.
1. « Elle pleure, t'appelle son étranger, déplore ce qu'elle nomme la routine solite des couples où l'on se rend sourd à l'autre et à soi... » (p. 114)
2. « Haletant, le dos conte la porte, tu sens alors une présence étrange à tes côtés, comme si le passe-muraille de Marcel Aymé, la tête sortant de la cloison, te toisait en silence, sans bouger. Tu as un mouvement de recul. Une carafe d'orignal pend au mur, un trousseau de clés accroché à ses cornes ! Assurément, Grace possède un sens de l'humour bien à elle. » (p. 70)
Dans le premier, préciosité pure. Dans le second, le choix du substantif carafe dans une acception méconnue vient renforcer l'effet de saisissement et de duperie que la référence au passe-muraille aurait rendu, sans cela, plutôt plate.
13:13 Publié dans Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.), Pynchoniana | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 17 mai 2015
Savannah — Un tatou mort avant nous
Le nouveau livre de Jean Rolin est un bref récit de son retour à Savannah, sept ans après y avoir séjourné avec sa femme, Kate, laquelle est morte dans l’intervalle. L’élément structurant de ces allers-retours entre 2014 et 2007, ce sont les films réalisés par Kate, que le narrateur décrit, dont il transcrit certains dialogues et qui lui servent aussi de guide pour repartir, le plus précisément possible, sur les traces du couple d’avant. Rêveries du veuf solitaire, les chapitres proposent une forme de condensé de la poétique de Rolin : attention aux détails incompatibles avec le tourisme, description des friches industrielles, mise en scène (au sens noble – il leur donne la parole) des laissés-pour-compte (je ne sais quelle expression convient le mieux pour l’anglais disenfranchised).
Outre que les chauffeurs de taxi jouent un rôle primordial (de passeurs ?) dans les itinéraires du récit, une figure prend plus d’importance au fur et à mesure qu’elle devient moins menaçante : celle du petit homme au parapluie à « l’allure invariable, mécanique » (p. 40) : Doppelgänger, image de l’errance déraisonnable et systématique, autre forme de passeur ?
Dans un récit qui gravite autour de la figure de Flannery O’Connor – dont je n’ai jamais rien lu, il me semble, et dont le texte a le mérite de donner envie de lire la nouvelle ‘The Lame Shall Enter First’ – et de la visite à sa maison fatale, perdue en forêt, Rolin ne dissimule rien de l’atelier, ainsi quand il avoue que Google Maps est « cette espèce de miracle informatique grâce auquel je viens de retrouver le lieu exact de cet épisode » (p. 37). De même, si fasciné soit-il par les friches et par ce que je tente parfois moi-même de décrire dans mes kleptomanies überurbaines, il n’en déplore pas moins la banlocalisation généralisée (ce que Renaud Camus nomme aussi “le devenir-banlieue du monde”, et dont il fut question dernièrement pour la France) : « on se retrouve dans un paysage de désolation, celui d’un mall démesurément étendu et de ses métastases, dont seules quelques prémices étaient visibles en 2007 » (p. 88). Sans mise en scène macabre, très naturellement pourrait-on dire, le narrateur se livre à une sorte de mime de la mort, de doublement spectral, comme lors de la visite au cimetière sur les traces de l’hypothétique tombeau du père de Kate. À cette occasion, le lecteur comprend que, deuxième vidéaste, Jean Rolin filme également ce deuxième voyage à Savannah :
À Lionell, j’avais prétendu qu’il s’agissait de ma propre famille, ou de quelque chose de ce genre, afin qu’il ne soit pas surpris quand il me verrait sortir de la voiture, comme je le fis, et reproduire scrupuleusement, en les filmant, tous les gestes que Kate avait accomplis dans le même lieu. » (p. 110, c’est moi qui souligne)
En fin de compte, dans un récit tout en strates et traces, où toute figure devient à chaque instant spectre d’un autre ou d’elle-même, le seul cadavre véritablement inscrit (on ne peut dire ni vrai ni réel ici) est celui du tatou mort filmé par Kate en 2007 (pp. 73-6). Ici, c’est aussi d’un langage vivant et imparfait que le récit devient la trace, rendue parfaite et plus froide. En effet, les propos transcrits de Kate sont étranges, car, quoique anglophone, elle s’exprime d’une façon difficilement compréhensible pour le chauffeur :
Nous revenons vers la voiture, Kate dit à Willy : « It was a tattoo, he had so many maggots ! »
Ce mot de tattoo n’évoque rien pour Willy, dans la mesure où en anglais, comme en espagnol, tatou se dit armadillo. (p. 74)
Cette scène montre que ce qui se joue, comme chez Beckett, c’est l’aventure de la langue vivante figée dans la bande, et que le récit tente de reproduire, même de re-présenter. L’erreur sur le mot tattoo peut-elle vraiment venir de l’anglophone Kate ? Rolin ne nous invite-t-il pas au soupçon, ainsi qu’à une lecture dynamique des signes faussés ? Le tatou mort était là avant eux, et donc avant nous, lecteurs, avec ses vers et son magot de mots.
12:41 Publié dans Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.), Questions, parenthèses, omissions, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 28 octobre 2014
Rubriques
2 octobre
À quoi pouvait servir cette rubrique ? À me trépaner un peu plus ? — Comme je l'ai dit, dans mon cas, ça va être plus proche de Cabillaud que d'Apollinaire.
Rubriquer, c'est séparer, découper. [Scinder Soi ?]
Travailler sur le découpage, la coupure des mots, la scission des pages, est une vieille obsession. À quels frais la reprendre.
12:02 Publié dans Chèvre, aucun risque, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 31 mai 2014
Malgré le vent...
Malgré le vent,
malgré le vent qui tournoie
efface parfois le printemps
sous les pépiements des mésanges,
chats du quartier tous à l'affût
depuis ce matin j'arpente les rues
dans mes sandales de jésus
en soie grège ma peau craquèle
un nouveau printemps que salue
le vent tournoyant.
14:08 Publié dans Ecrit(o)ures, Moments de Tours, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 18 mai 2014
“Good enough for Jehovah”
Tandis que je lisais dehors, sur la terrasse, en plein soleil (souvenirs de Tarkos sur le toit en zinc, à Beauvais), une minuscule araignée jaune tissait sa toile sur mon livre, et une tout aussi minuscule araignée noire tissait sa toile sur ma chemisette. Il m’a bien fallu les déranger pour aller chercher la feuille-de-chêne que mon voisin me tendait, par-dessus la haie qui sépare notre maison de son potager. Avant, deux paires de témoins de Jéhovah, écumant le quartier, se partageaient les demeures. Sur la marelle, je me suis contenté de leur opposer un ferme « Je ne supporte pas le prosélytisme », mais un autre voisin, sur le rond-point, leur a exposé sa vision du monde et de l’intolérance religieuse ; je buvais du petit lait, sans que les araignées en perdissent leur fil.
11:42 Publié dans Kleptomanies überurbaines, Moments de Tours, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 20 mai 2013
Pfingsten, na
L'arsouille avait la dalle en pente.
Moiteur rance.——— Le pupitre fut brisé, le service interrompu.
Sueur des mollets ankylosés, dans la côte.
Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde.
Antonin Artaud l'a appris hier.
L'arsouille, trois grammes à chaque bras, descend la pente. (Et maintenant je m'imagine sous vos dentelles vos crinolines le cœur coincé dans la portière...)
20:05 Publié dans Le Livre des mines, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 15 mai 2013
3061 !
Il faisait assez frais, à Silkeborg, l'an dernier, mais moins qu'à la mi-mai 2013 en Touraine.
 Tel un ténia, le temps s'enroule. ——— J'ai trouvé un système épatant pour composer des textes même sans l'envie.
Tel un ténia, le temps s'enroule. ——— J'ai trouvé un système épatant pour composer des textes même sans l'envie.
Leur froideur me grise, leur saveur me dérange.
Alors, sur le tour tu as mis avec foret et mandrin les conversation sur New York, tu les sculptes, le marteau Léger t'y aide, j'entre gratis pourquoi.
Le gras tisse.
Déjà ça de pas pris.
21:35 Publié dans Nathantipastoral (Z.), Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 28 février 2012
L'harmonie injuste, l'inconfort, les bêlements [Bax II]
Whatever the reason might be, for the first time in her life, instead of slipping at once into some curious pleasant cloud of emotion, too familiar to be considered, Rachel listened critically to what was being said. By the time they had swung in an irregular way from prayer to psalm, from psalm to history, from history to poetry, and Mr. Bax was giving out his text, she was in a state of acute discomfort. Such was the discomfort she felt when forced to sit through an unsatisfactory piece of music badly played. Tantalised, enraged by the clumsy insensitiveness of the conductor, who put the stress on the wrong places, and annoyed by the vast flock of the audience tamely praising and acquiescing without knowing or caring, so she was not tantalized and enraged, only here, with eyes half-shut and lips pursed together, the atmosphere of forced solemnity increased her anger. All round her were people pretending to feel what they did not feel, while somewhere above her floated the idea which they could none of them grasp, which they pretended to grasp, always escaping out of reach, a beautiful idea, an idea like a butterfly. One after another, vast and hard and cold, appeared to her the churches all over the world where this blundering effort and misunderstanding were perpetually going on, great buildings, filled with innumerable men and women, not seeing clearly, who finally gave up the effort to see, and relapsed tamely into praise and acquiescence, half-shutting their eyes and pursing up their lips. The thought had the same sort of physical discomfort as is caused by a film of mist always coming between the eyes and the printed page. She did her best to brush away the film and to conceive something to be worshipped as the service went on, but failed, always misled by the voice of Mr. Bax saying things which misrepresented the idea, and by the patter of baaing inexpressive human voices falling round her like damp leaves. The effort was tiring and dispiriting.
Virginia Woolf. The Voyage Out [1915], Hogarth Press, 1971,pp. 277-8.
14:28 Publié dans Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 30 septembre 2011
Le spectre et le mourant
(Note écrite le 13 juillet, à Hagetmau)
Le dernier, très court, chapitre d’Indignation apprend au lecteur que le narrateur, qui se présentait comme un spectre, était en fait un mourant qui, sur son lit d’hôpital, se retrouvait, grâce à la morphine, avec la mémoire dopée – d’où son récit. Bien sûr, comme souvent chez Roth, cette révélation finale ne va pas sans poser de nouveaux problèmes narratologico-théologiques, plus complexes encore. Surtout, en substituant un mourant comateux à un spectre, cette fin de roman semblait appeler la lecture que j’ai enchaînée –Malone Dies (je crois avoir lu Malone meurt il y a une éternité – mais je crois aussi ne jamais avoir lu L’Innommable – est-ce possible ?).
Il faudrait réellement qu’un jour :
1. j’achète (au lieu de toujours emprunter tel ou tel volume en bibliothèque) les œuvres complètes de Beckett
2. je me livre sérieusement à l’étude, non du bilinguisme et de l’auto-traduction (cela a été fait vingt fois déjà), mais d’un point précis de comparaison entre le texte français et le texte anglais. (Par exemple, dans Malone Dies, ce pourraient être les substantifs en –lessness ou les comparaisons ou le rythme ternaire.)
Ajout du 29 septembre.
Aujourd'hui, j'ai recopié, dans le fichier Word « Roth », les notes éparses gribouillées lors de ma lecture d'Indignation. Une fois encore, la parenté avec les thèmes constitutifs d'American Pastoral (désir rétrospectif, mais voué à l'échec, de reconstituer ; histoire et récit ; erreur et errements ; incertitude du sens et certitude du désastre) est évidente.
05:55 Publié dans Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 27 septembre 2011
Philip Roth – Nemesis (2010)
Dans la perspective de mon cours sur American Pastoral, je m’envoie (ou m’infuse) un certain nombre de romans de Philip Roth, dont les plus récents – la série des quatre brefs récits rassemblés sous le titre général de Nemeses (nemesis au pluriel, en anglais : je n’ai aucune idée du pluriel de némêsis en français, ou plutôt si : je me doute que c’est un substantif emprunté au grec, et donc invariable) – sentent la fatigue. J’ai manqué de temps pour publier mes notes de lecture sur les romans des années 70 et 80 ; elles sont encore sur des fiches bristol, ou dans le ventre de l’ordinateur.
Avant-hier soir, j’ai fini de lire Nemesis, le 4ème et dernier roman de la série des Nemeses (!). Il s’agit d’un roman en trois parties, dont l’action se déroule, pour l’essentiel, en 1945, à Newark, dans le quartier de Weequahic. Le sujet en est l’épidémie de poliomyélite, et les nombreuses victimes qu’elle fit sur la côte Est des Etats-Unis, en particulier parmi les enfants. (Dans le documentaire diffusé la semaine dernière sur Arte, Mia Farrow explique que c’est après avoir discuté avec elle, qui a survécu difficilement à la polio, que Philip Roth a écrit Nemesis.) Le personnage principal est Bucky Cantor, jeune homme de vingt-trois ans qui n’a pu se faire enrôler dans l’armée en raison de ses problèmes de vue et qui, professeur d’éducation physique pendant l’année, s’occupe de diriger les activités sportives des enfants pendant l’été (« playground supervisor » : surveillant de centre aéré ? responsable des activités en plein air ?). Il est nommé ‘Mr. Cantor’ tout au long du roman, car, ainsi que le lecteur l’apprend p. 108, le narrateur est un enfant qui avait douze ans lors de l’épidémie, Arnie Mesnikoff, et qui raconte l’histoire en 1972, après avoir retrouvé la trace de Bucky Cantor et appris, de la bouche même du protagoniste, l’histoire dans tous ses détails.
Les points que je retiens sont les suivants :
* récit en 3 parties – la 3ème, beaucoup plus brève, se passe en 1972, et raconte les circonstances de la rencontre entre Bucky et Arnie, qui ont tous deux survécu, avec de fortes séquelles, à la polio en 1945. Elle s’intitule ‘Reunion’, ce qui est ironique, puisque ces retrouvailles servent surtout à mettre en avant pourquoi Bucky Cantor, convaincu d’avoir infecté involontairement plusieurs garçons de Newark ainsi que plusieurs garçons, s’est condamné à ne plus avoir aucune vie sociale, et surtout à ne pas épouser Marcia Steinberg, à laquelle il venait de se fiancer lorsqu’il est tombé malade. Toute la question de la culpabilité et de la maladie est étroitement mêlée à un débat d’ordre théologique, qu’éclaire principalement le point de vue, explicitement athée, d’Arnie, le narrateur (Nemesis. Jonathan Cape, 2010, pp. 264-5). On peut aussi se référer à la divergence de vues entre Bucky et sa fiancée lorsque l’épidémie de polio prend de l’ampleur : praying vs vision d’un Dieu qui abandonne les humains (forsaking). Le découplage entre un Dieu vétéro-testamentaire et un Dieu néo-testamentaire est, comme toujours chez Roth, systématiquement évité, objet de brouillage.
* le personnage de Bucky Cantor n’est pas sans rappeler celui de Seymour Levov, « the Swede », dans American Pastoral è très sportif, il est perçu comme un modèle et un idéal par les enfants et les adolescents (Arnie et Donald seraient, à cette aune, des versions bis du jeune Nathan Zuckerman dans AP). Surtout, l’analyse que fait Arnie du sentiment de culpabilité de Bucky Cantor permet de nets rapprochements. Our ne citer que deux passages de la fin du roman :
He has to find a necessity for what happens. There is an epidemic and he needs a reason for it. He has to ask why. Why? Why? That it is pointless, contingent, preposterous and tragic will not satisfy him. […] this is nothing more than stupid hubris. (p. 265)
Such a person is condemned. Nothing he does matches the ideal in him. (p. 273)
Lors d’une visite que lui rend Bucky Cantor au début de l’épidémie, son futur beau-père, le docteur Steinberg, insiste sur le fait que, même quand on fait ce qu’il faut (« you do the right thing »), on ne peut s’empêcher de constater l’absurdité de l’existence : « Where is the sense in life ? » (p. 47)
* le statut du narrateur et les conditions d’énonciation originelle du récit sont complexes (cf pp. 244-5). Font l’objet d’une forme de dissimulation subjective/objective. Arnie compare le récit rétrospectif de Bucky comme un voyage impossible qui tourne autour de l’irréversible : « an exile’s painful visit to the irreclaimable homeland » (p. 245). L’image de l’exil et de la demeure suggère autant le Juif errant que le Paradis perdu (rêve d’Eden). / AP
* statut de la Nature et de l’idéologie de la vie sauvage. La 2ème partie, « Indian Hill », se situe dans un centre aéré fondé par un certain Blomback sur les théories d’Ernest Seton, une forme de scoutisme dont le principe fondamental est le respect des coutumes indiennes. La voix narrative semble prendre ses distances avec (voire se moquer implicitement de) ce nativisme, fantasme de retour à une pureté originelle d’autant plus paradoxal que ce sont les anciens colons, ceux qui ont expulsé/exterminé les Amérindiens, qui miment les coutumes indiennes. Il y a, à cet égard, une scène essentielle, juste avant la mort de Donald Kaplow (adolescent très sportif dont Bucky aide à améliorer les techniques de plongée), la cérémonie du Grand Conseil Indien (peintures de guerre, feu de camp, discours en indien). Cette cérémonie s’achève, assez symptomatiquement, par le God Bless America (p. 218). Par ailleurs, Donald Kaplow se moque, à l’oreille de Bucky, de tout ce tralala et du fait que Blomback prenne tout cela au sérieux. Les moqueries de Donald sont qualifiées de kibitzing ° .
Il est difficile d’interpréter la mort brutale de Donald Kaplow après cette scène. Bucky est convaincu de l’avoir contaminé à son insu. Le lecteur ne peut s’empêcher d’envisager l’hypothèse d’une vengeance divine : en se moquant des rites indiens sur un site sacré (Indian Hill), Donald n’a-t-il pas été puni de son outrage (hubris) par la poliomyélite (nemesis) ? Toutefois, cette interprétation est trop simpliste : le Dieu de l’Ancien Testament et les esprits sacrés des Indiens ne sont-ils pas distincts ? Surtout, le récit tend à insister sur le caractère fantasmatique de tout lien de cause à effet. (Elément faussement proleptique, juste avant la catastrophe : le papillon, en qui Bucky voit « an omen of bounteous days to come », p. 179.) Le point de vue développé en filigrane par Arnie, le narrateur, et par le docteur Steinberg, ne doivent-ils pas inciter le lecteur à ne pas faire de lien, à ne voir, dans tout événement, que pure contingence ?
° D’après l’OED, le verbe kibitz est tiré du yiddish, à partir de l’allemand kiebitzen (regarder un jeu de cartes). Le 1er sens du verbe, à valence transitive, est lié aux jeux de carte. Voici un copié-collé du 2ème sens, pour lequel le verbe est intransitif :
To chat, banter, or joke, freq. with a person; to behave in a lighthearted or informal manner, to fool around.
1930 G. Kahn & W. Donaldson My Baby just cares for Me (song) 5 She don't like a voice like Lawrence Tibbett's, She'd rather have me around to kibitz.
1969 P. Roth Portnoy's Complaint 244 Fierce as the competition is, they cannot resist clowning and kibbitzing around.
2002 National Rev. 1 July 27/2, I served coffee, I told bad jokes, and good ones. I kibitzed. I schmoozed.
11:21 Publié dans Nathantipastoral (Z.), WAW, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 20 septembre 2011
Les trois (ou quatre) D
(Billet écrit le 10 juillet 2011)
“Growing up, I’d never known of a single household among my friends or my schoolmates or our family’s friends where the parents were divorced or were drunks or, for that matter, owned a dog. I was raised to think all three repugnant. My mother could have stunned me more only if she’d told me she’d gone out and bought a Great Dane.” (Indignation, 2008. Vintage, 2009, p. 154-5)
Dans cet extrait, on ne peut qu’admirer le trait, typiquement rothien (voilà qui sonne bien mal – même « Rothian » en anglais ne me paraît pas souhaitable), qui consiste à scruter un moment particulièrement tragique et traumatisant à l’aune de ce qui pourrait sembler dérisoire : usages du sarcasme à fins d’ironie – ce qui renforce l’acuité du moment, dans son tragique même. Ici, les trois figures du Mal, liées par une allitération en anglais, sont, par un effet de chute, ou de gradation ascendante pseudo-sérieuse, le Divorce, l’Alcoolisme et les Chiens.
Le sème dogs se dédouble d’ailleurs, du point de vue de l’allitération, en Great Dane (dont je me demande (pas de dictionnaire ni d’Internet ici) si ce n’est pas, en anglais, le doberman : voilà qui aurait le mérite de sauver en partie l’allitération dans une traduction). Or, quoique ce bref roman n’appartienne pas au corpus des neuf ‘Zuckerman Novels’, on ne peut s’ [= je ne peux m’ ?] empêcher de songer que le choix de cette race de chien ne doit rien au hasard : à plusieurs reprises, le regard que porte sur ses parents le narrateur spectral d’Indignation, Marcus / Markie / Marc, rappelle, sur un versant négatif, l’idéalisation, dans American Pastoral et la perspective subjective de Zuckerman, de Seymour Levov, le jeune homme parfait de l’immédiate après-guerre, l’idole sportive dont le surnom n’est autre que ‘the Swede’. Est-ce pécher par excès d’herméneutique que de vouloir rapprocher le contexte complexe des deux romans, tant militaire (Seconde Guerre mondiale, guerre de Corée, guerre du Vietnam) que religieux, de la rivalité historique tout aussi complexe qui a longtemps opposé Danois et Suédois ?
N’y a-t-il pas, dans ce rejet du « grand danois », du doberman (du berger danois ???), un rejeu de la critique subtile de l’idéalisation de l’American way of life telle qu’elle est portée / incarnée par un protagoniste surnommé, dans American Pastoral, « le Suédois » ?
11:28 Publié dans Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 05 juillet 2011
La Pastorale, & le déni de réalité
Dans l'immédiat, je me contente de copier-coller ici (sorte de laboratoire tout à trac de mon futur cours, mais aussi du WiKi en gestation) deux longs extraits de la Contrevie (The Counterlife de Philip Roth, fini de lire il y a un mois). Il y a évidemment beaucoup à en dire. ce que l'on ne peut en dire est que ces pages donnent la clef du roman. Non, c'est plus compliqué. On ne saurait non plus affirmer qu'elles éclairent entièrement la question de la pastorale dans American Pastoral - mais elles l'éclairent passablement !
Excerpt from Maria’s letter to Nathan on leaving him (pp. 320-22)
You do want to be opposed again, don't you? You may have had your fill of fighting Jews and fighting fathers and fighting literary inquisitors—the harder you fight that sort of local opposition, the more your inner conflict grows. But fighting the goyim it's clear, there's no uncertainty or doubt—a good, righteous, guilt-free punch-up! To be resisted, to be caught, to find yourself in the midst of a battle puts a spring in your heel. You're just dying, after all my mildness, for a collision, a clash—anything as long as there's enough antagonism to get the story smoking and everything exploding in the wrathful philippics you adore. To be a Jew at Grossinger's is obviously a bit of a bore—but in England being Jewish turns out to be difficult and just what you consider fun. People tell you, There are restrictions, and you're in your element again, You revel in restrictions. But the fact is that as far as the English are concerned, being Jewish is something you very occasionally apologize for and that's it. It is hardly my perspective, it strikes me as coarse and insipid, but it still is nothing like the honor you have imagined. But a life without horrible difficulties (which by the way a number of Jews do manage to enjoy here—just ask Disraeli or Lord Weidenfeld) is inimical to the writer you are. You actually like to take things hard. You can't weave your stories otherwise.
Well, not me, I like it amiable, the amiable drift of it, the mists, the meadows, and not to reproach each other for things outside our control, and not every last thing invested with urgent meaning. I don't usually give in to strange temptation and now I remember why. When I told you about that scene at Holly Tree Cottage when my mother said, about my Jewish friend, “They smell so funny, don't they?” I saw exactly what you were thinking—not “How awful for someone to say such a thing!” but “Why does she write about those stupid meadows when she can sink her teeth into that? Now there's a subject!” Perfectly true, but not a subject for me. The last thing I would ever want are the consequences of writing about that. For one thing, if I did, I wouldn't really be telling the English anything they didn't know but simply exposing my mother and me to incalculable distress in order to come up with something "strong." Well, better to keep the peace by writing something weak. I don't entirely share your superstitions about art and its strength. I take my stand for something far less important than axing everything open—it's called tranquillity.
But tranquillity is disquieting to you, Nathan, in writing particularly—it's bad art to you, far too comfortable for the reader and certainly for yourself, The last thing you want is to make readers happy, with everything cozy and strifeless, and desire simply fulfilled. The pastoral is not your genre, and Zuckerman Domesticus now seems to you just that, too easy a solution, an idyll of the kind you hate, a fantasy of innocence in the perfect house in the perfect landscape on the banks of the perfect stretch of river. So long as you were winning me, getting me away from him, and we were struggling with the custody issue, so long as there was that wrestling for rights and possessions, you were en-grossed, but now it begins to look to me that you're afraid of peace, afraid of Maria and Nathan alone and quiet with their happy family in a settled life. To you, in that, there's a suggestion of Zuckerman unburdened, too on top of it, that's not earned—or worse, insufficiently interesting. To you to live as an innocent is to live as a laughable monster. Your chosen fate, as you see it, is to be innocent of innocence at all costs, certainly not to let me, with my pastoral origins, cunningly transform you into a pastoralized Jew. I think you are embarrassed to find that even you were tempted to have a dream of simplicity as foolish and naïve as anyone's. Scandalous. How can that be? Nothing, but nothing, is simple for Zuckerman. You constitutionally distrust anything that appears to you to be effortlessly gained. As if it were effortless to achieve what we had.
Yet when I’m gone don't think I didn't appreciate you. Shall I tell you what I'm going to miss, despite my shyness and well-known lack of sexual assertiveness? It's feeling your hips between my thighs. It's not very erotic by today's standards, and probably you don't even know what I'm talking about. “My hips between your thighs?” you ask, dumbly rubbing your whiskers. Yes, position A. You'd hardly ever done anything so ordinary in your life before I came along, but for me that was just lovely and I won't forget for a long time what it was like. I will also remember an afternoon down in your apartment before my enemy came home for dinner; there was an old song on the radio, you said it was a song you used to dance to in high school with your little girl-friend Linda Mandel, and so for the first and only time, there in your study, we danced the fox-trot like adolescent kids out of the forties, danced the fox-trot glued loin to loin. When I look back on all this fifteen years from now, you know what I’ll think? I’ll think, "Lucky old me." I’ll think what we all think fifteen years later: "Wasn't that nice." But at twenty-eight this is no life, especially if you are going to be Maupassant and milk the irony for all its worth. You want to play reality-shift? Get yourself another girl. I'm leaving. When I see you now in the lift or down in the foyer collecting your mail, I will pretend, though it may only be the two of us who are there, that we have never been anything other than neighbors, and if we meet in public, at a party or a restaurant, and I am with my husband and our friends, I will blush…
Excerpt from Nathan’s reply, on pastoralization (pp. 325-7)
Now what you say about pastoralization. Do you remember the Swedish film we watched on television, that microphotography of ejaculation, conception, and ail that? It was quite wonderful. First was the whole sexual act leading to conception, from the point of view of the innards of the woman. They had a camera or something up the vas deferens. I still don't know how they did it—does the guy have the camera on his prick? Anyway, you saw the sperm in huge color, coming down, getting ready, and going out into the beyond, and then finding its end up some-where else—quite beautiful. The pastoral landscape par excellence. According to one school, it's where the pastoral genre that you speak of begins, those irrepressible yearnings by people beyond simplicity to be taken off to the perfectly safe, charmingly simple and satisfying environment that is desire's homeland. How moving and pathetic these pastorals are that cannot admit contradiction or conflict! That that is the womb and this is the world is not as easy to grasp as one might imagine. As I discovered at Agor, not even Jews, who are to history what Eskimos are to snow, seem able, despite the arduous education to the contrary, to protect themselves against the pastoral myth of life before Cain and Abel, of life before the split began. Fleeing now, and back to day zero and the first untainted settlement—breaking history's mold and casting off the dirty, disfiguring reality of the piled-up years: this is what Judea means to, of all people, that belligerent, unillusioned little band of Jews . . . also what Basel meant to claustrophobic Henry lustlessly boxed-in back in Jersey . . . also—let's face it—something like what you and Gloucestershire once meant to me. Each has its own configuration, but whether set in the cratered moonscape of the Pentateuch, or the charming medieval byways of orderly old Schweiz, or the mists and the meadows of Constable's England, at the core is the idyllic scenario of redemption through the recovery of a sanitized, confusionless life. In dead seriousness, we all create imagined worlds, often green and breastlike, where we may finally be "ourselves." Yet another of our mythological pursuits. Think of all those Christians, hearty enough to know better, piping out their virginal vision of Momma and invoking that boring old Mother Goose manger. What's our unborn offspring meant to me, right up to tonight in fact, but something perfectly programmed to be my little redeemer? What you say is true: the pastoral is not my genre (no more than you would think of it as Mordecai Lippman's ) ; it isn't complicated enough to provide a real solution, and yet haven't I been fueled by the most innocent (and comical) vision of fatherhood with the imagined child as the therapeutic pastoral of the middle-aged man?
Well, that's over. The pastoral stops here and it stops with circumcision. That delicate surgery should be performed upon the penis of a brand-new boy seems to you the very cornerstone of human irrationality, and maybe it is. And that the custom should be unbreakable even by the author of my somewhat skeptical books proves to you just how much my skepticism is worth up against a tribal taboo. But why not look at it another way? I know that touting circumcision is entirely anti-Lamaze and the thinking these days that wants to debrutalize birth and culminates in delivering the child in water in order not even to startle him. Circumcision is startling, all right, particularly when performed by a garlicked old man upon the glory of a newborn body, but then maybe that's what the Jews had in mind and what makes the act seem quintessentially Jewish and the mark of their reality. Circumcision makes it clear as can be that you are here and not there, that you are out and not in—also that you're mine and not theirs. There is no way around it: you enter history through my history and me. Circumcision is everything that the pastoral is not and, to my mind, reinforces what the world is about, which isn't strifeless unity. Quite convincingly, circumcision gives the lie to the womb-dream of life in the beautiful state of innocent prehistory, the appealing idyll of living "naturally," unencumbered by man-made ritual. To be born is to lose all that. The heavy hand of human values falls upon you right at the start, marking your genitals as its own. Inasmuch as one invents one's meanings, along with impersonating one's selves, this is the meaning I propose for that rite. I'm not one of those Jews who want to hook themselves up to the patriarchs or even to the modem state; the relationship of my Jewish "I" to their Jewish "we" is nothing like so direct and unstrained.
08:52 Publié dans Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 04 juillet 2011
Anal > minéral > fascinal
“Well, if you are, as your work suggests, fascinated with the consequences of transgression, you’ve come to the right family. Our mother can be hellishly unpleasant when it comes to transgression. She can be hard like a mineral – an Anglo-Saxon mineral. I don’t think she really likes the idea of her languid, helpless Maria submitting to anal domination by a Jew. I imagine that she believes that like most virile sadists you fancy anal penetration.”
“Tell her I take a crack at it from time to time.”
Philip Roth. The Counterlife (1986). Penguin, 1988, p. 282.
21:41 Publié dans Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 21 juin 2011
The Prague Orgy
The Prague Orgy, troisième volet du cycle de romans dont le narrateur/ou/protagoniste est Nathan Zuckerman (N.Z. ci-après), a été présenté, lors de sa publication, en 1985, comme le dernier tome d’une trilogie, Zuckerman Bound. (Or, Exit Ghost, publié en 2007 et annoncé alors comme le dernier livre consacré à N.Z., est le neuvième titre de la nonalogie*. (Le titre, Exit Ghost, donne un effet de symétrie par rapport au premier volume, The Ghost Writer (que j’ai fini de lire hier), mais est aussi une citation tirée des didascalies (non shakespeariennes) de Hamlet.))
------- La nouvelle rubrique que je crée ce jour, premier d'un été peut-être pluvieux, me permet de combler un vide dans l'arborescence alphabétique. Il n'y avait pas de rubrique dont le titre commençât par la lettre N. Evrything goes into the blog. -------
C’est le texte le plus faible du corpus. Amusant que je commence cette rubrique sous le signe du texte le plus faible du corpus. Le plus bref (80 pages). A dû paraître bien peu de chose, pour une fin de trilogie.
The Prague Orgy n’a pas de dédicataire. (The Ghost Writer était dédié à Milan Kundera. La ville de l’impossible échappée, par un jeu complexe d’allusions à James, y est Florence. Les écrivains tchèques de The Prague Orgy suggèrent, de manière déformée, Kundera.)
- Eva, l’« actrice tchekovienne » : « in black like Prince Hamlet » (p. 3)
- Le père de Zdenek Sisovsky : « he was elliptical, humble, self-conscious, all in his own way. He could be passionate, he could be florid, he could be erudite – he could be anything. No, this is not the Yiddish of Sholem Aleichem. This is the Yiddish of Flaubert. » (p. 22)
- pp. 62-3 è l’envers de la pastorale et du rêve d’un Eden juif, vision d’une ville en ruines, image déformée de la cite hébraïque idéale
- « Why be drawn further along, the larger the obstacles ? That’s okay writing a book, that’s what it is to write a book. » (p. 68)
- Récit (story), métaphore de la mue et de la peau-prison (pp. 83-4) : « shedding my story », « snaking away from the narrative encasing me » è « one’s story isn’t a skin to be shed » (p. 84)
* Même l'OED, pourtant le plus complet qui soit, annonce :
No exact results found for nonalogy in the dictionary.
06:18 Publié dans Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)