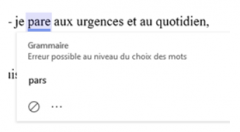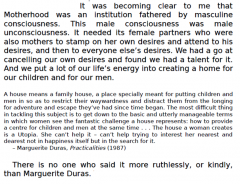mercredi, 03 décembre 2025
03122025 (Martin Chilton, suprémaciste monolingue ?)
C’est un grand classique des fins d’année dans la presse anglophone : les listes des 10, 15 ou 50 meilleurs livres de l’année. Bien sûr je regarde toujours cela avec le regard circonspect du traductologue et en chaussant mes lunettes post-coloniales.
Le dernier article de ce genre vient de paraître sous la plume de Martin Chilton, pour The Independent. L’introduction de l’article est tout à fait savoureuse :
Narrowing down the best books of 2025 to a list of 15 inevitably means leaving out fine works, including Shadow Ticket, the first novel by Thomas Pynchon in 12 years , and We Do Not Part by Nobel Prize in Literature winner Han Kang.
The year marked what would have been Jane Austen’s 250th birthday, and following the example of her Pride and Prejudice character Caroline Bingley, who said, ‘I declare after all there is no enjoyment like reading’, I have selected books that were, in the main, simply a joy to read.
D’accord pour exclure un récent Prix Nobel, ou Thomas Pynchon, aucun des deux n’ayant peut-être besoin d’être mis en avant. Toutefois, comme on devait s’y attendre, les quinze livres retenus sont tous – contrairement à celui de Han Kang – écrits en anglais. Tous. Pas une seule traduction. Ce qui fait donc plaisir (simply a joy to read) à Martin Chilton, c’est de se retrouver entre soi, dans le gentil petit cocon de l’ancien Empire britannique.
Et encore, il faudrait préciser, car parmi les auteurices on trouve onze Anglais·es, deux Américaines (Katie Kitamura et Amanda Quaid), une Indienne (Arundhati Roy) et une Irlandaise (Anne Enright). Quitte à ne lire que des anglophones, ce qui est déjà ahurissant, pourquoi ne choisir aucun livre écrit par des auteurices d’Afrique, ou d’Océanie, ou des Caraïbes ? Voyons, voyons, je me demande…
10:51 Publié dans 2025, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (2)
mardi, 02 décembre 2025
02122025
En train d’écouter l’émission dans laquelle Pierre-Édouard Deldique recevait Camille Froidevaux-Metterie pour la parution de l’ouvrage collectif Théories féministes, je suis toujours captivé par la grande clarté de la philosophe. Plusieurs articles de cet ouvrage ont l’air passionnants, comme celui sur le féminisme institutionnalisé et la silenciation des luttes.
Un peu choqué tout de même qu'elle prétende que le reflux anti-féministe, ou backlash, se situe surtout aux États-Unis, en Italie et en Hongrie, comme si la fascisation ne menaçait pas les luttes de façon très concrète dans notre pays ; agacé aussi que la question des féminismes non blancs soit réduite à une perspective « différentialiste », et qu’elle ait parlé de cultures « minoritaires » au sein des sociétés occidentales, alors qu’il ne s’agit pas nécessairement de « cultures », et surtout qu’elles sont minorisées, et non minoritaires. Par ailleurs, Awa Thiam, que cite en passant la philosophe, ne s’exprime pas au nom d’un afroféminisme minorisé en Europe, mais depuis l’espace africain. Froidevaux-Metterie a tout à fait raison de parler de l'invisibilisation des féminismes noirs africains, mais alors pourquoi insister autant sur Gloria Anzaldua (dont tout le monde dans le milieu se gargarise depuis plusieurs années, sans la lire d'ailleurs) en continuant d'invisibiliser les féminismes africains non francophones ?
Il a été beaucoup question de décentrement aussi lors des débats du festival Plumes d’Afrique ce week-end, et je regrette vraiment que mon étudiante N* ait abandonné sa thèse, qui était partie sur des rails absolument parfaits, et qui promettait de déconstruire aussi la notion de queer pour l’espace nigérian.
08:15 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 01 décembre 2025
01122025
Aujourd’hui a été diffusée la vingt-sixième émission de I Love Mes Cheveux. Je l’avais enregistrée jeudi 20 novembre en début d’après-midi, avec quatre des étudiantes qui suivent mon cours de deuxième année autour des voix de poètes et écrivaines hispanophones et anglophones des Caraïbes. Je ne reviens pas ici sur ce que je tente, depuis trois ans, de ce cours, car il suffit d’écouter l’émission, en quelque sorte, et aussi car j’en ai dit quelques mots au lendemain de l’enregistrement.
Ce que je veux noter ici, c’est que je me suis beaucoup replongé dans l’anthologie bilingue The Sea Needs No Ornament, dont je viens même de commander un second exemplaire afin de pouvoir l’offrir. Il faudrait vraiment traduire cette anthologie, telle quelle, avec l’excellente préface.
18:15 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 29 novembre 2025
29112025
Idée d’épigraphe, voire d’épitaphe :
« Si on veut faire éclater des baudruches, il ne faut pas les flatter mais y mettre les ongles. »
(Simone de Beauvoir, La Force des choses, II, vi)
09:05 Publié dans 2025, Aphorismes (Ex-exabrupto) | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 28 novembre 2025
28112025
Nuits courtes assez régulièrement ces temps-ci, et du retard dans le travail – je pare aux urgences et au quotidien, disons. Le plus étrange est que c’est Claire qui dort mal.
Aujourd’hui ça va être long encore : 7 h 30 de cours entre 8 h et 18 h 30, puis compétition de tennis de table à Saint-Cyr. Très content de mon entraînement d'hier, avec des revers globalement plus efficaces mais trop de déchet, et un essai de nouveau service court. Ça risque quand même de se solder par trois défaites ce soir, mais bon... cela n’a guère d’importance, tant que je m’amuse.
Demain, première journée du « temps fort » Plumes d’Afrique.
05:12 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 27 novembre 2025
27112025
J’ai publié aujourd’hui sur Facebook le paragraphe de La Force des choses (I, iv) ci-dessous, qui n’a suscité aucune réaction. J’avais fait exprès de ne rien en dire : seul le texte. Or, il est très intéressant, car tout en étant pleinement consciente de ne pas pouvoir adopter le point de vue des « indigènes » colonisés, Beauvoir les décrit sans se défaire d’un regard colonial piqué d’orientalisme. Elle pressent, lors de ce périple africain de 1950, certaines des analyses de Fanon, mais que n’avait-elle lu Du Bois… La dernière phrase semble illustrer si parfaitement la théorie de la double consciousness…
Le matin, une auto fournie par l’administrateur nous transporta dans la forêt. Nous vîmes sous un arbre le fétiche d’un village : une grosse boule hérissée de plumes très sales ; les femmes, vêtues d’un pagne, portaient en guise d’ornements des osselets d’ivoire incrustés dans leur menton (cela me rappela cette dent que j’avais extirpée un jour de mon menton) ; grandes, robustes, les cheveux enduits de beurre de cacao à l’odeur écœurante, deux d’entre elles pilaient des grains dans un mortier ; sur les marches d’un escalier (certaines des huttes, misérables, avaient deux étages) parmi d’autres enfants tout nus était assis un petit albinos ; sa peau décolorée ne paraissait pas naturelle ; on aurait dit qu’un acide l’avait décapée et qu’elle ne suffisait plus à le protéger. Nous étions tout près de la ville, et pourtant cette population semblait perdue au fond de brousses où le temps n’avait pas coulé. En repartant, nous avons croisé sur la route de jeunes garçons à bicyclette, vêtus à l’européenne, l’air vif, qui habitaient eux aussi ce hameau : en quelques années les enfants nus deviendraient des adolescents adaptés à ce siècle. Nous aurions bien voulu savoir comment les jeunes cyclistes vivaient cette double appartenance.
22:23 Publié dans 2025, Flèche inversée vers les carnétoiles | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 26 novembre 2025
26112025 (une phrase incompréhensible de Beauvoir)
Depuis quelques jours, j’ai repris – en parallèle d’autres lectures – les Mémoires de Simone de Beauvoir, et donc le troisième tome, La Force des choses. Il y a, page 1163 dans le Pléiade, une phrase que je ne comprends pas du tout et que je donne ici seule, car le contexte n’aide vraiment en rien :
Au soir, le commandant C. nous conduisit en jeep jusqu’au barrage du Niger, à travers une nature médiocrement boisée et sans beauté ; sur la route en latérite rouge, j’ai réalisé ce que j’avais entendu dire, sans trop y croire : une auto ne résiste à la tôle ondulée que si elle dépasse quatre-vingts kilomètres à l’heure, sinon les trépidations la brisent.
C’est la dernière partie de la phrase, celle après le deux-points, qui m’est inintelligible.
07:16 Publié dans 2025, Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 23 novembre 2025
23112025
Pas moyen de savoir pourquoi je me réveille au milieu de la nuit ; dans l’impossibilité de me rendormir, je finis par me lever à une heure acceptable car je n’ai pas beaucoup travaillé hier et il faut bien exécuter les innombrables bricoles qui n’en sont pas.
Lampe de bureau allumée, volet ouvert afin de voir les lampadaires s’allumer à leur tour (à 6 h du matin, le dimanche ? je ne sais plus) et le jour se lever…
Toutes ces histoires de deepfakes qui se multiplient, de guerre avec la Russie, l’abandon de toute tentative politique de lutter contre le changement climatique, la discussion avec C. N. hier qui pense que la campagne des municipales à Tours va être sale — cela n’aide pas, bien sûr…
Allez, au boulot.
04:36 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 22 novembre 2025
22112025
14:10 Publié dans 2025, Autoportraiture, Blême mêmoire, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 21 novembre 2025
21112025 (perméabilité de l'enseignement, de la recherche et de la radio)
Hier j’ai enregistré une émission (qui sera diffusée le 1er décembre) avec quatre des étudiantes de mon cours de deuxième année “Women Writers from the Caribbean”. Elles ont présenté chacune, en français, un texte tiré du syllabus mais pas étudié en cours.
C’est un cours que je donne depuis trois ans pour les étudiant·es de Double Licence ; le corpus est constitué de textes en anglais (Kincaid, entre autres) et en espagnol (Nancy Morejon notamment mais pas seulement). L’idée est qu’en espagnol les étudiant·es sont compétent·es, et pas le prof. Ce cours très ouvert, très démocratique, plaît beaucoup, il me semble, aux étudiant·es. Comme je ne suis pas stricto sensu spécialiste de la Caraïbe (mais un peu quand même, via le post-colonial et la question du plurilinguisme), c’est un cours qui est aussi peu dogmatique que possible.
Dès le début j’avais envisagé qu’une des notes (un oral bref en classe) puisse être remplacée par un podcast ou une participation à une émission de radio. Cela ne s’était pas encore fait. Ce semestre, grâce au fait que j’anime désormais ma propre émission, c’est plus facile à organiser. Levé tôt hier, j’ai pu jeter un œil à trois des 4 textes que les étudiantes ont présentés (elles m’ont confirmé leur choix hier après-midi) et je me suis essayé à les traduire en français. J’ai pu lire cet essai de traduction après chaque lecture.
Ces 3 poèmes se trouvent dans une anthologie bilingue que je ne me féliciterai jamais assez d’avoir mise au programme et fait découvrir à trois générations de L2 déjà. L’anthologie s’intitule The Sea Needs No Ornament.
Les étudiantes ont choisi les poèmes suivants :
* “La Cajita” de Gloriann Sacha Antonetty Lebrón
* “Snakes” de Jacqueline Bishop
* “History and Myth” de Shara McCallum
+ un poème de Nancy Morejon dans le recueil bilingue Mirar adentro (également dans la bibliographie de cours).
Les trois premières autrices, comme les trente autres de la géniale anthologie, ont toutes écrit des recueils, des romans... L’anthologie mériterait d’être traduite en français. Leurs livres aussi.
Enfin, j’espère que cette émission montrera que d’autres formes d’enseignement sont possibles, d’autres formes d’évaluation aussi. J’espère que le service chargé des FacLabs à l’université de Tours verra que des projets similaires voient le jour à la radio, grâce à la confiance et au matériel de Radio Campus Tours.
14:18 Publié dans 2025, ILMC, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 20 novembre 2025
20112025
Première nuit très écourtée depuis une bonne dizaine de jours, et juste le lendemain du jour où j’ai oublié de prendre le nouveau spray indiqué par ma doctoresse ; ça ne peut guère être une coïncidence. Cette sinusite chronique m’empoisonne (gentiment) la vie, mais s’il faut prendre ces gouttes tous les jours, eh bien on le fera.
(J’en profite pour noter que j’ai commencé à lire La force des choses il y a quelques jours, après m’être interrompu pendant une bonne année dans cette trilogie autobiographique ; Beauvoir écrit « doctoresse », donc j’y vais aussi.)
04:22 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 19 novembre 2025
19112025 (Pourquoi on ne “refait” jamais un cours)
Cette semaine j’assure le quatrième d’une série de cinq cours magistraux destinés aux étudiant·es de L1 LLCER Anglais. Le module s'appelle “Key Concepts: Introduction to Postcolonial Studies”. Comme j’ai remplacé une collègue qui devait l’assurer à ma place, et ce alors que le semestre avait commencé, les 10 séances d’une heure ont été condensées en cinq d’1 h 30 chacune.
Pour cette quatrième séance, les étudiant·es ont découvert le travail d’un écrivain et intellectuel majeur, le Kenyan Ngũgĩ wa Thiong’o, avec un accent particulier sur la question de l’écriture en langues africaines et la décolonialité.
Lorsque le cours a été mis en place en 2021-22, j’avais déjà assuré une des dix séances sur Ngũgĩ wa Thiong’o et je fonde donc le nouveau cours sur cette trame. Toutefois, entre-temps, Ngũgĩ wa Thiong’o est mort, ce qui implique certaines modifications factuelles.

Mon seul regret : comme c’est un cours magistral – je n’ai jamais aimé cela – il n’a pas été possible d’entrer profondément dans le texte de Decolonising the Mind. À peine ai-je pu commenter brièvement quelques paragraphes /phrases des sections III et VIII de la première partie.
22:30 Publié dans 2025, Affres extatiques, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 18 novembre 2025
18112025
Je viens de lire le chapitre que Kamil Naicker consacre à Crossbones dans son ouvrage récent Return to the Scene of the Crime. The Returnee Detective and Postcolonial Crime Fiction (Routledge / UKZN, 2023). Dès la première page, une erreur factuelle assez énorme, sur la date de publication de Links, me met la puce à l’oreille. L’article (car en fait, comme trop souvent, cet « ouvrage » est un recueil d’articles rapidement remaniés) n’est pas mauvais ; il est même stimulant par plusieurs côtés. Par contre, il démontre de façon quasi caricaturale que la tendance – devenue la norme – consistant à rassembler des analyses de cinq écrivain·es de trois continents différents sous un chapeau « post-colonial » ne produit rien de profondément rigoureux. Tenter de rendre compte de la façon dont Crossbones se joue des codes du roman policier sans lire l’ensemble de la trilogie dont le roman est extrait, et se priver autant des apports des anthropologues spécialistes de la Somalie que d’une réflexion sur les conflits entre plusieurs traditions islamiques, ça ne mène nulle part. L’auteur publie ce livre pour avancer dans la carrière, pas parce que son approche apporte quoi que ce soit de vraiment approfondi au champ dont il prétend parler ; d’ailleurs, la faiblesse du substrat théorique post-colonial montre que personne ne s’est vraiment soucié de relire ce chapitre avant de l’accepter pour publication.
Ce qui me semble particulièrement ironique, c’est qu’il n’y a jamais eu autant d’articles et de chapitres d’ouvrage consacrés à Farah, alors que son étoile s’est considérablement obscurcie et que, par exemple, ses livres ne sont plus guère traduits et ne font plus trop l’unanimité parmi les critiques et les lecteurices (j’ai déjà évoqué cela lorsque le Prix Nobel a été décerné à Gurnah en 2021). Toujours est-il que ça m’a quand même donné envie de relire toute la trilogie publiée entre 2003 et 2011. Je ne sais plus si je l’ai raconté, mais après la publication de Links (2003) et Knots (2007), j’avais parié – avec moi-même – que le troisième roman s’intitulerait Ties. (Raté !)
18:08 Publié dans 2025, Affres extatiques, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 17 novembre 2025
17112025 (LALA-Land)
Aujourd'hui, I Love Mes Cheveux inaugurait un cycle d’émissions autour des rencontres entre des classes de seconde de la région Centre et des traducteur·ices de romans. Mes invités étaient Julien Hairault, chargé de mission à CICLIC Centre Val de Loire, et Charles Devillard, professeur documentaliste au Lycée Grandmont de Tours.
Nous avons pu évoquer l’ensemble du dispositif LALA (Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui) et plus précisément la journée Lire.Ensemble : le grand rendez-vous organisé à Tours le mardi 25 novembre, avec la traductrice Chloé Billon et le traducteur Éric Boury.
Pendant toute l’année, trois classes de seconde (à Tours, Chinon et Vierzon) vont lire trois romans traduits du serbo-croate, de l’espagnol et de l’islandais, puis se réunir en jury afin de décider lequel des 3 sera lu en 2026-2027 par une vingtaine de classes des lycées généraux, agricoles et professionnels de l’académie. Les trois traducteur·ices rencontreront les trois classes au fur et à mesure de l’année.
Un projet qui sensibilise au rôle des traducteur·ices et à ce qu’est une œuvre littéraire contemporaine. Une émission très vivante. Et j’espère bien réussir à « coincer » Chloé Billon, Margot Nguyen-Béraud ou Eric Boury pour enregistrer une émission ; j’espère aussi faire une autre émission, en fin d’année scolaire, avec des élèves des trois classes pilote.
19:20 Publié dans 2025, ILMC | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 16 novembre 2025
16112025
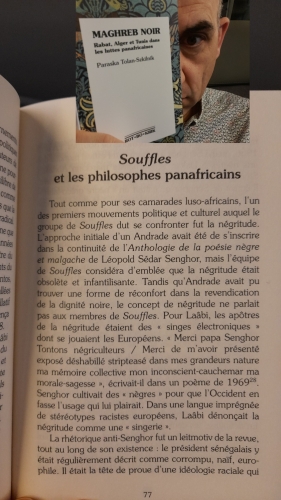
Dans le train pour Paris, 8 h 10.
08:10 Publié dans 2025, Autoportraiture, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 15 novembre 2025
15112025 (Patricia Mirallès, faussaire emblématique de la droite contemporaine)
Le quotidien Midi Libre a consacré un article à une polémique née d’une publication de l’ancienne ministre Patricia Mirallès sur les réseaux sociaux, notamment sur X, avec une image si évidemment générée par IA qu’elle comporte plusieurs erreurs hénaurmes.
Ce que l’article ne dit pas, toutefois, c’est que la citation attribuée à Genevoix est tout aussi étrange.
En effet, l’article ne signale pas que cette citation très douteuse (le -s à vivants m’a intrigué) ne provient absolument pas de Ceux de 14 (j'ai vérifié). Par contre, quand on cherche « ils sont restés parmi nous » entre guillemets sur Google, il y a 22 résultats : 22 posts de Patricia Miralles sur les réseaux sociaux. Je pense donc que cette citation est également apocryphe, totalement inventée par une IA aussi merdique qu’inutile et polluante (genre ChatGPT). Pour une figure politique nationale, utiliser l'IA, c'est normal ; ne pas voir que la carte est inepte et que le soldat n'est pas un poilu, n'en parlons pas ; quant à avoir lu un livre de Genevoix ou à faire autre chose que demander à une appli de merde de bidonner des citations, tout de même, on est de droite, on se respecte...
Et aussi : que les journalistes qui décryptent la double Bretagne n’aient même pas cherché cela en dit long aussi sur le niveau des “débunkeurs”.
10:52 Publié dans 2025, Chèvre, aucun risque, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 14 novembre 2025
14112025
22:55 Publié dans 2025, Chèvre, aucun risque | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 13 novembre 2025
13112025
Je dois diriger (entre autres bricoles) le mémoire de master d'une étudiante italienne en cotutelle. Elle travaille sur les questions de racisme, sexisme et LGBTphobie dans le contexte de l'interprétariat et de la traduction. Elle m'a envoyé de très longues vidéos de séances aux Nations-Unies : on peut écouter dans la langue d'origine ou via l'un des interprètes (anglais, russe, chinois). Dans un extrait que j'ai voulu transcrire pour voir si le module dictaphone du téléphone le faisait correctement, la phrase suivante
We must work to disarm and sideline Hamas which should no longer be a threat to Israel.
a été transcrite comme suit par le téléphone :
We must work to disarm and sideline hummus which should no longer be a threat to Israel.
14:01 Publié dans 2025, Chèvre, aucun risque, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 12 novembre 2025
12112025
Tout de même, la revanche, également sur le fil, n'a pas totalement effacé l'amertume d'avoir mené 59 à 1 à l'issue de la deuxième manche, et donc d'avoir été à un cheveu de mettre fin à la partie sur-le-champ, puis d'avoir été battu, coiffé sur le poteau même, pour ainsi dire, par 33 points marqués à l'issue d'un double koï-koï...
13:57 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 09 novembre 2025
09112025
Hier, pour la première fois depuis deux mois et demi, je pense, je n’ai pas du tout travaillé : pas de copies, pas de préparation de cours, pas de lectures professionnelles, pas écrit de parties d’articles etc. Comme c’est le week-end de mon anniversaire, comme A*et F* sont arrivés hier soir pour rester jusqu’à mardi, je ne vais pas avoir envie de m’enfermer toute la journée dans mon bureau non plus aujourd’hui et demain ; je vais au moins essayer de corriger le petit paquet de L1 et de rédiger l’évaluation d’article pour laquelle je suis déjà en retard.
Entre mardi et jeudi j’ai traduit les chapitres 8 et 9 de The Second Emancipation et je n’ai même pas écrit de billet dans les carnets de traduction.
08:05 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 08 novembre 2025
08112025
Depuis le temps qu’il fallait que j’enregistre une vidéo, avec la pile de livres à chroniquer pour le vlog qui grandissait, je l’ai fait, en oubliant plusieurs livres, tant il traîne partout, au salon, à la chambre. Avant la prochaine, je ne devrais pas attendre deux mois – et ce même si novembre s’annonce déjà assez infernal –, ne serait-ce que pour parler du livre de Maya Vitalia qu’elle m’a si gentiment envoyé il y a déjà un petit moment (à la fin de l’été).
Aujourd'hui, ma grand-mère paternelle (donc l'arrière-grand-mère paterno-paternelle d'A* et O*) aurait eu 111 ans.
23:18 Publié dans 2025, Autoportraiture, Flèche inversée vers les carnétoiles | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 07 novembre 2025
07112025 (Aujourd'hui, l’Iran ; demain l’Europe ?)
Je vous invite à lire cet article, qui date du mois d'août, en entier.
Les paragraphes que j’en ai extraits ci-dessous doivent nous inciter, d’une part à tenir compte de la situation particulière de l’Iran, mais d’autre part à ne pas nous dire qu’il s’agit d'une situation sans rapport avec la nôtre en France : les infrastructures de captation de l’eau qui provoquent un déséquilibre hydrologique généralisé, ce sont les mégabassines « comme chez nous » ; l’appauvrissement des sols par l’agriculture industrielle, c’est pareil ici ; la production agricole inadaptée et non respectueuse des ressources, on connaît ; la confiscation de l’eau par des grandes entreprises privées soucieuses de rentabilité à court terme, merci aussi...
Iran’s groundwater reserves, once a lifeline for farmers and cities, have been recklessly depleted. In many regions, wells now reach only dust. The land is sinking. Crops are failing. Entire villages have been abandoned. This isn’t just a natural drought.
For thousands of years, Iranians understood the balance: Never draw more from an aquifer than nature could replenish. That wisdom, once central to survival, has been buried under decades of short-term thinking and political negligence. What we’re witnessing now is the direct result of those choices. A system built on exploitation has quite literally run itself into the ground.
With groundwater depletion comes land subsidence. The spaces between soil particles, once filled with water, are now filled with air—and air can’t bear the weight of the layers above. As a result, compaction turns into collapse. That’s why so many cities in Iran today are sinking.
Although corruption lies at the heart of Iran’s water crisis, the problem goes far beyond dam contracts and insider deals. It’s also about how water is used, and wasted, every day. If the citizens of Cape Town, South Africa, managed to cut their daily water use to just 50 liters (about 13 gallons) per person to avoid Day Zero—the point at which a city’s taps would run dry and residents would need to queue for water rations—then why are residents of Tehran still consuming more than 250 liters per day—especially when water-intensive air conditioners dump tens of liters daily during the hottest months?
Cities such as Tehran have sprawled far beyond what local water sources can support. Overconsumption, leaky infrastructure, and unplanned urban growth have pushed the system to the brink.
Meanwhile, agriculture, the biggest water consumer, is stuck using outdated, inefficient methods. Flood irrigation, the cultivation of water-intensive crops such as sugar beet and rice in arid regions, and politically connected landowners have drained aquifers for profit rather than food security. To make matters worse, some research indicates that roughly 35 percent of agricultural products go to waste as a result of poor storage, weak distribution systems, and lack of planning. Instead of modernizing farming or managing demand, the state continues to look the other way.
While Iranians have long been experts at recharging aquifers and maintaining balance in the water table, the government continues to pour money into multimillion-dollar megaprojects that do the opposite. These projects, dams, diversions, and transfers end up killing rivers, draining lakes, drying out wetlands, and severing the natural connection between surface water and aquifers. Without that interaction, the aquifers die, too. What once sustained life is now being dismantled in the name of progress.
06:55 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 06 novembre 2025
06112025
4 h 50
J’en ai plus que marre de cette sinusite chronique qui dure depuis… deux ans ? je ne sais plus… des polypes que, d’après la spécialiste vue il y a deux ans, il n’est pas utile d’opérer, car trop peu conséquents. Désormais, j’ai le nez bouché en permanence, je me réveille trop tôt une nuit sur trois, ce matin avec une migraine que j’avais déjà hier depuis mes cours du milieu de l’après-midi (et que le paracétamol n’a pas calmée). Alors, certes, je réussis à travailler, je suis pas si fatigué que cela, mais je commence à en avoir assez. D’ailleurs, je vais voir ce soir mon médecin traitant (qui est excellente : je ne sais pas comment il faut féminiser « médecin traitant », la langue reste inexorablement sexiste pour les professions médicales) et le lui expliquer.
05:09 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 05 novembre 2025
05112025 (MGEN et Franc-Tireur)
Le 29 octobre j’ai alerté ma mutuelle de santé sur sa mise en avant de plusieurs figures de droite voire d’extrême-droite lors d’un événement consacré à la laïcité.
Un administrateur national, responsable de la région Centre Val de Loire et de l’Océan Indien (!), m'a répondu ceci :
Cher adhérent,
Vous nous interrogez sur la conférence du 16 janvier 2024 où sont intervenus pour MGEN plusieurs spécialistes, historiens et militants associatifs à propos de la laïcité.
Un certain nombre de manipulations et de contre-vérités circulent en ce moment à propos de cette conférence, aussi je vous remercie d’avoir attiré mon attention sur ce faux que vous joignez à votre message. En effet, la conférence intitulée « Servir la laïcité » n’a bénéficié ou n'a donné lieu à aucun partenariat et l’image que vous nous adressez avec le logo « Franc-Tireur » n’est pas une image MGEN ou qui a reçu une autorisation de MGEN. Par ailleurs, l’hebdomadaire n’est pas un partenaire de MGEN.
Lors de cette conférence sont intervenus :
- David Medioni, fondateur et rédacteur en chef de Ernest Mag ;
- Tristane Banon, autrice du livre Le péril Dieu ;
- Henri Peña-Ruiz, philosophe, auteur du Dictionnaire amoureux de la laïcité ;
- Michèle Vianes, co-fondatrice et présidente de l’ONG féministe reconnue au CES de l’ONU et de l’OIF « Regards de Femmes » ;
- Iannis Roder, professeur d’histoire-géographie, auteur de Préserver la laïcité, de La jeunesse française, l’Ecole et la République ou encore de Ecole et laïcité ;
- Raphaël Enthoven, philosophe, journaliste et essayiste ;
- Et également à part, le dessinateur JUL qui a fait des illustrations en direct pendant la conférence.
Cette conférence est née quelques mois après l’effroyable assassinat de l’enseignant Dominique Bernard. MGEN a souhaité l’organiser pour rappeler le lien inextricable qui unit la mutuelle au principe de laïcité depuis sa création en 1946 mais également son engagement auprès de celles et ceux qui le défendent.
Pour reprendre les mots de Matthias Savignac, président de MGEN, tout ce que nous avons défendu et défendons encore, l’accès à l’IVG, l’égalité entre les femmes et les hommes, l’émancipation des individus ou encore le droit à mourir dans la dignité, tout cela est combattu par les ennemis de la laïcité.
Les liens entre l’Ecole et la laïcité, entre la liberté et la laïcité, entre la République et la laïcité, font que nous nous engageons naturellement pour un dialogue sur ce principe qui nous apparaît capital pour cultiver l’altérité et le respect de chacun dans notre société.
Dans deux mois, la conférence « Servir la laïcité » aura deux ans. Alors que nous observons une recrudescence, en ce moment même, de fausses informations sur cette dernière, nous espérons que cela permettra à quiconque souhaite nourrir l’altérité, la curiosité et le débat, d’aller écouter les interventions disponibles en vidéos sur notre site.
Pour terminer, je tiens à préciser que MGEN ne pourrait être comptable des propos tenus par ces intervenants en dehors et, encore plus, postérieurement à cette conférence.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de nous écrire sur ce sujet qui, comme vous le voyez, est constitutif de notre manière de concevoir la Protection sociale pour toutes et tous.
Veuillez recevoir, Monsieur CINGAL, cher adhérent, l’expression de mes plus respectueuses salutations.
À quoi je viens de répondre ceci :
Monsieur,
merci pour cette réponse circonstanciée, qui confirme toutefois que des figures extrêmement problématiques, connues pour leurs écrits polémiques non argumentés voire manipulateurs sur le sujet (T. Banon, H.Ruiz-Peña, R. Enthoven) ont pu s'exprimer ce jour-là sans vraie contrepartie ou discours contradictoire. En un mot, vous avez organisé une conférence avec un ensemble des personnes qui confisquent toutes le concept de laïcité au profit d'un agenda politique qui n'a aucun rapport avec ce concept, en prenant pour prétexte l'assassinat horrible d'un de nos collègues. Vous comprenez donc que vos éclaircissements ne me rassurent guère. Je vous signale d'ailleurs que, contrairement à ce que vous écrivez, « l’accès à l’IVG, l’égalité entre les femmes et les hommes, l’émancipation des individus ou encore le droit à mourir dans la dignité » n'ont aucun rapport avec la laïcité.
Votre argument, selon lequel les ennemis de la laïcité (qui sont-ils ? comment les identifiez-vous ?) sont aussi les ennemis de ces quatre droits fondamentaux, est spécieux et porte un nom : sophisme. C'est un peu comme dire que les végétariens sont les ennemis des bouchers parce qu'ils ne mangent pas de viande. Une fois encore, je pense qu'il serait bon que vous organisiez des événements avec des vrais spécialistes (historiens, juristes ou sociologues) et pas avec des polémistes ou essayistes sans autres compétences avérées sur ces questions que d'avoir déjà leur rond-de-serviette dans les médias Bolloré.
Bien à vous, en espérant que la MGEN va promptement se ressaisir,
23:24 Publié dans 2025, Indignations | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 02 novembre 2025
Sans Barbara Bray, pas de “Vie matérielle” pour Deborah Levy
La traductrice se nomme Barbara Bray.
Plusieurs journalistes ou blogueuses qui rendent compte de leur lecture de La Vie matérielle de Duras en anglais, donc de Practicalities, ne mentionnent pas son nom. Je l’ai écrit plus tôt ce jour, ça m’a choqué que Deborah Levy, qui fait un tel foin de cette lecture, ou qui en fait tant son miel, Levy qu’on présente partout depuis quelque temps comme une grande féministe, Levy donc ne daigne pas nommer la traductrice, alors que sans la traductrice elle, Levy, serait visiblement incapable de lire ou de citer Duras.
Or, quand je relis cette demi-page, quand je la relis sans même me reporter au texte français de Duras, je reporte sur le « nous les femmes » de Levy un « nous les traductrices ». (Il y a une majorité de traductrices dans la profession, et l’invisibilisation de la pratique de traduction est aussi une pratique de marginalisation économique des femmes.)
Dans l’extrait ci-dessus de Things I Don’t Want to Know, remplacez Motherhood par translation, et tout suit.
It was becoming clear to me that translation was an institution fathered by masculine consciousness. This male consciousness was male unconsciousness. It needed its female partners who were also translators to stamp on her own desires and attend to his desires, and then to everyone else’s desires. We had a go at cancelling our own desires and found we had a talent for it. And we put a lot of our life’s energy into creating a home for our books and for our authors.
On n’a (je n’ai eu) besoin de remplacer que quatre mots, sur 84.
Bien entendu, ce report est un forçage. Je force le trait. Mais tout de même, je pose la question : que fait, au fond, Deborah Levy en se réclamant de Duras (en s’en drapant quasiment) tout en invisibilisant la traductrice, en invisibilisant le vrai travail féminin qui en anglais lui permet d’avoir accès à Duras ?
Et en allant plus loin, si on va lire la page en français, voici la phrase qui correspond aux deux phrases de Bray par lesquelles Levy achève sa citation :
Le lieu de l’utopie même c’est la maison créée par la femme, cette tentative à laquelle elle ne résiste pas, à savoir d’intéresser les siens non pas au bonheur mais à sa recherche comme si l’intérêt même de l’entreprise tournait autour de cette recherche elle-même, qu’il ne fallait pas en rejeter résolument la proposition du moment qu'elle était générale.
La phrase est longue.
Bray l’a coupée en deux, soit.
Levy ne cite qu’un petit bout, le début, de la deuxième phrase. Soit.
Ce faisant, Levy omet la partie que j’ai soulignée ci-dessus. Soit. (Ça permettrait peut-être de penser l’équilibre paradoxal qu’elle suggère sur le caractère à la fois implacable, ruthlessly, et bienveillant, kindly, de la déclaration de Duras. Mais soit.)
Sinon : « cette tentative à laquelle elle ne résiste pas » — les italiques sont dans le texte de La Vie matérielle. Bray n’a pas du tout traduit tentative, c’est-à-dire qu’en français la « maison créée par la femme » est une « tentative » (un essai presque). Il y a, dans la phrase suivante, le participe présent trying, mais il n’est pas relié à creates.
Bray a-t-elle traduit l’idée que la femme ne résiste pas à la tentative ? Comment l’a-t-elle traduit ?
She can’t help it – can’t help trying…
De l’absence de résistance à l’incapacité à réprimer une envie ou une tocade, il y a un pas. On peut faire mieux, sans doute, mais l’idée n’est pas ici de proposer une véritable critique en profondeur de la traduction de Barbara Bray (qui est globalement bonne d’ailleurs, j’en ai lu plusieurs pages) ; c’est bien de montrer que quand Levy invisibilise le travail de Bray, elle efface toute une partie de trajet qui va de Duras à son propre texte, tout comme elle efface une partie du paragraphe qu’elle cite (ça l’arrange).
Je le réaffirme donc : la traductrice de La Vie matérielle se nomme Barbara Bray.
Barbara Bray a traduit neuf autres livres de Duras, dont L’Amant. Elle a traduit deux livres de Pinget (ce qui s’explique notamment par le fait qu’elle était l’intime de Beckett), Ségou de Maryse Condé, L’avalée des avalés de Réjean Ducharme (quelle prouesse ce doit être !), Sollers, Tournier, Kristeva, et deux romans de Simone Schwarz-Bart : Pluie et vent sur Télumée Miracle (The Bridge of Beyond, 1975) et Ti Jean l’horizon (Between Two Worlds, 1992).
Entre autres.
Le catalogue de la British Library a pas moins de 125 items à son nom. Pascale Sardin, autrice d’une thèse importante sur l’auto-traduction chez Beckett, lui a consacré l’an dernier, à l’occasion du centenaire de sa mort, une biographie.
Il faut nommer les traductrices, il faut nommer Barbara Bray.
19:00 Publié dans 2025, Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)
02112025 (feuilles)
Sur la route, vent, pluie – ou plutôt averses ; un vrai temps de Toussaint. Des feuilles à ramasser en rentrant à Tours : un vrai temps de jour des morts. (Il paraît que c’est la journée nationale de la lecture au lit. Ce n’est pas possible, il doit y avoir une journée du macramé, de l’ornithorynque ou de la souris marsupiale.) Quand je ramasserai les feuilles, d’ici peu car la nuit ne tardera pas à tomber, je n’en tirerai pas d’allégorie bricolée, comme Deborah Levy.
Je n’ai pas emporté les deux premiers tomes de la trilogie autobiographique, lus à Cagnotte, mais, outre que j’aimerais bien désormais – malgré mes réserves – lire le troisième, j’ai noté que Levy cite abondamment Beauvoir et Duras (et notamment La vie matérielle, dont j’ai donc découvert le titre anglais, Practicalities) mais sans jamais citer le ou la traducteurice. Levy ne se soucie guère des personnes qu’elle juge marginales, sans importance, comme ces vil·es intermédiaires que sont les traducteurices ; peut-être est-elle plus marquée par le système classiste inégalitaire britannique, voire par son éducation sud-africaine, qu’elle ne semble le penser. En tout cas, les pages du premier tome sur sa nounou noire sont très belles et très lucides, mais aussi très gênantes par le paternalisme (inconscient ?) qui s’y insinue.
16:43 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)