dimanche, 23 février 2025
23022025 (Chœur infime - Billy-Ray-Belcourt, Dépaysage 2025)
Les éditions Dépaysage viennent de publier la traduction du premier roman d’un poète et professeur de creative writing appartenant à la nation crie d’Alberta, Billy-Ray Belcourt. Je n’avais pas entendu parler auparavant de cet écrivain, dont j’ai donc découvert l’œuvre en français canadien, grâce à la traduction de Mishka Lavigne et sous le titre français Chœur infime (2025) [A Minor Chorus (2022) – chœur en do mineur / chœur mineur].
J’ai énormément aimé ce livre, qui rejoint un certain nombre de mes préoccupations en matière de décolonialité, mais pas seulement. En effet, le roman prend la forme d’une enquête et d’un retour au pays pour un jeune doctorant qui interrompt sa thèse pour aller interroger et même, plutôt, écouter ses proches qui ont grandi dans la même réserve que lui : en ce sens, il s’agit d’un témoignage sur les discriminations et sur l’histoire complexe des communautés et des individus autochtones dans le Canada contemporain, mais, plus encore, il s’agit d’un journal de création tout au long duquel le narrateur tente d’inventer une forme et d’aborder, avec lucidité et espérance, le deuil de sa jeunesse et d’un certain nombre d’illusions. Une seule de mes attentes a été un peu déçue, car, si la quatrième de couverture présente l’auteur comme un « poète bispirituel de la Première Nation crie de Driftpile, en Alberta », sa réflexion porte plutôt conventionnellement sur l’homosexualité : même le terme de queer, plus eurocentré, est employé dans un sens assez restrictif. Il se trouve que la notion de two-spirit, qui est très particulière, permet habituellement de penser (et surtout de concevoir esthétiquement – c’est tout le propos de Billy-Ray Belcourt) la rupture avec l’hétéronormativité de façon novatrice : ici, à l'inverse d'un poème de 2018 très riche sur ce point, c’est sans doute codé ou implicite, et je pense même que c’est un choix de refuser l’anthropologisation d’un vécu intime personnel. [Intime : c’est l’importance politique de cette dimension qui rend si précieux le choix de l’adjectif infime dans le titre français.]
Si je commence par le dernier (onzième) chapitre, dans lequel le narrateur rend visite à son cousin Jack en prison, on y trouve ce qui est un des points d’aboutissement du genre de roman qu’il souhaite conceptualiser : « C’est notre devoir, ai-je pensé, de nous rebeller contre l’embellissement de la violence. J’ai tout de suite reconnu en cela la raison d’être du roman de la contre-culture. » (p. 183).
Ce qui m’intéresse, ici, c’est que cette notation intervient au terme d’une réflexion qui s’amorce par l’analogie « bizarre » entre roman et espace carcéral : « Bizarrement, je me suis mis à penser à la façon dont les romans présentaient parfois l’existence et les sentiments humains avec tant de précision qu’un personnage pouvait sembler emprisonné dans une structure sans agentivité. Ce n’était analogue à une prison d’aucune façon, mais dans mon esprit, on aurait dit que ça soulignait à quel point les gens normaux, les auteurices en fait, jouaient le rôle de gardiens de sécurité ou d’agents correctionnels sous les couverts de la littérature. » (pp. 181-2 – je vais aller piocher le texte anglais de la première phrase pour l’ajouter à ma réflexion sur Amma Darko). Il y a, dans cette esquisse d’analogie, la possibilité de structures romanesques normatives auxquelles s’opposent de contre-structures laissant les personnages libres de leur agentivité, sans doute un prolongement (inattendu, vu la figure que je m’apprête à convoquer) de l’opposition que faisait Ford Madox Ford entre nuvvle et novel. De fait, ça devient une conviction forte pour moi que les modernistes, même trèèès européens, ont aussi ouvert l’espace romanesque aux expérimentations de décentrement qui permettent aux personnages de dialoguer/dialogiser dans une structure réellement démocratique, voire anarchique. Justement, ce qui se passe dans les premiers romans de Darko relève assez de cela.
C’est là une réponse possible à la piste proposée dans le chapitre II : « Et si l’acte d’écrire un roman, me suis-je demandé, permettait de pratiquer un mode de vie qui réfutait les brutalités de la race, du genre, de l’hétéro et de l’homonormativité, du capital et de la propriété ? » (p. 39). Mieux, même, le texte même du livre met en pratique, de façon continuelle et discontinue, l’idée, énoncée plus tôt encore, au chapitre I, selon laquelle la prose (romanesque) et la théorie sont semblables en ce que « les deux nous demandent de refuser le romantisme du présent » (p. 23). L’ambivalence constante de la fonction du roman rejaillit sur l’écrivain : après sa rencontre avec sa grand-tante, la kokum de Jack, il remarque qu’il est « devenu l’écrivain de la famille, et, par le fait même, son historien, son coroner » (p. 69). Comme le confirme le glossaire, le coroner n’est pas n’importe quel enquêteur : c’est, dans la gradation ascendante que propose la phrase de Belcourt, un policier constitué historien de faits tragiques ou macabres. La tragédie, bien sûr, c’est celle de la racisation, c’est-à-dire tout d’abord l’histoire du vol des terres et du pouvoir même d’agir, puis la longue litanie des exactions, comme dans les tristement célèbres « pensionnats autochtones », qui font l’objet du magnifique chapitre VII. Cependant, l’invention d’un roman qui refuse d’embellir la violence implique aussi de frayer avec la langue coloniale qu’est l’anglais :
Mes propres angoisses au sujet du roman avaient à voir avec mon soupçon que l’anglais était une langue trop compromise pour engendrer un portrait de la vie autochtone qui ne fût pas imprégné des fantasmes coloniaux de notre délabrement. Peu de choses dans mon arsenal m’apparaissaient assez vastes pour combattre des siècles de lectures qui faisaient des peuples autochtones des bombes. Comment plutôt faire d’un roman une bombe ? Comment planter un roman dans l’infrastructure morale d’une nation corrompue ? Comment écrire des phrases qui font tic-tac, tic-tac ? (pp. 40-1 — et en recopiant ces phrases, je pense cette fois-ci à Patrice Nganang, tout m’y ramène).
En dépit d’un parti pris esthétique et narratif très différent, j’ai beaucoup pensé à ma lecture récente de Debra Dank (We Come with This Place, 2022 – texte fondamental des littératures aborigènes contemporaines), notamment au détour de ce propos que le narrateur attribue à sa tante Lena :
« Hmm, surtout pour nous, les Autochtones. Si n’importe quel·le Autochtone consignait sur papier les circonstances de sa vie, de l’enfance à la vieillesse, ça ferait un meilleur roman que n’importe quoi écrit par un gars blanc. Nous avons ri. Une femme s’est penchée vers nous comme pour participer à l’allégresse. » (p. 160)
Je clos ces notes en vrac sous deux aspects :
-
- en « cochant » les pages 116-122 et le très beau développement sur « la notion queer de la maternité », qui voit dans la « fonction maternelle » la capacité à faire émerger un nous collectif et à « s’en occuper comme un jardin
- en indiquant le motif de la terre et l’impératif de « se déterrer de soi » (p. 161 – reprenant p. 91, p. 112), que je développerai si j’ai le temps d’aller creuser dans le texte anglais
21:44 Publié dans 2025, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)


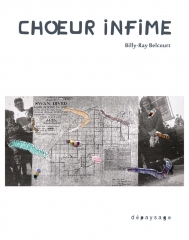
Les commentaires sont fermés.