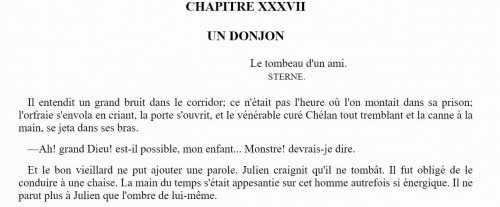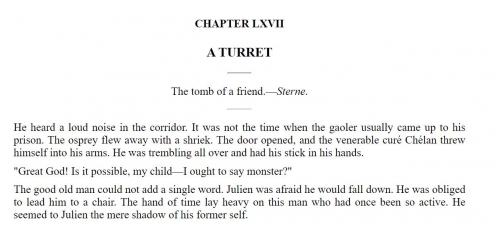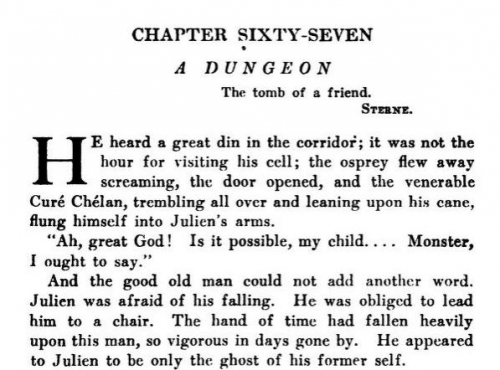samedi, 20 janvier 2024
The Promise
C’est le roman qui a valu à Galgut des torrents d’éloges – il n’est que de voir l’insupportable double rabat qui sert de couverture à cette édition de poche Vintage – et le Booker Prize 2021. Malgré les réserves que j’ai formulées, j’ai nettement préféré The Impostor, et je me dis à présent que c’est The Good Doctor qu’il faudrait lire, et – après en avoir parlé avec mon amie M*, qui est spécialiste des littératures sud-africaines, et de Galgut notamment – les premiers romans, car ce qui me retient (beaucoup) dans l’écriture de Galgut, c’est son côté trop maîtrisé, trop abouti, trop parfait en un sens. Il faudrait que je m’explique de ce « trop parfait ».
C’est donc un très bon roman, sans doute, si on s’en tient aux questions de maîtrise formelle et narrative : les changements de point de vue fréquents s’entrelacent de façon subtile à un point de vue omniscient ; le narrateur omniscient, quoique très discret, donne une forme de tonalité morale mais difficile à interpréter ; les notations ironiques succinctes, qu’il est difficile d’attribuer à tel personnage ou à la voix narrative, participent d’un portrait pessimiste de la société sud-africaine.
Mais… mais… mais…
Plus j’avançais dans la lecture, plus je trouvais les personnages factices, creux. La fameuse promesse du titre, dévoilée d’emblée, sert de fil conducteur – en fait, c’est cousu de fil blanc, jusqu’à sa fonction de décryptage des relations entre Blancs privilégiés de la société d’apartheid et Noirs victimes de ségrégation jusque dans les années 2000-2010. De plus, beaucoup de remarques misogynes émanent de la voix narrative principale (cf description, grossophobe pour tout arranger, de la notaire à la p. 280), sans compter un certain nombre de clichés sexistes qui servent d’astuces narratives (le dernier § sur la ménopause est totalement hallucinant pour un roman publié au 21e siècle – j'ai quasiment hurlé en lisant ça).
À force de vouloir dresser un portrait réaliste, sans fioritures de l'Afrique du Sud, le récit est d'un cynisme qui finit par rejoindre le discours suprémaciste blanc sur l'incompétence des Noirs. C’est ce qui m’avait déjà gêné dans The Impostor. Dans The Promise, les Noirs – catégorie homogène, fourre-tout – restent totalement marginalisés, sans voix dans le récit, et même ceux qui expriment une révolte sont ridiculisés, réduits au traumatisme de la prison, comme si l'argument de la confiscation du pouvoir économique par les Blancs était dérisoire : quand Lukas s’insurge contre la bienveillance paternaliste d’Amor, dans le dernier chapitre, je me suis dit que Galgut allait vraiment proposer ce point de vue à contre-courant du reste du roman… mais non… il choisit de raconter cet échange houleux du point de vue d’Amor, et donc d’en conclure que Lukas se trompe de colère et ne comprend pas qu’Amor est du bon côté.
Comme pour The Impostor, je n’ai pas cherché longtemps mais je m’étonne de ne pas trouver d’articles qui analysent ces traits néo-coloniaux qui usent de stéréotypes raciaux au lieu de les déconstruire.
11:36 Publié dans Affres extatiques, Lect(o)ures, Livres 2024, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 17 janvier 2024
Comment dire ce vers de Rimbaud ?
Réécoutant — via Ferré — un Rimbaud que je connais presque par cœur – via Ferré –, je m'aperçois qu'un vers est, sinon faux, du moins cacophonique. Il s'agit du vers 23 des “Assis” :
« Ouvrant lentement leurs omoplates, ô rage ! »
En effet, pour que ce soit un alexandrin, il faut bien faire la liaison omoplate-z-o-raj... et c'est ici que se trouve la cacophonie. D'ailleurs, Ferré, qui exprime toujours magnifiquement les subtilités de la versification (enjambements, diérèses, entre autres — pour les vers de 9 syllabes, allez écouter sa version du poème de Verlaine, “Il patinait merveilleusement”), ne conserve pas la liaison, ni dans la version enregistrée en album, ni dans les récitals. Il dit : “leurs omoplate — ô rage” (comme si c'était un singulier ou un pluriel amuï de chanson populaire).
L’excellent poète, romancier et traducteur Lionel-Édouard Martin a suggéré sur Facebook qu’il pouvait s’agir d’une erreur de copie sur l’exemplaire que l’on a, et qui est de la main de Verlaine. Comme la césure 5/7 est très rare chez Rimbaud, il est aisé d’imaginer le vers de Rimbaud comme suit :
En ouvrant lentement leur omoplate, ô rage !
dimanche, 03 septembre 2023
03092023 - le littéraire inintéresse
Cette nuit, en rentrant de la garden party de nos amis L* et A*, voyant qu’une ex-collègue (littéraire) avait commenté une de mes publications sur Facebook à propos de rugby en disant, en substance, qu’elle se sentait exclue car ça ne l’intéressait pas et que, parallèlement, mes 5 dernières publications à teneur littéraire depuis jeudi avaient été likées au mieux une fois (jamais par elle), et pas du tout commentées, j’ai affiché ceci :
Ce matin, je vois, sous cette publication, trois « likes », tous de contacts écrivain-es et/ou traductrices, ainsi qu’un commentaire d’un écrivain que j’admire beaucoup, qui m’a envoyé son nouveau texte en avant-première il y a une semaine (mais je lui avais dit que je n’aurais pas le temps tout de suite) et qui écrit : « Je me sens visé. » Je pense que c’est ironique ou facétieux mais je vais devoir lui écrire pour lui expliquer que ce n’était pas du tout la signification du message en question.
Toutefois, cette formule – le littéraire inintéresse – ferait un très bon titre de livre.
Il faudrait en parler avec mon amie E*, qui doit m’envoyer le tapuscrit de son livre (envoyé déjà à 3 éditeurs) depuis des mois, et à coup sûr, après promesse orale claire, depuis lundi.
08:18 Publié dans 2023, La Marquise marquée, Nathantipastoral (Z.), Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 23 août 2023
23082023 -- photos d'Alix (Roubaud) et usage d'Annie (Ernaux)
« Une photo peut être personnellement photographique tout en étant publiquement décente... n'est-ce pas ? »
Après avoir vu hier soir, au cinéma, Les Photos d'Alix, court-métrage de Jean Eustache dans lequel Alix Cléo Roubaud décrit ses photographies d'une manière de plus en fantaisiste et « discrépante », je n'arrivais pas à retrouver le titre du livre d'Annie Ernaux et Marc Marie que j'ai pourtant lu il y a moins d'un an (c'est sûr, c'était juste après le Nobel).
Ce livre, c'est L’usage de la photo, et il fait partie des ouvrages que j'ai empruntés, lus puis rendus sans les chroniquer dans la série je rends des livres. Ne pas réussir à retrouver le titre, alors que j'ai lu ce livre il y a moins d'un an et que je m'en souviens assez bien, qu'il m'a marqué en tout cas, c'est sans doute la confirmation de ce que dit mon épouse, que je lis trop et trop vite.
Pourquoi le film de Jean Eustache m'y a-t-il fait penser ? Pour une raison toute simple : une des photos qu'y décrit Alix Cléo Roubaud, au bénéfice de l'autre personnage, une sorte de vague sosie sonore du Jean-Pierre Léaud des années 70, représente une chambre, avec des chaussures abandonnées. Le personnage joué par Alix Cléo Roubaud explique qu'elle avait allumé une cigarette tout en faisant l'amour et que son partenaire le lui ayant reproché, elle avait alors dit « je peux même prendre une photo pendant qu'on fait l'amour ». D'où cette photo, qui m'a aussitôt évoqué le livre d'Annie Ernaux et du photographe Marc Marie, car l'origine du livre, ce sont les photos que M.M. prenait de la pièce où A.E. et lui venaient de faire l'amour. Annie Ernaux insiste beaucoup, dans le texte, sur les vêtements arrachés ou enlevés précipitamment, et plus encore sur les chaussures.
Le film de Jean Eustache date de 1980 (et je découvre que le comédien n'est autre que le fils du cinéaste, Boris Eustache). La liaison entre A.E. et M.M. a duré de 2003 à 2004, et le livre co-écrit a été publié en 2005. Je ne peux m'empêcher de penser que, dans le principe même de photographier les chambres après les ébats, en insistant autant sur les vêtements et les chaussures, il y a l'influence de cette scène du film de Jean Eustache, et ce d’autant que, selon les informations glanées sur le Web, Alix Roubaud avait eu une liaison amoureuse avec Jean Eustache dans les mois précédents, ce qui est aussi un des contextes cachés du film et de ses descriptions décalées.
08:34 Publié dans 2023, Chèvre, aucun risque, Questions, parenthèses, omissions, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 24 juillet 2023
24072023 - mais que lisait la grand-mère de Henry James ?
Et nous voici, le lendemain, et je n’ai pas écrit une ligne de plus. Qu’ai-je fait ? eh bien, j’ai glandouillé : lu des articles du Guardian, attendu de voir si le 5e et dernier jour du 4e test-match entre l’Angleterre et l’Australie allait reprendre, avancé dans le livre de Bill Bryson que je lis en parallèle du dernier Soyinka (expérience assez discontinue), préparé les cadeaux pour ma mère (c’est son anniversaire aujourd’hui – nous le fêterons demain avec elle), vaguement fait la sieste, relu en famille les journaux de voyage écrits par O* puis C* depuis 2014, téléversé sur Flickr les dernières photos et fait un peu de tri dans tout ça, regardé le dernier film de Dupieux à la télé… J’ai aussi préparé ma valise, dans laquelle je n’ai mis que cinq livres, je crois, et pas même celui que je dois commencer à traduire : je sais que je n’y toucherai pas, donc autant assumer les vacances.
 Hier, en regardant les photos du 19 (et donc d'Oxburgh Hall notamment), j’ai voulu vérifier ce qu’était A Small Boy and Others de Henry James, et il s’avère que c’est un de ses deux livres autobiographiques, écrit fort tard (1913, je crois). Mais combien a-t-il écrit ? J’ai l’impression d’avoir lu beaucoup de Henry James, pas loin de dix romans, les journaux de voyage, beaucoup de nouvelles, et je découvre encore des titres inconnus de moi… !
Hier, en regardant les photos du 19 (et donc d'Oxburgh Hall notamment), j’ai voulu vérifier ce qu’était A Small Boy and Others de Henry James, et il s’avère que c’est un de ses deux livres autobiographiques, écrit fort tard (1913, je crois). Mais combien a-t-il écrit ? J’ai l’impression d’avoir lu beaucoup de Henry James, pas loin de dix romans, les journaux de voyage, beaucoup de nouvelles, et je découvre encore des titres inconnus de moi… !
J’ai lu le premier chapitre de ce Small Boy and Others (le titre est vraiment étrange), et quand il parle des goûts littéraires de sa grand-mère, il ne parle que d’autrices dont il dit qu’elles sont oubliées, plus du tout lues. Voici la liste :
What she liked, dear gentle lady of many cares and anxieties, was the "fiction of the day," the novels, at that time promptly pirated, of Mrs. Trollope and Mrs. Gore, of Mrs. Marsh, Mrs. Hubback and the Misses Kavanagh and Aguilar, whose very names are forgotten now, but which used to drive her away to quiet corners whence her figure comes back to me bent forward on a table with the book held out at a distance and a tall single candle placed, apparently not at all to her discomfort, in that age of sparer and braver habits, straight between the page and her eyes.
Ce serait mal me connaître que de penser que je ne suis pas allé vérifier chacune de ces autrices grâce à Wikipédia (oui, j’avoue que je n’ai pas eu le courage de creuser sur la Britannica ni de me connecter à la base Oxford Reference), et j’ai notamment découvert que Mrs Trollope (1779-1863) était bien la mère d’Anthony Trollope (et que nombre de ses livres semblent encore d’un grand intérêt aujourd’hui, à commencer par Jonathan Jefferson Whitlaw, que WP présente comme le premier roman abolitionniste, ce qui me semble étrange) ; que Catherine Hubback (1818-1877), nièce de Jane Austen, a écrit dans l’ombre spectrale de sa tante (qu’elle n’a jamais connue), au point d’écrire son premier roman, The Younger Sister, à partir d’un synopsis de cette dernière et dans un style très imité aussi, autant que je puisse en juger après un survol, d’icelle ; que Grace Aguilar (1816-1847) est surtout connue pour ses poèmes et essais sur la religion et la tradition juives ; que Julia Kavanagh (1824-1877 – tiens, on fêtera le bicentenaire de sa naissance l’année prochaine), romancière irlandaise, a été suffisamment connue de son vivant pour que plusieurs de ses romans soient traduits en français, en allemand, en suédois, en italien, et que la critique contemporaine la redécouvre avec un intérêt prononcé pour les éléments protoféministes de ses romans (le Projet Gutenberg a peu de textes d’elle, et Internet Archive en a beaucoup, mais à chaque fois en 3 volumes dont l’ordre n’est pas indiqué dans la miniature, de sorte que c’est le bazar pour s’y retrouver).
Vous me direz que j’oublie Mrs Gore (Catherine, 1798-1861) et Mrs Marsh (Anne Marsh-Caldwell, 1791-1874 – tiens, on fêtera l’année prochaine le sesquicentennial de sa mort), mais assez pour aujourd’hui. Je noterai seulement qu’il est difficile de savoir si Henry James, hardly the feminist, décourage ici son lectorat de s’intéresser à ces écrivaines en les balayant d’un revers de la main, ou si le seul fait de les avoir énumérées permet à des olibrius dans mon genre de se dire : tiens, et si j’allais creuser un peu tout cela ? Les deux, évidemment.
À l’heure où les questions de canon et de postérité, d’invisibilisation et de marginalisation, occupent, heureusement, le centre des débats (et je recommande notamment la lecture d’Autrices invisibilisées de Julien Marsay ainsi que de suivre le compte Twitter), cette petite recherche m’a une fois encore montré que, même dans les Îles britanniques, qui ont toujours mis au premier plan Jane Austen, Mary Shelley, George Eliot, Elizabeth Gaskell, Christina Rossetti et Elizabeth Barrett Browning, il y a des foultitudes d’écrivaines marginalisées ou invisibilisées, comme l’excellente Mary Elizabeth Braddon dont j’ai lu plusieurs romans ces dernières années, ou encore Rhoda Broughton.
07:38 Publié dans 2023, Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 25 avril 2023
25042023
Retour à Tours. Pas beaucoup de courrier. Les six coronilles sont splendides, d’un jaune qui embaume, si je risque la synesthésie.
(Ces cinq derniers mots démontrent pourquoi je n’ai jamais pu écrire de livre : le prof qui fait son malin l’emporte toujours chez moi sur le poète. Et cette parenthèse même, je ne vous dis pas…)
________________________________
We never count our chickens before they are hatched, and we don’t count No.10 Downing Street before it is thatched.
Cette plaisanterie de l'ignoble Thatcher, la traductrice de la VOSTF de The Crown S4E1 a eu du mal à la restituer... mais on ne peut pas lui en vouloir... Quelques suggestions de ma part, all of which are awfully contrived :
(1) On a beau y croire dur comme fer, le 10 Downing Street ne sera à nous que quand s'y sera installée la Dame de Fer.
(2) On connaît bien le vers « Adieu veau, vaches, cochons, couvées... » Moi, je m'en tiens au réel, je m'appelle Margaret, pas Perrette.
(3) On peut toujours tchatcher, mais seuls comptent les faits : pas de tchatche mais Thatcher.
17:36 Publié dans 2023, Nathantipastoral (Z.), Questions, parenthèses, omissions, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 25 février 2023
Pineapple
Peut-être avais-je déjà « vu passer » ce tableau, ou plutôt une reproduction de ce tableau*. Je parle de reproduction, car outre la blagounette sur Twitter (cf ci-contre), je ne peux m’empêcher de trouver ce tableau réussi à tous égards sauf pour la représentation de l’ananas, justement. Or, le sujet est bien cet ananas : même si le roi en majesté ne doit pas se voir voler la vedette par un fruit, si exceptionnel soit-il sous les climats anglais, et encore moins par l’homme agenouillé qui le lui présente (et qui lui vole si peu la vedette que son identité est demeurée hypothétique), l’ananas est au centre du tableau.
Ce qui ne va pas, c’est qu’on ne le voit pas, cet ananas. Et peut-être est-ce justement dû à la qualité des reproductions sur le Web. J’en ai consulté une dizaine, et franchement sur toutes on devine l’ananas plus qu'on ne le voit. Il faudrait donc voir la toile « en vrai », pouvoir s’approcher, et, même sans s’approcher particulièrement, juger de cet ananas dans le contraste des couleurs. Il n’en demeure pas moins que le choix de placer l’offrande d’un fruit brunâtre devant la balustrade d’un gris ocreux n’était sans doute pas très judicieux. Imaginons que, même en trichant par rapport à la pose des sujets, le peintre ait choisi de placer le roi en haut des marches, et le jardinier deux ou trois marches plus bas, l’ananas se trouverait (à condition ne pas représenter le jet d’eau ?) devant l’allée blanchâtre, et ne pourrait que ressortir : n’est-ce pas ce qu’on demande à l’objet central d’une toile ?
Ou alors, le peintre aurait pu tricher et choisir des tons beaucoup plus clairs pour les deux balustrades et les deux statues. L’ironie est que la plante en pot située quelques centimètres plus bas sur le tableau, de forme ananasoïde, si j’ose le néologisme, est beaucoup plus visible que l’ananas, et que plus que je regarde ces reproductions, plus je me dis que, si le peintre était vraiment habile, il s’agit peut-être de la représentation d’une supercherie, avec ces huit jarres ananasoïdes entourant le jet d’eau, avec cette demeure difficile à identifier, avec ce petit chien dont la pose semble mimer celle du jardinier mais qui pourrait tout aussi bien pousser des jappements à l’encontre du monarque.
Il est impossible pour moi de finir ce billet sans donner en lien la chanson de mon (peut-être) groupe préféré, Sparks. À en croire les images choisies par l’auteur de la vidéo, il y aurait un Pineapple Rag de Scott Joplin, mais j’en ai assez vu et entendu pour aujourd’hui : trêve d’ananas.
* Ce billet n’existerait pas sans le visionnage, hier soir, d’un épisode de la 12e et dernière saison de The Big Bang Theory, dans lequel Sheldon Cooper est tout content de pouvoir placer l’anecdote sur le portrait de Charles II avec un ananas. La citation exacte (retrouvée sur le site officiel de la série) est : « Now, I'm not sure if this helps, but did you know that pineapples were once so rare that King Charles posed for a portrait with one? » Je n’ai pas le courage de retrouver le passage précis, mais il me semble que dans les sous-titres King Charles a été traduit par Charles Ier.
09:24 Publié dans Autres gammes, BoozArtz, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 02 décembre 2020
{brie}
Avant-avant-avant-avant-avant-avant-avant-avant-avant-avant-avant-avant-avant-avant-avant-avant-avant-avant-avant-hier j'ai fêté quarante-six brie. Un fromage qu'on ne mange que rarement, on en a quand même mangé une fois par an en moyenne quand arrive le début de la 47e année, non ?
(Il paraît que Jaenada est le roi de la parenthèse.)
07:30 Publié dans Balayages, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 27 mars 2020
Résilience et demande de conseils de lectures
Viens d'écouter le discours lèche-pompes et faux-derche de notre inénarrable ministre.
J'ai une question pour les personnes qui s'y connaissent vraiment.
En effet, je n'ai aucune connaissance réelle au sujet du concept de résilience, et à chaque fois que j'entends employer ce concept j'ai l'impression d'une manipulation rhétorique de première ampleur. J'ai l'impression que, quand quelqu'un (en particulier un responsable politique de droite) évoque ce concept, c'est pour nous dire : ça fait des années qu'on a tout bousillé, qu'on a sacrifié l'éducation et la santé, qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour la transition énergétique, qu'on a tout vendu au profit des actionnaires au lieu d'investir dans l'avenir du pays, mais bon voilà, les pauvres vont se bouger le train et assurer face à la crise, et les fonctionnaires vont encore faire plein d'heures bénévolement afin que ça ne soit pas trop le merdier.
Quand c'est Blanquer qui parle, je suis à peu près sûr de mon analyse. En revanche, j'aimerais savoir si :
a) le concept de résilience est lui-même porteur de cette dépolitisation de façade
b) à rebours du a) il s'agit là d'un dévoiement du concept
c) quels articles ou livres vous me conseilleriez pour m'informer mieux sur ce concept et ses éventuelles dé/constructions
J'ai dit plus haut que je voulais de vrais conseils de lecture, pas des trucs pétés du genre entretien avec Cyrulnik dans le Nouvel Obs ou mème trop rigolo d'un pote à Yann Barthès.
15:29 Publié dans Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (2)
mardi, 24 mars 2020
Des cris d'orfraie sur le tombeau d'un ami
Suite au visionnage de la dernière vidéo d'Azélie Fayolle (qui m'a donné envie de relire enfin Stendhal (mais est-ce que cela adviendra ?)), je signale tout d'abord qu'à ce stade je n'ai pas retrouvé la trace de la citation attribuée à Sterne par Stendhal dans les deux textes principaux de Sterne lui-même, ni dans des sources secondaires. L'enquête a duré dix minutes, autant dire que je n'ai pas forcé.
La question reste posée : où, dans Sterne, pourrait-on trouver une formule telle que Stendhal la traduise par « Le tombeau d'un ami » ? Il y a deux passages dans Tristram Shandy qui peuvent suggérer cela, mais pas texto. Sans doute est-ce, comme le dit Azélie, une épigraphe fausse...
J'en profite, au détour de mon enquête, pour vous donner à étudier le début du chapitre XXXVII de la Seconde Partie, en français et dans deux traductions.
Horace B. Samuel (1916)
C.K. Scott-Moncrieff (1922)
Je ne commenterai ici que la traduction d'orfraie, ce mot que l'on n'emploie plus guère en français que dans l'expression pousser des cris d'orfraie (et encore...). Le terme d'orfraie n'est plus utilisé par les ornithologues depuis fort longtemps, et la principale référence en ce sens est Buffon, qui l'a utilisé pour décrire le pygargue. D'autres auteurs ont utilisé ce mot comme une sorte de mot fourre-tout plus ou moins synonyme d'aigle, et parfois pour parler du Balbuzard pêcheur (comme chez Michelet dans le tome 1 de son Histoire romaine).
Le TLFi, toujours précieux, précise qu'il s'agit bien d'un « oiseau de proie diurne » mais que le nom est très souvent employé pour désigner une chouette, par confusion avec effraie. Ainsi d'ailleurs dans l'expression pousser des cris d'orfraie.
Les deux traducteurs de Stendhal ont choisi d'identifier l'orfraie du donjon comme un balbuzard (osprey). Pourtant, voici ce qu'on lit quelques paragraphes plus haut : « Ses remords l'occupaient beaucoup et lui présentaient souvent l'image de Mme de Rênal, surtout pendant le silence des nuits troublé seulement, dans ce donjon élevé, par le chant de l'orfraie! » (II, xxxvi). Cela démontre qu'il s'agit bien d'un rapace nocturne, et donc, de toute évidence, d'une confusion avec l'effraie. Les deux traducteurs ont d'ailleurs traduit cette première occurrence par osprey, en bonne logique “interne” ou intra-textuelle.
Toutefois, si, pour un lecteur français, le terme vague autorise la compréhension par une confusion semblable à celle de l'auteur (le lecteur français lit orfraie mais peut tout à fait imaginer une chouette), les anglophones, globalement plus versés que les Français en ornithologie, n'y comprendront rien. Un certain nombre d'entre eux, en tout cas, tiqueront passablement en lisant ceci : “the silence of the night, which in this high turret was only disturbed by the song of the osprey” (Samuel, 1916).
Il faut donc, en ayant raison contre la littéralité stendhalienne, traduire orfraie par owl.
mercredi, 18 mars 2020
Ça c'est fait, babe
Le PC de bureau n'a pas planté (encore).
Hier, premier jour de confinement. Une belle attente à la boulangerie, pour acheter un peu ce qu'il restait. À la Poste, le matin, avant le début du confinement, C*** n'a pas pu expédier son envoi recommandé avec avis de réception.
Le préfet Lallement, qui devrait être démis depuis des mois, a pavané sur sa capacité bien connue à faire respecter les arrêtés de confinement.
Les Parisiens qui le peuvent quittent la capitale.
Hier soir, Blow Out, pas vu depuis que j'avais l'âge d'A***, peu ou prou. Un peu déçu, mais cela reste un grand film sur le cinéma, belle métaphore, pas appuyée, avec des séquences génialement filmées.
C*** a suggéré avant qu'on se couche que chacun de nous quatre tienne son journal du confinement. De mon côté, ça c'est fait babe, pour citer le dernier Murat.
Agnès Buzyn a donné un entretien à je ne sais plus quel journal. Si elle y dit la vérité, les propos qu'elle y tient devraient lui valoir la prison, et valoir au gouvernement la démission et la honte éternelle.
Ce fut pour rester dans le monde.
Hier soir, j'ai débranché la multiprise où sont branchés les deux PC de bureau, les lampes etc. ; peut-être est-ce pour cela que, mieux dispos, mon PC de bureau ne plante pas (encore).
Hier j'ai même inventé un exercice en partie d'invention pour qu'O*** (qui a commencé à avoir du travail via Pronote et le CNED) révise ses verbes irréguliers ; il s'en est très bien sorti, alors que je craignais qu'il ait du mal à trouver des idées pour finir les phrases.
Ma grand-mère, qui aura 93 ans dans six jours, a écrit pour remercier d'une vidéo et d'un mail envoyés dimanche. J'espère qu'elle va tenir le coup. Elle a de la ressource comme on dit maintenant, mais ce n'est vraiment facile pour personne.
Annulé le dîner chez L° et A° samedi soir à Fondettes. Annulé le séjour, ici, de notre ami C°, qui devait venir dans dix jours. Déplacé, à la demande de la kiné elle-même qui voit se multiplier les annulations, le rendez-vous de jeudi.
Rangé mon bureau, mais aujourd'hui je veux trier un peu dans les clés USB. Si pas trop crevé, enregistrer une première vidéo de la série je range mon bureau. Il y a 18 livres sur la pile. Ce confinement, s'il dure au-delà des 15 jours annoncés par Macron lundi soir, devrait me permettre de relancer le Projet Pinget (honte à moi). Et boucler les 29 CONTEMPORAINES en réglant leur compte aux 8 qui restent (plus facile, ça).
Pour le travail, hier, enregistré et monté à la buanderie (où j'ai eu peur ensuite de m'être enrhumé) la première vidéo d'une nouvelle série destinée aux étudiant·es, Cours confinés.
Il y aurait aussi à reprendre tant de chantiers, les limericks par exemple, tiens, même si “Montboudif lui dit plus trop” ; ne pas se disperser, pourtant...
Scènes de ruées dans les commerces et images de rayons vides : ça continue. Tant et si bien que C* et moi nous interrogeons sur la meilleure stratégie : gros “drive” d'ici trois ou quatre jours une fois que l'orage sera passé, ou alors un tour à Naturéo demain et un autre à Leader price vendredi, avant de compléter avec un petit “drive” ? Dimanche, C*** avait calculé que nous avions 17 repas “devant nous”, sans compter certaines conserves familiales (confits etc.). Pas d'urgence, donc.
Ce billet, trop long, vais-je le prolonger dans la journée ? — On ne sait.
dimanche, 09 février 2020
Pokot / Spoor / Tableau de chasse
Regardé ce soir ce film magnifique, qui a le seul défaut, peut-être, de proposer une résolution finale des meurtres, quand on (je, en tout cas) aurait pu préférer le maintien de l'incertitude fantastique. En tout cas, film splendide, qui donne à voir, et à réfléchir aussi, bien sûr, sur le spécisme, les "traditions", l'animalité, la vie sauvage.
Pokot est un film coécrit par Olga Tokarczuk, d'après un des livres d'elle que je n'ai pas lus (j'en ai lu trois, dont le pavé des Livres de Jakob, à l'automne*). On y retrouve sa fascination pour des modes de vie singuliers, et surtout pour des époques, je dirais même des temporalités, en rupture avec la nôtre.
La scène finale met en scène une forme de communauté utopique heureuse, tout en proposant une nouvelle énigme, plus profonde sans doute que l'élucidation de l'énigme policière.
* Je m'aperçois, en tenant ces carnets de façon quotidienne, que je m'offre à moi-même ces respirations indispensables, notations qui finissent par faire archive. Je le fais d'autant plus volontiers que plus personne ne me lit.
23:21 Publié dans *2020*, Questions, parenthèses, omissions, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 18 janvier 2020
Questions, toujours
Tôt le matin, j'ai évacué une partie du travail (mails professionnels). Mais le plus long reste à faire : refaire le corrigé du concours blanc (le document est dans l'ordinateur de l'université et j'ai oublié de m'en envoyer une copie (or, le site est bloqué (et, apparemment, carrément fermé administrativement la semaine prochaine))), préparer des documents à mettre en ligne pour le cours de L3, essayer de contacter tou·tes les étudiant·es d'échange dont je suis responsable afin de leur donner rendez-vous avant mon cours déplacé à Fromont, histoire que ce créneau serve à quelque chose.
Ce week-end, il faut que j'avance dans mes lectures : depuis deux jours, trop de réseaux sociaux et de glandouille. Il y a aussi une sacrée pile que je devrais écluser dans une vidéo. Irai-je au Salon des Lycéens ? Et comment se remettre à Pinget ?
Tant que je n'ai pas de soucis plus graves...
Hier, l'IRM, c'était comme se trouver dans la sono d'une technoparade, mais avec un casque anti-bruit, heureusement. Pas de résultats avant la semaine prochaine ; je ne sais pas quand prendre rendez-vous avec ma toubib.
06:34 Publié dans *2020*, Questions, parenthèses, omissions, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 09 janvier 2020
Battre le pavé
Aujourd'hui, journée de grève et surtout de manifestation. Je vais enfin pouvoir battre le pavé, après avoir raté les précédentes pour cause d'arrêt maladie et de lombalgie. Même si la lombalgie/tendinite qui me diminue sérieusement depuis bientôt neuf mois me taraude, je manifesterai aujourd'hui.
Hier soir, avant d'éteindre la lampe, je lisais les premières pages du Journal 1943-48 de Sandor Marai, traduit par Catherine Fay. Le livre est resté dans la chambre, et j'écris ces pages dans le bureau, mais il y évoque à un moment donné le fait de continuer à écrire au milieu des bombardements et de la menace d'une destruction totale de Budapest : cela m'a évoqué toutes ces fois où je me demande pourquoi je continue à lire, à travailler, à écrire, alors que la catastrophe de partout nous entoure. Et pourtant je continue.
05:22 Publié dans *2020*, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 01 juillet 2019
En douze parties
Depuis quelque temps, je me lève, le matin, pour découvrir une grande ride verticale sur la joue gauche, que j'ai d'abord attribuée à une trace d'oreiller, embarrassante, mais dont je pense désormais qu'il s'agit bel et bien d'une ride. Comme mon père, mais surtout comme ma grand-mère paternelle, je vais donc me rider de façon verticale : c'est bien maladroit, comme formule, mais je n'en trouve pas d'autre.
Le 6 juin dernier, pour les 14 ans de ce blog, j'ai failli lancer tout un nouveau projet. J'ai bien fait de ne rien en faire, car, happé par le maelström du mois de juin et aussi par le découragement de voir que tout cela, encore et toujours, n'aboutit à rien, je n'ai pas écrit un billet ni publié de vidéo de tout le mois de juin. Il me sera impossible de laisser tout en plan, donc je vais poursuivre, mais plus conscient de l'absurdité de tout cela et plus amer que jamais.
En attendant, je vais procéder à quelques archivages rétrospectifs.
Juillet commence, après tout.
07:29 Publié dans Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 11 mars 2019
Les chats & les chiens de Clonck
Pour traduire le chapitre 66, cette idée qu’on pourrait traduire « pluies torrentielles » par raining cats and dogs, qu’aucun anglophone n’emploie vraiment, ou – en tout cas – sérieusement. Et, dans la foulée, cette idée qu’il serait possible de garder cette idée de traduction, mais implicite, de sorte que Clonck’s Glitches pourrait finir par décrire un autre univers, parallèle à l’univers déjà parallèle de Clonck et ses dysfonctionnements.
Rue Fontestit. Les arbres ont tant enflé qu’ils éclatent un à un ; peut-être en raison d’un dysfonctionnement, mais il se peut que les pluies torrentielles soient la cause du problème.
Fontestit Street. The trees have swollen so much that they burst one after the other–possibly due to a glitch, but who knows if cats and dogs are not to blame.
Il y aurait donc une infinité de textes dépliables : la traduction de Clonck au sens classique du terme, et les différentes dystranslations de Clonck.
08:27 Publié dans Questions, parenthèses, omissions, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 13 octobre 2018
Projets / chantiers
Il faudrait, il faudrait...
Tant de projets en l'air qui viennent s'ajouter aux chantiers.
Et tout ça face à quoi : cette après-midi, nous allons participer à la seconde Marche pour le climat, après celle de septembre, déterminés, mais si désemparés à la fois. Je me rappelle avoir passé toute mon adolescence à être tiraillé entre la noirceur de tout ce qui se produisait d'atroce en matière de saccage des ressources naturelles et l'aspiration à quelque chose d'autre — l'art, on dira, pour faire vite. Mais l'art n'est-il pas une manière de se dérober ?
Il n'en demeure pas moins que je suis embringué dans des projets et des chantiers, et que, tout en cherchant à faire de mon mieux à ma modeste échelle pour que « ça aille mieux » (ou que le pire scénario en matière de réchauffement climatique soit évité), ça n'aurait pas grand sens non plus de ne rien faire d'autre.
Donc, les chantiers : les vidéos, bien entendu — et, le 13 novembre, une communication à Lyon sur ce que produisent et/ou ont produit jusqu'ici mes improvisations de traductions.
Les projets.
Il me faut reprendre l'écriture, car l'expression sous forme de vidéo, pour pratique et irremplaçable qu'elle est, ne peut entièrement se substituer au travail en profondeur, au travail de creusement que suppose l'écriture. À court terme, il faudrait que je me mette enfin à la tâche pour écrire un article, ici, un billet de blog donc, sur Empreintes de crabe. Le problème, c'est que, pour bien faire, je souhaiterais y associer une réflexion sur l'ensemble de la trilogie, donc aussi Mont Plaisant et La saison des prunes.
Régulièrement, je me dis qu'il suffit, pour l'écriture dans les blogs, de me forcer à écrire chaque jour un texte, même bref, dans n'importe laquelle des dizaines et des dizaines de rubriques de celui-ci ou de celui-là. Mais ça ne marche pas comme ça, ça n'a jamais marché comme ça.
Il y a quelques jours, lors d'un échange avec Pierre Barrault, je me suis rendu compte — c'est lui qui me l'a soufflé — que le nom des éditions Louise Bottu, dans les Landes, venait du nom de la poétesse dans Monsieur Songe. Quelle honte, de ne pas m'en être aperçu. Ainsi, l'idée qui me trottait dans la tête, de reprendre tout Pinget et de tenir la chronique de cette réappropriation, ne serait pas chimérique.
Et traduire...
Oh la la...
09:53 Publié dans Amazone, été arlequin, Pynchoniana, Questions, parenthèses, omissions, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 07 septembre 2018
7 septembre 2018 : pas d'accord
Après l'accent circonflexe (défendu à longueur de commentaires Facebook il y a 3 ans par des gens qui faisaient 6 fautes de conjugaison en 3 lignes), après la réforme du collège pourfendue « car sans latin on ne peut plus comprendre notre culture » (nota : quand j'étais collégien, au début des années 80, 80% des collégiens ne faisaient pas de latin, et la majorité de ceux qui en faisaient n'en tiraient à peu près aucun surplus culturel), l'intelligentsia franco-française s'est trouvée un nouveau combat d'arrière-garde, une nouvelle croisade pour gens figés sans compréhension de ce qu'est une langue, bref, une nouvelle guerre picrocholine de grand-boutiens et de petit-boutiens : l'accord du participe passé.
Sans moi, hein.
(Nota : une faute d'accord s'est glissée dans ce texte. Sauras-tu la débusquer ?)
10:43 Publié dans Amazone, été arlequin, Indignations, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (1)
mercredi, 26 avril 2017
Pause (ou pas)
Depuis plusieurs mois, je manque de ressort, un peu pour tout d'ailleurs : tâches professionnelles et chantiers personnels. Désespoir, désarroi, sentiment d'impuissance face au naufrage de nos sociétés : accélération constante de la destruction de la planète et aggravation des attaques contre la démocratie.
Il n'y a pas eu de décision d'arrêter d'écrire, ou même d'arrêter les vidéos. J'ai arrêté, voilà tout.
Incapacité totale à m'y mettre ou à m'y remettre dans un tel isolement.
08:12 Publié dans Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 25 mars 2017
3699, ou tout autre nombre
François Bon s'est rendu récemment dans deux villes que je connais bien, l'une pour y avoir longtemps été élève (Dax), l'autre pour y avoir vécu six ans (Beauvais). De la seconde, il a rapporté un film très émouvant. Ce film m'a donné l'idée, au détour d'un commentaire (cf infra), d'écrire, par petites touches, un texte sur Beauvais. Quoi que, dans l'idée de départ, il y ait un rapport avec cette histoire de mêmoire autour de laquelle je tourne depuis plus de dix ans, je refuse en fait de circonscrire le propos : ce sera un texte sur Beauvais. Et surtout, je vais tenter de l'écrire sans le publier au fur et à mesure dans un des blogs.
__________________________________________________
La musique d'Arve Hendriksen est très sinueuse, prenante, défile comme le paysage. Parties de foot, cabanons, nuages lourds et blancs au-dessus des labours... Beauvais, tant de souvenirs... six ans, si peu écrit... si peu écrit dont j'aie gardé de vraies traces, surtout... (Et si j'écrivais un texte genre Trois-mille six-cent quatre-vingt-dix neuf choses que je peux dire de Beauvais ?) Me rappelle comment je prenais le train pour Paris à 5 h 07 le matin en gare de Beauvais — par une distorsion lynchienne tu eusses pu me filmer la nuit dernière. Le cinéma n'existait pas, pas à cet endroit-là, pas que je me souvienne. Donc ton film involontaire, pourquoi ne me captera-t-il pas ? La cathédrale et les galeries nationales de la Tapisserie, tant de souvenirs. “Lieux ingrats”, je ne suis pas forcément d'accord. (En fait, j'adore l'intérieur des Galeries. Énorme émotion de revoir ça dans ton film.) Blues autour du zinc, je n'y traînais pas trop ; les autres festivals, oui ; ville très dynamique ; magnifique médiathèque. Dans la partie accélérée on voit les personnes (personnages) à l'étage de la gare qui s'activent, vibrionnent, « et les mots trop pauvres qu'on [leur] impose comme un masque ».
jeudi, 16 février 2017
La douceur
Bien entendu, la douceur n'explique pas tout.
Ni la douceur d'un visage, ni la douceur du temps.
D'ailleurs, depuis le temps que je commence des textes ou des mails par bien entendu, j'aurais dû finir par devenir sourd. Déverser des phrases sur un écran, c'est bien commode.
Et depuis le temps que je commence des paragraphes par d'ailleurs, n'en parlons pas, s'il vous plaît, rompons les structures, n'en parlons pas. Presque toutes les rubriques ont fini par sombrer, ou plutôt par tomber en friche. C'est curieux, cela : tomber en friche.
Et d'ailleurs n'en parlons pas.
07:43 Publié dans Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 13 février 2017
Suffire
Tout de même, irai-je plus loin ?
Je pense ne plus pouvoir mieux que ressasser, je songe à faire mieux que ça. Mais le pouvoir ?
Même les bilans — je n'y parviens pas.
Face à l'écran des heures chaque jour pour le boulot, alors le pouvoir, tu parles...
Il suffirait de posséder la puissance. Cette suffisance-là n'est tout simplement pas à portée de main.
08:10 Publié dans Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 30 janvier 2017
Trump, ou le leurre de la dispersion
Je parle très peu, ici — contraste avec mon activité ailleurs —, de l'administration Trump.
Je vois passer depuis deux ou trois jours quelques articles sur telle ou telle hypothétique destitution de Trump, pour telle ou telle raison (le 25e amendement, par exemple), ou sur le fait que les patrons des grands groupes de la Silicon Valley feraient part de leurs inquiétudes.
Tout cela, c'est un rideau de fumée pour que la société civile se disperse. Pendant que les patrons des grands groupes font semblant de se désolidariser (haha, Zuckerberg et le patron d'Uber qui font semblant d'être choqués par le décret sur l'immigration, quelle comédie) ou que la “presse” (Yahoo !)* balancent ce genre de choses, les citoyens sont incités à se bercer d'illusions.
Je m'interdis totalement de relayer ce genre de château en Espagne : il faut relayer les vraies infos concernant les décisions antidémocratiques de l'administration Trump (comme le font de nombreux internautes américains et comme l'a notamment fait mon amie Valérie en traduisant la liste des décisions et déclarations antidémocratiques de la première semaine de pouvoir), et les vraies mobilisations populaires ou institutionnelles contre les dites décisions : manifestations dans les aéroports, discours très fort du gouverneur de Washington, mise en œuvre d'une mobilisation des scientifiques américains et du monde entier, etc.
* Au demeurant, every cloud has a silver lining** : l'article de Yahoo! News rappelle que la procédure d'impeachment est réservée aux méfaits commis par un Président au cours de son mandat (“investigating if a president acted illegally while in office”), donc ceux qui parlent d'impeachment pour toutes les casseroles antérieures du Twittler-In-Chief peuvent se mobiliser sur quelque chose d'un peu plus consistant.
** Tout n'est pas tout noir, ni tout blanc. [?] — Je laisse filer ; ceci n'est pas un billet de traductologie.
09:29 Publié dans Indignations, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 25 janvier 2017
Les 500.000 de la Dégomme (quintil épigrammatique)
Peut-être fallait-il, Pénélope,
Pour te voir, à l’Assemblée
Ou encore à Sablé,
Amasser le blé,
Être quelque peu nyctalope ?
09:04 Publié dans Aphorismes (Ex-exabrupto), Indignations, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (1)
dimanche, 15 janvier 2017
ǝésɹǝʌuı ǝɥɔèןɟ
Tellement corrigé de copies, de TP etc., encore depuis trois jours que je suis à peu près incapable de faire un travail sérieux, un peu soutenu, d'écriture par exemple. En effet, l'écriture dans ces carnets verts ou gris me demande un peu d'énergie qui n'ait pas été préalablement consommée par tâches administratives ou ingrates à haute dose. 2017 ne commence pas si bien que ça, alors. En tout cas, je maugrée. C'est plutôt bon signe : vient toujours, régulièrement, un moment où je maugrée.
Dans les carnets gris je tente de reprendre un peu le chantier des Élugubrations, qui est un des projets que je verrais bien aboutir en volume.
Ici, peut-être qu'il faudrait que je m'en tienne, faute de mieux, à un côté plus journal, à moins de me contraindre à continuer le bilan rubrique par rubrique. Même le recyclage de billets pondus à l'emporte-pièce sur Facebook — habituellement une des ressources de ma fainéantise —, je n'ai pu y consacrer de temps. Il y a notamment deux séries de quatramways écrits la semaine dernière et qui se sont déjà enfoncées dans les limbes de mon mur (voilà une métaphore hardie, que permet seule la métaphore du mur sur FB). Faudra attendre l'année prochaine, que la fonction On This Day, si décriée mais que j'aime beaucoup en ce qu'elle supplée mieux que bien ma pauvre mémoire (en faisant resurgir l'autre et le même), les fasse remonter à la surface.
D'ici là, quoi, et tant d'interrogations.
Je me suis aperçu en cours de billet que j'allais écrire un texte complètement creux, tournant à vide sur lui-même, et dont la rédaction prendrait moins de temps que la création des liens. Il y a une semaine aussi (déjà) que je promettais de m'atteler aux sonnets perroquets — rien de fait — tout défait ——— ça
y est : je maugrée : faut fermer boutique !
(Billet écrit en écoutant certains des Préludes pour piano de Sulkhan Tsintsadze par Roman Golerashvili.)
21:39 Publié dans Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 06 novembre 2016
Détresse des tresses
Ce matin, je me suis rendu compte que, dans la boulangerie où j'ai mes habitudes, la pâtisserie le plus souvent nommée tresse au chocolat (encore qu'elle connaisse quelques variations d'appellation) était baptisée (c'est le cas de le dire) « saint-christin ».

Une rapide recherche sur le Web a achevé de m'empêcher d'y voir goutte.
En effet, il semblerait que le saint-christin (ou sacristain ? quel est le bon terme ?) soit une tresse, mais aux amandes.
11:44 Publié dans Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (1)