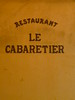samedi, 03 décembre 2011
De la situation économique
How did things go so wrong? The answer you hear all the time is that the euro crisis was caused by fiscal irresponsibility. Turn on your TV and you’re very likely to find some pundit declaring that if America doesn’t slash spending we’ll end up like Greece. Greeeeeece!
But the truth is nearly the opposite. Although Europe’s leaders continue to insist that the problem is too much spending in debtor nations, the real problem is too little spending in Europe as a whole. And their efforts to fix matters by demanding ever harsher austerity have played a major role in making the situation worse.
(Paul Krugman, éditorial du New York Times, hier)
Traduction :
Comment en est-on arrivé là ? On n'arrête pas d'entendre dire que c'est une mauvaise gestion de la fiscalité qui serait responsable de la crise dans la zone euro. Il vous suffit d'allumer votre télé pour voir un expert déclarer doctement que si les Etats-Unis ne réduisent pas leurs dépenses on finira comme la Grèce. Mon Dieu, comme la Grèèèèce !!!
Pourtant, c'est l'inverse qui est vrai, ou presque. Même si les dirigeants européens continuent d'affirmer que c'est l'excès de dépenses qui a mis les nations endettées dans le rouge, le véritable problème est en fait le faible volume de dépenses en Europe, et c'est leur volonté de régler les choses en demandant encore plus d'austérité budgétaire qui a joué un rôle majeur dans l'aggravation de la situation.
(N.B. : renseignez-vous - Krugman n'est pas un gauchiste.)
09:21 Publié dans Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 27 novembre 2011
Ballard et les Eglogues ?
Samedi dernier, lors du colloque international « Blowing Up the Sixties » organisé à Tours par mon excellente collègue Molly O’Brien, j’ai écouté, avec un intérêt sans cesse grandissant, une communication consacrée au roman composite de J.G. Ballard, The Atrocity Exhibition, qui date de 1969. L’intervenante était une doctorante québécoise de Montréal, Vicky Pelletier, qui a – entre autres mérites de son travail – fait circuler un exemplaire papier de la version publiée vingt ans après la première publication (cette édition comporte de nombreux annotations et ajouts, de J.G. Ballard lui-même). L’univers et le style de Ballard (que je ne connais que par ouï-dire, de nom, et aussi à travers le film de Cronenberg (Crash)) ne m’attirent guère, mais je dois reconnaître que ce que j’en ai entrevu à cette occasion donne plutôt, et ce malgré le bric-à-brac « transgressif » assez dérangeant, envie de s’y plonger.
En l’occurrence, ce qui m’a le plus frappé, sur le coup, ce sont les nombreux parallèles scripturaires et sémiotiques que l’on peut déceler avec les Eglogues de Renaud Camus, en particulier avec Travers (dont le quatrième et dernier tome devait paraître ce mois, publication repoussée au petit printemps). Je manque affreusement de temps pour approfondir tout cela, et j’attendrai d’avoir enfin reçu (puis lu) un exemplaire du classique de Ballard avant de proposer des pistes plus fournies. Dans l’immédiat, je me contenterai de noter, sans commentaires, ce que j’ai glané vite fait sur le Web. En effet, contrairement à ce que je pensais en écoutant la communication de Vicky Pelletier, le fait que le roman de Ballard puisse être l’une des sources explicites les plus agissantes de Travers n’a fait l’objet d’aucune remarque, ni sur le site Web de la Société des Lecteurs de Renaud Camus, ni (et c’est plus étonnant), sur le site exceptionnellement dense et fouillé de Valérie Scigala, la meilleure exégète des Eglogues. Il n’y a pas d’occurrence du patronyme Ballard sur le site personnel de Renaud Camus, à l’exception d’un paragraphe des Vaisseaux brûlés qui évoque un (assez énigmatique, dois-je avouer) John-Richard Ballard.
Entre autres ramifications, le titre de Robbe-Grillet, Projet pour une révolution à New-York (qui joue un rôle dans le premier tome, Travers), provient sans doute du titre de l’un des chapitres du roman de Ballard, « Plan for the Assassination of Jacqueline Kennedy », d’autant que ce fragment avait été publié en revue dès 1966.
Voici donc quelques copiés-collés, pour lancer la machine :
The character about which these figures play (he could hardly be called the protagonist) is variously named Travis, Talbot, Traven, Tallis, Trabert, Talbert, Travers, etc. The haziness of his characterization, the blurred outlines of his figure, amount to a radical critique of the very notion of character, so central to the realist novel, as a unified, autonomous being. (Source : The Electronic Labyrinth)
Travers looked up from the collection of objects and documents. The chief prison psychiatrist’s gaze was abstracted, as if his mind were turning inward as some kind of defence against the delusions of his patients.
“And you’re telling me that this collection constitutes some sort of time machine?”
“Not in the conventional sense.”
Travers slapped him.
(Extrait de The Atrocity Exhibition, trouvé ici)
La Foire aux atrocités, traduction française de François Rivière, est paru en 2003 aux éditions Tristram. (Or, le signifiant Tristan et Tristram Shandy sont des références-phares dans les Eglogues.)
15:22 Publié dans Corps, elle absente, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (2)
samedi, 22 octobre 2011
Faudrait-il
10 h --- publié à 12 h 30.
Il y a de plus en plus souvent des bugs ou des pannes d’affichage sur les blogs Haut&Fort. Cette semaine, je suis allé cinq jours à l’université, comme à l’époque où j’étais directeur. Pannes d’affichage. Il faudrait. Cela m’inquiète, et je me dis que je devrais faire des sauvegardes par rubriques. Il faudrait. Avant de partir, je voudrais aussi achever la mise en fiches de Patrimony et Letting Go. Et il faudrait anticiper encore un peu sur l’autobiographie. Il y a du soleil. Parties de Cocotaki ™ et de Croque-Carotte ®. Soleil, vétérinaire. Il faudrait. Il faudrait. Il faudrait.
12:28 Publié dans Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 16 septembre 2011
Guillaume Cingal sort du placard (version sans Bartissol)
Mardi soir, mon père rentrait de Bruxelles dans les Landes. Le lendemain, je recevais un mail de ma mère me disant qu'il était arrivé avec du retard et faisant allusion à un mail que mon père aurait envoyé, en transit à Paris, à ma soeur et moi afin que nous puissions prévenir ma mère, car elle n'était pas là ce jour-là. (La phrase est horriblement compliquée, la situation est très simple : relisez ce qui précède à tête reposée.)
N'ayant reçu aucun mail de mon père ni mardi ni mercredi, je réponds donc à ma mère que je n'ai jamais reçu le mail en question et qu'il s'est peut-être trompé en utilisant mon ancienne adresse Wanadoo (ça lui arrive). Elle m'a donc écrit ce soir pour m'apprendre les choses suivantes :
1. En dépit de la fonction de saisie semi-automatique des adresses électroniques dans son navigateur, mon père a tapé mardi une adresse mail qui, à un signe près, n'est pas la mienne. Cette adresse ne lui est d'ailleurs toujours pas proposée par son navigateur, et il a donc fallu qu'il ignore les propositions automatiques pour la saisir en entier.
2. Il a reçu hier jeudi une réponse d'un autre Guillaume Cingal, qui lui a répondu, en substance, qu'il ne le connaissait pas, ni les destinataires de son mail, et que, même si lui s'appelait bien Guillaume Cingal, celui à qui mon père souhaitait s'adresser devait être un homonyme.
3. Mon père (dont le principal défaut, depuis toujours, est de ne jamais envisager, ne serait-ce qu'une seconde et même dans les situations les plus évidentes, qu'il a pu faire une quelconque erreur, et persuadé, donc, que c'était moi, son fils, qui lui faisais une blague) a répondu à cet autre Guillaume Cingal, sans consulter personne, d'une seule phrase que je vous livre ici, car elle relève d'un génie de la gaffe tout à fait étonnant : "Moi, je n'ai pas de trou de mémoire : tu es bien mon fils."
(Vertigineux, non ?)
D'où le mail de ma mère, ce soir, pour me demander si c'était bien moi qui avais fait une blague. Hélas, non, je l'eusse souhaité. Comme je l'ai écrit à ma mère, j'avais déjà connaissance d'un homonyme (rencontré par hasard à l'époque de l'affaire Asensio, et en faisant une recherche Google sur mon nom) et la gaffe de mon père n'est pas si grave que cela... sauf si l'autre Guillaume Cingal est orphelin, accouché sous X, brouillé avec son père, que sais-je. (D'ailleurs, s'il lit cette page, je lui adresse un amical et homonyme salut, tout en lui présentant mes excuses pour cet imbroglio ébouriffant !)
 Bon, ce n'était peut-être pas une très bonne idée, cette barbe, finalement.
Bon, ce n'était peut-être pas une très bonne idée, cette barbe, finalement.
23:15 Publié dans Autoportraiture, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (7)
mardi, 30 août 2011
À bâtons rompus
(10 juillet)
Bien entendu, j’ai emporté, pour ces six semaines surtout landaises, beaucoup trop de livres, ou de travail, ou de livres pour le travail. J’ai aménagé le bureau de la maison hagetmautienne de manière à avoir cet ordinateur portable branché, et installé près du vieil ordinateur qui ne sert quasiment plus jamais (et qu’on ne garde qu’en cas de panne, au cas où, ou par un inexplicable conservatisme) ; j’ai rangé sur deux étagères distinctes les affaires de C. et les miennes (livres à lire, livres de Roth lus et dont je veux tirer des fiches). C’est en regardant cette étagère, et d’autant que trois livres en cours de lecture sont à la chambre ou au salon, que je me dis qu’à coup sûr j’ai emporté, pour ces six semaines (dont une, au moins, aura lieu ailleurs, dans l’Aude), trop de lecture. À côté de moi, c’est-à-dire à côté (à gauche) du clavier de l’ordinateur portable, sont posés American Pastoral, avec la bibliographie officielle établie par Paule Lévy, et Parti pris.
Avant-hier soir, avant le samedi sans lecture (nettoyage, installation d’une boîte à lettre sur piquet métallique, ébranchage, courses landaises), j’ai commencé Indignation, un des très brefs et récents romans de Roth. Quoique je n’aie pas encore compris le choix du titre, je n’ai pu m’empêcher de repenser à la rubrique Indignations, que j’avais « doublonnée » plus tard, dans mes autres carnets, au moyen de la rubrique Narines enfarinées : ce mot même d’indignation, qui signifie que l’on s’insurge contre quelque chose d’indigne, n’est-il pas quelque peu ambigu ? ne pourrait-on supposer que celui qui s’indigne se rend lui-même coupable d’intempérance, et qu’il est, par là même, indigne de ce qu’il devrait être ? Le récent succès de librairie, tout à fait grotesque, d’un Hessel a marqué de manière claire que, si l’indignation pouvait être présentée comme une vertu, elle n’en était pas moins fortement imprégnée d’indécence, voire d’indignité en tant que stratégie systémique.
(Un des côtés les plus reposants, mais également – c’est tout à fait logique – les moins propices au travail ou à l’élaboration de réflexions écrites, ici, c’est l’absence de connexion Internet. Bien que je persiste à y trouver le principe fondamental d’un ressourcement, ou d’un repos forcé, souvent, il n’en demeure pas moins que, dès que j’essaie de mettre quelque chose au propre, pour mon travail ou en vue d’une publication ultérieure dans un carnétoile, je me retrouve coincé. Ainsi, pour le travail, il faudrait ici que je puisse creuser le sens du titre de Roth, même sans avoir achevé la lecture du roman dont tout me laisse penser, au demeurant, qu’il ne va pas casser trois pattes à un canard ; pour l’écriture, je devrais pouvoir aller farfouiller du côté de l’OED, ou m’enquérir de toponymie – la ville de Digne ?)
Cela s’est déjà produit : un minuscule insecte se promène sous l’écran, entre les lettres du texte qui s’écrit. Tandis que j’écrivais la phrase qui précède, il est passé du v de ville au r d’écriture. (Insecte ascendant.)
Les textes que j’accumule (et encore : pas toujours) lors des séjours landais pourraient être regroupés dans une nouvelle rubrique : À bâtons rompus. Les textes, devenus rares (je m’échinais ou ferraillais plus souvent en 2005 – non que je me sois tout à fait calmé depuis, comme l’affaire Asensio a pu le démontrer, mais j’ai aussi eu ma part de batailles dans le domaine professionnel), de la rubrique Indignations pourraient, eux, porter le titre collectif : À lances rompues. (Ne dit-on pas, pourtant, briser des lances ?)
11:39 Publié dans Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 20 juillet 2011
Pantalon d'épousaille
Ce n'est pas un été pourri.
Ce n'est pas un été pourri qui vous fera changer d'avis sur les rapiéçages divers d'une année de bonne fortune.
Ce n'est pas un été pourri avec vue sur la montagne.
Ce n'est pas un été pourri dont la trêve sera hivernale. (Juste à côté, elle avait ajouté ^^, mais je n'ai jamais compris ce signe (froncement de sourcils ?).)
Ce n'est pas un été pourri à s'espalaser dans la verdure moite.
(Enlève des adjectifs.) Ce n'est pas un été pourri à s'espalaser dans la verdure. (N'abuse pas de patois.) Ce n'est pas un été pourri à s'étendre nonchalamment dans la verdure. (Pourtant, s'étendre nonchalamment ne dit pas la même chose que s'espalaser, qui n'a pas d'équivalent en langue d'oïl.)
Ce n'est pas un été pourri si tu revois le soleil.
Ce n'est pas un été pourri comme ceux de 2007 ou 2009, et quoique tu penses des nombres impairs.
Ce n'est pas un été pourri qui changera grand chose à mon style.
Ce n'est pas un été pourri à peindre, à rafistoler.
Ce n'est pas un été pourri. (On verra bien.)
05:20 Publié dans Questions, parenthèses, omissions, Un fouillis de vieilles vieilleries | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 28 juin 2011
Elucubrations de quasiminuit
Hier, dans ma tenue d'Hindou ou de Jean Borotra, une Affligem, à une heure de l'après-midi, en plein soleil, place Plumereau. (Le serveur de l'Epée royale : Je ne sais pas comment vous faites...)
Ce midi, un déjeuner preste mais avec un excellent septuor. (Moins de scintillations, pourtant. Le ciel s'était chargé de nuages mi-lourds.)
Avec tout ça... je ne sais pas comment je tiens... aux nerfs... au ciel... à la nécessité de tenir...
Pas à la perspective de vacances, en tout cas. Famille, été, impression de farniente, certes. Mais trois nouveaux cours, plus les deux cours d'agrégation -- et les responsabilités qui reviennent par la fenêtre quand on les chasse par la porte. Voilà ce que sera 2011-2012. Alors, la recherche (si : deux colloques, un de plus à organiser...)...
Enfin, le travail, c'est comme la vie : ça ne s'arrête que quand ça s'arrête, et non quand on pense que ça va se calmer. Le creux de la vague, ça n'existe pas. C'est une invention de l'écume, pour nous attraper.
(On en revient à Mallarmé. Nous naviguons, ô mes divers.)
23:53 Publié dans Autoportraiture, Questions, parenthèses, omissions, WAW | Lien permanent | Commentaires (1)
mercredi, 22 juin 2011
Se dévêtir de gris
Nous évitions les bals où les mines étaient grises
afin de mieux nous revêtir des nôtres.
(Haute lice, p. 33)
De quel mystère a-t-on trouvé à se parer, dans un bal démultiplié ? (Démultiplié : un bal qui se généralise et devient le signe, ou l'exemple, des bals, de tous les bals.) On peut penser que, refusant de faire grise mine, cherchant à avoir sa propre figure, on arborera une allure autre que grise. D'ailleurs, cela n'a rien d'évident, car le gris lui-même est d'une grande richesse : ainsi, un mur gris n'est jamais uniforme ou monochrome, mais constitué d'un nombre presque infini de teintes, de variations, de subtils passages (jaune sale, beige terne etc.).
Je n'ai jamais su (vérifié) si les belles phrases que l'on prête à François Mitterrand sur la beauté du gris (dans le film de Guédiguian ou le docu-fiction de Moati) sont bien de lui. Peu importe, si un sujet en chasse un autre. Le revêtement des routes, par exemple, varie (j'avais d'abord écrit : vire) du bleu très sombre à l'anthracite. Et c'est toujours le temps de l'attente, dans les salles de bal (la salle des bals).
Par voie de conséquence (mais il n'y a là ni voie, ni variation), par tel ou tel canal d'emprunt, on peut souligner que c'est aujourd'hui un jour d'été singulier : longue, très longue averse de plus de quatre heures (laquelle a commencé, sur un coup de tonnerre, un peu avant 6 h du matin), puis, après dissipation progressive de la grisaille, un soleil doublé d'un vent moins gorgé d'humidité qu'on ne l'aurait cru, et qui n'a cessé de s'imposer en trompe-l'oeil.
Des ardeurs perçaient (sous la grande mondaine). Le soleil, toujours en trompe-l'oeil, est de ce monde.
2300 - D'ailleurs quelles régions
Nous voici de l'autre côté, en pensée à tout le moins. Des arbalétriers sont à pied d'oeuvre. Mettre le roi en pièces en un clin d'oeil ? Le vieux projet (Eu dans l'eau) refait surface. Et pourtant le désir de Lisbonne me hante.
Tout de même, on est mal barrés ! Revenons à Lyon, si vous le voulez bien, dans les traboules, et dans les bouchons où l'on déguste d'excellentes fricassées, ou les plats qui, de tous ceux que la cuisine française a pu inventer, sont les plus susceptibles de faire peur aux Amerloques. Des ribambelles nées à Babel rebondissent. Le texte alors se compliqua, encore un tour de vis, encore un faisceau supplémentaire, des strates en veux-tu en voilà (Lisie n'a pas dit non), puisque le scripteur se mit en tête, se fit un devoir, d'ajouter aux citations barrées et aux citations non identifiées d'autres citations, des sortes d'autocitations que, faute d'autre police possible dans les "fenêtres de commentaires" de son site de photographies (la source de tout texte, ici), il italicisa. Rome caracole. Comme ce verbe "caracoler" tombe à point nommé. Comme tout se rejoint, comme tout fait sens !
Unissons !
Frissons ! Revenons à Lyon, en gardant notre sang-froid. Confondus avec la foule. Ce qui nous berce nous bannit. Primatiale de tous les saints, frissons du pardon. Avoir visité, jadis, Lyon avec un fervent catholique a dû colorer mon regard. Comme ce verbe "colorer" tombe à pic. Vincent vint sans son yacht. Il s'appelle évidemment ..... Tristan.
Comment nommer un texte composite formé de collages et de bribes qui sont-elles mêmes dérivées de textes polymorphes où l'on sent la pratique du centon, l'ekphrasis, la sortie impossible du langage ? Ce n'est pas la bucolique. Ce voyage, du jeudi au mardi matin (tôt, il n'est pas sept heures et je suis levé depuis deux heures déjà), a connu un coup d'arrêt. Un coup d'épée. Et pourtant le désir de Lisbonne me hante. Allez savoir de qui (de quelle contrée?) il s'agit... (D'autres s'interrogent, non sur Zimbazane, en Corrèze (qui vaut mieux qu'une montre en or, mais pas que le Zambèze), mais sur Fonbalquine, qui doit connaître des ressourcements.) Faute d'autre police : il faudrait, lors de la publication finale, en arborescence, un jeu de couleurs. Comme ce mot "couleurs" tombe à merveille. Et du Rhône on ne peut dire qu'il possède l'aura diaphane, si particulière à ces régions. D'ailleurs, quelles régions ? D'ailleurs quelles régions.
Avec tous ces détours, nous n'avons pas vu Lyon.
Y étions-nous ?
Unissons.
D'ailleurs, quelles régions ? (Tu reviendras. La sottise n'est pas mon fort.)
08:37 Publié dans Entre Baule et Courbouzon, Hors Touraine, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 14 juin 2011
Dialogue écrit
— Expression tautologique de la mélancolie, par mon fils (10 ans) : "j'aime cette musique, ça me rappelle la nostalgie".
— Ce n'est pas tautologique, c'est une vraie mise en abîme. Soupir ! La nostalgie n'est plus ce qu'elle était… C'est marrant, ça nous ramène au papier sur le regrès.
— Me sens très abîmé. C'est la nostalgie, un puits sans fond.
Dans mon autre site, j'avais tenté des transcriptions de conversation en ligne ("chat"). Ici, peut-être, commence un nouveau projet : le recyclage d'échanges sur Facebook.
02:00 Publié dans ... de mon fils, Chèvre, aucun risque, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 09 juin 2011
De quoi Cucuphas est-il le nom ?
 Les entrées des différentes WP (francophone, lusophone, hispanophone) donnent la même étymologie pour le nom de saint Cucuphas, dont on peut voir, dans la basilique de Saint-Denis, une chapelle qui lui est consacrée. (Je ne suis pas très sûr de la syntaxe, bancale voire fautive, de la phrase qui précède.*) Il s’agirait d’un nom dérivé du copte cacupat, par l’intermédiaire du grec kukupha et du latin upupa : ces noms désignent la huppe.
Les entrées des différentes WP (francophone, lusophone, hispanophone) donnent la même étymologie pour le nom de saint Cucuphas, dont on peut voir, dans la basilique de Saint-Denis, une chapelle qui lui est consacrée. (Je ne suis pas très sûr de la syntaxe, bancale voire fautive, de la phrase qui précède.*) Il s’agirait d’un nom dérivé du copte cacupat, par l’intermédiaire du grec kukupha et du latin upupa : ces noms désignent la huppe.
Or, pour l’entrée de la WP anglophone, nettement plus complète, l’étymologie proposée, empruntée au site Web Santi Beati, fait remonter ce nom à une expression phénicienne dont le sens serait « celui qui aime faire des plaisanteries ».
 Je ne dispose ni des compétences ni des ressources, ni surtout du temps nécessaire à l’élucidation de ces hypothèses contradictoires, de sorte qu’il m’est aisé d’imaginer qu’elles sont en fait complémentaires : le cri de la huppe appelle l’analogie avec l’homme qui se gausse, comme on le dit du merle moqueur, ou qui glousse. Cela, pourtant, est bien incertain. Je ferais mieux de m’intéresser à cet Ayne Bru qui a peint le tableau le plus connu, et surtout le plus reproduit, représentant ce martyre – ou tenter de lire sérieusement l’hymne que Prudence lui a consacré – ou encore envisager d’aller me promener dans le bois de saint Cucufa à La Celle-Saint-Cloud – ou, seulement, décrire la chapelle à la minute même où je la vis.
Je ne dispose ni des compétences ni des ressources, ni surtout du temps nécessaire à l’élucidation de ces hypothèses contradictoires, de sorte qu’il m’est aisé d’imaginer qu’elles sont en fait complémentaires : le cri de la huppe appelle l’analogie avec l’homme qui se gausse, comme on le dit du merle moqueur, ou qui glousse. Cela, pourtant, est bien incertain. Je ferais mieux de m’intéresser à cet Ayne Bru qui a peint le tableau le plus connu, et surtout le plus reproduit, représentant ce martyre – ou tenter de lire sérieusement l’hymne que Prudence lui a consacré – ou encore envisager d’aller me promener dans le bois de saint Cucufa à La Celle-Saint-Cloud – ou, seulement, décrire la chapelle à la minute même où je la vis.
* ...saint à qui une chapelle est consacrée, dans la basilique Saint-Denis.
05:00 Publié dans BoozArtz, Questions, parenthèses, omissions, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (3)
lundi, 02 mai 2011
Chaorgasme
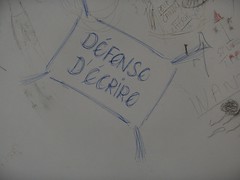 Un carnétoile est comme une bibliothèque qui se rangerait, s'arrangerait d'elle-même, avec ses trous et ses chaos, ses pleins et ses déliés -- ou plutôt : le chaos, l'amoncellement, l'accumulation (de rubriques, dont certaines sont comme mort-nées, n'ont pas donné suite, have finally petered out) n'y empêche aucunement l'impression de bonne tenue. Il serait facile de redécorer radicalement la pièce, repeindre les murs et les rayonnages d'une autre couleur : d'un simple clic, le vert de Touraine sereine, omniprésent depuis la création, le débarquement, deviendrait grisâtre ou orangé. Pourtant, le graphomane résiste à cette tentation.
Un carnétoile est comme une bibliothèque qui se rangerait, s'arrangerait d'elle-même, avec ses trous et ses chaos, ses pleins et ses déliés -- ou plutôt : le chaos, l'amoncellement, l'accumulation (de rubriques, dont certaines sont comme mort-nées, n'ont pas donné suite, have finally petered out) n'y empêche aucunement l'impression de bonne tenue. Il serait facile de redécorer radicalement la pièce, repeindre les murs et les rayonnages d'une autre couleur : d'un simple clic, le vert de Touraine sereine, omniprésent depuis la création, le débarquement, deviendrait grisâtre ou orangé. Pourtant, le graphomane résiste à cette tentation.
(J'écris ces lignes en surveillant un examen, au fond de la salle 413. Il me semble que j'ai photographié, il y a longtemps, des nids de pie depuis cette même salle, à moins que ce ne fussent les graffiti sur les tables. Si je retrouve ces images sur FlickR, j'en illustrerai ce billet. Pour de sombres et pragmatiques raisons, j'ai dû faire, entre 7 h 50 et 9 h 05, deux fois l'aller-retour entre la salle de surveillance et le secrétariat, laissant ma collègue surveiller seule la quarantaine d'étudiants de master. L'ascenseur étant en panne, j'ai donc monté trois fois les 4 étages, l'équivalent donc, très approximativement ou de façon hachée, de deux orgasmes. (J'avais entendu, adolescent, les résultats d'une étude qui expliquait que monter 6 étages équivalait, du point de vue de la dépense d'énergie, à un orgasme. Like most people, I'd rather have a fuck.))
Le carnétoile, dépaysé, raccroché ou renfloué, s'accommode aussi bien des parenthèses languissantes que de liens hypertextuels à foison. C'est lundi matin, back to the grindstone.
(Une nouvelle parenthèse, comme si je suivais ici le flux et le reflux des odes composées selon strophe et antistrophe, mais en oubliant, savamment ou sottement, de composer d'épodes : je n'ai pas retrouvé de photographie du nid de pie, mais bel et bien les graffiti, dont l'un vient orner, en lettrine, le début de ce billet. L'éléphant polygraphe a encore du pain sur la planche.) ----- Puis, j'ai cherché encore, mieux, autrement, dans le fouillis gravement ordonnancé de cet autre carnétoile qu'est mon site FlickR, et j'ai retrouvé le nid de pie capt(ur)é depuis la salle 413 :  Aujourd'hui, ce sont les mêmes fenêtres, et les mêmes platanes, beaucoup plus feuillus et verts (nous sommes en mai, et non le 26 mars 2007). Héraclite peut prendre des cours de conduite auprès de l'éléphant polygraphe.
Aujourd'hui, ce sont les mêmes fenêtres, et les mêmes platanes, beaucoup plus feuillus et verts (nous sommes en mai, et non le 26 mars 2007). Héraclite peut prendre des cours de conduite auprès de l'éléphant polygraphe.
10:22 Publié dans Questions, parenthèses, omissions, WAW, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (2)
mardi, 29 mars 2011
Inquiétudes immobilières (maybe de nada)
Reprenons à rebours.
Lundi, 15 h 50. En rangeant la vaisselle dans les placards (tandis que chauffait l'eau pour le thé), je me suis surpris, pour la deuxième fois de la journée, à ouvrir le placard des tasses et des mugs afin d'y ranger les cinq verres que j'avais dans les mains... (Il me semble que je n'ai jamais commis cette bévue. Il me semble aussi que, dans la maison où nous vivions jusqu'en décembre 2008, le placard des verres était situé au-dessus du four, alors que, désormais, nous rangeons les mugs près du four.)
Dimanche, promenade dans le quartier. Le chantier de la grande résidence qui va remplacer le grand terrain vague a bien commencé. Comme nous le craignions, la piste cyclable qui passe de l'autre côté du rond-point en cul-de-sac où se trouve notre maison (je sais : cette description ne permet nullement d'appréhender la situation topographique de manière concrète, même avec un solide sens de l'orientation et un bac+8 en sémantique) sera doublée par une voie pour véhicules, sans doute à double sens, afin de desservir cette fichue résidence. (N'y a-t-il plus de règlementation sur les espaces verts ? A Tours, le moindre recoin de trois fois rien où je n'aurais pas su comment caser un cabanon pour mes lapins donne naissance, du jour au lendemain, à un bloc de 12 ou 14 appartements, façon Jack & the Beanstalk. Bref...) Découragée par cette vision, ma compagne lance "pfff, c'est foutu, on n'a plus qu'à déménager"...
(Nota bene 1 : nous avons emménagé il y a deux ans et demi, dans une rue qui, quoique prise entre une ZAC et une ZI, et dans une zone quadrillée par deux 2x2 voies, est tout à fait calme.)
Il y a quelques semaines, ma compagne m'a dit avoir fait le même rêve récurrent (4ème occurrence, je crois) : nous vivions de nouveau (ou encore) dans notre précédente maison, qui n'avait pourtant rien d'idéal, sauf le jardinet, qui était plus joli et bien chez soi comme disent les blaireaux de l'immobilier. (Nota bene 2 : ma compagne n'est pas du tout portée, contrairement à moi, sur la nostalgie, et fort peu, en particulier, attachée aux lieux de vie du passé. Un tel rêve prend un relief singulier.)
Alors ? quoi...? prémonitions ? le plus étrange est que nous sommes très à notre aise dans cette maison, et aussi heureux qu'on peut l'être je crois. Au demeurant, j'incline à penser que la résidence ne devrait pas drainer une circulation si démente que cela, et surtout à des heures ciblées d'ailleurs (comme actuellement, d'ailleurs, pour les rues Curie ou Torricelli).
------- Et, pour donner plus de relief à ce billet un brin terne, j'y accroche quelques liens vers d'autres verdures, d'autres grisailles.
02:20 Publié dans Moments de Tours, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 21 mars 2011
Affairés
Felix, heureux et sombre, tapote, pianote (Bilder keiner Aufstellung, ce disque qui depuis si longtemps m'accompagne et que voilà revitalisé par l'écoute, samedi, des Tableaux d'Une par la fidèle Akiko Yamamoto). Le bambin ne pleurait pas. Le bambin ne pleurait plus. Felix n'est pas si modeste qu'il y paraît, et, dans le soleil du deuxième jour de printemps, reprenant de bonnes vieilles habitudes (en 1994 ou 1996 ou 1999 ç'eût été du thé), je bois un peu de café noir avec des McVitie's Ginger Nuts : on peut lire £1 sur le paquet que j'ai payé deux euros peut-être -- ou peut-être un peu moins -- au supermarché asiatique de la Petite Arche. Nolportano : qu'est-ce que ça veut dire ?
Nolportano, qu'est-ce que ça veut dire Nolportano ? Cinzano !
Vous n'y croiriez pas. Vous n'y croiriez guère. Autres gammes : tout, dans cette traduction, était (d'ailleurs) un problème de portée. Et quand votre monde s'effondre, quand la radio irradie, quand le béton ne coule plus, croyez-vous qu'il soit facile de se glisser dans un strapontin et de rire tout de go (viz. : l'histoire du Texan qui s'abreuve dans une empreinte de fer à cheval) ? Soy califa : le Sphinx interroge. Felix continue de faire la musique avec le couvercle rabattu. (Draps souillés.)
Donc, n'y croiriez-vous pas ? Vraiment ? Le soleil dans la poire ??!? Et que, dans le seul canton de Marseille où le Front National n'arrive pas en tête (quelle ville de dingues, décidément), il y ait eu quatre candidats écologistes, ça ne vous défrise pas ? Etude de cas pour politologue. L'observation désastre, en quelque sorte, quand le champ des ruines (albeit ever so slightly) se métamorphose sous vos yeux en carte postale sépia.
Vous n'avez rien compris à ma simplicité. (Et, ajouta-t-il à 11 h 11, je ne peux pas ne pas dire un mot, ou une phrase, ou me livrer à quelque envolée, au sujet de Korkelwurz : alors, toujours, il, sur le métier, l'ouvrage remit, et de fil en aiguille se mit aussi à dire du bien de Pentachords, de Bazar, tout à fait asiatique encore, des Impondérables, et même (fut-ce brutal !) de Torschluss. (Les circonflexes ne comptent pas pour du bas-beurre.))
Korkelwurz, qu'est-ce que ça veut dire Korkelwurz ? Marlbroutz ! ------------- A ma simplicité vous n'avez rien compris.
11:11 Publié dans Autres gammes, Moments de Tours, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 14 mars 2011
Sang
" A la suite de disputes au sujet de terres avec des cousines, et pour fuir les commérages, critiques et ragots de la famille, il avait juré de se vider de tout son sang et de s'en transfuser un autre, et de changer son patronyme d'Abad pour celui de Tangarife, qui avait l'air moins juif et plus arabe (menace burlesque qu'il ne mit jamais à exécution). "
(Hector Abad. L'oubli que nous serons, traduction d'Albert Bensoussan.
Gallimard, 2010, p. 90.)
12:24 Publié dans Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 09 février 2011
Rame
Dès que je n'y tiendrai plus, je me gaverai de café, tenir le coup.
J'aurai bientôt achevé de lire Dorian. Pourquoi est-ce que j'éprouve de telles difficultés, et même à prendre e main, rassembler les fils enchevêtrés de l'existence (ses tâches, ses taches) ?
Le futur antérieur m'enterre sous son aile. Pas gai.
07:17 Publié dans Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 12 décembre 2010
Summertime / L’été de la vie
Il ne m’est pas possible de revenir ici en détail sur les raisons qui font que je lis chaque nouveau livre de Coetzee, alors que cet auteur me laisse généralement sur ma faim, voire qu’il m’agace (son côté scalpel, sa forme froide et quelque peu osseuse (voire en arêtes), son éloignement de tout dérapage). Peut-être y reviendrai-je, si tant est que j’en éprouve le besoin (ici, ce me semble, je suis un peu mon seul lecteur).
Plus que les précédents, ce qui n’est pas peu dire, le troisième volet de l’autobiographie du Prix-Nobel-sud-africain-exilé-en-Australie me semble fade, bien peu de chose. Ça ne démarre pas mal, en un sens. Il nous est donné de lire quelques fragments de carnets avant les transcriptions de cinq entretiens entre un biographe fictionnel et des personn(ag)es ayant compté dans la phase 1972-77 de la vie de John Coetzee, le grand écrivain désormais décédé (double ou décalque morbide de J.M. Coetzee). C’est là une très bonne idée, dans la perspective de distanciation autobiographique (soit = pas du tout l’autofiction) qui est celle de Coetzee. Ce qui est regrettable, c’est que Coetzee n’en fait rien. Il reste à mi-chemin de tout. Aucune envolée, ou alors pas assez de sécheresse. Bizarrement, on frôle l’autocomplaisance, peut-être le seul reproche qu’on n’eût pu jusqu’alors formuler.
J’avais commencé à griffonner quelques bribes dans les marges de mon exemplaire de Summertime, tandis que C. en lisait la traduction (L’été de la vie. Seuil, 2010, traduction de Catherine Lauga du Plessis). Et je n’ai pas envie d’en faire quoi que ce soit. D’autres, beaucoup, écriront au sujet de ce petit texte bien terne. Aussi ai-je décidé de reprendre certains des passages que j’avais annotés, et de voir comment Catherine Lauga du Plessis les a traduits. Après tout, Coetzee est un fabricant de petits mécanismes textuels tellement rôdés qu’on n’y sent plus la moindre fibre ; autant le prendre à son jeu, et décortiquer des micro-fragments dans une perspective ultra-décorticante (la traductologie, dira-t-on pompeusement).
Agenbite of inwit. (Summertime. Vintage, p. 4).
Agenbite of inwit, remords de conscience. (L’Eté de la vie, p. 10).
Je ne savais pas du tout ce que c’était que cette expression ; je constate que la traductrice choisit de la garder telle quelle. Il doit s’agir d’une citation. La Wikipedia me permet prestement de combler mes lacunes : il s’agit en effet du titre d’un texte en prose en moyen anglais, de genre confessionnel. La traduction en anglais contemporain que propose la WP (Prick of Conscience) me confirme ce que je pensais : il doit y avoir, dans l’allusion de Coetzee, un jeu sur les connotations sexuelles (bite, wit = morsure, bite, vit). Pour lui, aussi, ce doit être une reprise de Joyce, puisque, comme nous en informe doctement la WP : « In the 20th century, the work gained some recognition when its title was adopted by James Joyce, who used it numerous times in his novel, Ulysses. In Joyce's spelling, agenbite of inwit, the title has gained a limited foothold in the English language. » On peut supposer que la traductrice française est allée fouiner du côté des traductions du texte médiéval, et des traductions d’Ulysse. Passons.
As for the fate of Christian civilization in Africa, they have never given two hoots about it. (Summertime, p. 6)
Quant au sort de la civilisation chrétienne en Afrique, ils s’en sont toujours moqués comme de l’an quarante. (L’été de la vie, p. 12)
L’équivalence trouvée est judicieuse – on aurait pu songer aussi à « leur première chemise », mais l’an 40 est bien vu, dans le contexte. Pouvait-on conserver une tournure négative ? Ils n’en ont jamais eu cure. Jeu de mots assez fin, mais niveau de langue trop soutenu.
Breytenbach […] queered his pitch… (Summertime, p. 8)
… il a brûlé ses vaisseaux… (L’été de la vie, p. 15)
Elle n’a pas beaucoup cherché, là. Equivalence, oui, mais d’un autre niveau de langue. L’idée est légèrement différente : en anglais, il s’agit plutôt de quelqu’un qui met à mal une situation idéale par irréflexion, sans les connotations bravaches du français (jeter son bonnet par-dessus les moulins ?). Souvent, d’ailleurs, l’expression ne s’emploie pas de façon réflexive. On pourrait envisager : il s’est mis dans le rouge / il a franchi la ligne jaune / il s’est tiré une balle dans le pied / il a scié la branche sur laquelle il était assis. En quelque sorte, dans le texte français, Coetzee-le-narrateur est beaucoup plus admiratif du geste de Breytenbach que dans le texte anglais. En anglais, Coetzee-le-narrateur intègre le point de vue raciste de l’opinion afrikaner officielle. C’est beaucoup plus intéressant.
… he swarthily handsome, she delicately beautiful… (Summertime, p. 8)
… lui séduisant et basané, elle d’une beauté délicate… (L’été de la vie, p. 15)
Un cas d’école. Adverbes qu’il est impossible de calquer, qui appellent des transpositions. La traduction est un modèle.
… the muzak… (Summertime, p. 21)
… la musique d’ambiance… (L’été de la vie, p. 29)
Pas d’autre choix, sans doute, que cet étoffement. Quoi d’autre ? La musiquette ? La soupe ? NON. C’est frustrant, quand même.
Mister Prod (Summertime, p. 22)
Il est trop long d’expliquer pourquoi l’interlocutrice du biographe surnomme ainsi John Coetzee. Toujours est-il que la traduction
… ce picador à la manque… (L’été de la vie, p. 31)
est absolument enthousiasmante. Coetzee tiendrait-il, en Catherine Lauga du Plessis, une traductrice si bonne qu’il ne la mérite pas ?
… nothing but a clumsy accident, the act of a Schlemiel… (Summertime, p. 25)
… rien d’autre qu’un accident, une maladresse de Schlemiel… (L’été de la vie, p. 34)
Pas d’autre choix que de conserver le xénisme, le terme yiddish. Contre ce choix, il y aurait l’argument suivant : la littérature en langue française n’est pas traversée par le yiddish dans les mêmes proportions que la littérature en langue anglaise (surtout avec les textes américains). Mais cet argument ne tient pas, pour deux raisons clairement repérées :
- Le texte français est une traduction, ce qui est connu du lecteur.
- Le yiddish est une des langues de référence possible de tout texte littéraire, quelle qu’en soit la langue.
Il y a une autre raison, plus spécifique : --- 3. Il y a un écho sémiotique évident avec le célèbre conte (ou bref roman) d’Adalbert von Chamisso, Peter Schlemihl (une histoire de double).
Aussi, sur un plan linguistique : --- 4. Coetzee fait dire ce mot à Julia car il s’agit aussi d’un terme afrikaans (et même néerlandais).
“Only something that, being a schlemihl, he'd known for years: inanimate objects and he could not live in peace.” (Thomas Pynchon. V. 1963, p. 37)
Excitement all around, an envelope of libidinous excitement. From which I purposely excised myself. (Summertime,pp. 26-7)
Tous baignaient dans l’excitation, tous pris dans une excitation libidineuse. Quant à moi, je me tenais à l’écart. (L’été de la vie, p. 36)
Dans la première phrase, l’étoffement au moyen d’un verbe conjugué n’était peut-être pas évitable. Il était possible de risquer une dilution, plus proche stylistiquement du texte-source : Partout tout n’était qu’excitation, la gangue libidineuse impudique de l’excitation.
L’adjectif impudique serait bien meilleur ici, d’un point de vue rythmique. Mais le rythme n’est pas tout.
Ce qui est regrettable, c’est d’avoir effacé, dans la deuxième phrase, l’adverbe purposely (qui n’est pas purposefully), mais surtout de n’avoir pas conservé la paronomase excite/excise. Quand c’est une femme qui dit s’être tenue à l’écart d’un système social proche de l’échangisme, le recours au verbe excise myself (« m’exciser ») n’est pas banal. Il s’agit d’ailleurs d’un emploi très « limite » par rapport à l’usage en anglais.
‘Once,’ he repeated, cementing the lie. (Summertime, p. 29)
« Une fois », a-t-il répété, s’enferrant dans son mensonge. (L’Eté de la vie, p. 39)
Outre mon obsession très récente pour le ciment – qui est un motif agissant de ce chapitre, la 1ère interview – je m’étais demandé comment traduire cela. Il s’agit d’une parole qui scelle un mensonge : le mensonge est en béton, au moins pour celui qui le profère (et, d’une manière performative assez habituelle chez Coetzee, pour son interlocutrice aussi). L’expression française s’enferrer dans son mensonge (modulation avec changement d’image : ciment è fer) a d’autres connotations, me semble-t-il. A tout prendre, j’aurais opté, moi, pour scellant ainsi son mensonge.
(Remarque tout à fait annexe : a-t-on oublié, aux éditions du Seuil, les règles typographiques de base pour la présentation des dialogues en français ??? Il semble que tout le roman soit imprimé selon les conventions typographiques anglo-saxonnes, avec multitude de guillemets ouvrants et fermants en tous sens. Du grand n’importe quoi. Mais il est vrai que je cherche peut-être la petite bête, vu que j’ai de bonnes raisons d’en vouloir au Seuil, et notamment à la grande chamane et brasseuse de vent Anne Freyer.)
[Je me suis arrêté là, pour le moment, de l'exploitation traductologique de mes annotations. Il y a moins de petits ticks dans les pages qui suivent, de toute façon. J'ai lu pour lire, pour finir, pour voir, pour m'agacer encore de cette médiocrité froide.]
00:05 Publié dans Affres extatiques, Pynchoniana, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (7)
samedi, 11 décembre 2010
Oloron, Pau, le honk des oies
Je me gave de café, moins pour me réveiller, me réchauffer ou atténuer l'effet de l'oreiller trop volumineux sur ma nuque, que pour me donner une contenance. Un samedi qui commence bien. Déjà un long texte écrit en hypographe à une photographie récente de la chapelle Saint-Georges à Rochecorbon. (J'ai raté une occase : Lamba / lambda. Il faut aussi que je trouve ma voie.)
Bientôt aux Tanneurs pour la soutenance de thèse de Stéphanie.
Longs textes.
Pourtant, choses à faire : sujets d'oral pour le M1 (marathon de mardi) ; placer les 56 groupes de tutorat Asiaco dans les emplois du temps du deuxième semestre ; faire les listes des étudiants pour ces mêmes séances. (WAW.)
Côté écriture : je me tâte pour l'autre texte. Celui que j'ai commencé par pochade me stimule plus. (Le scripteur, quelle forfanterie !) Il n'est pas anodin que cela permette, par recoupements citationnels, de récupérer tels quels (ou presque) un nombre presque infini de textes déjà écrits sur l'un ou l'autre blog carnétoile.
Même côté, presque : billet sur quelques phrases de Summertime (et regarder leur traduction) ; billet sur l'un des récits brefs de Mia Couto ; billet sur Herta Müller ; billet sur le journal 2009 de Renaud Camus. Chantiers, toujours, et dans une semaine plus de connexion Internet. (WAOW !) Et aussi, cette phrase lue hier soir, ou plutôt cette nuit, phrase idéale pour Le Livre des mines (dans Les Inachevés).
Nouveaux limericks (à l'ancienne) attendront (désolé, Valérie).
08:05 Publié dans Entre Baule et Courbouzon, Questions, parenthèses, omissions, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
Louv(r)e à la b(r)asse
Traversé le Louvre à la brasse, quel cirque ! Aujourd'hui, Edmond et Jules se reposent. Ron et Mael discutent de Derrida. Denis et Maurice évoquent de vieilles photographies jaunies (le temps, à peine, d'un clignement de paupières, tant et tant que le phraseur bataille), par-dessus la ligne imaginaire du tropique du Cancer. C'est Michael qui est mort.  La trompette est-elle veuve ou orpheline. (Pour le frère, il n'y a pas de mot. Le sujet du roman de Vassilis Alexakis est pourtant ce veuvorphelinage, deuil, insurrection tendre des spectres, et poème brusqué la Vénus de Brassempouy. Au moins, nous saurons où diriger nos pas, dans la galerie de portraits, pour la prochaine notule. Il faut refermer la parenthèse. Il faut refermer la parenthèse.)
La trompette est-elle veuve ou orpheline. (Pour le frère, il n'y a pas de mot. Le sujet du roman de Vassilis Alexakis est pourtant ce veuvorphelinage, deuil, insurrection tendre des spectres, et poème brusqué la Vénus de Brassempouy. Au moins, nous saurons où diriger nos pas, dans la galerie de portraits, pour la prochaine notule. Il faut refermer la parenthèse. Il faut refermer la parenthèse.)
Escalier. Escalier somptueux. Escalier somptuaire. Manquent les majuscules d'usage. Escaliers. Grand miroir d'eau à la versaillaise. Traversé les douves à la brasse ; mouvement, immobilité, blanches courbes.
Bien des jeux de mots. Peu de ratures. Pas de ratures. Phrases courtes, blanches courbes dans le ciel. Château en Saintonge, songes creux. (Pourtant, pensait-il, ces petites phrases sèches dont on pourrait penser que le scripteur les a tirées de sa manche comme au jeu des kyrielles sont tout simplement de fades enchaînements, sans contrainte, pure suite sèche, pas même énigmatique. Qui en dit trop ne dit rien.)
MAIS VOYONS (bon sang, mais c'est bien sûr !!) :::: IL S'EST AFFRANCHI ----- de QUOI ??? des culs obliques ? (blanches courbes, bon sang mais c'est bien sûr !)
Il faut refermer la parenthèse. Il faut refermer la parenthèse. Le revoilà qui bégaie. Qui en dit trop ne dit trop rien.  Le revoilà qui bégaie. Mais tout de même, cette silhouette pataude (fermière d'été ? veuvorpheline de comédie larmoyante ?) ne manque pas de se diriger, d'un mollet agricole mais décidé, vers les marches inférieures d'un escalier du haut duquel se donne à voir, dans toute sa splendeur, le grand miroir d'eau, puis, dans sa perspective mieux encore que cavalière, le château de La Roche Courbon lui-même.
Le revoilà qui bégaie. Mais tout de même, cette silhouette pataude (fermière d'été ? veuvorpheline de comédie larmoyante ?) ne manque pas de se diriger, d'un mollet agricole mais décidé, vers les marches inférieures d'un escalier du haut duquel se donne à voir, dans toute sa splendeur, le grand miroir d'eau, puis, dans sa perspective mieux encore que cavalière, le château de La Roche Courbon lui-même. ![]() Irons-nous porter nos regards vers Racan, ou vers la Vénus de Brassempouy ? Décidément, nous ne savons rien. le scripteur ne nous aide pas. Il faut refermer la parenthèse, retrouver la perspective mieux que cavalière du haut de laquelle -- n'y avait-il pas là quelque glougloutante fontaine ? -- nous pûmes admirer le grand miroir d'eau et au-delà, altier mais épars, le château de La Roche Courbon. Et de là rebondir
Irons-nous porter nos regards vers Racan, ou vers la Vénus de Brassempouy ? Décidément, nous ne savons rien. le scripteur ne nous aide pas. Il faut refermer la parenthèse, retrouver la perspective mieux que cavalière du haut de laquelle -- n'y avait-il pas là quelque glougloutante fontaine ? -- nous pûmes admirer le grand miroir d'eau et au-delà, altier mais épars, le château de La Roche Courbon. Et de là rebondir
(le grand mot des médias ; le grand mal du début de siècle )
et rafraîchir notre regard, si cela est possible.
Oh oui, cela est possible, même aisé. (Il bégaie, il zézaie. Réjean Ducharme m'ennuie : pourquoi fais-je pire ?) Possible de rafraîchir le regard, d'aligner les phrases, de se rappeler même les sept fois où vraiment je suis passé près de la chapelle des Carmes en la regardant pour de bon, non inattentif (si je peux risquer cette double négation), ne songeant pas à quelque maroquin, maudit rond-de-cuir !  Possible de rafraîchir le regard sans être obnubilé de l'obturateur, dératé du déclic (pourtant, sans ces clichés par milliers, aurais-je matière à tant de phrases ? ils sont le déclic), et d'échapper aux culs obliques (hardly a savoury phrase, quite a sorry sight too). Et, à la lisière du vendredi et du samedi, après avoir trimé sur les petits rectangles roses, bleus, jaunes ou verts du logiciel ADE (tels qu'ils apparaissent, sur les pages individuelles des emplois du temps, dans l'Environnement Numérique de Travail), le scripteur (qui n'est pas je : les instances importent) se repose-t-il vraiment à colorier des pattes-de-mouches ?
Possible de rafraîchir le regard sans être obnubilé de l'obturateur, dératé du déclic (pourtant, sans ces clichés par milliers, aurais-je matière à tant de phrases ? ils sont le déclic), et d'échapper aux culs obliques (hardly a savoury phrase, quite a sorry sight too). Et, à la lisière du vendredi et du samedi, après avoir trimé sur les petits rectangles roses, bleus, jaunes ou verts du logiciel ADE (tels qu'ils apparaissent, sur les pages individuelles des emplois du temps, dans l'Environnement Numérique de Travail), le scripteur (qui n'est pas je : les instances importent) se repose-t-il vraiment à colorier des pattes-de-mouches ?
(Trop de questions, trop de parenthèses. A quoi bon, alors, se passer des ratures ?)
dimanche, 21 novembre 2010
Feignant de s'étonner
Comme C. a écrit, dans un mail qu'elle m'a envoyé (oui, on peut travailler dans le même bureau, at home, et s'envoyer des mails - la vie moderne), faignasse, j'ai voulu vérifier si cette orthographe était acceptée, en alternative à feignasse.
Et là, stupeur ! j'ai toujours cru que fainéant, étant courant voire soutenu, était le terme originel, et que feignant, adjectif ou nom familier, en était la corruption ou l'altération. (Peut-être me suis-je vu confirmer cela, à une certaine période très germaniste de mon existence, par le fait que fainéant se dit Taugenichts en allemand...) Or, après vérification, feignant est attesté dès la fin du XIIème siècle ; il s'agit bien du participe présent de feindre (le feignant = celui qui feint de travailler). Et fainéant, donc ? Nettement postérieur, c'est ce mot qui est une altération, selon une rationalisation erronée attribuant à feignant l'étymologie "faire néant".
[ J'adore ces phases, dans l'histoire d'une langue, où des semi-érudits (dans mon genre) pleins de bonne volonté ont pensé corriger et simplifier une langue, semant en fait un bazar insensé. (Exemple : l'invention du verbe burgle en anglais, dérivation inverse de la plus belle eau.) ]
Si j'ai pu me laisser duper, c'est tout d'abord que l'étymologie de fainéant est tout à fait transparente (et pour cause : il s'agit d'une réinterprétation, un peu comme les étymologies à la Heidegger), mais aussi (surtout ?) qu'entre un terme courant et un terme familier, on a tendance à penser que le mot familier est une corruption du mot plus "noble". Pan dans les dents !
(Et c'est là un sujet bien choisi, qui tombe bien, bien-tombant, pour un dimanche pluvieux de novembre, à l'heure de la sieste !)
14:01 Publié dans Questions, parenthèses, omissions, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 20 novembre 2010
Pourquoi pour moi a des couilles
« J’écris des livres anti-patates : la patate y est contenue. »
(Tomates, p. 88)
Le dernier livre de Nathalie Quintane est peut-être son meilleur. (J’ai une véritable affection pour les textes de Nathalie Quintane – même les ratés comme Cavale*. C’est dire.)
Son titre ? Tomates**.
Le livre parle de plants de tomates (de purin d’orties, aussi), mais, à la faveur d’une métonymie originelle, dérive vers Tarnac et Julien Coupat. C’est ainsi que le livre finit par devenir (aboutit à) une sorte de poème-essai très beau, très drôle aussi, sur l’insurrection qui vient, Auguste Blanqui (le révolutionnaire, pas le boulevard), les émeutes en banlieue… Texte qui allie à une véritable audace formelle (ce qui signifie qu’il n’est pas constitué d’une suite de petites audaces formelles discontinues) une profondeur philosophique à faire pâlir Walter Benjamin (mettons).
Poème-essai ? pourquoi ? [« poème-essai » : ce n’est pas Quintane qui le dit, c’est moi qui l’écris.] La langue de Quintane est poétique ; son rapport au langage est de nature poétique. Pas poésie au sens d’invention stylistique, beauté rythmique etc. : « peut-être qu’un livre se juge aussi aux moments où il refuse de faire galoper le petit cheval » (p. 66) Et ESSAI : par la structure du discours (sauts et gambades) et sa teneur (je donnerai Badiou et tout Minc pour Tomates***).
Cela faisait bien belle lurette (dit le petit cheval) que je n’avais pas lu un texte aussi bref qui donne autant à réfléchir, et à rire ; pour l’alliance du rire et de la profondeur, je recommande sans conteste les deux pages sur les testicules (pp. 96-97 : « la couille est sans pourquoi »).
* Bien sûr, ce n’est pas Cavale qui est raté. C’est ma lecture de Cavale, au moment où je l’ai lu, qui a achoppé, échoué. Enfin, c’est pour moi un livre raté de Nathalie Quintane. Je conseille plutôt : Chaussure et Début. (Pour commencer.)
** Chez P.O.L., paru en septembre 2010. 144 pages, dont peu blanches, 80 francs pour les nostalgiques.
*** Cela ne m’est pas très difficile : je n’ai aucun livre de ces deux Alain(s ?).
14:33 Publié dans Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 09 novembre 2010
Etincelles d’un lundi
(Il faudrait en terminer de ces petits exercices d’écriture frustes, en ça frustrants. Mais ne serait-ce pas en terminer, déjà, de l’écriture, de sa reprise ?)
 Hier, patraque, rentrant de la fac plus tôt que prévu : la pluie torrentielle du matin se déversait au parking du 2e sous-sol [insérer litanie : avec l’argent dépensé pour les ridicules commémorations du 40ème anniversaire, on aurait pu colmater etc.], avec quatre heures de décalage, alors que brillait au-dehors, étincelant sur la statue dorée du monument aux morts comme sur les moindres hideurs de la ville, un magnifique soleil d’éclaircie automnale.
Hier, patraque, rentrant de la fac plus tôt que prévu : la pluie torrentielle du matin se déversait au parking du 2e sous-sol [insérer litanie : avec l’argent dépensé pour les ridicules commémorations du 40ème anniversaire, on aurait pu colmater etc.], avec quatre heures de décalage, alors que brillait au-dehors, étincelant sur la statue dorée du monument aux morts comme sur les moindres hideurs de la ville, un magnifique soleil d’éclaircie automnale.
Le soir, guetté par l’insomnie, glandouillant : passé presque une heure à écumer l’œuvre récent du duo des frères Mael, Sparks, le seul groupe anglo-saxon (avec Talking Heads) que j’aie vraiment aimé dans mon enfance. Revient alors la fureur grise des circonflexes, vous vous en doutez : journées de novembre passées près du gramophone (qui n’en était pas un, mais le mot n’est-il pas poussiéreusement désuet ?), à me passer les toasts noirs de Charlélie Couture ou de Sparks, justement, dont les chansons, avec leur rose vivacité ou leur violette mélancolie, donnaient un cadre sonore à mes plus banales imaginations. Dans le sous-bois, après (disons que j’avais neuf ans ?), ou pataugeant dans la rivière, plus loin (onze ?), je pouvais soit me taire pour observer tel ou tel troglodyte en chantonnant That’s Not Nastassia in petto, ou chanter à voix douce, audible de tous les oiseaux qui allaient alors s’enfuir, Tips for Teens (juste un exemple : je ne possédais qu’un vinyl de Sparks, que mes parents ont ramené d’Angleterre, je m’en avise maintenant, en avril 1985 – donc mes années Sparks furent forcément pré-adolescentes, comme on ne disait pas (aujourd’hui, l’adolescence ne dure-t-elle pas vingt ans au bas mot, de la prépré à la post-post ?)).
Méandres du circonflexe, certes. Soyons perplexes. Je ne connaissais que l’album Whomp That Sucker ! – qui, incidemment, fut ma première introduction à la nuance entre les déictiques this et that, puisque l’index des morceaux des deux faces figurait sur une seule étiquette : j’avais donc appris, avant d’apprendre l’anglais, que les morceaux de « this side » étaient du côté de l’étiquette écrite, alors que les morceaux de « that side » étaient du côté non écrit. Ce seul album, noir (oxymore après la synesthésie, 2010 est une année trop laborieuse). Cet unique recueil de 10 chansons. Pendant vingt-cinq presque trente ans. Les chansons de Sparks, toutefois, ont mené, dans mon existence, dans ma mémoire, une course souterraine. (Et je m’en ravise, en fait, mes parents avaient ramené l’album de notre périple familial en caravane, été 1982. [Très vague souvenir d'une de leurs amies, Edna (?), qui tenait (?) un magasin de musique. Où ? Dans le nord de l'Angleterre ?] J’avais donc raison en me revoyant enfant, vraiment pas grand. D’où le barré dans la phrase pénultième.) À peine plus tard, ma tante maternelle m’avait parlé, peut-être parce que j'avais chanté Wacky Women (j'adore, surtout la rime Russell / muscle)), de « Pineapple », que je n’ai entendu qu’hier. Course souterraine : j’ai mis plus de vingt ans à avoir la curiosité minimale de chercher la version originale de « Pineapple », dont je me rappelle très précisément comment ma tante l’avait chanté, cette seule et unique fois.
Curieuse chose, livide mais aussi bien vive, soudainement passée à la flamme, la mémoire.
Je ne vais pas en faire fromage. (Il faudrait etc.) Quel âne à nasse.
 En tout cas, hier soir, j’ai découvert certaines chansons des derniers albums de Sparks, années 2000, et j’ai décidé de me faire un petit cadeau, automne oblige, en commandant 3 albums, soit anciens soit récents. Assumant un héritage compliqué de mon enfance. M’assommant sous de diffus souvenirs. Les panthères rugissent, pas les félins. Et pour le reste, il y a le vert de la sérénité.
En tout cas, hier soir, j’ai découvert certaines chansons des derniers albums de Sparks, années 2000, et j’ai décidé de me faire un petit cadeau, automne oblige, en commandant 3 albums, soit anciens soit récents. Assumant un héritage compliqué de mon enfance. M’assommant sous de diffus souvenirs. Les panthères rugissent, pas les félins. Et pour le reste, il y a le vert de la sérénité.
16:10 Publié dans Blême mêmoire, Moments de Tours, Questions, parenthèses, omissions, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (5)
mercredi, 03 novembre 2010
Let's Get to the Nitty Gritty
Bientôt midi, bientôt l'heure d'essayer, dans la douceur automnale, d'aller chez le coiffeur. Mais enfin, je ne suis même pas rasé, j'ai une tronche de décavé. Une vache lancée à plein galop, un couple d'amoureux, un Christ en croix : les téléchargements simultanés provoquent des effets de contiguïté intéressants. Trop précieuse, l'écriture d'Hélène Grimaud m'éloigne de son expérience. Un quintette qui sonne exactement comme un medium band, ce pourrait être l'une des définitions du hard bop, encore que Horace Silver n'appartienne ni au hard bop ni au cool jazz. Sorte de mixte des deux. Naguère (presque jadis), ce genre de texte trouvait naturellement sa place dans mon autre blog carnétoile. Il est des mots bannis, je peux taxer les autres de préciosité... Et aller se raser au lieu d'ennuyer tout le monde ? C'est assez poil à gratter, ça agace, et les pétales givrés sur un océan bleu dévisagent le pianoteur (pinailleur), lui demandant encore et encore de se lever de son fauteuil, et d'aller une bonne fois pour toutes se raser avant d'essayer d'aller chez le coiffeur. Curieuse expédition, que semblent décourager les brassées vives de feuilles d'un jaune éclatant, envahissant de leur lumière la bibliothèque (les deux néfliers, un roman sans cesse à recommencer). Et si j'y allais ? Les boules parfaitement sphériques, juste évasées, brunes et plombant les branches entre les feuilles d'un or terne étincelant, sont pareilles à des yeux exorbités, m'interrogent, ou m'exhortent, ou me fusillent. Il faut bien embrayer, se lancer à corps perdu dans la jungle (pianotements têtus vers 5'15") jaune, roussâtre, d'albâtre vous mettrez l'adjectif ou le qualificatif que vous préférez. Au point où j'en suis (même pas rasé en plus (il a fallu, ici, se baisser au ras du carreau pour vérifier le minutage (et plus qu'une minute pour clore l'écriture de ce texte))), je peux vous laisser les clefs. La porte fermée. Le coiffeur ne m'attend même pas ; il prend sans rendez-vous. Et ça résonne, au ralenti, comme un medium band de foire du mercredi, en attendant la sirène du début du mois : bientôt midi.
11:55 Publié dans Jazeur méridional, Moments de Tours, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 24 octobre 2010
Vertige morbide
Tout de même, ce peut être vertigineux, la publication anticipée (ainsi que cela se nomme).
Ainsi, ce vendredi, avant de quitter mon bureau, sachant que je n'aurai pas de connexion Internet pendant plusieurs jours sur la fin du mois d'octobre, j'écris ce petit texte afin qu'il vienne renouveler mon stock oiseux de balivernes, et en prévois la publication d'ici quelques jours...
Que serai-je vraiment, que serai-je devenu d'ici ce dimanche, après-demain, si proche, si lointain ? Serai-je sous le soleil, au froid des glaciers, écrasé contre un pont d'autoroute, en train de faire la sieste etc. ?
(Alors, quoi ?) Se projeter : n'est pas possible.
13:45 Publié dans Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (1)
mardi, 12 octobre 2010
(peu de) Café :
Le café n'y suffit pas. Six heures du matin, mardi, pas moyen de dormir, d'où levé depuis deux heures déjà. Pas possible de tenir le coup même avec le café (froid à peine bu, qu'est-ce que ça veut dire). S'est aperçu, le farfadet qui tient son log-book ailleurs, que ça prend moins de temps d'écrire à jet continu que de recopier soigneusement telle ou telle page, et l'odeur du vinaigre blanc n'y changera rien. Sait pertinemment qu'hier dans le bus 10, une fois dépassée la place René-Coty, il a songé à un très beau billet sur une scène de son enfance (de sa jeunesse ?), pour Blême mêmoire, mais qu'elle a disparu (irrémédiablement ? il faut diablement se méfier de ces adverbes) ; c'était en lisant Beinstingel, coincé contre une belle rousse. Au retour, le soir, dans le bus 1A (il faut bien varier les plaisirs), il ne put même pas extirper le livre du sac de toile Mobility Forum (la classe - en toile verte et blanche, pas un rond, une sous-bouse mais australienne, je vous prie). Et à part ça, quoi ? Rémi Latapy a triomphé à Pécorade. Bruit de mobylette NR dans la rue Mariotte. Quitte l'école taurine - pour une ganaderia de formelle ?? Froid, bu, disparu, insuffisant : le (peu de) café.
06:09 Publié dans Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (1)
vendredi, 08 octobre 2010
Weshalb, deswegen
How typical of me !
Mardi soir, après une longue soirée, j'ai commencé la lecture de La Mise en scène (Claude Ollier est, d'une certaine façon, ou dans un certain genre d'écriture, un de mes écrivains préférés -- pourtant, je n'ai jamais lu son roman le plus célèbre, ni d'ailleurs aucun des huit tomes du Jeu d'enfant).
Mercredi après-midi, voulant passer un peu de temps au salon avec les garçons, j'ai commencé Bestiaire domestique de Thierry Beinstingel (j'en suis parvenu à "Pigeons : 5"). Le soir même, j'ai poursuivi, à peine quelques instants, La Mise en scène (j'en suis au début du chapitre V, pas de quoi pavoiser).
Et jeudi soir, vers six heures, me trouvant sur la terrasse, puis dans le rond-point de l'impasse, à surveiller Oméga (tracteur, vélo), j'ai saisi le livre arrivé par la Poste le jour même, Black Dogs d'Ian McEwan, dont j'ai atteint la page 30, avec maintes interruptions, le temps d'y admirer bien des phrases, et d'y remarquer aussi que l'action se situe à Saint-Maurice de Navacelles (où je fus ce mois d'août).
Ainsi, alors que je croule encore sous diverses tâches qui vont blinder désagréablement et puissamment mon week-end, me voici à la tête de trois ouvrages en train, dont un au moins n'a rien d'un opuscule. (Mais, si je finissais fissa Bestiaire domestique, le jeudi soir, qui me dit que je ne me saisirais pas d'Eloge de la marâtre le vendredi au petit bonheur, au retour de la fac ?)
Wie typisch Ich !
06:00 Publié dans Ex abrupto, Moments de Tours, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)