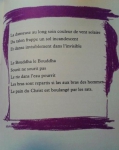vendredi, 14 août 2020
Présomption
Saint-Cirq Lapopie, où nous n’étions pas allés depuis ce fameux été 1999. Cette fois-ci Alain Prillard exposait carrément dans le Musée Rignault. Très belle rétrospective, avec toujours les linotypes, des toiles récentes moins convaincantes et des sculptures en fer forgé très réussies. La plupart des sculptures perdraient une partie de leur charme en dehors de cet écrin de collines pentues et de pierres calcinées. La maison d’André Breton semble, non pas à l’abandon, mais enfin…
À Domme, personne ne portait de masque dans la Grand’Rue bondée. L’hôtelier ne l’avait ni pour nous accueillir ni dans l’hôtel même ; même aberration le soir avec le patron du restaurant (alors que les serveurs étaient dûment masqués). Le soir, en promenade, nous avons discuté avec un cycliste qui cherchait le site de tournage du Tatoué (film pas vu). C’était, finalement et tout simplement, la Porte des Tours.
23:14 Publié dans *2020*, Autoportraiture, BoozArtz, Hors Touraine, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 04 mai 2020
Un beau bouic par Beuys
Levé tôt, avant même le réveil, à 6 h 30. Raté le café, c'est assez rare pour être souligné : il m'arrive d'avoir la main lourde, mais cette fois-ci j'ai fait, exceptionnellement, un café trop léger. C'est vraiment infect.
La journée est studieuse pour tous ici, dans la maisonnée : A* a deux examens à distance, dont un de maths tous les matins de la semaine à 7 h 30 ; O* en face de moi écoute des documents en espagnol pour une compréhension orale ; C* dans la chambre fait un cours en visioconférence ; de mon côté, j'ai déjà fini un de mes 5 paquets de copies, traité les mails professionnels, commencé à préparer le cours de demain matin (commentaire de texte sur un extrait de Gordimer). Suis en pleine lecture et correction aussi du chapitre que m'a envoyé mercredi dernier mon étudiant de M2.

Hier, je me suis “débarrassé” de la vidéo très longue dont j'avais commencé l'enregistrement le 6 avril. Une bonne chose de faite, en attendant mon improbable liste des 100 (73 ? 41 ?) livres majeurs du 21e siècle. — Hier soir, aussi, le nanard du dimanche soir : Les Bons Vivants, film à sketches de 1965 qui n'est (vaguement) sauvé que par le troisième “acte” et un de Funès en pleine bourre. Petit détail, l'excellent dictionnaire de l'argot Bob suggère plusieurs citations pour le mot bouic, synonyme de bordel que je n'avais jamais rencontré.
10:32 Publié dans *2020*, BoozArtz, Flèche inversée vers les carnétoiles, Tographe, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 28 janvier 2020
Arithmétique et tricherie
J'ai lancé, pour 2020, sur l'autre blog, un ambitieux projet d'écriture dont j'ai donné les principes à quelques ami·es, sur Facebook. Ce texte s'intitule pour le moment lactations: déSastre.
Ce texte, qui doit in fine se composer de 555 textes principaux (+ 1 poisson d'avril), est constitué de quadrilatères. Cela signifie que j'écris toujours les textes par groupes de 4. Je viens de composer le quadrilatère 53-56 en une demi-heure, ce qui est assez rapide, et surtout j'ai composé le dernier en moins de huit minutes : cela signifie qu'il m'a fallu un peu moins de deux écoutes de la K56 de Scarlatti par François Guerrier pour écrire le texte, le mettre en forme pour le blog, y ajouter les liens hypertexte puis le mettre en ligne.
Cette rapidité est liée au fait qu'une fois le texte fini, j'ai vérifié le nombre de signes : 841. Soit pile le nombre que doit avoir chaque texte multiple de 4. J'avais vérifié le nombre de signes avant d'écrire la dernière phrase (en fait, pour savoir s'il n'était pas déjà trop long). Il y avait 740 signes. J'ai écrit une phrase supplémentaire, que je pensais trop longue également. Cette dernière phrase était donc longue de 101 signes, exactement la longueur souhaitée.
Il y a des jours, comme ça, où ça s'embouche bien.
________________________________________________
La raison pour laquelle j'ai voulu aussi écrire un billet ici, c'est parce que la vidéo YouTube utilisée pour écouter une version de la sonate K56 reproduit, de manière partielle et sans indiquer aucune référence, la toile célèbre de Caravage, Les Tricheurs. Or, cela m'a fait penser qu'une façon de faire déraper ce projet déjà insensé serait de dériver vers les références picturales des vidéos YouTube. Par lâcheté, je préfère prétendre que cela reviendrait à tricher.
13:45 Publié dans *2020*, BoozArtz | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 11 février 2018
Traduire “A Humument”
Hier, j'ai donc enregistré, au petit salon à l'étage, ma 137e traduction improvisée, ou traduction sans filet. C'est un chantier qui me tient à cœur et que j'ai relancé en 2018 avec pour principe de ne pas dépasser 10 minutes et d'en enregistrer 3 par semaine en moyenne.
Hier, c'était effectivement la troisième de la semaine, de sorte que, si j'en enregistre une aujourd'hui, ce sera en bonus, ou en prévision de semaines moins fastes. (Il y a ce genre de calcul dans le roman d'Ursula K. Le Guin que je suis en train de lire, The Left Hand of Darkness : le premier ministre déchu et l'Envoyé doivent gagner la frontière de Karhide, et, pour ce faire, couvrir 800 miles en 70 jours en traversant un immense glacier. Les journées où ils ne parcourent que 6 ou 8 miles en raison de la pluie et des ascensions difficiles s'achèvent dans le doute ou la déprime.)
Hier, je me suis décidé — mais comment l'idée ne m'en était-elle jamais venue ? — à traduire une page de A Humument. Bien entendu, j'ai choisi une seule page, la page 198, mais “traitée” différemment dans deux éditions différentes. Quand j'enregistrerai le dixième épisode de la série JE RANGE MON BUREAU, je parlerai encore de A Humument. Hier, j'ai tout de même bafouillé cinq minutes avant de traduire à proprement parler, ce qui ex plique un léger dépassement du temps maximal autorisé : la vidéo fait 10 minutes et 56 secondes. Il aurait suffi d'un montage un peu nerveux pour descendre en-dessous des 10 minutes, mais c'est un autre principe : si je procède à un montage, ça me prend entre 30 et 90 minutes, et ce projet ne peut se maintenir s'il devient aussi chronophage.
A Humument — je n'en reparle pas ici ; je l'ai souvent fait ; je renvoie le lecteur égaré ici à la préface de Tom Phillips, disponible sur son site à l'instar de nombreux documents et reproductions de l'œuvre.
Dans la vidéo, je ne suis pas parvenu à traduire de manière satisfaisante la paronomase triple shuttered/ fluttered/ muttered. Je n'y reviens pas ici, mais ce qui m'a frappé, en fait, c'est que le contenu presque arbitraire de certains redécoupages en îlots rendait plutôt aisée la tâche de traduire. En d'autres termes, comme je le dis dans la vidéo, cela fait bientôt treize ans que je connais cette œuvre et la traduire ne m'avait jamais traversé l'esprit. Je songe à le faire avec l'édition la plus courte à ma disposition, The Heart of Humument. Il faudra respecter la disposition et surtout la longueur des phylactères, comme pour une bande dessinée. Si je m'y mets vraiment, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps.
(Dans un autre ordre d'idées, si quelque généreux mécène ne sait pas quoi m'offrir pour me remercier de mes blogs et de mes vidéos, voici quelques suggestions. ;) )
07:14 Publié dans BoozArtz, Improviser traduire | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 06 février 2018
66 secondes de lecture, 27 : les fausses évidences de Tom Phillips
Après avoir reçu, aujourd'hui, dans la boîte à lettres que commençait à recouvrir la neige, l'édition définitive (final edition) de A Humument, il était évident que c'était ce livre qu'il fallait choisir pour la lecture du jour, oubliée le matin faute de temps.
Et n'est-il pas évident, depuis le temps que je tourne autour de ce(s) livre(s), ou que ce projet ferraille en moi, qu'il faudra consacrer une traduction improvisée à une page de A Humument ? Pourquoi pas la même page dans 4 éditions différentes ? (Je ne possède pas, hélas, la première édition.)
18:30 Publié dans 66 SECONDES DE LECTURE, BoozArtz | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 03 février 2018
37 shenanigans
17:06 Publié dans BoozArtz, Nathantipastoral (Z.), Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 27 janvier 2018
66 secondes de lecture, 17 : “children opened the imagination”
Pour la dix-septième lecture à haute voix, un défi & un plaisir : en revenir (toujours) à ce chef-d'œuvre sublime, drôle, joyeux, beau, A Humument de Tom Phillips, l'œuvre d'une vie. J'en ai déjà parlé par le passé dans ce blog, et me contente aujourd'hui de renvoyer au site officiel de Tom Phillips.
Ici, j'ai donc ouvert au hasard la quatrième édition (je possède un exemplaire de la 2e et un de la 3e) et tenté de lire le texte formé par les phylactères non caviardés. Ça fait une sorte de poème, mais en improvisation ma lecture s'est faite trop solennelle, pas dans le ton de l'œuvre.
Peu importe.
C'est un livre auquel, forcément, je reviendrai.
(Autre innovation : en écho à cette première lecture d'un texte “illisible”, j'ai lu avec un fond sonore, en quelque sorte. En général, c'est une mauvaise idée ; la variation exige que cette série de lectures à voix haute soit, parfois, constituée de mauvaises idées. — Il y a aussi le fait, agaçant mais auquel je finis par me résigner, que le smartphone a tendance à flouter soudainement, et pendant plusieurs secondes, l'image : c'est gênant pour moi, qui lis en fait à l'écran (car l'écran souvent me cache la page), plus que pour l'éventuel vidéospectateur, qui, après tout, est censé m'écouter.)
10:01 Publié dans 66 SECONDES DE LECTURE, BoozArtz, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 02 décembre 2017
Hommage à la mafieuse

16:20 Publié dans BoozArtz, Nathantipastoral (Z.), Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 24 février 2017
“That's a pure Malevitch”
Il y a trois ans, je faisais réciter par écrit un poème de Dickinson que j'avais fait apprendre par cœur à mes étudiants de première année... l'occasion d'être un peu sarcastique.
De mémoire, l'étudiante n'était pas venue me demander d'explication sur l'annotation, et aurai-je la naïveté de penser qu'elle a gouglé Malevitch ?
12:00 Publié dans Autoportraiture, BoozArtz, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 08 juillet 2016
charrette à bras
ça semble un enfant au cerceau
& ce serait un charretier
pas rue du château des rentiers
où dort le mort dans son berceau
d'un épais trait d'encre de chine
tel pour le croquet les arceaux
dépenaille tous les pinceaux
le diable veille à sa machine
ton regard hautain pas altier
s'abstient d'embrasser les chantiers
pour y dénicher la bobine
d'un trait d'encre de chine épais
tel que sous la télécabine
on prend le forfait au rabais
08:59 Publié dans BoozArtz, Ecrit(o)ures, Sonnets de janvier et d'après | Lien permanent | Commentaires (1)
samedi, 09 avril 2016
Léo & Pipo dans le rétro
Ce matin, en allant récupérer la voiture à Charenton (et j'en profite pour recommander très vivement le site Néoparking, qui nous a permis de garer notre véhicule pour 7 jours tout près de notre logement parisien pour 41 euros), j'ai photographié, comme samedi dernier, un des nombreux pochoirs reproduisant une citation de Camille Claudel, et qui émaillent (recouvrent ? décorent ? (peut-on émailler un trottoir ?)) le trottoir qui mène de la porte de Charenton au métro sis sur l'avenue de Paris.
Au retour, en voiture, sur la rue qui porte le nom de la fondatrice — ainsi que je l'ai appris cette semaine — du Planning familial*, j'ai vu (et également photographié) un mur que décorent deux œuvres de street art, toutes deux immédiatement identifiées par ma mère. La plus réussie des deux est donc l'œuvre du duo, fort connu semble-t-il, Léo & Pipo. Le smartphone ayant publié automatiquement la photographie en indiquant l'heure de la prise de vue, j'ai pu constater que j'avais raté d'une seconde la perfection : il était 9 h 09... et 10 secondes.
17:51 Publié dans BoozArtz, Hors Touraine, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 27 janvier 2016
L'étrange sérénité des fonds marins
Ce texte de Christian Garcin, publié fin 2014, se présente sous la forme d'un petit format carré glissé dans une pochette en plastique et qui, quand on commence à le lire, se déplie soit comme un livre classique soit en accordéon aboutissant à un octogone, les pages formant un rempart autour du vide. L'éditeur se nomme circa 1924, et à n'en pas douter il y a un véritable choix de proposer autre chose qu'un texte en ligne (ici : un texte crénelé).
Objet sobre et marquant, ce mince volume est porteur d'un texte qui est loin d'être anecdotique. Je l'ai lu une première fois il y a une semaine, et la Mina du texte m'a d'abord évoqué la M'dina de Sardines, puis, une fois ma comprenette désalentie, je me suis rappelé avoir déjà rencontré le nom de Mina Loy, déjà associé à celui d'Arthur Cravan.
Le texte raconte un moment dans la vie de ce bizarre couple, juste avant la disparition de Cravan, en 1918. Garcin s'est inspiré d'une série de photographies faussement anciennes (le rabat les nomme “pictorialistes” et les attribue à un certain Hugo Brehme [j'apprends donc à cette occasion que ce n'est pas par un effet de fausse ancienneté mais bien parce que ces images sont peu ou prou les contemporaines de l'idylle imaginée entre Cravan, ici “Colossus”, et Mina Loy qu'elles semblent anciennes, tant pis, je laisse mon erreur puisque ce crochetage l'affirme : elles ne sont pas faussement anciennes !]) pour raconter comment, au Mexique, Cravan et Mina Loy cherchent une cathédrale rose : d'une part, les photos sont sépia ; d'autre part, comme l'écrit Garcin, au Mexique « de nombreuses cathédrales sont roses : comment trouver la bonne ? ».
De Mina Loy — que, moi aussi, en fin d'adolescence, j'avais provisoirement confondue avec Myrna Loy —, retenons, pour le moment, un poème, Lunar Baedeker qui n'est pas sans échos avec le texte de Garcin.
L'expression citée entre guillemets, « au torse immature de bébés géants », provient d'un poème de Mina Loy, “Property of Pigeons” (dans le texte : the immature torsos / Of their giant infants). Je ne le mets pas en lien, car Google Books est un répertoire particulièrement bordélique et difficile à consulter, mais cela se retrouve facilement — un très beau poème, aux pages 120-1 du recueil posthume The Lost Lunar Baedeker (repris en 2015).
De Cravan, je mets en lien le texte singulier (détestable ? Cravan voulait-il se dépeindre de manière à ce qu'on le trouvât détestable ?) sur André Gide. Je pense que Breton, devenu un poil dogmatique à partir de la fin des années 20, ne devait pas se retrouver totalement dans cette ambivalence opaque.
22:54 Publié dans BoozArtz, Larcins, Le Livre des mines | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 11 novembre 2015
Sarihs
J'ai donc 41 ans, ai passé une agréable journée (nuageuse et tiède) en famille – dont un déjeuner tout à fait honorable au Bistrot de la Tranchée – ai été gâté, ai reçu plusieurs coups de fil, ai passé trois heures à déménager des étagères et à réorganiser tous les rayonnages de littérature étrangère en traduction (presque 7 ans après l'emménagement ici, tout un programme), et poursuis donc le plan quotidien de reprise des publications, à quoi s'ajoute le nouveau texte, sur l'autre carnétoile. En revanche, je n'ai toujours pas mis au propre ma recension du Lit des ombres de Victor Kathémo, dont j'ai terminé la lecture dimanche à l'aube... et j'ai peur que, les jours passant, je ne perde le fil de ce que j'avais à en dire.
L'artiste qui marquera ce jour est George Shiras, dont j'ai découvert – via le livre préfacé par Jean-Christophe Bailly – l'existence, et le travail précurseur.
Sur l'exposition, lire ici. ▓▒░ Sur les pièges photographiques, plus particulièrement : LÀ.
20:34 Publié dans 10 ans, BoozArtz, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 10 novembre 2015
Une suite & 1 photo
Juneteenth est une suite pour piano seul de Stanley Cowell. Sur l'album que vient de publier le jazzman américain, les 15 mouvements de cette suite sont précédés d'un titre en forme de prologue, “We Shall 2”. L'album est publié sur le label français de “musique narrative”, Vision Fugitive. L'occasion en est le cent-cinquantenaire de l'abolition de l'esclavage, qui fut célébré le 19 juin dernier.
Je connais mal Cowell ; un rapide survol de mes étagères me rappelle qu'il joue sur certains albums plus ou moins fétiches de ma discothèque (le disque de standards de J.J. Johnson au Vanguard, un Stan Getz...) Se proclamant narrative, Juneteenth s'inscrit pleinement dans cette optique, puisqu'il s'agit d'une suite dédiée à la mémoire des esclaves afro-américains et inspirée par une série de photographies et de documents liés à l'histoire de l'esclavage et inclus dans le livret, sans autre explication. Les titres des mouvements marquent assez nettement le rapport avec le sujet annoncé, mais j'avoue avoir beaucoup de mal avec la musique narrative... en d'autres termes, ne rien y entendre, stricto sensu. Cela est vrai de certaines symphonies de Beethoven, qui me bouleversent mais où je suis infoutu d'entendre tel épisode ou tel phénomène naturel que l'orchestre, sur ces mesures, est censé mimer, mais aussi d'autres œuvres, comme cette suite.
Pour ce que j'y entends (guère, je l'ai déjà écrit maintes fois), le piano, très improvisé/maîtrisé, de Cowell penche plus du côté d'Erroll Garner (“Ask him”) et de Debussy (voire de Stockhausen (cf le “Finale”)) que du negro spiritual, même si un des plus beaux mouvements, “Commentary on Strange Fruit”, est une longue variation à partir du thème de When the Saints. Le huitième est un blues lumineux et mélancolique. Le long mouvement final, “Juneteenth Recollections” est le plus complexe, peut-être celui où Cowell se livre le plus à une forme d'introspection : cette suite est-elle l'aventure d'une mémoire individuelle aux prises avec la mémoire collective ?
Une des photographies du livret m'a, plus que d'autres, intrigué. Elle représente deux ou trois familles de Noirs, très jeunes pour l'ensemble, sept ou huit adultes, et trois très jeunes enfants, dont l'un dort, au premier plan, allongé sur une sorte d'édredon très blanc. Presque tous regardent vers la droite et se trouvent sur une langue de terre entre deux grandes étendues d'eau (on voit des peupliers inondés, au fond, à gauche). Le titre en est “Refugees on levee, April 17, 1897”, et elle se trouve dans le fonds photographique de la Librairie du Congrès. J'avoue que mon ignorance me fait m'interroger sur ces “réfugiés”, quarante-deux ans après l'abolition de l'esclavage : a-t-on continué de nommer réfugiés, comme naguère les esclaves fuyards, les Noirs fuyant la ségrégation des États du Sud ? ou le titre joue-t-il sur le sens de réfugiés, car cette douzaine de sujets bien vêtus ont-ils simplement trouvé refuge sur la digue (la levée, dit-on en Touraine) ? et où cette scène a-t-elle été saisie ? Heureusement, la notice détaillée de la photographie dans le catalogue de la Library of Congress offre toutes les réponses : cette photographie a bien été prise à Grenville, dans le Mississippi, et si tous les adultes regardent vers la droite, hors cadre, c'est qu'ils se sont effectivement laissés piéger sur cette langue de terre et qu'ils attendent le navire qui va venir les secourir.
14:17 Publié dans BoozArtz, Jazeur méridional, Pynchoniana | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 27 novembre 2014
Violons pour L’Uræus
Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’Alechinsky – lui dont les belles planches pour le Traité des excitants modernes de Balzac m’ont tant ému – ne s’est pas trop foulé pour illustrer (encadrer ? ses traits violets servent en effet de marges aux poèmes de ce bref recueil) L’Uræus de Salah Stétié. Les traits du premier poème sont très dynamiques, avec trois fois rien Alechinsky invente un monde ; et puis après, on a l’impression qu’il s’est désinspiré.
(Ce n'est pas la page que j'ai choisie comme illustration de ce billet. Ici ↓ je reprends le poème dansé/dansant.)
Il a résisté à la tentation de dessiner ou d’évoquer des cobras (l’uræus est, je l’apprends à cette occasion, le cobra femelle (pas une seule occurrence de ce mot dans l’ensemble des textes intégraux mis en ligne sur le site Latin Library (!??))), tout comme Stétié n’explicite guère son titre. Certains poèmes sont très forts, prenants, résonnent. Il y a au moins un choix de préposition que je ne comprends pas :
Des enfants pourtant crient sur un préau d’école
ils vivent tous sur un seul grain de sable
échappé
Le premier sur est-il appelé par le second ?
Beau mot, en tout cas, que préau, peu présent en poésie ni prose. Citons seulement Les Misérables : « La première chose qui le frappa dans ce préau, ce fut une porte du seizième siècle qui y simule une arcade, tout étant tombé autour d'elle. »
10:04 Publié dans BoozArtz, Lect(o)ures, Où sont passées les lumières? | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 22 novembre 2014
Lenka Clayton
Cette artiste propose des œuvres qui font une sorte de synthèse légère entre le pop art, l'OuLiPo et les tentatives plus objectales ou sérielles d'un Rauschenberg. C'est souvent amusant, toujours émouvant.
▬·▬·▬ Entre la pile de livres dont les titres vont de 1 à 50, le voyage de James et Lenka en vélo de James à Lenka, et enfin la prouesse consistant à faire tenir des confetti en colonnes, mon cœur balance !
08:55 Publié dans BoozArtz | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 18 octobre 2014
Humumental
24 septembre
The Heart of Humument, finalement, n'est pas la 1ère édition, mais, pour 25 euros, une curiosité valable : tiré-à-part à 367 exemplaires d'une partie des pages de l'édition 1, en Allemagne en 1985 — donc une pierre à ma collection humumentale, tout de même.
Sinon, No Longer At Ease, que je devais racheter parce que ça fait partie (avec les Tutuola) des bouquins que je prête et que je ne vois jamais revenir, est arrivé dans une collection dégueulasse de 2013, un truc ronéo, éditions "Important Books" je crois (!) — bref, un exemplaire à donner ou à enterrer dans un rond-point — et je peux me recommander la Heinemann.
10:42 Publié dans Affres extatiques, BoozArtz | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 16 octobre 2014
Expositions Gilles Caron & Jean-Luc Olezak, au Château de Tours
Aujourd'hui, peu avant la clôture des diverses expositions du château, nous sommes allés voir l'exposition Gilles Caron, en partenariat avec le Musée du Jeu de Paume, et celle consacrée, sur le dernier étage, à un photographe tourangeau d'origine polonaise, Jean-Luc Olezak, dont le nom, apparemment, devait à l'origine s'écrire Olczak.
Gilles Caron est très célèbre, non seulement parce qu'il est l'auteur de reportages de guerre mémorables et de photographies non moins célèbres (les enfants dénutris du Biafra, images magnifiques et atroces, ou le Cohn-Bendit jovial souriant à face d'un CRS sur un trottoir parisien), mais aussi pour avoir fait partie des photographes retranchés dans une école, en plein désert, avec les rebelles du Tibesti. Cette histoire, grave, lourde de symboles, je la connaissais pour l'avoir lue et entendue de Depardon. Ce que j'ignorais, c'est qu'il n'était pas mort jeune, mais qu'il avait disparu en 1970 en territoire khmer rouge. Disparu, cela signifie que son corps n'a jamais été retrouvé, non ?
Ce que j'ai découvert, dans cette exposition qui permet d'espacer les vues, de faire respirer le regard entre chaque série, grâce aux belles et vastes salles du Château, ce sont les photographies de manifestations en Irlande du nord, mais aussi que Gilles Caron — lui, dont le nom suggérait ce retournement du chapeau circonflexe ou incurvé de Twiggy en un œil acéré tourné vers toute la saloperie militaire de ce monde — avait commencé par la photographie de mode.
 Jean-Luc Olezak, lui, n'est pas, à ma connaissance, très connu. Pourtant, cette rétrospective, qu'il ne reste que trois jours pour aller voir, contient quelques véritables pépites. Par-delà l'aspect amusant (mais anecdotique) qui permet de revoir tel lieu tourangeau qui s'est déjà, même en dix ou quinze ans, métamorphosé, Olezak porte un regard profond, mais sans sécheresse, sur les gens et sur les lieux. Le risque est parfois qu'un certain kitsch vienne côtoyer une plus rigoureuse beauté, ainsi de ce diptyque de la Tour Eiffel : dans une image, superbe et qui n'est pas sans évoquer Kertesz, à une Tour Eiffel tronquée dans le ciel grège répond une flèche semblablement étêtée sur le bitume gris... et dans l'autre, un orteil flou, au premier plan, semble toucher le haut de la Tour Eiffel en arrière-plan (le comble du kitsch à cartes postales). Peut-être le tri n'a-t-il pas été fait très judicieusement, car on sent que sur certaines séries, il doit y avoir des dizaines d'autres photographies tout aussi fortes dans les cartons de l'artiste... à moins que ce kitsch ne soit le goût que l'on souhaite aussi inculquer, ou respecter chez certains visiteurs ?
Jean-Luc Olezak, lui, n'est pas, à ma connaissance, très connu. Pourtant, cette rétrospective, qu'il ne reste que trois jours pour aller voir, contient quelques véritables pépites. Par-delà l'aspect amusant (mais anecdotique) qui permet de revoir tel lieu tourangeau qui s'est déjà, même en dix ou quinze ans, métamorphosé, Olezak porte un regard profond, mais sans sécheresse, sur les gens et sur les lieux. Le risque est parfois qu'un certain kitsch vienne côtoyer une plus rigoureuse beauté, ainsi de ce diptyque de la Tour Eiffel : dans une image, superbe et qui n'est pas sans évoquer Kertesz, à une Tour Eiffel tronquée dans le ciel grège répond une flèche semblablement étêtée sur le bitume gris... et dans l'autre, un orteil flou, au premier plan, semble toucher le haut de la Tour Eiffel en arrière-plan (le comble du kitsch à cartes postales). Peut-être le tri n'a-t-il pas été fait très judicieusement, car on sent que sur certaines séries, il doit y avoir des dizaines d'autres photographies tout aussi fortes dans les cartons de l'artiste... à moins que ce kitsch ne soit le goût que l'on souhaite aussi inculquer, ou respecter chez certains visiteurs ?
17:54 Publié dans BoozArtz, Moments de Tours, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 04 janvier 2014
Signets peints
Essayant de rester concentré sur la Deuxième de Mahler (par Abbado, toujours le coffret), je lisais le livre XXXV de l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien (très instructif *), la chatte sur les genoux — et figurez-vous que cette andouille de bestiole, qui semblait profondément assoupie, calée entre mes cuisses et mes genoux, n'a rien trouvé de mieux que de prendre le signet du Pléiade, qui ballait mollement non loin de son museau, pour un fil de pelote et donc de s'y attaquer, elle qui est si peu joueuse. Il va de soi qu'elle s'est coincée une griffe dans le dit signet tout en le lacérant. Après avoir décoincé la griffe de la demoiselle (sur un violent passage cuivré), j'ai repris ma lecture, en veillant à maintenir le signet (en partie effiloché) entre ma main et la couverture du Pléiade.
* Il serait tentant (mais cela n'a-t-il pas été tenté ?) de proposer, pour chaque tableau signalé par Pline, la plupart d'entre eux n'étant pas véritablement décrits et beaucoup étant perdus, une version imaginaire, esquissée, dont le titre serait, à chaque fois, et par exemple
ASTYANAX par Callimaque
— (titre imaginaire).
19:09 Publié dans Autres gammes, BoozArtz, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 26 mai 2013
Schwitters en vitesse
Hier soir, j'ai lu, en quatrième vitesse (il s'agit d'un texte très bref) et, dois-je l'avouer, tout en faisant semblant de regarder la finale de la Ligue des champions (le football ne m'ntéresse plus du tout, ou alors seulement en regardant les matches avec Oméga ou en écrivant mes foutus distiques), le petit récit de Kurt Schwitters que les éditions Allia viennent de publier en édition bilingue, initiative que je salue — La Loterie du jardin zoologique. J'ai donc pu le lire en allemand (comme Kafka, qui me voit, par la grâce des proses courtes, faire des incursions régulières dans le fort volume de ses œuvres, mais contrairement à Arno Schmidt, que j'aime énormément et dont il va bien falloir que j'achète les romans en allemand, faute d'exemplaires disponibles à la B.U.), tout en regardant la traduction (ce qui m'a évité de devoir chercher Nilpferd, dans lequel seul (est-ce la fatigue ?) je n'aurais pas reconnu l'hippopotame, trop happé peut-être par les valeurs de néant du signifiant nil).
Le texte est très drôle, plus absurde sans doute que nonsensical — toutefois, plus je travaille sur la question du nonsense, moins j'ai le sentiment d'en savoir quelque chose : après tout, le nonsense est ce qui nous fuit, se dérobe à la catégorisation... En particulier, le dénouement est totalement rationnel, raisonnable, logique, même s'il est présenté de façon loufoque. Cela rejoint mon impression déjà ancienne (que ne confirme pas trop le texte donné en post-face (mais en français seulement [??!]) par Allia, Merz et Anti-Dada de Raoul Hausmann), selon laquelle les collages de Schwitters (et tout son Merzisme en quelque sorte) s'expliquent, se conceptualisent beaucoup plus facilement que la poésie d'un Tzara, par exemple, qui est ce que le dadaïsme a donné de plus dur et de plus durable (de plus admirable aussi). Ou est-ce le dadaïsme allemand qui fut d'emblée plus politique, plus adversatif... plus spartakiste ?
06:41 Publié dans BoozArtz, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 02 mai 2013
XX-Art (Espace Nobuyoshi, Saint-Antoine du Rocher), 1er mai 2013
 Sous une pluie battante, plus digne de novembre que de mai, nous nous sommes promenés, à un rythme de marathon plus que de manifestation de Fête du Travail, dans le parc de La Mulonnière, et dans les serres et resserres de l’Espace Nobuyoshi, à Saint-Antoine du Rocher. Il s’y tient, depuis trois ou quatre ans, une exposition d’une semaine, dont le principe est que chaque artiste ne propose qu’une seule œuvre de grand format. Le titre de cette exposition est XX-Art, ce qui est un nom un peu bêta, mais qui a au moins le mérite de la brièveté, et d’être, à cet égard, facile à retenir.
Sous une pluie battante, plus digne de novembre que de mai, nous nous sommes promenés, à un rythme de marathon plus que de manifestation de Fête du Travail, dans le parc de La Mulonnière, et dans les serres et resserres de l’Espace Nobuyoshi, à Saint-Antoine du Rocher. Il s’y tient, depuis trois ou quatre ans, une exposition d’une semaine, dont le principe est que chaque artiste ne propose qu’une seule œuvre de grand format. Le titre de cette exposition est XX-Art, ce qui est un nom un peu bêta, mais qui a au moins le mérite de la brièveté, et d’être, à cet égard, facile à retenir.
 Il me semble que, si agréable qu’ait été la découverte de ce lieu (nous n’en avions jamais entendu parler jusqu’à la veille), la promenade a été gâchée par les hallebardes, les ornières boueuses, le parking gavé de voitures à la manœuvre – un curieux afflux de peuple, étant donné que cette manifestation n’est pas très médiatisée.
Il me semble que, si agréable qu’ait été la découverte de ce lieu (nous n’en avions jamais entendu parler jusqu’à la veille), la promenade a été gâchée par les hallebardes, les ornières boueuses, le parking gavé de voitures à la manœuvre – un curieux afflux de peuple, étant donné que cette manifestation n’est pas très médiatisée.
 Il n’y avait pas grand-chose de transcendant à se mettre sous l’œil, si ce n’est quelques amusantes sculptures extérieures, et deux ou trois toiles abstraites dérivatives mais pas désagréables ; il y avait, dans la grande serre principale, des sortes de sculptures (en plastique renforcé ?) tout à fait réussies, et j’ai pu découvrir un échantillon de la dernière manière de Juliette Gassies, qui se rapproche désormais un peu de sa voisine Florence Lespingal, mais de façon plus contrastive et surtout plus foncièrement figurative. Il y avait, cette année, un hommage à Didier Bécet, artiste sans doute trop tôt disparu (il n’avait pas cinquante ans), mais dont la petite « rétrospective » a confirmé tout le mal que je pensais de ses hideuses kitscheries.
Il n’y avait pas grand-chose de transcendant à se mettre sous l’œil, si ce n’est quelques amusantes sculptures extérieures, et deux ou trois toiles abstraites dérivatives mais pas désagréables ; il y avait, dans la grande serre principale, des sortes de sculptures (en plastique renforcé ?) tout à fait réussies, et j’ai pu découvrir un échantillon de la dernière manière de Juliette Gassies, qui se rapproche désormais un peu de sa voisine Florence Lespingal, mais de façon plus contrastive et surtout plus foncièrement figurative. Il y avait, cette année, un hommage à Didier Bécet, artiste sans doute trop tôt disparu (il n’avait pas cinquante ans), mais dont la petite « rétrospective » a confirmé tout le mal que je pensais de ses hideuses kitscheries.
 Reste qu’une année prochaine, sous des cieux plus cléments, on pourra tenter de se promener à grands et amples enjambées, dans un style plus proche des Tableaux d’une exposition.
Reste qu’une année prochaine, sous des cieux plus cléments, on pourra tenter de se promener à grands et amples enjambées, dans un style plus proche des Tableaux d’une exposition.
09:57 Publié dans BoozArtz, Sites et lieux d'Indre-et-Loire | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 22 avril 2013
Erki Kasemets
 Il y a cinq ans, j'avais pris plusieurs photographies d'une très belle, très forte, très inspirante installation d'un artiste estonien contemporain, ce dans le cadre d'une exposition d'art estonien contemporain qui avait été annoncée, alors, à grands renforts de clairon, comme la première d'un événement appelé à se répéter, et baptisé, du coup, biennale. Cinq ans après, on attend toujours la deuxième partie de cette biennale.
Il y a cinq ans, j'avais pris plusieurs photographies d'une très belle, très forte, très inspirante installation d'un artiste estonien contemporain, ce dans le cadre d'une exposition d'art estonien contemporain qui avait été annoncée, alors, à grands renforts de clairon, comme la première d'un événement appelé à se répéter, et baptisé, du coup, biennale. Cinq ans après, on attend toujours la deuxième partie de cette biennale.
18:31 Publié dans BoozArtz, Sites et lieux d'Indre-et-Loire, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 22 mars 2013
Poignée d’heures

Déjeuner au BarJu, qui a dû changer de propriétaire (plus classique, moins chichiteux, plus cher aussi – mais avec les insupportables interruptions (« Bonne dégustation » et autres) indissociables des restaurants contemporains), puis achat de nippes (godasses, futals) avant un détour par “Le Cosmographe” (qui ne s’appelle plus Les Amours jaunes depuis trois ans, là encore je semi-débarque), où j’ai acheté un recueil de Fitzgerald que je n’avais pas (mais lu, pourtant : The Diamond as Big as the Ritz), Suicide d’Edouard Levé, La langue maternelle de Vassilis Alexakis, La grammaire en forêt de Josée Lapeyrère, et enfin, in extremis, entr’aperçue sur une étagère, une monographie consacrée à Achille-Etna Michallon, dont je ne cesse de croiser le chemin ces temps-ci et qui, tenez-vous bien, avec son prénom volcanique, a tout de même peint des éruptions de Vésuve !
17:04 Publié dans BoozArtz, Moments de Tours, Pynchoniana, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 16 mars 2013
Insolite épisode de la vie d'Anton(in) Dvořák
08:35 Publié dans Albums de limericks non ligériens, BoozArtz | Lien permanent | Commentaires (6)
jeudi, 07 mars 2013
Ode à la ligne 29 des autobus parisiens
 Grâce à Facebook, où j’avais publié en cours de lecture quelques images reproduisant telle ou telle page du poème en question, je peux dater ma lecture de l’Ode à la ligne 29 de la fin novembre. Je lisais ce petit livre à la couverture grise et aux pages colorées (Roubaud est, avec Butor et Danielewski, un écrivain qui fait de polychromie un principe formel aussi exigeant qu’excitant), au lit, mais aussi, je m’en souviens, dans la salle d’attente de l’école Louis-Pergaud, où Oméga suit ses leçons d’éveil musical, le mercredi matin.
Grâce à Facebook, où j’avais publié en cours de lecture quelques images reproduisant telle ou telle page du poème en question, je peux dater ma lecture de l’Ode à la ligne 29 de la fin novembre. Je lisais ce petit livre à la couverture grise et aux pages colorées (Roubaud est, avec Butor et Danielewski, un écrivain qui fait de polychromie un principe formel aussi exigeant qu’excitant), au lit, mais aussi, je m’en souviens, dans la salle d’attente de l’école Louis-Pergaud, où Oméga suit ses leçons d’éveil musical, le mercredi matin.
L’Ode est – outre un de ces ouvrages empilés près de mon bureau dans le but d’en écrire un jour quelques phrases – un très beau poème narratif et lyrique, autobiographique et mélancolique, novateur tout autant que passéiste.
On lit les vers de Roubaud avec une exultation de métromane, et aussi une forme de fascination lexicographique. En fin de compte, c’est de ma relecture récente de L’Année terrible que je pourrais le mieux rapprocher ma perception de cette Ode. Comme Hugo, Roubaud ose – va de l’avant, suit son fil, trace sa voie. On le suit, ou on le délaisse. L’un comme l’autre m’emporte.
18:00 Publié dans BoozArtz, Pynchoniana, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 25 janvier 2013
La Crasse bitumineuse
Vieux restes de fruits pourris, excroissances, chewing-gums écrasés et en voie de décomposition, morceaux de sac en papier de fast-food déchirés et collés par la pluie… depuis le temps que je voudrais m’en saisir… C’est là un des sens possibles de la texturologie : un fragment banal de sol, ou d’une surface quelconque, est généralement complexe, dense, hétéroclite. Le plus difficile est de rendre l’impression de fondu, de masse informe, en n’appuyant pas trop sur les contrastes. Par le film ? la vision de biais ? toujours, à défaut, reste l’écriture, qu’on emporte partout avec soi.
08:16 Publié dans BoozArtz, Kleptomanies überurbaines, Tographe, Un fouillis de vieilles vieilleries | Lien permanent | Commentaires (1)