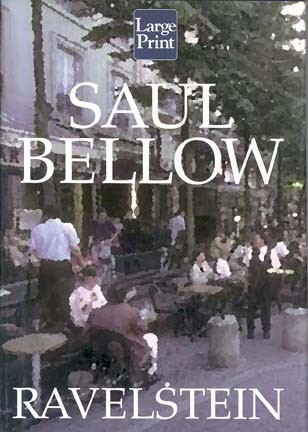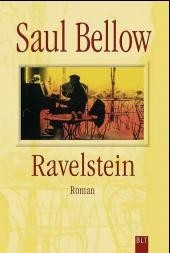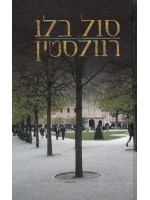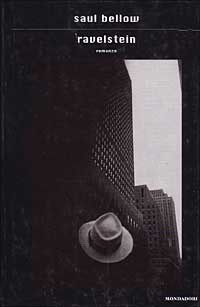mercredi, 16 novembre 2005
Ah, désolé
Cela n'arrive qu'à moi, je suppose...
Voilà. Je me suis enfin décidé à m'équiper de l'ADSL, qui coûte tout de même plus cher: or, l'un de nos ordinateurs, pourtant acheté en janvier dernier, n'est pas compatible (aaargh, Apple); et pour l'autre, mon portable, vieux de deux mois, je ne vois pas la différence. C'est aussi long avec la Livebox de Wanadoo et le Wifi qu'avec le bas débit avant.
Quelle fumisterie...
18:05 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (5)
Exposition Daniel Buren, au château de Tours
Ecrire ou ne pas écrire… L’exposition présentée par Buren au château de Tours est une telle imposture, une fumisterie, que l’on aimerait l’ignorer, tout bonnement – ce d’autant qu’il me faudra justifier mon avis pour ne pas donner l’impression de n’avoir « rien compris » (vous n’avez rien compris : c’est l’argument habituel des avant-gardistes les plus chevronnés et inconditionnels, ceux qui, au nom de Soulages, Fontana ou Pollock, artistes vraiment géniaux, vous feraient avaler les pires couleuvres en vous menaçant d’être d’“affreux réactionnaires” – rien n’est mieux à même de dégoûter de l’art dit « contemporain » que le zèle mis par ses thuriféraires à affirmer que toutes les œuvres ont une valeur).
Toujours est-il que Buren n’a pas réellement enlaidi le château. Son exposition s’appelle « plus petit ou plus grand que », et le seul concept a consisté à transformer l’espace rectangulaire du château en un triangle, au moyen d’échafaudages tout à fait hideux. La figure géométrique du triangle représente, je suppose, les signes > et <.
A l’intérieur du château, le triangle est constitué, sur trois niveaux, par des planchers colorés qui redéfinissent le sol. L’installation se limite à ces planchers de couleur (vert au rez-de-chaussée, orangé au premier étage, rouge au second étage), et – outre son caractère complètement superficiel, qui ne redéfinit rien du tout, et ne permet en rien la « déconstruction de l’espace visuel » vantée par les argumentaires bien-pensant – elle n’est même pas techniquement bien faite : les bordures des planchers peints, qui débordent sur les escaliers, ont été peintes avec force dégoulinures, de toute évidence involontaires, à faire honte au plus inepte des apprentis. Ici, l’art ne produit ni une belle vision, ni le moindre sens ; il ne témoigne pas même d’une quelconque compétence technique.
Au mieux, on pourrait penser que l’installation est propre à scandaliser les badauds, ou à épater les gogos. Mais y a-t-il des gens encore assez incultes pour se laisser épater ou scandaliser par une telle médiocrité ? Peut-être ; ce qui est certain, c’est que l’on peut s’offusquer de la médiatisation d’un si fade imposteur.
17:15 Publié dans BoozArtz, Moments de Tours, Sites et lieux d'Indre-et-Loire | Lien permanent | Commentaires (5)
“Semi-colons”, je sème à tout vent…
Je m’entretenais hier avec un collègue, spécialiste des littératures britanniques des dix-neuvième et vingtième siècles, au sujet de la rumeur, fausse mais assez fréquemment répandue, que le point-virgule est un signe de ponctuation rare en anglais. Je prenais pour exemples les poèmes de John Donne et les proses de Henry James – il est vrai assez peu représentatifs, les uns comme les autres, de l’anglais courant ou standard –, mais je suis certain que des œuvres plus « grand public » témoigneraient d’une pareille importance statistique des semi-colons.
Ce collègue m’a appris qu’Adorno avait écrit quelque part que l’abandon du point-virgule était l’un des premiers signes de la fin de la civilisation. J’espère qu’il retrouvera la référence précise.
15:10 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles | Lien permanent | Commentaires (1)
L’ondieu
que notre monde
heureux d’être obstiné
et forcené par la technique
prenne l’eau, la barque à l’onde,
d’un regard dérétiné,
énucléé – chemin de ronde
où s’inscrive un tantinet
cette merveille de cantique
Une fontaine nous inonde
et le chagrin lâche la bonde
comme le cordon des tuniques
Tu verras l’œil
perdu au milieu des nuages
de Dieu dont nous portons le deuil –
en ce soudain écobuage
le feu n’a pas franchi le seuil.
Aussitôt c’est la peur panique,
frisson inné
au cœur du monde.
13:40 Publié dans Ecrit(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
Où je m’interroge
Entendu hier, à la radio, de la bouche d’un député UDF (de Drancy, je crois) : « On peut s’interroger sur le fait de savoir pourquoi… »
Ce qui ne pourrait sembler qu’une banale périphrase jargonnante, lourde et incorrecte (en français, on dit « on peut se demander pourquoi ») est, en fait, un non-sens : si l’on parvient encore à comprendre – à la rigueur – ce qu’est un fait de savoir, il est impossible de donner le moindre sens à l’expression s’interroger sur le fait de savoir.
Que l’un des représentants officiels du peuple français ne parle pas sa langue, cela ne choque guère plus personne, j’en ai peur.
11:11 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (9)
Romanse, ça continue...
Je suis heureux de vous faire part de la publication, à l'instant même, du chapitre 1 de La Flemme de faire la vaisselle le soir après le dîner sur le site Romanse.
08:35 Publié dans Ecrit(o)ures, Flèche inversée vers les carnétoiles | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 15 novembre 2005
Le singe et le chameau
(Détail d'une tapisserie du château de Langeais.)
***************************
Tout de même, ce singe a l'air d'un homme, mais pas tout à fait non plus. Le chameau me fait penser à cette réplique célèbre du Flying Circus:
"What is it now, you great pillock?"
Les admirables feuillages jurent de miroiter le ciel.
07:55 Publié dans BoozArtz, Sites et lieux d'Indre-et-Loire | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 14 novembre 2005
Passage interdit
18:55 Publié dans Où sont passées les lumières? | Lien permanent | Commentaires (0)
Du mauvais côté du filet
Je viens de me déclarer déçu par Match Point, le dernier film de Woody Allen, tant dans ce carnet que sur le site ami de Philippe[s]. Quelques éclaircissements s'imposent.
Tout d'abord, j'ai trouvé ce film très longuet ; il ne semble pas qu'Allen ait maîtrisé du tout le montage. Je ne suis pas du tout un fanatique des films courts ou "efficaces" (ma grande passion pour Kiarostami, Monteiro ou Bartas convaincront, je l'espère, les plus sceptiques), mais il faut que les scènes lentes ou en surplus aient un minimum de signification, ou, à tout le moins, qu'elles soient bien jouées. Ce n'est pas du tout le cas, par exemple, des deux scènes au cours desquelles Chris rencontre un camarade du circuit professionnel ATP. Pour donner un autre exemple, les deux scènes dans la salle des armes et la longue scène du double meurtre ne présentent pas grand intérêt, dans la mesure où il devient vite clair 1) que Chris compte se débarrasser de sa maîtresse et 2) qu'il est tellement manche qu'il aurait pu se faire pincer mille fois. C'est là le problème principal du film: Allen tire sur la ficelle du hasard à double tranchant jusqu'à élimer la corde.
Toutefois, ce n'est rien encore. Ce qui m'a le plus énervé, ce sont les acteurs, car, à l'exception (notable) du duo tête d'affiche, c'est la calamité absolue: non seulement l'actrice qui joue le rôle de l'épouse de Chris ne sait pas jouer, mais elle ne sait ni marcher ni écarquiller les yeux de manière convaincante; je ne dis rien de la belle-mère, dont on n'a pas dû vouloir dans le pire sitcom. L'acteur qui joue le rôle du fils de famille n'est pas mauvais dans les premières scènes, puis son jeu d'effrite jusqu'à n'être plus que sourires niais de circonstance, fades tentatives pour occuper le champ de vision.
Enfin, même si j'apprécie à sa juste valeur le désir du réalisateur de faire un film qui ne lui ressemble pas (pas de dialogues brillants, pas de cynisme doux-amer, aucune vue captivante de la ville, absence de jazz), je ne peux que constater qu'il n'a réussi que sur un seul et unique point: alors que la plupart de ses films, même récents, étaient très réussis, celui-ci est un naufrage désolant.
Le film ne m'a guère procuré qu'une seule joie, outre d'apprécier le goût chaque année plus prononcé d'Allen dans le choix de ses acteurs masculins: Allen fait entendre une infinie variété d'accents (irlandais soft, cockney, posh, du Nord de l'Angleterre, américains...), ce qui donne, à son film, une musicalité plus convaincante que la référence, poussive et râpeuse, à l'opéra italien.
13:29 Publié dans Tographe | Lien permanent | Commentaires (2)
Langeais: Vues du haut du chemin de ronde
11:40 Publié dans Ecrit(o)ures, Où sont passées les lumières?, Sites et lieux d'Indre-et-Loire | Lien permanent | Commentaires (0)
Romanse... c'est parti !
Touraine sereine est heureux de vous annoncer la parution du premier chapitre d'Avril déjà dérape. A l'issue de leur lecture du chapitre 1, les lecteurs sont invités à voter, par voie de commentaire, pour l'un des trois choix de chapitre 2 proposés.
08:32 Publié dans Ecrit(o)ures, Flèche inversée vers les carnétoiles | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 13 novembre 2005
… le bal des cormorans…
Ce soir, un beau week-end oisif et fatigant s’achève – un comme je les aime, d’autant qu’avec les lunettes cassées pendant deux jours et demi, je n’ai pas pu corriger un paquet de copies que je dois remettre demain ; je doute d’avoir le courage ou la force de les corriger cette nuit.
Vendredi, j’avais trente et un ans ; le soir, nous avons vu Des crocodiles dans tes rêves, cinq pièces brèves de Tchekhov mises en scène par Gilles Bouillon. Samedi, après une matinée diversement occupée (dont une visite chez l’opticien), et une après-midi pluvieuse à visiter le château de Langeais, C. et moi avons sacrifié à l’épisodique et infréquente sortie cinéma ; comble de malchance, nous avons choisi d’aller voir le dernier Woody Allen. Enfin, aujourd’hui, outre de variées anodineries, nous avons raccompagné mes parents à la gare après une visite de l’exposition Buren au Château de Tours et une promenade sur les bords de Loire, à admirer le bal des cormorans, par dizaines dans le ciel, sur les bancs de sable, et par centaines dans les peupliers de l’autre côté, sur la rive nord.
21:15 Publié dans Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (4)
Comité ;
Touraine sereine s'associe à la création du Comité de Défense du Point-Virgule; soyez nombreux à réhabiliter, par une pratique sobre mais puissante, ce merveilleux signe de ponctuation.
17:30 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles | Lien permanent | Commentaires (4)
Neuf couleurs: Blanc
11:25 Publié dans ... de mon fils | Lien permanent | Commentaires (3)
samedi, 12 novembre 2005
A quoi servent les proverbes...
Il faut que jeunesse se passe.
17:20 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (2)
vendredi, 11 novembre 2005
Neuf couleurs: Jaune
22:40 Publié dans ... de mon fils, Autres gammes, Où sont passées les lumières? | Lien permanent | Commentaires (4)
jeudi, 10 novembre 2005
Neuf couleurs : Vert
22:25 Publié dans ... de mon fils, Ecrit(o)ures, Où sont passées les lumières? | Lien permanent | Commentaires (2)
Insolite?
Autre léger détail: ce "couple" n'avait, malheureusement, rien d'insolite. Il était tristement banal, au contraire.
15:55 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
Atelier Markowicz
Jeudi, 14 h 15.
Je viens de me promener dans le vieux Tours, pour un aller-retour inutile - mais toutefois agréable - entre le site Tanneurs et le Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance (C.E.S.R.), rue Rapin. C'est dans les locaux du C.E.S.R. qu'ont lieu, tous les jeudis de deux à cinq, les séances de l'atelier de traduction animé par André Markowicz. Toutefois, il y a, ce jeudi, relâche, comme vient de me l'apprendre l'attachée culturelle. Cela m'apprendra à consulter les plannings qui me sont envoyés!
Je n'ai pas encore parlé de cet atelier, et c'est peut-être l'occasion de le faire, brièvement. L'objectif est, sur l'année, de faire traduire à un groupe d'étudiants, collectivement mais sous la direction de Markowicz, The Merry Wives of Windsor de Shakespeare. C'est une gageure, certainement, d'autant que la majorité des étudiants ne sont pas anglicistes.
Jeudi dernier, c'était la quatrième séance, que j'ai manquée pour cause de colloque (à Montpellier, on le saura). Sinon, les trois premières séances furent absolument passionnantes. Lors de la première, Markowicz a expliqué un peu la méthode et le fonctionnement de l'atelier. Il y a environ vingt étudiants (en fait, un seul garçon; sinon, des filles), qu'il a répartis en cinq groupes, un pour chaque acte. L. A.-F., ma collègue spécialiste de littérature comparée, et moi-même sommes présents à chaque séance pour encadrer le travail; lors des séances auxquelles Markowicz himself ne peut participer, nous assurons le relais. Chaque semaine, les étudiants de chaque groupe doivent traduire 70 lignes de "leur" acte (dix lignes par jour, tous les jours, sans exception, c'est la consigne markowiczienne).
Lors de la première séance, Markowicz nous a fait traduire l'incipit de Crime et châtiment. Il faut savoir qu'à l'exception de lui et d'une étudiante russophone, personne ne parle un traître mot de russe dans cet atelier. Il nous a donc dicté une version mot à mot des dix premières lignes, et chacun devait proposer une traduction. On a ferraillé, bataillé ferme. C'était fascinant, et cela a surtout permis à Markowicz un grand nombre d'idées sur la pratique de la traduction, la langue française, etc.
Lors des séances suivantes, le groupe a procédé à l'examen des "débuts d'acte": en d'autres termes, le groupe chargé de l'acte I a lu ses propositions de traduction pour les premières répliques de l'acte I; on en a discuté, débattu; on a modifié, médité, laissé en suspens... Et ainsi de suite pour chaque acte.
14:25 Publié dans Moments de Tours, WAW | Lien permanent | Commentaires (1)
Planche à roulettes?
Pourquoi ai-je écrit cette note? Peut-être pour rappeler quelques notions de savoir-vivre, dans un monde où les codes les plus élémentaires de la politesse et de l'attention aux autres ont quasiment disparu... Oui, c'est cela... Ce faisant, j'ai aussi livré un autoportrait de moi en vieux râleur impénitent et grognon. C'est cela aussi... je l'admets et l'assume volontiers.
Je m'aperçois aussi que je n'ai pas hésité une seule seconde à employer, par trois fois, le franglais skate-board. Je ne sais pas si le très linguistiquement correct "planche à roulettes" a pris racine, ou non; au temps de mon adolescence, nous disions tous skate-board.
Pourtant, le terme de "planche à roulettes" aurait présenté un intérêt non négligeable: celui d'infantiliser un peu cet étudiant, car, franchement, cet accessoire donne une bien piètre idée de sa mâturité, et de sa motivation pour le travail. Quelle image veut-il donner de lui-même? Aucune, sans doute, et c'est bien là le problème.
13:50 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (1)
Imbécile...
... que je suis, je ne me suis pas rendu compte que j'écrivais le 1111ème commentaire !
12:15 Publié dans Ecrit(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)
Le faux Tourangeau n'a pas lu Ravelstein
Russie éternelle, ou encore grimaces.
Âtre où folâtrent des pigeons,
vide, éteint, sans embrasement.
Est-ce cette planète, ou ce roi
lucide, en sa danse de la pluie,
sereinement conquis?
Terreur, apothéose!
Est-ce, de sons, une overdose?
Il paraît que je ne suis rien,
non, au chaud sous les couvertures.
Malentendus et incivilités
La scène se passe à l'université, sur le site Tanneurs. Deux étudiants, inconnus de moi, occupent toute la largeur du couloir, et marchent à une vitesse approximative de 500 mètres à l'heure. Celui de gauche porte, à la main gauche (de manière, je suppose, à ne pas gêner son camarade, qui lui raconte quelque chose d'essentiel avec force gestes et force cris), un skate-board.
Pour essayer de passer à gauche de ce couple insolite, je dis alors, comme on le fait habituellement: "Pardon..." Au moment même où je prononce ce mot, l'étudiant me balance, involontairement bien sûr, son skate-board dans le genou. Et, comme je le dépasse, il me lâche:
"C'est pas grave..."
Que mon "Pardon..." ait pu impliquer que c'était lui qui obstruait le passage ne lui a pas effleuré l'esprit. Qu'il ait pu me faire mal en me donnant un coup, moins encore... Quant à déambuler nonchalamment dans les couloirs bondés d'une université avec un skate-board, ça...
Enfin, l'éventualité de s'adresser autrement à un professeur qu'avec ce ton désabusé et mollasson semble reléguée, à tout jamais, aux oubliettes.
10:50 Publié dans WAW | Lien permanent | Commentaires (9)
Album de limericks ligériens
En attendant la parution du premier chapitre de l'un de mes romans, vous pouvez toujours participer à la discussion autour des limericks en français, sur mon blog pédagogique. Il s'agit d'écrire des limericks en français.
Le limerick est un poème court, humoristique, absurde ou grivois, toujours un quintil de forme AABBA, et dont la première rime est un nom de commune. Habituellement et originellement de langue anglaise, cette forme se transporte très bien, à mon avis, en langue française.
08:47 Publié dans Ecrit(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)
mercredi, 09 novembre 2005
Neuf couleurs: Rouge
22:20 Publié dans ... de mon fils, Autres gammes, Où sont passées les lumières? | Lien permanent | Commentaires (0)
L’Amant bilingue, de Juan Marsé
On ne devrait jamais écrire sans avoir tous les ouvrages de référence nécessaires à portée de main, déclarait Jacques Marais, qui n’a jamais rien écrit (et pour cause). Je m’apprête pourtant à écrire quelques phrases sur ce roman lu il y a quelques jours, mais sans avoir même l’exemplaire – emprunté en bibliothèque – sous les yeux ni à ma disposition. Qui veut voyager loin ménage sa valise.
***********
Le paragraphe que vous venez de lire a été écrit, il y a une semaine exactement, par un autre moi qui voyageait et qui balisait. Aujourd’hui, je suis à ma table de travail (which is anywhere : in this very case, the dining room table) et je reprends cette note, car je dois rendre le roman demain à la bibliothèque universitaire.
Ce qui m’a le plus déconcerté, dans ce roman de Juan Marsé, c’est la référence constante (et centrale) à la rivalité entre Catalans de Barcelone et « Murciens », ou charnegos, c’est-à-dire, à ce que je crois comprendre, les Andalous ou habitants du sud de l’Espagne. Vendredi dernier, à Montpellier, une collègue de Madrid, qui se nomme Teresa Gibert (ça se prononce comme la librairie, a-t-elle précisé), m’affirmait être dépassée par l’essor incroyable des diverses langues jadis considérées comme régionales en Espagne ; d’après elle, la messe n’est plus retransmise à la télévision qu’en galicien, catalan, etc. Ce qui est le plus gênant, dans cette situation, c’est qu’elle a constaté un déclin incroyable du niveau moyen des étudiants espagnols en castillan (elle enseigne à Madrid).
Bref… L’Amant bilingue, comme son titre l’indique, traite essentiellement de cette question des langues et de leur pouvoir érotique/politique. En ce sens, c’est une gageure de le lire en traduction française.
La situation narrative est assez simple : un Catalan d’une quarantaine d’années est quitté par sa femme, nettement plus jeune que lui et issue d’une très riche famille ; la séparation a lieu après que le mari a découvert que sa femme le trompait avec un charnego, amant de rencontre qui solde la fin du couple. Marsé s’amuse beaucoup à imaginer diverses situations, dans lesquelles le mari inconsolable, devenu clochard et musicien des rues (entre autres, il joue de l’accordéon avec les pieds), téléphone à son ex-femme, qui est à la tête d’un programme linguistique officiel pour la promotion du catalan : il se fait passer pour un petit commerçant et, prenant un accent charnego à couper au couteau, lui demande, en castillan, la traduction de toute une série de mots désignant vêtements et sous-vêtements.
De prime abord, le roman semble raconter la tentative de reconquête, avant que Joan Marés (nom-miroir de celui de l’auteur) ne semble changer son fusil d’épaule et, se déguisant en Andalou, ne se fasse passer pour un ami d’enfance disparu – un certain Faneca, qu’il finit par imiter à la perfection –, afin de séduire son ex-femme ; naturellement, cette stratégie de dédoublement se referme sur lui comme un piège à mâchoires.
Le roman m’a plu, par bien des côtés. Ce qui ne laisse pas de m’agacer, d’un certain point de vue (comme lorsque j’avais découvert Napoléon VII de Javier Toméo, il y a deux mois et quelque), c’est la banalité du thème. Cette histoire de double – ce récit d’une aliénation (ou d’une métamorphose), pour être bien mené, sent le déjà-lu, quand même… Dès les premières phrases (plus précisément : dès la deuxième), le lecteur comprend que le miroir sert à la fois de piège et de moyen d’expression principal pour Joan. L’idée que le reflet infiniment diffracté, le contraste entre l’image et l’identité, est la source des métamorphoses de Joan, est répétée de manière plus ou moins subtile, de loin en loin, comme au chapitre XIX de la première partie :
Marés réussit à se faire une place au bout du comptoir, à côté de Ribas et de Norma, et il se regarda dans le miroir moderniste qui le répétait à l’infini dans un autre miroir frontal : un type méprisable, tapi près de Norma, qui respirait le mensonge avec son air farouche de Charnego à longs cils, un peu canaille. (p. 107)
La fin du chapitre I de la deuxième partie vient d’ailleurs confirmer ce dédoublement, de manière plus explicite encore :
une main invisible lui tapotait amicalement l’épaule, pour lui donner du courage : si tu deviens un autre sans cesser d’être toi-même, plus jamais tu ne te sentiras seul. (p. 128)
Pourtant, Marsé glisse plusieurs indices quant au caractère factice de ce dédoublement. Il semble erroné de lire le roman dans son entier à l’aune de cette dualité Marés/Faneca. En effet, j’ai remarqué que, si le roman se divise en deux parties de vingt chapitres chacune, il existe une autre structure, celle des cahiers dans lesquels Marés, initialement narrateur de sa propre histoire, écrit. Or, le premier cahier occupe les six premiers chapitres ; le deuxième s’étend du chapitre VII de la première partie au chapitre II de la seconde (soit seize chapitres à lui seul) ; le troisième cahier vient définitivement briser l’apparente symétrie de la structure narrative, puisqu’il occupe le reste de la seconde partie. Chaque nouveau cahier correspond à un changement de voix, de point de vue, mais aussi à un nouveau degré de métamorphose. Marsé a-t-il cherché à suggérer quelque chose par ce biais ? Qu’il existe une troisième instance, l’auteur lui-même, qui préside aux destinées du personnage clivé ? Rien de moins sûr… mais le roman échappe à la lourdeur du thème par ce vacillement permanent, et surtout par ses audaces linguistiques, son humour féroce et caustique.
*********
Juan Marsé. L’Amant bilingue. Traduit de l’espagnol par Jean-Marie Saint-Lu. Paris : Christian Bourgois, 1996.
20:00 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)