mercredi, 14 mars 2007
Petit Faucheux, 13 mars 2007
Cédric Piromalli / Patrice Grente / Pascal Le Gall
John O' Gallagher Trio
Huit heures et demie.
Je me suis assis derrière le photographe. À chaque fois, si je le peux, je m'assieds derrière le photographe, toujours le même photographe, qui gesticule, couvre son colossal objectif avec son écharpe ou son pull, et se contorsionne parfois à même le sol. Et lu trente pages de ce livre laconique acheté l'après-midi même. Lu en entendant le murmure des voix et la rumeur monter, comme arrivaient les spectateurs. D'ordinaire, je ne lis, ni n'écris. Me contente de regarder, observer aux alentours, écouter, ou quand je ne suis pas seul discuter. Ce soir lisant, je m'imaginais la scène en fonction de mes observations des autres fois. Devais être d'autant moins loin du compte que ce sont toujours peu ou prou les mêmes habitués ici. Une agglomération de 200.000 habitants, et toujours dans la salle de jazz de 200 places plus ou moins les mêmes visages.
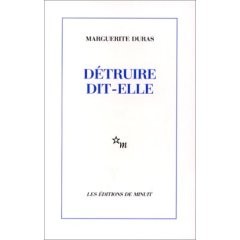
--- Dis, tu le connais, toi ?
--- Pas du tout.
--- Tout le monde le connaît pas du tout.
**************
Ce mercredi matin, les phrases d'hier soir recopiées, je veux tracer quelques signes pour fixer ce concert dans ma mémoire. J'étais déçu. Pas parce que ça n'était "pas bien", ou parce qu'un des deux sets était mauvais, non. Pour des raisons différentes, chaque set m'a laissé sur ma faim.


Piromalli (voir photo ci-contre) est un pianiste remarquable, qui, s'il a su montrer qu'il maîtrisait les facettes les plus classiquement virtuoses de son instrument, a surtout joué des poings, du dos des mains, brutalisant avec doigté son Steinway qui, tout en se demandant ce qui lui arrivait, déployait une vraie palette d'harmonies tumultueuses. (Voyez, je trouve quand même d'autres adjectifs.)
D'où alors vint ma déception ? du peu de résistance de mes oreilles, tout simplement. C'était trop intense, trop long, par rapport à la sursonorisation, travers de l'époque & surtout défaut récurrent du Petit Faucheux. À la pause (entr'acte ? entre-deux-sets ? mi-temps ?), j'ai mis trois bonnes minutes à me remettre les acouphènes en ordre de marche. Peut-être suis-je vieux jeu, un vieux râleur monotone, mais je ne vais pas au concert par hâte ardente de rapprocher le moment où je devrai porter un sonotone.
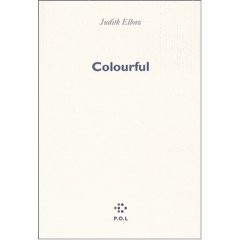
Pour ce qui est de la deuxième partie, elle était, quoique plus colorée, plus chromatique, franchement frustrante. John O' Gallagher est certainement un excellent saxophoniste, qui n'est pas sans rappeler Steve Lacy (ce qui, pour moi, est un compliment), mais il n'a rien à raconter. Rien de rien à dire. Toutes ses interventions se ressemblaient, et son phrasé toujours identique a fini par faire fuir la plupart des spectateurs avant même la fin du set. C'est dommage, d'ailleurs, car Jeff Williams est un très bon batteur, pas très inspiré, malheureusement, par la soupe fadasse de son leader.
Seul le contrebassiste, inconnu de moi, s'en tire with flying colours. Il s'appelle Masa Kamaguchi, ne doit pas être bien vieux, a déjà un CV long comme le bras, et sait (qu'il accompagne, métronome aux effets imprévus, ou qu'il parte en cavalier solitaire) faire ce qu'O'Gallagher a jeté aux orties : raconter, de ses cordes tendues, une histoire. Si Patrice Grente avait, au cours de la première partie, montré tout ce que l'on peut faire, en frénésie, d'une contrebasse, jusqu'à faire tomber son archet à trois mètres de lui et à manquer chuter lui-même, Masa Kamaguchi a, de ses doigts seuls, distillé des notes tenues, retenues, subtilement relâchées, toujours au point d'équilibre et jamais loin du point de rupture. Un musicien à suivre...
11:30 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Ligérienne, Jazz, Littérature, écriture
mardi, 13 mars 2007
Retour sur remaniements (tourne manivelle)
Mardi, dix heures.
Juste là, je pourrais revenir sur chacune des variantes entre la première version (first bad draft, in Nuruddin’s words) et le texte remanié qu’on va dire définitif (mais toujours décevant, frustrant). Il y en a beaucoup, et chacune avec ses raisons. Je veux seulement noter ici – pour aide-mémoire, comme on consigne, sur une feuille volante, un rendez-vous déjà passé chez le dentiste – que j’ai remis l’asyndète fautive et tout à fait involontaire de la toute première version, que j'avais corrigée avant première publication :
N’avait-il pas choisi le lectorat à Cambridge comme d’autres, il n’y a pas si longtemps, choisissaient de s’embarquer sur un baleinier ou la légion étrangère ?
Pour involontaire qu’elle soit, elle me plaît beaucoup, et, comme il n’y a pas grand-chose qui me plaise dans tout ce texte, allons-y gaiement.
Sinon, F.B. avait justement remarqué l’écho entre la situation narrée/décrite et les années de lecteur de Beckett à Paris. Cela, c’était à peu près conscient quand j’ai écrit le texte, et d’ailleurs, si j’ai choisi de préciser la variété de bière (Murphy’s), ce n’est pas seulement que j’en buvais beaucoup cette année-là (le choix était moindre à Cambridge qu’à Oxford).
Moins conscient, déjà, dans la double triangulation qui structure le texte – ou, tout au moins, son invention –, le fait que la thèse de Hugo portait, si je ne m’abuse, sur Faulkner, Joyce et Proust. Peut-être aussi n’ai-je écrit ce texte (mais là, ça devient du mauvais Aragon) que pour y placer les frasques, phrase réellement prononcée par Hugo, sur le maudit punt, mais titre aussi d’un petit roman que j’écrivis cette année-là, concomitamment dirons-nous. Que ces frasques aient en retour attiré la ribambelle du premier paragraphe (puisque j’avais projeté d’écrire un roman appelé Ribambelles l’année d’avant à Paris, projet resté sans suite (mais non sans suie dans les turbines)), c’est possible, mais je ne m’en avise que maintenant.
De là, je pourrais enchaîner sur cette heure de solitude à visiter St John’s, à Cambridge, pendant que Jean-Pascal donnait un cours peut-être bien, et à prendre des photographies (en noir et blanc ? je ne suis plus si sûr), véritable et durable moment épiphanique, ou sur la salle informatique sans fenêtres et surchauffée, à Oxford, où j’avais écrit Frasques et aussi de nombreux poèmes en anglais jamais sauvegardés et dont la version imprimée s’est perdue, je crois.
Pendant ce temps-là, Frédéric Monino et ses cinq comparses (Stefano Di Battista et Thomas de Pourquery surtout) s’échinent superbement sur Caravan. Au début de Moya, composition que je ne connaissais pas de Laurent Cugny, c’est le tromboniste Francesco Castellani qui donne à rêver. Je dors si peu et si mal, cauchemars, angoisses. Et maintenant que l’électricien est passé relever le compteur, aller au turbin.
17:00 Publié dans Ecrit(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Jazz, écriture
La littérature est-elle dangereuse ? [5] : Juliet/Beckett & lambeaux de discours direct
******************** Tout va par deux
Voici ce que j’ai noté, en totale anarchie, au cours de la séance, et avant de partir écrire Onze ans après. Ce que j’écris est en Times 10. Ce que j’ai noté de l’intervention de François Bon (que j’ai préféré écouter sans être rivé au clavier cette fois (…)) est en Times12.
Il y a très peu de monde : jour de rentrée ? atelier déplacé du jeudi au lundi ? Moi, j’étais absent aux séances 3 et 4, dont François Bon redit le plus grand bien. (Il nous en a envoyé, dans la nuit, des morceaux choisis.) La salle 80 est hérissée de pieds de chaises, car elles sont toutes renversées, par paquets de deux, sur les tables. On a dû chasser deux pauvres étudiants qui finissaient un devoir (concours blanc ?)
******************** Par maints et par vaux
Oralité, ce qui remonte, ce qui traverse le texte et n’est pas narratif.
J’ai amené Charles Juliet. Montre Rencontres avec Samuel Beckett. Parle de Lambeaux. Dans ce texte restreint sur Beckett…
Le mot du jour est restreint. Est-ce sur, l’écrivain, l’influence du train ? L’entrée dans la langue française se fait, pour Beckett, avec ce vocabulaire restreint. Juliet, passage du silence contraint à l’écriture du silence.
Quatre rencontres. Neuf ans s’écoulent entre la première et la quatrième.
Juliet publie déjà son journal, mais s’interdit de parler de sa rencontre avec Beckett tant que l’écrivain est vivant.
Deux mecs qui ne parlent pas : le dispositif d’écriture de Juliet est intéressant (notation précise des propos de Beckett).
François Bon raconte son dernier voyage en train à Lille, face à un type qui trimbalait des rats dans une cage verte et orange fluo. Il parle aussi d’un vieux cousin mort depuis longtemps, coupures de journaux, notices de médicaments, etc. Dans quel livre a-t-il parlé de ce parent ? Je n’ose demander.
Le rapport du dialogique au narratif est inversé par rapport à la logique ordinaire. Les rencontres sont brèves et la parole rare : c’est cela qui fait exister l’écriture.
Il faut donc raconter une ou plusieurs rencontres importantes avec quelqu’un de marquant (et pas forcément célèbre).
Technique, forme du texte : cf la manière abrupte dont le narrateur de la Recherche entre en rapport dialogique avec une multitude d’interlocuteurs.
Nombreux extraits des Rencontres avec Samuel Beckett.
Poème de Morand sur Proust, ‘Ode à Marcel Proust’, 1915.
******************** La main du diable (Un échec)
Après la présentation de la séance par François Bon, je suis allé dans mon bureau, dont les volets roulants, par un miracle étonnant, étaient restés ouverts, ce qui fait que j’ai écrit le texte Onze ans après, au crépuscule puis dans la suie, face à la passerelle faiblement éclairée. De ce texte, Onze ans après, j’ai livré, illico, à huit heures du soir, la première mouture, puis je suis retourné en salle 80 où ça grattait sec, et me suis remis au texte. Disons-le tout net : la consigne de ce jour m’a profondément embarrassé, car, contrairement à la plupart des fois où je me suis trouvé en situation de contrainte, j’ai mis beaucoup de temps à trouver un sujet. Ensuite, une fois le sujet trouvé, je me suis embarqué dans l’écriture en ne parvenant aucunement à restituer la voix du portraituré rencontré, Hugo A. J’ai raturé, repris, modifié, même écrit un paragraphe encore plus mauvais dont je me suis rendu compte, juste avant la lecture à haute voix, qu’il n’était « insérable » nulle part dans mon texte. J’avais déjà modifié pas mal de choses au texte publié à huit heures du soir, mais pas comme il faudrait : dans le détail et non dans la trame. Alors, pas du tout convaincu, j’ai lu mon texte qui, ça tombe bien, n’a pas convaincu François Bon – même s’il a pris de fort élégantes pincettes pour me le dire. Pour ma part, ce n’est pas tant le côté suranné (« plus France que Proust », a dit F.B.*) qui me gêne que le côté mou de ce texte ; je n’ai pas su trancher, et c’est un texte au mitan, oui, grassouillet. Du coup, ce mardi matin, je prends le parti, après un nouveau toilettage, d’instiller polyphonie pour de bon, avec insertion / injection de phrases hugoliennes.
*Ah oui : François Bon a aussi parlé d'une traduction de Henry James qui aplatirait ou raterait (je ne sais plus) ce qui fait le génie de James. Cela dit, même en mauvaise traduction, je prends la référence à James comme un compliment, vu ma grande frustration face à ce texte dont je ne sais que faire. Dans la discussion qu'il a eue avec une étudiante qui prépare un travail de master 1 sur Danielle Collobert, F.B. a raconté que Jérôme Lindon avait, à l'époque, refusé de publier Meurtres, qui lui paraissait trop directement inspiré de / calqué sur l'écriture de Beckett. Pour ma part, même si le texte de R., une autre étudiante, était très réussi, j'ai trouvé qu'il était trop directement inspiré de / calqué sur l'écriture de Duras. (Ou de François Bon, peut-être ?)
10:20 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : Ligérienne, Littérature, écriture
Onze ans après, remanié
Je l’ai rencontré plusieurs fois, quand j’allais passer quatre ou cinq jours d’affilée à Cambridge, chez cet ami que je perds aussi de vue maintenant. Jean-Pascal m’avait présenté la ribambelle de ses amis, et parmi eux Hugo.
Hugo s’appelait en fait Hugues, mais il régnait, autour de son vrai prénom, un parfum d’interdit. You go first, right ? Lui, contrairement à nous autres, était lecteur pour une durée de cinq ans, et finissait sa thèse. Il était donc sensiblement plus âgé que nous, et avait plus ou moins claqué la porte au nez des siens, Parisiens. N’avait-il pas choisi le lectorat à Cambridge comme d’autres, il n’y a pas si longtemps, choisissaient de s’embarquer sur un baleinier ou la légion étrangère ? That’s one goal now.
Étonnamment séduisant, et – à sa façon – raffiné, Hugo n’était en rien poseur. Un jour, nous discutions, tous les trois, avec Jean-Pascal, à la table crasseuse d’un bar de college, et Hugo, de façon tout à fait caractéristique, s’était assis en dehors du cercle formé au départ par la table et les trois chaises. Comme ça, non ? Tout aussi caractéristique, sa façon de nous encourager à reprendre une pinte, à ses frais, une Murphy’s, je dirais, tout en laissant quasi imbue la sienne. Il se contentait d’y tremper les lèvres, et discutait avec feu, riait, fronçait les sourcils, parfois les trois à la fois, puis, de son profil acéré, nous lançait des phrases ambiguës, tout en oubliant consciencieusement de boire. C’est une violence. Puis, entre deux paroles enflammées, deux rires, deux froncements, il se levait, comme nous partions, et vidait en deux fois une bonne part de la pinte jusque là délaissée. Let’s go lads, et le jus noir abandonné.
Il me semble qu’une autre fois, au début d’une soirée qui fut la plus arrosée de mon existence – avec les conséquences que l’on imagine –, je le vis jouer, avec une élégance rare, au baby-foot. Trois à rien quand même (l’accent sur à et quand, je pense). J’ignorais que l’on pût s’adonner à ce jeu, et même s’y donner, d’une façon qui fleure autant le gentleman. Hugo était autant fait pour les envols de l’imagination que pour l’atmosphère feutrée des clubs les plus select. Tu es sûr que ça va, Guillaume ?
Il y eut aussi, peut-être la dernière fois que nous nous vîmes, son détachement dans ce punt infâme que nous avions loué à six et dont seul il se débrouillait, piroguier expert de ces bords presque gallois. Il faisait beau et frais, sur la Cam. Je m’énervais après tout le monde. Mais après lui, impossible.
Ma mémoire persiste à me tendre de curieuses perches et à évoquer une possible rencontre, l’année suivante, ou même celle d’après, à Paris (pour sa soutenance de thèse ?). Pourtant, aucune image, aucun son précis ne me vient de cet épis od e pourtant ultérieur, s’il a bien eu lieu. Hugo, à Paris, cela ne se pouvait. Ce devait être Hugues : ce fantôme imposteur n’aura pas laissé de traces dans ma mémoire vive.
Je vois ça d’ici, toi avec tes frasques.
09:00 Publié dans Ecrit(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Ligérienne, écriture
lundi, 12 mars 2007
Onze ans après
Je l’ai rencontré plusieurs fois, quand j’allais passer quatre ou cinq jours d’affilée à Cambridge, chez cet ami que je perds aussi de vue maintenant. Jean-Pascal m’avait présenté la ribambelle de ses amis, et parmi eux Hugo.
Combien de fois suis-je allé à Cambridge ? On dira trois. À chaque séjour peut-être je voyais Hugo trois ou quatre fois. Et que m’importent ces chiffres ? Je ne sais.
Hugo s’appelait en fait Hugues, mais il semblait régner, autour de son vrai prénom, un parfum d’interdit. Lui, contrairement à nous autres, était lecteur pour une durée de cinq ans, et finissait sa thèse. Il était donc sensiblement plus âgé que nous, et avait plus ou moins claqué la porte au nez des siens, Parisiens. N’avait-il pas choisi le lectorat à Cambridge comme d’autres, il n’y a pas si longtemps, choisissaient de s’embarquer sur un baleinier ou partent pour la légion étrangère ? Si je raconte tout ça, c’est que sa vie paraissait nimbée de tant de demi-secrets, mais sans afféterie.
Étonnamment séduisant, Hugo n’était pas poseur. Ses excentricités verbales et sociales étaient d’une totale sincérité. Un jour, nous discutions, tous les trois, avec Jean-Pascal, à la table crasseuse d’un bar de college, et Hugo, de façon tout à fait caractéristique, s’était assis en dehors du cercle formé, au départ, par la table et les trois chaises. Tout aussi caractéristique, sa façon de nous encourager à reprendre une pinte, à ses frais, une Murphy’s, je dirais, tout en laissant quasi imbue la sienne. Il se contentait d’y tremper les lèvres, discutait avec feu, riait, fronçait les sourcils, parfois les trois à la fois, et, de son profil acéré jamais détendu, nous lançait des phrases si ambiguës qu’elles prenaient valeur de sentences, tout en oubliant consciencieusement de boire. Puis, entre deux paroles enflammées (« C’est une violence » ou « on te verra avec tes frasques »), deux rires, deux froncements, il se levait, comme nous partions, et vidait en deux fois une bonne part de la pinte jusque là délaissée.
Il me semble qu’une autre fois, au début d’une soirée qui fut la plus arrosée de mon existence – avec les conséquences que l’on imagine –, je le vis jouer, avec une élégance rare, au baby-foot. J’ignorais que l’on pût s’adonner à ce jeu, et même s’y donner, d’une façon qui fleure autant le gentleman. Hugo était autant fait pour les envols subits et violents d’imaginations fébriles que pour l’atmosphère feutrée des clubs les plus select.
Il y eut aussi, peut-être la dernière fois que nous nous vîmes, son détachement somptueux dans ce punt infâme que nous avions loué à six et dont seul il se démenait, en rameur expert, piroguier de ces bords presque gallois. Il faisait beau et frais, sur la Cam. Je m’énervais après tout le monde. Mais après lui, impossible.
Ma mémoire persiste à me tendre de curieuses perches et à évoquer une possible rencontre, l’année suivante, ou même celle d’après, à Paris (pour sa soutenance de thèse ?). Pourtant, aucune image, aucun son précis ne me vient de cet épisode pourtant ultérieur, s’il a bien eu lieu. Hugo, à Paris, cela ne se pouvait. Si ça se trouve, c’était Hugues, et ce fantôme imposteur n’aura pas laissé de traces dans ma mémoire vive.
20:00 Publié dans Ecrit(o)ures, Hors Touraine, Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Ligérienne, écriture
La littérature est-elle dangereuse ? [5]
Quelques minutes avant la cinquième séance de l'atelier d'écriture animé par François Bon sur le site Tanneurs, "La littérature est-elle dangereuse ? " (j'ai manqué la troisième séance pour raisons personnelles et la quatrième car j'avais oublié de la noter dans mon agenda, pensant que la fréquence régulière était d'un atelier tous les quinze jours), j'ai réussi, fait rarissime, à me garer du côté impair de la rue des Tanneurs, sans avoir à risquer un périlleux (et limite illégal) demi-tour sur voie au niveau des feux tricolores qui suivent.
Des affiches déchirées, des prospectus, du béton gris. La fac ne donne pas son meilleur visage en ces jours de grand soleil, premières chaleurs dans l'air & premières terrasses à lézards place Plumereau. Quand elle si belle, la lumière adoucit ce qui n'est que médiocre, mais les choses laides, elles, ressortent de manière plus vive, plus poignante.
Ce matin, vers dix heures et demie, en descendant l'escalier le formidable après un cours au quatrième étage, j'ai pu admirer les remous de la Loire sous le soleil doucement incandescent. Durant le cours, j'ai fait remarquer aux étudiants qu'une pie, peut-être la même qui m'avait incité à leur apprendre quelques noms d'oiseaux deux semaines auparavant, faisait son nid pile à notre niveau, à portée de nos regards. Les nids de pie, ces constructions foutraques de grosses brindilles pas même branches, on les voit rarement à niveau, et suffiraient-ils d'ailleurs à suggérer une métaphore malingre et alambiquée de ce carnet de toile ?
To room 80 now !
18:25 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Ligérienne, écriture
Journalese (again & again)
Ils s'y sont mis à trois (Le Monde, l'AFP et l'agence Reuters) pour faire, dans un titre de dépêche, une faute "à trois points" (comme les paniers).
Ségolène Royal estime que les "éléphants" ne l'ont pas assez soutenu. [sic]
Nouveau scoop, les amis : Ségolène Royal est un homme !
00:05 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Langue française
dimanche, 11 mars 2007
Glissé loin des ombres (Ahalco, 11/11)

16:15 Publié dans Autoportraiture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Photographie, écriture
samedi, 10 mars 2007
Plus qu'une ombre penchée (Halco, 10/11)

17:20 Publié dans Autoportraiture | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Photographie
vendredi, 09 mars 2007
Onze quasiombres, 9/11

18:25 Publié dans Autoportraiture | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Photographie
jeudi, 08 mars 2007
Le Manteau du harle (Halco, 8/11)

19:30 Publié dans Autoportraiture | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Photographie
mercredi, 07 mars 2007
Ombres, 7/11 (Miniature béton)

20:35 Publié dans Autoportraiture | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Photographie, Poésie
Peluches sous Souchon
5 mars, vers quatre heures.
J’ suis moins bon / j’suis à la bourre chantait il y a quelque temps Baguian. À mon fils j’explique que Souchon – dont il aime beaucoup l’album Jamais content, que nous écoutons dans la voiture – est maire, m’a-t-on rapporté, d’un petit village des bords de Loire.

Nous avons traversé Amou, où, le 2 janvier, j’avais photographié cette affiche défraîchie. Nous traversons Pouillon, où enfant je prenais des cours de tennis. « Tu vois, Papa, Tigré, autrefois, il était maire de ce village. Et Panthérou, avant, elle était maire de Bordeaux. »
08:15 Publié dans ... de mon fils | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Ligérienne, Photographie
mardi, 06 mars 2007
Bouillon d'onze ombres, 6/11

On est tous un peu transformistes. On s'affiche. On est tous un peu exhibitionnistes. Jouant avec la mémoire vive, avec nos souvenirs d'éléphants, en avant les défenses.
21:40 Publié dans Autoportraiture | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Photographie, écriture
Eh non, c’est faux
Au petit jeu des neuf énoncés vrais, seul le seigneur Chieuvrou – ainsi que je l’ai annoncé avant-hier – a tiré son épingle du jeu.
En effet, seule la phrase n° 2 était fausse. Il s’agissait d’un énoncé farci de petits détails qui pouvaient être autant de chausse-trapes, mais qui, du coup, donnèrent l’illusion du réel. Terrain miné, ce qui est anecdotique et loufoque paraît toujours vrai, n’est-ce pas ?
Quel est donc l’élément du deuxième énoncé qui le rend faux ? Récemment : exact ; ce dont il est question dans cette phrase a eu lieu le 27 février dernier. Hôtel du Mail à Angers : c’est bien là que nous nous trouvions. Sécher un chien en peluche : grotesque mais vrai. Sami est le nom du chien : oui (même si le taulier a lancé, assez énigmatiquement, à mon fils : « eh bien, tu ne risques pas de le perdre, ton Chonchon »). Ce qui est faux donc n’est ni le prédicat ni les compléments, ni la relative, mais le sujet : c’est ma compagne qui – le ridicule ne tuant pas et le chien s’étant mouillé sous la pluie – entreprit, mardi dernier, de sécher Sami dans la salle de bains de l’hôtel du Mail. J’ajoute que, si j’avais bien ruminé ce projet de billet depuis douze jours au moment de sa publication réelle, c’est cet incident absurde qui m’a donné l’idée de l’énoncé erroné à glisser au milieu des véritables.
Voilà. Je rappelle au seigneur Chieuvrou que je lui offrirai un livre et l’invite à boire un bon verre somewhere. Des internautes à qui j’ai demandé de faire ce jeu, certains se sont défilés ; je ne dénonce personne, mais bon… Allez, du nerf, comme aurait dit Robert Pinget ! Je signale aussi qu’Aurélie m’a envoyé ses 10 phrases, qu’elle me demande de ne publier qu’après le 23 mars. Rendez-vous pris donc, dans deux semaines et demie.
07:50 Publié dans Le Livre des mines | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Ligérienne
lundi, 05 mars 2007
Halco en ombres, 5/11

22:45 Publié dans Autoportraiture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Photographie, écriture, Ligérienne
dimanche, 04 mars 2007
Ombres du lac d'Halco, 4/11

23:50 Publié dans Autoportraiture | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Photographie
Journalese, ill-at-ease
Dans Sud-Ouest de ce jour, Catherine Debray écrit, à propos des parrainages : « l’ex-ministre Corinne Lepage, targuée de 503 soutiens ». En français, on peut se targuer de quelque chose (autrement dit : s’en vanter). Ainsi, si on peut être crédité d’une action, ou d’un score, on ne peut nullement en être targué.
Le verbe est exclusivement pronominal, comme le confirment les cinq sources que j’ai consultées pour vérification (Robert, Littré, Lachâtre, Grévisse & Landais). Ce dernier – le Dictionnaire général et grammatical des dictionnaires français de Napoléon Landais (troisième édition, 1836, tome II) – nous apprend, à la page 636, l’origine possible de ce verbe : « Se targuer signifiait autrefois, selon Borel, se couvrir le corps de ses bras, en se mettant les poignets sur les flancs […], la TARGE étant une sorte de bouclier dont on se servait autrefois ». La targe a elle-même donné la targette, qui existe encore, et peut-être faut-il voir dans cette famille oubliée l’explication d’un faux-ami courant (target, en anglais, c’est la cible).
Bref, et pour en revenir à nos moutons, Catherine Debray, dont le métier consiste en bonne part à manier la langue française, a le droit de s’y mettre…
11:45 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Langue française
samedi, 03 mars 2007
Frasques de fresque
Je ne sais plus à quand remonte le brouillon de billet ci-après, car il est en carafe depuis des semaines. Un mois et demi, peut-être ? Je comptais donner, à ce quatrain, quelques frères, mais il est préférable de poser d'ores et déjà les jalons. De plus, c'est l'occasion rêvée d'annoncer (avec une semaine de retard) la parution d'un ouvrage en collaboration avec Tinou, qui a très bien fait le service de presse sur son blog ! Merci à elle d'avoir accordé sa confiance à mes mirlitoneries.
Vous souriez, mais ce n'est rien.
Vos lèvres déjà vous échappent ;
Le sourcil baissé patricien
Ploie sur la peau comme une chape.
06:05 Publié dans BoozArtz, Ecrit(o)ures, Flèche inversée vers les carnétoiles, Words Words Words, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Ligérienne, Poésie
vendredi, 02 mars 2007
9 out of 10, right ?
Ils s'y sont tous risqués, ou presque : Philippe[s], Zvezdo, et j'en passe. Personne ne m'a demandé de relever ce défi (d'ailleurs je crois que tout le monde me croit mort), mais je le fais quand même. Voici ce dont il retourne : des 10 affirmations suivantes, une seule est fausse. À vous de deviner laquelle.
1. J'ai failli naître dans l'ascenseur de la maternité, à Dax.
2. Récemment, j'ai séché, grâce au sèche-cheveux de l'Hôtel du Mail, à Angers, un chien en peluche nommé Sami.
3. Un jour de 1995, j'ai recouvert les murs d'une cuisine de papier journal et d'affichettes diverses.
4. J'ai déjà mangé des pièces en chocolat habillé en seigneur du XVIIème siècle.
5. Le seul match de foot d'un niveau correct que j'aie jamais vu des tribunes d'un stade était un pitoyable Eintracht Frankfurt / Hamburg, en 1987. Les deux buts ont été marqués à 130 mètres de mes yeux.
6. Le jour de la première d'Architruc, à Paris, j'ai reçu un télégramme de Robert Pinget me transmettant ses encouragements.
7. J'ai le même âge, au jour près, que Leonardo Di Caprio.
8. La veille de l'entrée en sixième, je me suis fait un grand trou dans les cheveux avec des ciseaux rouillés, car je trouvais que le coiffeur n'avait pas bien fait son travail.
9. Mon meilleur ami des années 1980-1987 s'appelle Pierre Lassartesse.
10. Cela fait douze jours que je pense à élaborer ce billet.
Comme je suis un garçon bien élevé qui aime refiler ses microbes, je refile le défi à Tinou, VS (qui ne l'a pas fait, ce me semble), Simon (gnêrk gnêrk), Didier Goux*, Christophe (ça lui apprendra à confondre égocentrique et narcissique), Mélisande, Aurélie (qui peut répondre comme elle le souhaite, par mail, ici, ou encore en ouvrant son blog), Astolphe Chieuvrou (même remarque), Fuligineuse (même remarque que pour VS) et enfin MuMM (même remarque que pour Simon).
* [EDIT de minuit vingt-cinq] Alors là, personne ne va me croire, mais Didier Goux, que d'ordinaire je lisais ici, vient d'ouvrir un blog, et je m'en suis aperçu après l'avoir choisi et en pensant, à l'origine faire un lien vers le Forum de la SLRC... (Cette astérisque ne fait pas partie du jeu ; elle est vraie.)
00:25 Publié dans Autoportraiture | Lien permanent | Commentaires (27) | Tags : Ligérienne
jeudi, 01 mars 2007
Snow on Hades

Le voici enfin, le troisième de cette série d'autoportraits... (Comme il y en a onze, j'aurais voulu écrire onzain d'autoportraits, mais cet onzain n'est pas joli et ce onzain est incorrect).
Voyez que je reviens petit à petit. (Encore une ombre, encore.)
Toutes les onze le 30 décembre... (and all that in the meantime)
-----------
Aujourd'hui, tous les intertitres sont en anglais. H&F fait des siennes... mais la publication à heure non fixe est redevenue possible !
23:55 Publié dans Autoportraiture | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Photographie


