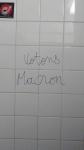mardi, 20 décembre 2016
Ai-je déjà raconté...
14 décembre 2016, 7 h 52 — 8 h 04
Ai-je déjà raconté
Cet émoi quand s'éloigne
Un visage entrevu
Dans la noirceur de l'aube
La douceur gagne
Les premiers prés
Dissipés sous le bitume
Un regard une robe
Qui habite ce saule
Seul imprévu
Pour d'autres horizons té
Nèbres sans un signe
Moi aussi dans l'étuve
Glaciale j'aurai été
Mieux que le colobe :
Le singe au cœur qui saigne
L'avenue
Luisant de chatoyances mauves
Offre la plaie
De sa modernité maligne
Le cœur qui saigne cogne
Dans le cadastre étoilé
De la besogne
Corps couvert par sa verrue
Descendant vers la Tranchée
J'aurais pu écrire "vertu",
L'apparence sauve
Et le parfum des châtaignes
Voici dans la cohue
L'image se dérobe
Pour un point à la ligne
Ou un point de côté
Grand assemblage des
Pierres le long du
Boulevard où s'abreuve
Chaque jour mon regard
.
14:36 Publié dans Quatramways | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 19 décembre 2016
au bec du masque songye
12.12.2015.
sans parler de débandade
au général inquiet
voir qui dormait et qui est
réveillé par la saudade
au bec du masque songye
suspendre la rebuffade
la douleur n'est pas en rade
ni sommeil pour la pitié
après lire Atatao
âpre poème pastiche
retrouver son territoire
front bombé du calao
pleurer pour exécutoire
& rien soulage hémistiche
22:28 Publié dans Sonnets de janvier et d'après | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 18 décembre 2016
Musique d'endives
27.11.2013.
aujourd'hui pas de lessive ·
je joue aux congas
avec deux endives ·
vous voyez les gars
c'est pas compliqué ·
c'est pas des salades
brumes maussades ·
une tronche de vieux ticket
hachuré par la moissonneuse ·
mine poisseuse
je tape sur des bongos ·
avec la pince à linge
peau tendue les méninges ·
un bruit de vieux frigo
18:21 Publié dans Chèvre, aucun risque, Sonnets de janvier et d'après | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 17 décembre 2016
Rondel 12 — Déploiement d'ayaux
Toi, tu me pètes les noyaux
À chercher le jaune aux narcisses.
Qu'inlassablement tu grossisses
Le trait me gonfle les boyaux.
Où sont les ayaux ? quels tuyaux
As-tu pour farcir les saucisses ?
Toi, tu me pètes les noyaux
À chercher le jaune aux narcisses.
Tu gémis en vers déloyaux —
Cherche, pour tes fards liliaux,
D'autres Torretons ou Hancisses.
Qu'Österglöckchen, tu les noircisses ?
Toi, tu me pètes les noyaux !
09:12 Publié dans Rondels | Lien permanent | Commentaires (0)
Anciens sans hapax
Recyclage de statuts FB n'ayant eu aucun like.
6.XI.2016.
Mon épouse fait des powtoon, et après j'ai la petite musique casse-noix dans la tête pendant des plombes.
6.XI.2016
Pour ceux qui comprennent le russe...
Et, pour les autres, l'occasion d'entendre un opéra du vingtième siècle avec, si je pige, un seul personnage. Combien existe-t-il d'opéras-monologues ?
(Et, curieusement, connaissant Gogol, j'ai l'impression d'entraver quelque chose à ces modulations du baryton.)
5.XI.2016. — 3 h 37
Encore la grasse matinée.
4.XI.2016. — 13 h 37 (après le cours de Littérature L3)
C'est poussif aujourd'hui.
3.XI.2016.
Découverte de Valentin Jamerey Duval.
3.XI.2016.
Tabish Khair. — JIHADI JANE, Indian edition of Just Another Jihadi Jane, listed for the Tata Book of the Year Award.
06:43 Publié dans Autres gammes, Chèvre, aucun risque | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 16 décembre 2016
Chignon de Krefeld
17.12.2015.
Ton gros chignon, en loucedé,
Recoiffe-le, Karl Lagerfeld !
Le petit-fils de Yaoundé
Gambade au zoo de Krefeld.
07:49 Publié dans Quatrains conversationnels | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 15 décembre 2016
Diffraction
J'ai aperçu — au passage zébré de l'I.U.T. — un piéton qui était le sosie d'Olivier Gourmet, mais en jeune et efflanqué.
Olivier Gourmet efflanqué, quel peut être son nom ?
Olivier Vegan, peut-être ?
******************
Peu avant, rue Colbert, j'avais assisté au spectacle d'enfants de dix ou onze ans s'amusant à faire les fous après l'école, et dont l'un d'eux lança à un autre, sur le mode de la blague, « Eh, bléda ! ». L'autre venait de faire mine de lui piquer un bonbon. Donc voleur = bléda. Tout s'arrange, dans ce pays.
21:10 Publié dans Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 14 décembre 2016
4040
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma sœur.
On ne se voit pas très souvent, on s'écrit beaucoup moins qu'à une certaine époque, aussi parce qu'on se suit sur Facebook (est-ce un maintien illusoire du fil ? question complexe).
Bien qu'elle soit née, elle, en Gironde, nous avons vécu ensemble toutes mes premières années, jusqu'à son départ pour Paris en 1988.
Quatorze années dans les Landes.
Et elle, donc, ma sœur aînée, quarante-six ans aujourd'hui.
22:07 Publié dans Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)
4039
D'innombrables sites Web attribuent à Richard Strauss ou à Richard Wagner la citation suivante : « Never look at the Trombones, you'll only encourage them. »
Évidemment, aucun des deux n'a dit cela, fût-ce en allemand.
C'était la minute d'érudition inutile et de vaine déhoaxisation du jour. Ne me remerciez pas.
07:00 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 13 décembre 2016
Rondel 11 — Le bonheur à cinq sous
Un beau jour un ménage ami
Arriva rue Henri-Martin.
Je vous passe le baratin
Qu'engendra un tel tsunami.
Qu'importe cet origami
Pour un cœur vraiment libertin ?
Un beau jour un ménage ami
Arriva rue Henri-Martin.
Plût à Nobodaddy qu'à mi-
Chemin on s'arrêtât parmi
Les missels comme à Poyartin,
Et que décampât du fortin
Un beau jour un ménage ami !
21:31 Publié dans Rondels | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 12 décembre 2016
Rondel 10 — Le dangereux jeune homme
Il fut élevé à Grenoble
Et sa famille est très vieux jeu.
Que son physique avantageux
Et son allure fière et noble
Ne tourne façon paso doble
Aussi votre esprit ombrageux :
Il fut élevé à Grenoble
Et sa famille est très vieux jeu.
Comme Noé dans son vignoble
Il joue très rarement franc jeu.
Épousez-le, si c'est l'enjeu,
Mais c'est vous qui tiendrez l'escoble. —
Il fut élevé à Grenoble !
05:15 Publié dans Rondels | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 11 décembre 2016
Rondel 9 — L'hérésiarque
Foin des sympathies bohémiennes
Au centenaire de Victor
Hugo. Comme un alligator
Dénoue ses parties diluviennes,
Oui, il faudrait que tu contiennes
Ton fin sourire de butor.
Foin des sympathies bohémiennes
Au centenaire de Victor !
De Gand jusqu'aux Aléoutiennes
On entend ta voix de stentor
Résonner dans le transistor
Pour quels narvals, quelles juliennes !
Foin des sympathies bohémiennes.
10:13 Publié dans Rondels | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 10 décembre 2016
Ralliez-vous...
J'ai donné à traduire, en sujet de thème, un extrait du plus récent roman de Philippe Djian, Dispersez-vous, ralliez vous ! (L'écriture en a l'air navrante, mais là n'est pas le sujet ce soir ; je choisis des textes dont la syntaxe ne pose pas de difficulté, car il s'agit d'un cours de traduction pour étudiants d'échange.)
Le titre du roman est évidemment le vers qui clôt la deuxième strophe des “Corbeaux” de Rimbaud.
Or, cherchant sur le Web des traductions anglaises du poème de Rimbaud , je constate, comme toujours, une grande diversité de choix, ainsi qu'une véritable disparité dans la qualité des textes. Par exemple, l'une d'entre elles, sur le site French Songs Translations, multiplie les contresens : longs angélus traduit par “long angels” (?), calvaires traduit par “ordeals” (alors qu'il s'agit bien de l'ouvrage d'art, pas d'un sens abstrait), et j'en passe.
Or, et c'est ce qui m'intéresse, l'auteur de ce blog — comme tant d'autres — affiche sa faible compétence en écrivant ceci en préambule : “Those are mostly litteral translations (at the best of my means, mistakes happen) in order to convey the meaning of the songs. I'm not trying to recreate the poetry.”
Non seulement les erreurs sont loin d'être occasionnelles (mistakes happen a lot !), mais surtout ce blogueur anonyme tombe dans un double panneau assez courant :
1) Il croit qu'une traduction littérale n'implique pas de connaissance précise des langues mises en jeu, alors que les deux erreurs que j'ai signalées plus haut relèvent d'une incapacité totale à trancher dans les cas de polysémie et montrent bien, très entre autres, que les moyens modestes du blogueur l'empêchent totalement de rendre le sens du poème, même de manière maladroite.
2) Il croit que la poésie de la langue source doit être “recréée” à partir du mot à mot, ce qui est absurde : la poésie est dans les mots, dans leur interaction, et n'est évidemment pas distincte ni distinguable du langage. Un traducteur qui commence par un mot à mot pour tenter ensuite, dans une phase séparée, de “recréer la poésie” n'aboutit à rien.
20:31 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)
« Quelqu'un a perdu son charme »
Ce matin, après avoir passé l'aspirateur, j'ai dû reprendre Oméga qui, en se faufilant sous l'immense épicéa — on se souviendra longtemps de l'année où j'ai envoyé un SMS « Le sapin est trop petit » et où mon épouse n'a saisi l'antiphrase qu'en débarquant à la maison — a fait tomber des brassées d'aiguilles, ce deux heures à peine avant son frère aîné, qui, dansant pour nous faire rire entre deux plis à la belote (oui, nous avons des débuts d'après-midi très traditionnels !), en a aussi fait tomber.
▓▒░░▒▓▒░▓
Avec ça, et le reste, je n'ai pas commencé à corriger de copies, mais je visionne Coiffeuses, le film que François Bon a fait avec le réalisateur Fabrice Cazeneuve et qu'il vient de mettre en ligne. Ça aussi, notre dialogue, nos polylogues sur la Toile, même par la vidéo : ce matin, j'ai fait ma cinquante-neuvième vidéo de traduction, avec une qualité inférieure, des hésitations à la pelle. En regardant une des séquences dans lesquelles une des apprenties lit le texte qu'elle a écrit pour l'atelier de François, je suis frappé par cette phrase : « Quelqu’un a perdu son charme mais a toujours son charme quelque part. » — Frappé, car je trouve ça très fort, très durassien. Je vérifie le texte, que je n'ai aucun mal à retrouver sur le site de François, et il s'avère que l'antithèse repose, non sur une répétition mais sur une paronomase que je trouve, pour le coup, plus faible : quelqu’un a perdu son charme mais a toujours son arme quelque part.
Les rayons percent, filtrent, et les aiguilles peuvent tomber. Ça fait des semaines que je bloque sur deux sonnets à écrire, et quelques chapitres à relire. J'aimerais m'en moquer.
▓▒░░▒▓▒░▓
C'est vers cette même époque, fin 2006 puis 2007, qu'on a un peu travaillé ensemble, avec François Bon.
Sur des erreurs de perception repose beaucoup, pour moi, le charme de la poésie. On a perdu ce charme en fixant trop à l'écrit. Le passage par la piste audio — ici, par le visionnage — restitue un charme ambivalent. Dans l'image, retenir par exemple ce plan où, tandis que la jeune fille parle du renoncement à sa vulgarité, on voit le couple de dos, main dans la main, marcher le long des panneaux électoraux, avant le rodéo du scooter tout seul devant des portails de garages.
Faut-il aussi me moquer de tout ce que je laisse en plan (ici) ?
▓▒░░▒▓▒░▓
Aiguilles d'épicéa qui tombent : mes cheveux ras qui tombent dans la bassine quand je me tonds la tronche, deux fois par moi, ou les mèches blanches dans cet autre film de François que j'ai découvert ce matin (on partait pour l'Angleterre).
15:37 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles, Moments de Tours, Résidence avec Laloux, Tographe | Lien permanent | Commentaires (1)
vendredi, 09 décembre 2016
Quatrain écrit aux gogues
13:48 Publié dans Mirlitonneries métaphotographiques | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 08 décembre 2016
Rondel 8 — Empoisonnement
À noircir le quadrilatère
Où nos espoirs sont enterrés,
Les chevaux, bien ou mal ferrés,
Martèlent durement la terre.
Qu'on tombe au fin fond du cratère,
On mettra la langue en carrés
À noircir le quadrilatère
Où nos espoirs sont enterrés.
Ton manteau cloué à la patère
Arrache des collés-serrés
À des cossons énamourés,
Qui trouvent la potion amère
À noircir le quadrilatère.
13:49 Publié dans Rondels | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 07 décembre 2016
Choses qui font mourir de rire mon fils cadet dans la voiture que nous prête une amie
- Le bruit du moteur en première.
- Le hochet rose Hello Kitty.
- Le jeton de caddie qui fait un barouf d'enfer à chaque virage.
- Le klaxon qui sonne par inadvertance quand on baisse le siège du conducteur pour faire entrer le camarade que l'on prend le matin chez lui.
- Papa a bien du mal à enclencher la marche arrière. Que c'est cocasse.
- Un pruneau fendillé au marché d'Akutanagawa.
11:08 Publié dans ... de mon fils, Ex abrupto, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 06 décembre 2016
Rondel 7 — portrait à charge
Votre long large cou d'autruche
Noué d'un foulard à rabats
Renâcle poireaux et abats
Sous la tête en forme de cruche.
Vais-je dégonfler la baudruche
Et n'est-il donc d'autres combats
Que votre large cou d'autruche
Noué d'un foulard à rabats ?
Ainsi que l'abeille à la ruche,
Vous luttez — et tu te débats !
Vous plongez — toi, tel Joël Bats,
Ton corps si noueux de lambruche
Sous votre large cou d'autruche.
18:40 Publié dans Rondels | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 04 décembre 2016
Rondel 6 — sous la figurine Zandé
Calé dans le fauteuil Régence
Sous la figurine Zandé,
On s'est peut-être demandé
Ce qui en soi criait vengeance.
Est-ce d'avoir connu Argence
Ou joué son avenir au dé,
Calé dans le fauteuil Régence
Sous la figurine Zandé ?
Oh les beaux jours ! Denise Gence
D'un sourire t'a brocardé,
Et le poème de Kandé
Te tance pour ta négligence
À clé dans le fauteuil Régence.
16:48 Publié dans Rondels | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 03 décembre 2016
Rondel 5
Pondre des vers sur un parking
N'est pas plus dur que d'en traduire.
On passe la brosse à reluire
À un minus qui se croit king.
Google, ni Reverso, ni Bing
Ne sauraient, ici, nous suffire :
Pondre des vers sur un parking
N'est pas plus dur que d'en traduire.
La prochaine fois, Stephen King
Dans ma voix joue les durs à cuire,
Ou peut-être Duras : détruire,
Dit-elle, ton beau vase Ming
(Pondre des vers sur un parking ?) !
08:25 Publié dans Rondels | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 02 décembre 2016
Rondel 4
L'âme s'embrase d'un rien
Dans les trumeaux ou les pierres,
Qu'on lève un peu la paupière
Écrabouillé sous l'airain.
On ne donne un coup de frein
Qu'au mépris de la jambière.
L'âme s'embrase d'un rien
Dans les trumeaux ou les pierres.
Sculpture pour ce vaurien
Ou délice à garçonnière,
L'âme contrefaçonnière
Y mène toujours grand train :
L'âme s'embrase d'un rien.
20:29 Publié dans Rondels | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 01 décembre 2016
Premier décembre
Décembre vient à point
En tabac de Hollande.
Vous direz que je glande
Ou que je fume un joint.
Le maître a mis grand soin
À cette réprimande :
Décembre vient à point
En tabac de Hollande.
Le safran, le benjoin
Font tes yeux en amande
Plus belles que guirlande.
Quand s'épuise le foin
Décembre vient à point.
21:49 Publié dans Rondels | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 30 novembre 2016
Rondel 2
Ni le paprika ni le sel
Ne métamorphosent ces viandes
En des invites plus gourmandes
Comme la Sixtine au missel.
Jadis, au bas de Marissel,
— À Beauvais, tu me le demandes ? —
Ni le paprika ni le sel
N'ont métamorphosé ces viandes
En un frimas de carrousel.
On festoya (tourteaux, limandes
Et vin jaune de contrebandes)
Et ne pensa universel
Ni le paprika ni le sel.
06:18 Publié dans Rondels | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 29 novembre 2016
Ballade des drames du tens futur, de Françoys Fillon
Ballade des drames du tens futur
par Françoys Fillon, escholier françoys de souche (sarthoyse)
Dites-moy où, n’en quel pays,
On sucrera l'aide sociale
Aux smicards, ces sales nantis,
Leur préférant l'évasion fiscale ?
Peu me chaut en ça la cabale
Des démocrates et des perdans !
Où raflerai-je la timbale ?
C'est ès Frances, au prochainz printens.
Une fois gauchistes enfuis
On portera l'âge de retraite
À septante ou soixante-dix
Pour saigner la nation distraite.
Peu me chaudra l'anachorète
Qui va de la loi soulignant
Que du chomasge ça sécrète
En la France, au prochainz printens.
Préceptes chrétienz rétablis
On boutera hors du domaine
Mahométans & surtout laïcs
Qui n'ont foi qu'en la science humaine
Et jettera dessus la Seine
Services publics & savans.
Et invertis le mal les prenne,
Sans mariage au prochainz printens !
ENVOI
Françoys, la fable américaine
Ne vous distraise même un tens :
Mes sourcils de croquemitaine
Règnent France au prochainz printens.
09:59 Publié dans Ecrit(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 28 novembre 2016
Sur une série de 24 rondels découverts
Ces quelques rondels de Banville
Sont de genre à désemparer
L'esprit même le plus carré
Et la conscience la plus vile.
On les lit d'une âme tranquille ?
La noirceur vient vous égarer !
Ces quelques rondels de Banville
Sont de genre à désemparer.
Certes, la verve très habile
Portant tant d'habits chamarrés
Pousse sous nos yeux effarés
Comme des perles à la file
Ces quelques rondels de Banville.
14:43 Publié dans Rondels | Lien permanent | Commentaires (1)
dimanche, 27 novembre 2016
à mon tiers café...
Après un mois d'abstinence, à peu près, j'ai de nouveau écrit, ce matin, un sonnet alternant heptasyllabes et octosyllabes, sans doute sous l'influence de ma lecture du Sexe des rimes et de ma découverte des « vers baïfins » (“un nouveau vers de 15 syllabes bien comptées, césuré clairement (7/8)”, Chevrier, p. 64).
Ce sonnet est logiquement dédié à Valérie Scigala.
à mon tiers café je n'eus qu'à
prendre presto la tangente
imposer la rime indigente
piquante tel le yucca
c'est au jour de la saint Lucas
que le poème déjante
une diction décourageante
sous les volées des Stuka
comme coincé dans ta guimbarde
c'est le temps de s'envoyer
la lettre au travers du trimard
refuge chez Gallimard
la douce lueur du foyer
pendant que l'avion te bombarde
10:18 Publié dans Sonnets de janvier et d'après | Lien permanent | Commentaires (2)