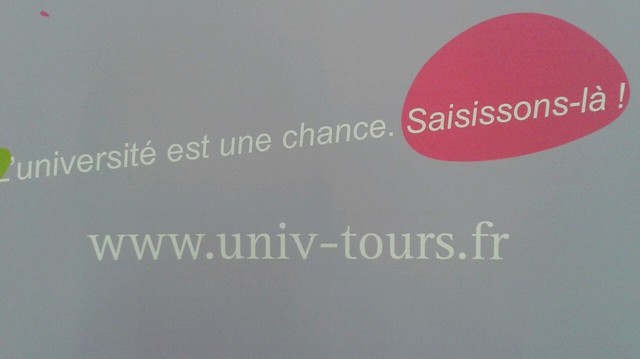lundi, 18 mars 2013
Dernière demeure ¦ destination finale
Depuis quelques jours, je me suis plongé dans la poésie de Cynthia Atkins (dont on peut lire des poèmes ici et là - sans oublier son site personnel), et ai même (à peine) commencé à la traduire. Très ému, pour diverses raisons – pas seulement littéraires – par “The Information Age”, un poème qui se trouve au début du recueil Psyche’s Weathers, je viens d’en achever, à l’instant, un premier jet.
Dans ce poème, la première et la deuxième strophe (16 vers chacune) se répondent. Dans l’une, le corps de l’oncle est comparé à une lettre, et la terre où il est inhumé au « trajet de la lettre » ; dans l’autre, ce sont les lettres qui sont comparées à un corps passant de main en main et, dans le texte
strung from house
to house—to its final resting place
Pour l’image de ‘final resting place’, j’hésite entre dernière demeure (euphémisme funèbre qui offre un beau contrepoint à ‘house’, maison) et destination finale (expression plus respectueuse de la métaphore postale). Je me pose aussi des questions de ponctuation : j’aime beaucoup le tiret, et je serais d’avis de le conserver tel quel, d’autant que la virgule – seule alternative ici – est vraiment de nature à “aplatir” la portée du suspens.
16:37 Publié dans Résidence avec Laloux, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 13 mars 2013
Aaaaaargh ou youpi
Il est notoire que je ne suis pas carriériste, puisque, depuis 2005 au moins (tiens ? année de naissance de ce carnétoile… coïncidence ? je ne kroille pas), j’ai fait à peu près tous les choix qui m’éloignent des promotions, des avancements, et surtout, surtout, de la sacro-sainte HDR (Habilitation à Diriger des Recherches), ce fleuron de l’Université française, ce sésame, ce fanal, ce CRITERE ABSOLU au titre duquel, entre un feignant complet grand intellectuel retiré dans sa tour d’ivoire qui ne fait qu’à moitié ses cours et ne fait jamais ni réunion ni travail de fond dans sa fac MAIS publie en dix ans 20 articles et 1 livre que personne ne lit de première importance, et un tâcheron qui fait tourner la boutique en s’occupant des échanges Erasmus, de faire les emplois du temps, d’assurer les cours dont personne d’autre ne veut, d’aider les étudiants dans leur projet professionnel ETC., le premier finira professeur hors-classe à 6.000 euros par mois, avec des semestres sabbatiques dans l’intervalle, et le second prendra sa retraite de maître de conférences, avec, peut-être, s’il n’a pas trop déconné, 3.000 et quelque euros dans l’escarcelle. (Je ne mentionne pas, parmi les privilèges du second, le droit de bosser in situ 5 jours sur 7 pendant 40 semaines et de recevoir les mails des collègues absentéistes qui s’offusquent qu’on envisage de leur demander de venir sur leur lieu de travail en dehors des 24 semaines de cours, et, sacrilège absolu, le vendredi.)
Eh bien, figurez-vous que le plumitif, le polygraphe, le tâcheron Cingal essaie depuis deux ans (après un hiatus de trois années de jachère) de renouer les fils de sa recherche, en se disant que, si, si, il est capable de tout faire, et qu’il va se remettre à publier, oui, oui, oui. Figurez-vous que, autre coïncidence, il va être appelé à plusieurs reprises, dans les deux ans, à siéger dans des jurys de thèse (ce qu’il a déjà fait en 2003 et 2004). Or, il vient, à la demande d’une doctorante, de tenter une plongée en eaux troubles, à savoir dans son propre CV.
Il va de soi que je n’ai pas de CV à jour, et même la version ancienne doit être quelque part dans un pénultième, voire antépénultième, voire antédiluvien ordinateur portable. Que fis-je, oncques ? Ni une, ni deux, une recherche fissa sur la base bibliographique du MLA, à mon nom. Fissa toujours, je classai tous les articles que j’ai écrits et qui sont répertoriés dans MLA, et, alors qu’il en manque une demi-douzaine, MLA en répertorie pas moins de quinze, dont trois seulement publiés pendant mes années de thèse, ce qui signifie qu’en allant rechercher les trois ou quatre articles importants qui ne figurent pas dans MLA, et si j’avais eu le temps – ou l’inspiration, ou l’envie – d’écrire les articles correspondant aux cinq ou six communications de ces cinq ou six dernières années, j’aurais à peu près de quoi attaquer le dossier de synthèse et enquiller sur la fichue HDR.
Aaaaaargh, hein, ou youpi, ça dépend du point de vue.
17:20 Publié dans WAW | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 04 mars 2013
Sept colonnes
Cloîtré dans le bureau – il y fait trop chaud – je poursuis ma trace, mes tâches. Depuis six semaines, la maladie (banale mais défigurante) a creusé l’épuisement, de sorte que je me trouve sans ressort, capable seulement de faire ce que j’ai à faire au coup par coup, et au prix, à chaque fois, d’un effort de volonté qui, le reste du temps, semblerait ridicule et disproportionné. Je dois me dire qu’en écrivant ici ce paragraphe, je tente de reprendre pied – symboliquement ? En tout cas, tout m’épuise.
La nuit dernière, j’ai bien dormi. Bien, profondément. Au réveil, vers six heures, je me sentais reposé. Même si cette impression n’a pas duré, il était déjà essentiel de la ressentir. Et, à présent, je dois m’arracher à ce bureau (paperasses, relectures, lettres professionnelles) pour aller marcher au soleil, trouver le soleil.
Peut-être qu’après tout – après tout ça (j’en rirai ?) – il ne sera pas tout à fait trop tard pour adopter enfin l’emploi du temps.
11:52 Publié dans Moments de Tours, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 02 mars 2013
En mission à Pietermaritzburg (11-16 février 2013)
Voici un copié-collé (pour raison de sauvegarde - je doute que cette page Web soit éternelle sur le site d'UKZN) de l'article paru le 1er mars à propos de notre mission de cinq jours en Afrique du Sud. Je corrige juste deux ou trois inexactitudes, par rapport à l'original. [Oui, j'utilise ce blog aussi comme archivage professionnel et autobiographique. Touraine sereine et moi sommes de vieux amis, on se passe toutes nos fantaisies.]
------------------------------------------------------------
Two visiting French academics, Professor Philip Whyte and Dr Guillaume Cingal of the University of Tours, addressed staff and students at a UKZN seminar at the Centre for African Literary Studies (CALS) recently. CALS held an informal lunch for the two visitors who were invited by Professor Bernard DeMeyer of French Studies and also a member of CALS Board.
The main purpose of the visit was to discuss the partnership between the two institutions which involves staff and student exchange and joint research among other co-operation and thus the visitors met the French discipline on the Pietermaritzburg campus, the English Discipline, International Relations and the Dean and Head of the School of Arts, Professor N Zulu.
They also held a meeting with two University of Tours exchange students who are at UKZN this semester.
Informal discussion at the seminar included ideas on the sort of student, staff and research exchanges that could be arranged in future between UKZN and the University of Tours involving English literary studies.
Whyte formerly co-ordinated the MA programme at the University of Tours and his field of specialisation is postcolonial theory and literature in West Africa. He has published a book on Ayi Kwei Armah and about 20 articles on African writers, Ben Okri of Nigeria, Kojo Laing of Ghana, Syl Cheney Coker of Sierra Leone, Syl Bendele-Thomas of Nigeria, Abdulrazak Gurnah of Zanzibar and Kofi Awoonor of Ghana.
Cingal is the co-ordinator of first-year Applied Languages and is the former Head of the English Department. His fields of specialisation are postcolonial literatures, semiotics and translation studies. He wrote several articles on Nuruddin Farah, Breyten Breytenbach, Arundhati Roy, as well as on Jamal Mahjoub.
In his presentation Whyte gave an overview of the history of West African writing in English while Cingal analysed two South African poems, including Jeremy Cronin’s poem, Who. He emphasised the need to provide the historical and social contexts to poems when teaching them to French students.
The French visitors were very impressed by the collection of books at CALS, especially the Onitsha market literature, and the newly archived unpublished materials. They found several items they had previously been unable to locate. "Each shelf cries out for a conference about its holdings," said Dr Cingal. "Future research exchanges will certainly provide the opportunity to take this challenge further."
/ Source de l'article original : UKZN.
05:39 Publié dans Hors Touraine, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 13 février 2013
Balivernes déplorables
Charles Gould assumed that if the appearance of listening to deplorable balderdash must form part of the price he had to pay for being left unmolested, the obligation of uttering balderdash personally was by no means included in the bargain.
(Nostromo, I, 7)
J'ai cru me revoir pendant mes trois années à la direction du département d'anglais, quand je devais rencontrer certains collègues qui se prenaient pour des pontes, ou lors de certaines réunions.
(Philippe Vendrix et Bernard Buron, les rois du "deplorable balderdash")
02:37 Publié dans Autoportraiture, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (1)
mercredi, 06 février 2013
Grippe, grêle
La grippe – la première depuis treize ans – aura eu raison de l’emploi du temps, car, après, il a fallu bricoler la communication, puis se vider du peu d’énergie restant pour le colloque.
Désormais, dans la série « dossiers en retard », ce sont les étudiants sud-coréens et australiens qui vont plomber les journées, avant le départ pour la mission en Afrique du Sud (Pietermaritzburg et Durban, où, entre autres joyeusetés, visites de campus, réunions de travail, je dois assurer 45 minutes de séminaire (jeudi prochain, me semble-t-il) sur je ne sais pas quoi encore). Rappel de l’immuable règle : quand le deuxième semestre s’annonce beaucoup plus léger que le premier, il paraît souvent pire, une fois au pied du mur.
J’espère tout de même avoir le temps, de mars à juin, de mettre en place mon nouvel emploi du temps, et notamment traduire les trois essais de Chaudhuri, la nouvelle de David Francis, et peut-être reluquer du côté de Parker Bilal (dont, en coup de vent, j’ai eu le temps de discuter avec Jamal hier, Jamal apparu in extremis pour une communication qui a tapé pile dans le mille, et a ouvert des dizaines de ramifications dans ce qui avait été dit jusque là – vertigineusement même).
Me suis rarement couché aussi épuisé qu’en ce moment. Entre autres choses, chantiers en souffrance, je devrais, pour ces carnets, rassembler mes notes ou souvenirs relatifs aux différents moments forts de la résidence.
——— La grêle contre les vitres, la grippe contre l’être.
07:51 Publié dans Questions, parenthèses, omissions, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 18 janvier 2013
Softly-softly
Western governments are believed to have urged the Algerian authorities – in vain – to take a softly-softly approach.
Dans cette phrase extraite d’un article du quotidien The Independent (John Lichfield. “Algeria crisis 'still ongoing' after British hostages killed in Saharan bloodbath”, vendredi 18 janvier 2013), et d’un niveau de langue plutôt soutenu, l’adjectivation (avec redoublement) de l’adverbe softly pose un véritable problème de traduction. En effet, le redoublement adverbial existe en français, mais implique un niveau de langue familier, par exemple : Vas-y mollo mollo. Le traducteur peut donc préférer une traduction d’un niveau de langue égal, dans laquelle l’effet stylistique de la langue-source est gommé : « une approche en douceur » (recatégorisation de l’adjectif en syntagme prépositionnel) — ou, mieux, une double recatégorisation, au titre de laquelle le nom approach devient un verbe : Les gouvernements occidentaux ont demandé, à ce que l’on sait, aux autorités algériennes d’y aller en douceur, mais en vain.
Toutefois, des tentatives pour rendre l’effet stylistique porté par le redoublement (effet qui suggère, par exemple, une conversation téléphonique informelle pas trop diplomatique entre David Cameron et son homologue) sont possibles :
[1] … d’adopter la tactique tout doux tout doux
[2] … de choisir une approche moins va-t-en-guerre
[3] … de se hâter avec lenteur
Dans le choix [2] ci-dessus, la traduction en langue-cible recourt à une stratégie proche du contraire négativé. En [3], le texte-cible ajoute une référence culturelle spécifiquement française (La Fontaine), ce qui implique une élévation du registre. Une dernière possibilité mérite d’être signalée, même si, bien entendu, elle est interdite aux étudiants (en traduction universitaire, cela serait sanctionné comme un non-sens), et même si elle peut faire grincer les dents des adversaires absolus du franglais :
[4] … de choisir la stratégie « softly-softly »
08:46 Publié dans Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (1)
mardi, 08 janvier 2013
D'un planisphère entrevu plus qu'observé
 Ce planisphère (dont on ne voit, sur un autoportrait pris ce matin, qu'un fragment océanien, et dont je n'ai trouvé, sur Google Images, que des versions de petite taille (y compris, donc, celle copiée ci-contre)) est très curieux. Ce matin, dans le vestibule du nouveau Service des Relations Internationales de mon université (nouveau au sens où le Service a investi de nouveaux locaux depuis quelques mois), j'ai passé plusieurs minutes à l'inspecter. Il a été édité par l'IGN en 1994, et le principe de nomenclature est que les noms de pays figurent dans la langue du pays. Evidemment, c'est un pari intenable, puisque le recours strict à l'alphabet latin, garant de la lisibilité de la carte, interdit toute littéralité originaire, par-delà le fait même que cette littéralité est un pur fantasme.
Ce planisphère (dont on ne voit, sur un autoportrait pris ce matin, qu'un fragment océanien, et dont je n'ai trouvé, sur Google Images, que des versions de petite taille (y compris, donc, celle copiée ci-contre)) est très curieux. Ce matin, dans le vestibule du nouveau Service des Relations Internationales de mon université (nouveau au sens où le Service a investi de nouveaux locaux depuis quelques mois), j'ai passé plusieurs minutes à l'inspecter. Il a été édité par l'IGN en 1994, et le principe de nomenclature est que les noms de pays figurent dans la langue du pays. Evidemment, c'est un pari intenable, puisque le recours strict à l'alphabet latin, garant de la lisibilité de la carte, interdit toute littéralité originaire, par-delà le fait même que cette littéralité est un pur fantasme.
La Russie est donc "Russika", ou quelque chose comme ça, tandis que l'Inde est signalée par un BHARAT très idéologiquement discutable. En effet, l'Inde a deux langues nationales officielles, et le nom officiel du pays en hindi est Bhārat Gaṇarājya. Donc, soit on respecte la formule complète (avec les diacritiques), soit on a recours au nom anglais, "Republic of India".
De même pour les noms de villes : Le Cap y figure sous son nom afrikaans, alors que la version anglaise "Cape Town" est tout de même plus répandue, y compris dans le pays même. Y a-t-il dans ces choix une volonté de mettre à mal l'hégémonie de l'anglais, comme on dit ? Si tel est le cas, ce planisphère mériterait des recherches plus poussées, et semble démontrer que la géographie est une pratique scientifique éminemment subjective, ou soumise à des idéologèmes.
Il y a aussi des cas intermédiaires, comme les Îles Mascareignes, dont le nom anglais est donné entre parenthèses.
Tout cela est assez étrange.
À défaut d'en avoir trouvé une saisie suffisamment précise sur le Web, je retournerai prendre des photographies avec mon Lumix (pas le smartphone), au Service des Relations Internationales.
13:47 Publié dans Questions, parenthèses, omissions, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
Cherchez l'erreur
06:36 Publié dans WAW | Lien permanent | Commentaires (1)
mercredi, 12 décembre 2012
Y en a qui doodlent
Sans penser à mal ni être certain d'avoir raison, je me demande ici (après tout, le blog sert aussi à cela – archivage des incompréhensions) ce qui peut motiver certains collègues, sollicités pour un sondage Doodle en vue d'une réunion, à répondre, presque immédiatement pour certains, en indiquant qu'ils ne sont disponibles pour aucun des 18 créneaux horaires proposés (sur 5 jours différents, sur 2 semaines distinctes). Comme les deux semaines choisies se trouvent en dehors des semaines d'enseignement, il est donc tentant d'imaginer, les surveillances d'examen n'occupant jamais 18 créneaux horaires, que ces collègues, qui, peut-être, ne veulent pas assister aux réunions quoi qu'il advienne, marquent ainsi leur refus de toute réunion, mais la participation au vote ne laisse pas de m'intriguer : s'ils veulent montrer leur sérieux, leur professionnalisme, leur réactivité électronique, ne s'aperçoivent-ils pas que s'étale là, en face de leur nom, en dix-huit cases rouges visibles de tous, leur totale absence d'investissement, ou, à tout le moins, leur refus de se déplacer sur ces jours-là ? Même s'ils ont d'excellentes raisons de ne pouvoir être présents (et l'une, au moins, n'est pas du tout absentéiste, en général), pourquoi ne le signalent-ils pas en commentaire ? ne peuvent-ils imaginer qu'ils prêtent le flanc à la moquerie ?
)))))))))))))((((((((((((
(sans aucun rapport) Moi qui croyais qu'avec le raccourci clavier alt+0151 on pouvait, en tous espaces électroniques, obtenir mon cher tiret semi-cadratin, je suis bien attrapé : avec ce netbook, dont le clavier, réduit à l'essentiel, n'a pas de pavé numérique, je ne parviens pas, même en utilisant les chiffres majuscules, à obtenir le foutu caractère. Donc recours à la bonne vieille méthode DIY du copier-coller.
02:50 Publié dans Questions, parenthèses, omissions, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 05 décembre 2012
Dommage, dimanche !?
Je tiens à signaler – fût-ce pour une douteuse postérité – que je me trouve à cet instant précis dans mon bureau des Tanneurs, où je vais assurer mon dernier cours de la journée, et que je me rends 6 jours sur 7, cette semaine, à l’Université. Ce n’est pas la première fois que cela arrive, bien sûr. Mais voilà : cours les lundi, mercredi, et vendredi (matin). Le mardi, une réunion sur les projets (que je pilote) de programmes courts à destination des étudiants étrangers. Demain, conférence de Chandani Lokugé dans le cadre de sa chaire Studium. Et, après l’atelier de traduction dont j’anime la troisième séance vendredi après-midi, réunion du groupe des doctorants samedi matin (avec intervention d’une ancienne étudiante, désormais collègue).
17:50 Publié dans WAW | Lien permanent | Commentaires (1)
jeudi, 22 novembre 2012
Rencontre avec Amit Chaudhuri (site Tanneurs, 22 novembre 2012)
Ce jeudi 22 novembre, le grand écrivain, critique et musicien indien Amit Chaudhuri nous a fait l’honneur de venir à la rencontre des collègues et des étudiants, notamment autour de son dernier roman, The Immortals, dont la traduction vient de paraître aux éditions Aux Forges de Vulcain (Les Immortels).
La rencontre, qui a été filmée in extenso et sera visible sous peu sur le site de l’Université, n’a été possible que grâce à l’entregent efficace de Stephen Romer, distingué poète et collègue éminent, et au travail toujours précieux de Chandani Lokugé, qui ne ménage aucune piste lors de ce semestre de résidence. C’est d’ailleurs à la suite de sa présentation du roman de Chaudhuri le 28 septembre dernier qu’est née l’idée de cette rencontre. Cet événement, qui avait été annoncé sur les réseaux sociaux, dans La Nouvelle République et sur le site Web de Livre Au Centre, a eu lieu dans la salle de conférences du 5ème étage de la Bibliothèque des Arts et Lettres (site Tanneurs). Le public était composé d’une quinzaine de collègues et d’une quarantaine d’étudiants de tous niveaux (surtout L1 et L3, mais aussi quelques étudiants de Master – ceux qui sont censés être le plus motivés…).
Amit Chaudhuri a lu deux extraits de son roman, et répondu à plusieurs questions, sur le personnage de Nirmalya, sur les lieux, sa situation particulière au sein des études « post-coloniales », mais aussi la « révélation théologique » que constitue l’expérience musicale. Grâce à la diffusion d’extraits de son œuvre de musicien classique, mais aussi de morceaux appartenant à son répertoire plus personnel (le double projet not fusion), un échange s’est amorcé autour de la pratique musicale, et du sens qu’il donne à ces approches multiples d’une grande complexité.
Subtile, profonde, émouvante, tout en restant éminemment lisible, l’œuvre d’Amit Chaudhuri demande à être découverte, prise à bras-le-corps. Je chroniquerai prochainement ma lecture des Immortals, ainsi que la traduction fraîchement publiée.
 Lors du déjeuner, à la Deuvalière, j’étais le seul non-écrivain des convives : entre Amit, Stephen (qui est pléiadisé, tout de même) et Chandani (dont je traduis en ce moment plusieurs textes, inédits ou parus chez Penguin), il y avait de quoi être intimidé. Après le repas, j’ai raccompagné Amit à son hôtel, et lui ai montré, au passage, dans le jardin de l’archevêché, le cèdre bicentenaire et l’éléphant empaillé, Fritz, icône tourangelle qui a tellement marqué Chandani qu’elle va peut-être lui consacrer une nouvelle !
Lors du déjeuner, à la Deuvalière, j’étais le seul non-écrivain des convives : entre Amit, Stephen (qui est pléiadisé, tout de même) et Chandani (dont je traduis en ce moment plusieurs textes, inédits ou parus chez Penguin), il y avait de quoi être intimidé. Après le repas, j’ai raccompagné Amit à son hôtel, et lui ai montré, au passage, dans le jardin de l’archevêché, le cèdre bicentenaire et l’éléphant empaillé, Fritz, icône tourangelle qui a tellement marqué Chandani qu’elle va peut-être lui consacrer une nouvelle !
(Photo : Amit Chaudhuri et Stephen Romer, rue des Tanneurs.)
22:10 Publié dans Lect(o)ures, Studium Chandani LOKUGE, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 23 octobre 2012
Déshabiller Pierre, habiller Paul
Je viens de découvrir que, dans le "référentiel des tâches 2012-2013" adopté par le conseil d'U.F.R. de mon Université, la décharge annuelle des directeurs des départements d'allemand et d'italien s'élevait désormais à 20 heures (pour 19 et 41 étudiants respectivement en tout en Licence), alors que celle de directeur des études de L1 LEA restait de 20 heures annuelles... pour 331 étudiants. La décharge de directeur de la filière LEA (750 étudiants, 80 collègues) est de... 64 heures.
Précision supplémentaire. Allemand = 19 étudiants en LLCE, 40 en LEA. 13 enseignants.
Anglais = 419 étudiants en LLCE, 690 en LEA. 42 enseignants (lesquels, soit dit en passant, corrigent 5 fois plus de copies qu'un germaniste ou qu'un italianiste).
D'un côté, 1 enseignant pour 4 étudiants. De l'autre, 1 pour 26. Et une bien meilleure décharge, proportionnellement, pour les germanistes.
Autre précision : pour la seule et unique tâche consistant à préparer les documents individuels de modalités transitoires des redoublants de 1ère année de LEA (presque 70 étudiants), le directeur des études de L1 LEA a travaillé 28 heures. Or, ce n'est qu'une infime partie de sa tâche.
Dans le même ordre d'idées, je pourrais aussi égratigner les collègues littéraires (236 étudiants inscrits dans les trois années de Licence), qui réussissent à obtenir 32 heures de décharge pour le directeur du département de français et 32 heures de décharge pour le responsable du Pôle Lettres, alors que le Pôle Lettres n'ajoute que les étudiants de Lettres classiques, et ne représente un vrai travail qu'au moment des négociations de contrats quinquennaux. En tout, ils ont don autant que le responsable de la filière L.E.A. (690 étudiants pour les 3 années de Licence), sans compter la gestion des 70 collègues, des intervenants professionnels, et la coordination des stages obligatoires à l'étranger (étudiants de L3 et de M1).
Si je note tout ceci, ce n'est pas seulement pour dénoncer de très fortes disparités dans le travail de collègues censément tous logés à la même enseigne. C'est pour signaler que l'inégalité, liée à la nécessité de répartir la misère, est renforcée par des décisions politiques que tout le monde, sans doute par prudence ou respect de l'omerta, semble avoir votées.
13:16 Publié dans WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 16 octobre 2012
Bahala na !
J'ai fini de lire The Match de Romesh Gunesekera. « Presque fini » serait plus juste : je me suis gardé, exprès, les sept ou huit dernières pages pour ce soir. L'écriture de Gunesekera – qui a atteint les plus hauts sommets, selon moi, avec Heaven's Edge, livre absolument magnifique et bousculant – s'est un peu attiédie ici. Tant le protagoniste que son parcours font songer au roman de Jamal Mahjoub, Travelling with Djinns.
 C'est le séjour, dans le cadre de la Chaire Studium, pour un semestre entier, de Chandani Lokugé dans notre Université qui m'a replongé totalement dans le Sri Lanka. La semaine dernière, j'achevais Turtle Nest. Et là, après The Match – parabole historique ? Underworld à la sri lankaise ? roman philippin ? — j'enchaînerai avec Softly As I Leave You, le dernier roman de Chandani. Fin novembre et début décembre, j'organiserai avec elle un atelier de deux ou trois séances consacré à la traduction de certains extraits de ces deux romans. Son dynamisme et son hyperactivité me font bien plaisir, ont dynamité un peu le début d'année, sinon terne ou simplement laborieux, de sorte que je me suis retrouvé propulsé avec le comité d'organisation du festival « Voix d'ici, voix d'ailleurs », ou encore à discuter de Ronsard avec elle pendant un bon bout de temps, sans compter le projet de programme d'hiver à mettre en place chez nous à destination des étudiants australiens non francophones.
C'est le séjour, dans le cadre de la Chaire Studium, pour un semestre entier, de Chandani Lokugé dans notre Université qui m'a replongé totalement dans le Sri Lanka. La semaine dernière, j'achevais Turtle Nest. Et là, après The Match – parabole historique ? Underworld à la sri lankaise ? roman philippin ? — j'enchaînerai avec Softly As I Leave You, le dernier roman de Chandani. Fin novembre et début décembre, j'organiserai avec elle un atelier de deux ou trois séances consacré à la traduction de certains extraits de ces deux romans. Son dynamisme et son hyperactivité me font bien plaisir, ont dynamité un peu le début d'année, sinon terne ou simplement laborieux, de sorte que je me suis retrouvé propulsé avec le comité d'organisation du festival « Voix d'ici, voix d'ailleurs », ou encore à discuter de Ronsard avec elle pendant un bon bout de temps, sans compter le projet de programme d'hiver à mettre en place chez nous à destination des étudiants australiens non francophones.
Turtle Nest est un très beau roman, très équilibré, qui s'inscrit dans une forme de modernisme classique, si j'ose ce qui pourrait sembler un paradoxe, et qui s'achève sur une pointe narrative aussi efficace qu'inattendue. Si j'ai bien compris les allusions de Chandani lors de notre promenade dans les jardins du Prieuré, il s'articule autour d'un symbolisme complexe (animaux, éléments naturels) dont tout ou presque doit m'échapper.
Entre ses diverses tâches au titre de la chaire Studium, Chandani a commencé d'écrire un roman dont l'action se passera, au moins en partie, en Touraine. Après-demain, je vais lui faire découvrir le manoir de La Possonnière ; si nous avons assez de temps, j'essaierai de lui montrer d'autres beaux sites voisins de Couture, quoique le très beau château de Poné n'ouvre au public qu'en été.
Nous verrons. Bahala na. Bahala na kayo ! (The Match, p. 255)
14:03 Publié dans Hors Touraine, Lect(o)ures, Résidence avec Laloux, Studium Chandani LOKUGE, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 03 octobre 2012
Dédésir de lalavenir
Dans le récent numéro du magazine hebdomadaire local TMV, on trouve, dans un entretien avec le doyen de la faculté de médecine, M. le Professeur Dominique Perrotin, la phrase suivante, attribuée à l’auguste personnage : « C’est impossible d’oublier le passé quand nous réfléchissons au futur et avoir en tête que nous sommes ici pour former de très bons médecins. »
On ne peut tout à fait exclure que l’incohérence vienne d’une erreur de saisie, ni qu’elle soit une bourde du journaliste. Toutefois, quand on a entendu, une fois ou deux, l’auguste personnage prendre la parole en public, on ne peut pas exclure, non plus, qu’il soit entièrement l’auteur de cette bouillie asyntaxique.
(Précision supplémentaire. L’entretien se clôt sur cette belle (…) formule : « Il est là l’avenir. »)
11:33 Publié dans Indignations, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 13 septembre 2012
All the Crap in this Year
Grand soleil par les baies. Bricoles expédiées -- enfants chacun dans son école -- How My Heart Sings par Bill Evans, Marty Morell et Eddie Gomez. Me voici à même de consacrer une grande part de ce jeudi à boucler les premières séances du nouveau (et peu roboratif, sur le papier) cours magistral que je dois assurer en première année.
Demain, réunion pour fixer plus précisément les contenus des T.D. de méthodologie (il y a encore des zones d'ombre).
Sinon, pour la première séance de traductologie en agrégation interne, je sais ce que je vais proposer, afin que ça ne soit pas trop rébarbatif pour les "doublants". Outre la présentation de l'épreuve (passage obligé, il y aura des petits bleus) et un rapide survol des différents procédés qu'il faut savoir identifier, mais surtout mettre en place, je vais ponctuer le tout d'un exercice de traduction et commentaire de traduction à partir des titres de chansons d'un des derniers albums du groupe Sparks :
Good Morning
Strange Animal
I Can't Believe That You Would Fall for All the Crap in this Song
Let the Monkey Drive
I've Never Been High
(She Got Me) Pregnant
Lighten Up, Morrissey
This is the Renaissance
The Director Never Yelled 'Cut'
Photoshop Me Out Of Your Life
Avec ces dix titres, je peux présenter et même commencer à élaborer tous les concepts principaux : recatégorisation, étoffement et effacement, dilution et concentration, chassé-croisé (avec étoffement), modulation du contraire négativé, hypéronymie, modulations métaphoriques... sans parler des questions de genre, de nombre et de choix verbaux. À la rigueur, on pourrait tenir le semestre là-dessus...
09:20 Publié dans WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 07 septembre 2012
L'Université de Tours, ou le dogme de la triple unicité
Pour mon deuxième jour (après lundi) de passage à la B.U., j’ai découvert un très intéressant marque-pages vantant la migration de la totalité des « services centraux » sur le site, pas très éloigné mais peu commode à trouver quand on ne connaît pas bien Tours, du Plat d’Etain.
 En voici, saisis côte à côte, le recto et le verso (cliquer sur l'image pour agrandir). On découvre ainsi que le « guichet unique » se trouve sur trois sites différents. Cherchez l’erreur !
En voici, saisis côte à côte, le recto et le verso (cliquer sur l'image pour agrandir). On découvre ainsi que le « guichet unique » se trouve sur trois sites différents. Cherchez l’erreur !
Accessoirement, le Service des Relations Internationales, qui se trouvait naguère rue des Tanneurs, juste à côté du site principal, se trouve désormais au Plat d’Etain, ce qui signifie que tous les étudiants étrangers sont encore plus paumés et déboussolés qu’avant. Le planning à la tourangelle, une longue tradition d’absurdité…
09:22 Publié dans WAW | Lien permanent | Commentaires (2)
mardi, 26 juin 2012
Vers la nouvelle énième réforme de la formation des enseignants...
 Dans une note très importante parue aujourd'hui même dans le Bulletin Officiel de l'Education Nationale, les nouvellement nommés Vincent Peillon et George Pau-Langevin confirment plusieurs choses :
Dans une note très importante parue aujourd'hui même dans le Bulletin Officiel de l'Education Nationale, les nouvellement nommés Vincent Peillon et George Pau-Langevin confirment plusieurs choses :
- le gouvernement compte poursuivre la so-called "formation professionnelle" aux dépens d'un renforcement, pourtant hautement souhaitable, des socles de connaissance (en Licence et en Master)
- le gouvernement compte recréer, en leur donnant le pouvoir qu'ils n'ont jamais vraiment perdu et sous le nom d'"école supérieure du professorat", les IUFM
- les bureaucrates qui rédigent les textes officiels que cosignent ensuite des ministres ignorent presque tout de la syntaxe française. Je prendrai, pour seule preuve de cela, une phrase assez hallucinante : "Les systèmes éducatifs les plus performants sont ceux qui assurent une formation initiale et continue de grande qualité des professeurs."
12:12 Publié dans WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 25 avril 2012
Let The Great World Spin
Le roman le plus récemment lu, assez poussivement en raison du manque de suivi, m’avait été recommandé par une collègue irlandisante, à la Saint-Patrick – ça ne s’invente pas – et avec la promesse que c’était un chef-d’œuvre absolu. Il s’agit du grand roman de Colum McCann, Let The Great World Spin, qui n’a rien d’un chef-d’œuvre. Tout – à commencer par le style, très académique, de McCann – donne une impression de déjà-lu. Rien ne dépasse, en quelque sorte, ce qui est fâcheux pour un texte dont le motif central est l’exploit de Philippe Petit, funambule qui fit tout un numéro d’équilibre, le 7 août 1974, entre les deux tours du World Trade Center, au niveau du 110ème étage. Le croisement de deux époques (les années 60, avec le Viêtnam, et les années 2000) et de deux contrées (l’Irlande et la Nouvelle-Angleterre) s’inscrit dans un récit à plusieurs narrateurs non récursifs. McCann pense tout ce qu’il est bon de penser (sur les minorités, sur la guerre, sur les drogués, sur l’amour), et écrit comme il faut écrire au début du 21ème siècle : d’une manière léchée, classique, tout en empruntant un certain nombre de ressorts aux avant-gardes narratives des années 70-80. L’ensemble est tout à fait middle-brow, et semble préfabriqué pour ces gens qui emportent un Amélie Nothomb sur la plage en se croyant terriblement supérieurs à ceux de leurs voisins qui se servent, pour pare-soleil pendant la sieste, d’un Musso ou d’un Marc Lévy. Entre autres, la façon dont les vies des différents protagonistes/narrateurs se croisent n’a plus rien de surprenant (mais ce jugement vient de quelqu’un qui a trouvé, en le revoyant il y a quelque temps, que Mystery Train de Jarmusch avait très mal vieilli).
Je suis plutôt méchant, et vais m’amender en citant quelques passages particulièrement réussis.
Old domino players sat in the courtyard, playing underneath the flying litter. The sound of the plastic bags was like rifle fire. If you watched the rubbish for a while you would tell the exact shape of the wind. Perhaps in a way it as alluring, like little else around it: whole, bright, slapping curlicues and large figure eights, helixes and whorls and corkscrews. (Bloomsbury, 2009, p. 31)
The men sat rooted like Larkin poems. (p. 33)
She wore a ring on her right hand, twirling it absently. There was a grace and a toughness about her, entwined. (p. 57) – Je pense avoir noté ces phrases car j’écoutais, au moment où je les ai lues, l’album des deux saxophonistes Urs Leimgruber et Evan Parker, dont les titres sont Twine, Twirl et Twist. Je ne minimise jamais ce genre de coïncidence ; elles sont le sel de l’art.
[Blaine] was a dynamo of ambition. Another film, Calypso, had Blaine eating breakfast on the roof of the Clock Tower Building as the clock behind him slowly ticked. On each of the clock hands he had pasted photographs of Vietnam, the second hand holding a burning monk going around and around the face. (p. 123)
Billy recited pages from Finnegans Wake in my ear. The father of fornicationists. He had learned twenty pages by heart. It sounded like a sort of jazz. Later I could hear his voice ringing in my ear. (p. 125)
Enfin, je voulais donner in extenso (déformation professionnelle oblige) un très bon sujet de version, mais n’ai pu copier-coller à partir du site Wattpad. Le passage commence à « The lack of money didn't bother my mother too much. » (pp. 286-8 de l’édition Bloomsbury).
11:01 Publié dans Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 21 avril 2012
Le Syndrome du 21 avril
Etant déjà rentrée chez elle, la veille, à presque 21 h, et devant encore rendre huit ouvrages usuels qui avaient servi à la préparation des colles de Capes à la B.U., la marquise s'apprêta à repartir à la faculté des Tanneurs le samedi matin, soit une semaine de six jours "in the workplace".
(in La Marquise n'est pas un turboprof. Fleuve noir, p. 26)
07:43 Publié dans WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 01 avril 2012
Version d'Agrégation externe 2012 (Sinclair Lewis, Babbitt, ch. XVII)
Ayant découvert le sujet de version de l'agrégation externe d'anglais 2012 vendredi soir, après la fin de l'épreuve, et ayant été pas mal pris depuis, je viens de terminer le premier jet, qui a été fait en 50 minutes environ (en deux fois). J'ai vérifié quatre ou cinq mots, soit de l'original, soit pour des recherches de synonymie. [Je n'ai pas vérifié les termes qui ne feront pas la différence entre les candidats, car personne ne les connaîtra précisément, ainsi hooptedoodle. Il convient de traduire ce genre de mots le plus précisément possible en fonction de ce que le contexte permet d'en saisir. * ] --- Je ne suis pas membre du jury, mais j'enseigne la version depuis 12 ans et ai eu, en 1997, des notes plus qu'honorables à l'agrégation dans cette matière (si vous me soudoyez, je vous les donnerai !).
Premier jet, donc modifications à suivre et commentaires bienvenus. Que l'on considère donc ceci comme le brouillon : dans l'hypothèse où je serais candidat face à ma table, il me resterait pas mal de temps pour peaufiner la version au propre.
Autre remarque importante : la traduction "de concours" implique parfois une plus grande littéralité, voire des choix visant à montrer au jury que l'on maîtrise parfaitement les structures de la langue-source. [Ce point est l'objet de nombreux débats : par exemple, les rapports de jurys sont parfois critiqués car les solutions proposées par le jury lui-même peuvent être considérées comme des semi-calques, voire inexactes.]
Le texte était plutôt long, et sa caractéristique principale était l'accumulation, dans une longue première moitié, de phrases nominales abondant en participes présents (V-ing étant, en soi, une des plus éminentes difficultés dans le passage de l'anglais au français). Le vocabulaire de la lumière, souvent très riche en anglais, n'était pas trop problématique ici, dans la mesure où Sinclair Lewis joue beaucoup, en fin de compte, sur la répétition de light/lights.
Il va de soi que je ne sais pas du tout ce que décidera le jury, mais que plusieurs participes présents appelaient une verbalisation au moyen de verbes conjugués. Le temps grammatical du récit qui suit les phrases en V-ing étant le passé, j'ai préféré opter pour des imparfaits, même si je prends le risque de proposer des présents pour les deux premières occurrences. Si l'on se rappelle qu'au moment de publier ce billet, je suis dans la situation fictionnelle du candidat après le premier jet au brouillon, ce choix fait partie des options sur lesquelles je reviendrai(s) peut-être dans un second temps.
Par ailleurs, on peut retrouver ici le texte du chapitre 17 de Babbitt.
-----------------------------------------------------------
Voici donc ce que je propose, provisoirement. Les nombres entre crochets sont évidemment ajoutés pour permettre la fragmentation en unités de traduction, et surtout les commentaires.
[1] A snow-blanched evening of ringing pavements and eager lights.
>>> Un soir blanchi par la neige, tout en trottoirs qui résonnent et vives lumières.
[2] Great golden lights of trolley-cars sliding along the packed snow of the roadway.
>>> Immenses lumières dorées des trolleys qui passent en glissant sur la neige tassée de la chaussée.
[3] Demure lights of little houses.
>>> Lumières sages des maisons basses.
[4] The belching glare of a distant foundry, wiping out the sharp-edged stars.
>>> Au loin la lumière, aussi criarde qu’un rot, d’une fonderie, et qui effaçait les étoiles aux contours bien nets.
[5] Lights of neighborhood drug stores where friends gossiped, well pleased, after the day’s work.
>>> Lumières des épiceries de quartier, où on potinait entre amis, bien contents, après une longue journée de travail.
[6] The green light of a police-station, and greener radiance on the snow; the drama of a patrol-wagon-gong beating like a terrified heart, headlights scorching the crystal-sparkling street, driver not a chauffeur but a policeman proud in uniform, another policeman perilously dangling on the step at the back, and a glimpse of the prisoner.
>>> La lueur verte d’un commissariat, qui se réfléchissait en éclats plus verts encore sur la neige, l’apparition mouvementée d’un fourgon de police qui passait en faisant sonner son alarme comme un cœur en proie à la terreur, les phares qui balayaient la rue aux scintillements de cristal, le conducteur qui n’était pas un chauffeur mais un policier portant fièrement son uniforme, on voyait un autre policier se tenir de façon précaire sur le marchepied, et on apercevait à peine le prisonnier.
[7] A murderer, a burglar, a coiner cleverly trapped?
>>> Un meurtrier, un cambrioleur ou un faux-monnayeur qui s’est fait pincer habilement ?
[8] An enormous graystone church with a rigid spire; dim light in the Parlors, and cheerful droning of choir-practise.
>>> Une immense église en pierre grise, flèche bien droite, pénombre dans les parloirs, et le babil enjoué du chœur en pleine répétition.
[9] The quivering green mercury-vapor light of a photo-engraver’s loft.
>>> La lumière, vacillante et verte sous l’effet des vapeurs de mercure, d’un atelier de photographie.
[10] Then the storming lights of down-town;
>>> Puis les lumières ardentes du centre ville,
[11] parked cars with ruby tail-lights;
>>> les feux arrière, couleur rubis, des voitures garées,
[12] white arched entrances to movie theaters, like frosty mouths of winter caves;
>>> les entrées des cinémas, aux arcatures blanches, comme l’entrée gelée d’une grotte en hiver,
[13] electric signs—serpents and little dancing men of fire;
>>> les enseignes électriques (des serpents et de petits bonshommes en feu),
[14] pink-shaded globes and scarlet jazz music in a cheap up-stairs dance-hall;
>>> des globes entourés d’un halo rose, et la musique de jazz – écarlate – qui résonne à l’étage, dans un dancing populaire,
[15] lights of Chinese restaurants, lanterns painted with cherry-blossoms and with pagodas, hung against lattices of lustrous gold and black.
>>>les lumières des restaurants chinois, leurs lampes peintes aux motifs de fleurs de cerisier et de pagodes, et accrochées à des paravents noir et jaune vif.
[16] Small dirty lamps in small stinking lunchrooms.
>>> De petites lampes sales dans de petits réfectoires nauséabonds.
[17] The smart shopping-district, with rich and quiet light on crystal pendants and furs and suave surfaces of polished wood in velvet-hung reticent windows.
>>> Le quartier des boutiques chic, dont les lumières opulentes et paisibles coulent de lustres en cristal, et les fourrures, la surface doucereuse du bois poli dans des vitrines discrètes aux rideaux de velours.
[18] High above the street, an unexpected square hanging in the darkness, the window of an office where some one was working late, for a reason unknown and stimulating.
>>> Plus haut dans la rue, une place inattendue, plongée dans l’obscurité, la fenêtre d’un bureau où quelqu’un travaillait tard, pour une raison inconnue, source de questions.
[19] A man meshed in bankruptcy, an ambitious boy, an oil-man suddenly become rich?
>>> Un homme enchevêtré dans une histoire de faillite, un adolescent ambitieux, un spécialiste du pétrole qui vient de faire fortune ?
[20] The air was shrewd, the snow was deep in uncleared alleys, and beyond the city, Babbitt knew, were hillsides of snow-drift among wintry oaks, and the curving ice-enchanted river.
>>> L’air était aux magouilles, la neige épaisse dans les ruelles non dégagées, et, en dehors de la grande ville, Babbitt le savait, il y avait, sur les flancs des collines, des chênes glacés par l’hiver et les congères, et le fleuve sinueux transfiguré par la glace.
[21] He loved his city with passionate wonder.
>>> Il aimait sa ville avec un émerveillement passionné.
[22] He lost the accumulated weariness of business-worry and expansive oratory;
>>> Il sentait se détacher de lui la lassitude accumulée au gré des soucis professionnels et de discours interminables,
[23] he felt young and potential.
>>> il se sentait jeune et Plein de vigueur /prêt à tout casser/.
[24] He was ambitious.
>>> Il était ambitieux.
[25] It was not enough to be a Vergil Gunch, an Orville Jones. No.
>>> Être un Vergil Gunch, un Orville Jones, ce n’était assez, oh non.
[26] “They’re bully fellows, simply lovely, but they haven’t got any finesse.”
>>> « Ce sont des rustres, adorables certes mais dénués de finesse. »
[27] No. He was going to be an Eathorne; delicately rigorous, coldly powerful.
>>> Non. Ce qu’il serait, c’est un Eathorne : rigueur subtile & puissance austère.
[28] “That’s the stuff. The wallop in the velvet mitt. Not let anybody get fresh with you.
>>> « Voilà, c’est ça. La gifle sous le gant de velours. Pas laisser qui que ce soit vous prendre de haut.
[29] Been getting careless about my diction. Slang. Colloquial. Cut it out.
>>> Me suis laissé aller, sur le plan verbal. De l’argot. Des familiarités. Fini, ça.
[30] I was first-rate at rhetoric in college. Themes on— Anyway, not bad.
>>> A la fac, j’étais doué en rhétorique. Des thèmes qui traitaient de… bon, enfin, je me débrouillais.
[31] Had too much of this hooptedoodle and good-fellow stuff.
>>> J’en ai eu ma dose des verbiages et de faire le gentil.
[32] I— Why couldn’t I organize a bank of my own some day?
>>> Pourquoi ne pourrais-je pas fonder ma propre banque, un jour ?
[33] And Ted succeed me!”
>>> Oui, et Ted me succèderait ! »
[34] He drove happily home, and to Mrs. Babbitt he was a William Washington Eathorne, but she did not notice it.
>>> Il rentra chez lui en voiture, parfaitement heureux. Pour sa femme, c'était un autre [un homme de la trempe de ?] William Washington Eathorne, bien qu’elle ne le remarquât pas.
----------------------------------
* Ajout publié sur Facebook à 12 h 20 :
Il m'arrive un truc amusant. Voulant vérifier ma traduction pifométrique de "hooptedoodle", et ce donc dans l'outil lexicographique le plus complet qui soit, j'ai nommé l'OED, voici ce qui se passe :
"No exact results found for hooptedoodle in the dictionary."
Vérification faite, Elmore Leonard aurait prétendu qu'il s'agissait d'un terme forgé par Steinbeck en 1954, alors qu'on le voit apparaître déjà dans Babbitt (1922). L'absence de ce terme dans l'OED, qui répertorie pourtant foultitude d'archaïsmes, argotismes et termes dialectaux est très curieuse.
Ce blog en donne une définition qui fait de ma traduction pifométrique ("verbiages") une des meilleures possibles ;-))
Best possible example of what I always say : if you spot a word you've never come across, well then not having come across it will be the case of at least 90 percent of the other "candidats", so translate it as close as possible, and it'll be fine. So at that level translation (especially from English to French for French native speakers) is not about vocabulary.
11:31 Publié dans WAW | Lien permanent | Commentaires (10)
vendredi, 30 mars 2012
Du long pourrissement de Mohamed Harinordoquy
Tiens, un énième exemple (sans mériter la une du JT de France 2 comme le collègue du lycée Chaptal) de la nécessité de savoir lire, réfléchir et recouper ses sources quand on fait des recherches sur Internet : l'entrée "Thomas Fersen" sur Wikipedia (très mal fichue, ce qui déjà incite à la prudence*) signale en cours d’article que le chanteur a adopté son nom de scène en 1986, sans jamais donner, toutefois, le « vrai nom » de l’artiste. Intrigué, j’ai fait quelques recherches et découvert que la page WP avait été, à un moment donné, piratée par un plaisantin : pendant quelques jours (quelques semaines ?), on pouvait donc lire dans la WP que Thomas Fersen était de père kurde et de mère basque, et se nommait en fait Mohamed Harinordoquy. Il s’agit évidemment d’un canular total – dont il ne serait d’ailleurs pas surprenant que Fersen ou des amis à lui (le facétieux Pierre Sangra ? le déjanté Alexandre Barcelona ?) l’aient fomenté.
En vertu des processus de vérification constante, il y a belle lurette que l’entrée WP ne mentionne plus ces informations farfelues (erronées). Eh bien ! Essayez de taper « vrai nom de Thomas Fersen » dans Google : vous verrez que cette pseudo-info a été largement reprise et que
- il n’est pas possible de déterminer si Thomas Fersen est un pseudonyme
- la référence à « Mohamed Harinordoquy » fleurit de ça de là
Il y a donc, sur ce détail sans importance, foule d’informations contradictoires, qui découlent d’un petit canular de trois fois rien, et – par conséquent – absence totale d’informations. « Pourrir le Web », comme dirait l’autre, c’est monnaie courante**, c’est d’une facilité consternante… et c’est totalement indigne, en tant que méthode pédagogique, d’un enseignant, fût-il dépressif, hautain et réactionnaire – ou les trois à la fois, comme Loys de Chaptal.
---------------------------------------------
* Je tiens à préciser/rappeler que, contrairement à ce qu'écrivent un certain nombre d'internautes (dont des enseignants), Wikipedia n'est pas du tout "un nid à conneries". Il y a un certain nombre d'entrées douteuses, ou dont certaines sections n'ont pas été suffisamment vérifiées. Il n'en demeure pas moins, que même la WP francophone (la WP anglophone est encore beaucoup plus documentée et fiable) propose un contenu plus riche que n'importe quelle encyclopédie papier (Universalis et Britannica incluses). Evidemment, dans la masse, beaucoup des "sujets" traités sont dérisoires : par exemple, la WP anglophone consacre un long article (16 sections et 210 notes de bas de page) à la chanson Born This Way. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain ! Quand on sait s'en servir (notamment par le truchement des catégories, des liens internes ou des liens entre les différentes WP (colonne de gauche)), Wikipédia est un irremplaçable outil de connaissance et de langue.
** Concernant le débat autour du pseudo-exploit de Chaptalman, il y a eu de nombreux échanges sur Facebook. Pas le courage de les recopier ici. Sinon, certains commentateurs de Rue89 n'ont pas donné dans le panneau de la démagogie et de la célébration irréfléchie de Loys-le-faussaire.
10:11 Publié dans Autres gammes, Indignations, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 26 janvier 2012
François Hollande, et l'Université...
Je viens de découvrir que François Hollande aurait dit ça :
Je réformerai les premiers cycles universitaires, en décloisonnant les filières à l’université afin d’éviter une spécialisation trop précoce des étudiants.
Et moi, j'ai écrit ça (sur FB) :
À force de ne pas vouloir spécialiser les étudiants trop tôt, on se retrouve dans la situation intéressante de renseigner des élèves de 4ème sur les études d'anglais à l'Université, et, presque dans la foulée, de renseigner des étudiants titulaires d'un bac+4 qui ne savent toujours que faire avec. Sans parler des flopées d'étudiants de L1 "spécialité" Anglais qui disent "I don't wanting" et ne savent pas dire parapluie, vélo, bureau... ni même "réseau social".
Ni la gauche ni la droite ne semblent savoir que presque tous les Français d'une même classe d'âge sont titulaires d'un baccalauréat qui n'a aucune valeur, ce qui dévalue par contrecoup toutes les formations du supérieur (même les prétendument prestigieuses).
17:04 Publié dans Chèvre, aucun risque, Indignations, WAW | Lien permanent | Commentaires (4)
dimanche, 22 janvier 2012
Aby Warburg, pas demain la veille
Je prépare mes commandes auprès de la Bibliothèque Universitaire (si je peux m'habituer à écrire éventuellement B.U. dans ce carnétoile, il m'est difficile d'employer le sigle officiel, S.C.D. - Service Commun de Documentation), comme souvent le dimanche soir, et, faisant une recherche sur Aby Warburg, je constate qu'un des trois livres que possède la B.U. est
EN REPARATION
Le deuxième est ........................... DISPONIBLE EXCLU DU PRÊT
Le troisième devait être ramené par son emprunteur le 3 janvier dernier.
J'en suis à me demander qui je dois maudire le plus, du service si réfractaire à faire partie de la communauté qu'il exclut ses ouvrages du prêt (il s'agit de la Bibliothèque de Section d'Histoire et d'Histoire de l'Art, une secte hors de saison), ou de l'emprunteur assez indélicat pour avoir déjà trois semaines de retard pour le retour d'un ouvrage. (Pour ce dernier, je subodore un collègue.)
18:38 Publié dans Indignations, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 21 janvier 2012
Paperolles avant printemps
Mardi, me semble-t-il, j'ai aidé une collègue à faire du tri et surtout du ménage dans le bureau qu'elle occupe avec quatre autres collègues et qui, parce qu'il est propre et bien rangé, avait échappé à mes razzias de fou de la benne (à recyclage) lorsque je dirigeais le département d'anglais - oui, femme de ménage faisait partie de mes attributions officieuses. Il se trouve que nous avons déniché des paquets de copies vieux de parfois dix ans (or, lorsque les étudiants ne les ont pas récupérés au bout d'un an, on peut s'en débarrasser) ainsi que divers papiers ou supports de cours de collègues partis depuis parfois trois ans, parfois cinq, parfois une décennie. J'ai sauvé de l'immense masse de paperasses obsolètes et sans aucune utilité des centaines de photocopies de sujets de thème dont je pourrai sans doute me servir si j'enseigne le thème littéraire dans les années à venir. Il s'agit de textes de Pagnol, de Modiano, d'Alain-Fournier, de Camus - mais aussi de Paul Bonnecarrère et de Maurice Pons. Je lis ces textes en les traduisant in petto, selon le principe de la traduction improvisée (encore en vigueur lors des épreuves orales de l'agrégation interne), et tout en regardant le match le rugby Stade français - Worcester. La chatte, après avoir farfouillé de ci de là, tracassière, m'a rejoint sur le canapé, et fait la patouille sur le plaid à imprimé panthère (du meilleur goût). Avant le dîner, à la buanderie, j'ai écrit trois poèmes, Poèmes de la buanderie donc. L'autre jour (oui, c'était mardi), nous avons rempli deux chariots métalliques de ces kilos de paperasses. Gâchis, yet spring cleaning (in winter).
21:12 Publié dans Moments de Tours, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 20 janvier 2012
La langue française, version Université de Tours
20:00 Publié dans Indignations, Moments de Tours, WAW, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (2)