samedi, 15 décembre 2007
Mines farouches
En cherchant dans le Robert culturel divers renseignements sur les deux étymologies de mouche et moucher, mais aussi les dates de première occurrence de certaines expressions idiomatiques (dont faire mouche ou fine mouche), je découvre la citation suivante, si typique de Rousseau paranoïaque :
Je pris l'enfant dans mes bras, je le baisai plusieurs fois dans une espece de transport, & puis je continuai mon chemin. Je sentois en marchant qu'il me manquoit quelque chose. Un fort besoin naissant me ramenoit sur mes pas. Je me reprochois d'avoir quitté si brusquement cet infant, je croyois voir dans son action, sans cause apparente, une sorte d'inspiration qu'il ne falloit pas dédaigner. Enfin cédant à la tentation, je reviens sur mes pas ; je cours à l'enfant, je l'embrasse de nouveau, & je lui donne de quoi acheter des petits pains de Nanterre, dont le marchand passoit là par hasard, & je commençai à le faire jaser ; je lui demandai qui étoit son pere ? il me le montra qui relioit des tonneaux ; j'étois prêt à quitter l'enfant pour aller lui parler, quand je vis que j'avois été prévenu par un homme de mauvaise mine, qui me parut être une de ces mouches qu'on tient sans cesse à mes trousses. Tandis que cet homme lui parloit à l'oreille, je vis les regards du tonnelier se fixer attentivement sur moi d'un air qui n'avoit rien d'amical. Cet objet me resserra le coeur à l'instant, & je quittai le pere & l'enfant avec plus de promptitude encore que je n'en avois mis à revenir sur mes pas, mais dans un trouble moins agréable qui changea toutes mes dispositions. (Rêveries du promeneur solitaire, IX)
Du transport au trouble, on passe par les trousses. La mouche, c'est ici l'espion, le mouchard. L'homme de mauvaise mine, c'est la némêsis toujours retrouvée de Rousseau.
(Dans le Robert culturel, la citation, plus restreinte que ci-dessus, se trouve entre bateau-mouche et fine mouche.)
12:40 Publié dans Le Livre des mines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, écriture, Ligérienne
Bergman, où passé
Dans Corée l'absente, Renaud Camus s'offusque de découvrir qu'Arte diffuse le dernier film d'Ingmar Bergman en version doublée (et donc en français). Il note alors ce dont je me suis souvent fait la remarque : "Je ne vois pas très bien qui peut avoir envie de voir un film de Bergman en français. Surtout je ne vois pas très bien ce qui en subsiste. Je ne dirais pas que la langue est tout, chez Bergman, mais elle est le ciment qui tient le reste." (p. 622).
Quand j'essayais de lui expliquer ce point de vue, P. (dont la mort remonte à 10 mois et 1 jour (tandis que je fêtais hier mes 33 ans et 33 jours)) me rétorquait que, pour les personnes qui, comme lui, ne comprennent pas la langue d'origine et qui sont en partie sourdes, passer la totalité du film à lire les sous-titres est pire que tout. Il n'en demeure pas moins qu'à mon avis, on n'a pas vraiment vu un film de Fellini s'il n'était pas diffusé en V.O., de même que les quelques anglophones qui ont fini par céder aux sirènes de la collection Shakespeare Made Easy ne connaîtront jamais Shakespeare : ce n'est pas que la difficulté ou l'abstrusion soient shakespeariennes par essence, mais, par le processus de facilitation (made easy), disparaît ce qui fait la force de ce théâtre. De même, les voix de Roma ou de E la nave va n'ont d'autre écho, fondamentalement, qu'italien.
En lisant cette page du journal 2004, je me suis aussi rappelé ma lecture du Journal de Travers, au printemps dernier. J'avais été frappé de constater que le narrateur (Renaud Camus diariste, mais en 1976-77) réitérait plusieurs fois l'idée, évidente à ses yeux, selon laquelle Bergman était un cinéaste mainstream, pour les petits-bourgeois, et nullement de l'ordre de la grande culture :
" (Le p.-b. français voit la marque du génie dans l'élévation du sujet : d'où l'estime durable dans laquelle est tenu Bergman par exemple, par l'étudiant du quartier Latin : c'est le cinéaste middlebrow type.) " (Journal de Travers I. Fayard, 2007, p. 186)
Cette affirmation récurrente m'avait étonné, et je constate qu'en presque trois décennies, il se pourrait que Renaud Camus ait changé d'avis.
[Ici, il faudrait citer le long passage de la page 475, toujours dans le premier tome : Camus y définit, après Woolf, l'intellectuel middlebrow, "la strate Télérama de la pensée", en citant de nouveau Bergman. Il faudrait citer aussi Didier Goux, qui m'a appris que la diffusion de Sarabande en version doublée avait été voulue par Bergman lui-même.]
11:11 Publié dans Corps, elle absente | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Littérature, Langue française, Cinéma
vendredi, 14 décembre 2007
L'Ermitage de Buron
" Le ciel lui-même s'est mis de la partie : il était aussi tumultueux que le paysage, tout en balafres énormes,  en striures gigantesques, en boursouflures du diable, prêtes à s'écraser sur le wanderer nain au pied de la forteresse maudite, le tout à l'encre noire comme chez Hugo, ou bien à l'huile, mais avec le manche du pinceau, comme chez le plus sauvage Constable."
en striures gigantesques, en boursouflures du diable, prêtes à s'écraser sur le wanderer nain au pied de la forteresse maudite, le tout à l'encre noire comme chez Hugo, ou bien à l'huile, mais avec le manche du pinceau, comme chez le plus sauvage Constable."
(Renaud Camus. Corée l'absente. Fayard, 2007, p. 655)
--------------------------------------------------
Pourtant, jamais aucun navire ne l'avait emportée loin du village ..... en tombant du ciel ..... ..... absente ..... sans la menace du monde à portée ..... en aucune musique tombée, elle, pourtant.
11:05 Publié dans Corps, elle absente | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Art
samedi, 08 décembre 2007
Nus et vêtus
Emprunté avant-hier à la B.U. (dans les casiers réservés aux "ouvrages réservés", les piles s'empilaient : conséquence de la fermeture administrative du site) Nus et vêtus de Christian Combaz, dont j'ai lu les 70 premières pages en une demi-heure : le style est d'une indigence étonnante, et le sujet scabreux tout à fait prévisible.
Bien entendu, la vie est brève, et j'ai mieux à faire que de continuer la lecture de ce roman.
08:15 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Ligérienne, Littérature
mardi, 04 décembre 2007
No blamocracy, please...
L'hebdomadaire Courrier international propose, cette semaine, à la page 33, deux articles d'opinion relatifs à la situation actuelle du Liban. L'un, signé Ghassan Charbel, a été publié dans al-Hayat et s'intitule, dans cette version française, "La honte d'être libanais". L'autre, signé Pierre Akel, a été publié dans Shahaf, et s'intitule "L'incompétence du French Doctor". Tandis que Ghassan Charbel se livre à une attaque en règle contre Michel Aoun, Pierre Akel impute, lui, une part non négligeable des problèmes actuels à la médiation ratée de Bernard Kouchner.
Comme, de ces deux articles, je me livrais à une "lecture flottante", pour reprendre l'expression du psychanalyste et critique André Green, j'ai été frappé par l'absence de toute critique un peu constructive, ou, à tout le moins, englobante. Quand je traduisais Yesterday, Tomorrow. Voices from the Somali Diaspora de Nuruddin Farah (Hier, demain. Serpent à plumes, 2001), je me rappelle m'être arraché les cheveux pour traduire blamocracy, dans le dernier chapitre. Après avoir été tenté par un semblable néologissme (reprochocratie ? pas très beau), j'ai fini par opter par une périphrase qui étoffait blamocrats en "rois de la réprimande", ou quelque chose dans ce style-là.
Dans ce très beau passage, Nuruddin explore en effet la responsabilité collective de tous les Somalis dans le naufrage de la nation au cours des années 1990. Il écrit en substance que, dès que l'on écoute les discours des uns et des autres, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais d'autocritique : "the self is never to blame". J'ai songé qu'on pourrait transposer cette idée aux deux articles d'opinion que je cite plus haut, et qui, si fins soient-ils par ailleurs, évitent d'évoquer l'idée de responsabilité partagée : c'est toujours la faute des Syriens, de Michel Aoun (qui, de fait, n'a pas un bilan très glorieux) ou de Kouchner (que je n'estime pas beaucoup)...
Je me souviens des Moi volatils des guerres perdues et de Sous le ciel d'Occident, deux romans de Ghassan Fawaz, excellent romancier libanais francophone, dont on peut dire, pour le coup, que sa matière littéraire est pétrie de ces ambiguïtés, se nourrit du jeu complexe des responsabilités partagées. D'où il ressort que la littérature est, comme souvent, tellement supérieure au journalisme...
08:50 Publié dans Affres extatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Liban
dimanche, 02 décembre 2007
Plus bien bon
Hier soir, j'ai lu une très belle nouvelle de Henry James, "The Story of a Masterpiece", qui présente certains des aspects les plus rugueux (ou les moins arrondis) de ses récits de jeunesse, mais qui est d'une grande puissance évocatrice. Ce récit, qui oscille entre Le Chef d'oeuvre inconnu et Dorian Gray, tout en suggérant, dans la figure de Stephen Baxter, un frère d'âme de Roderick Hudson, est vraiment d'une grande beauté. La fin en est très ironique, et la figure de la jeune femme, Marian Everett, nourrie de contradictions jusqu'au terme.
Toutefois, ce n'est pas de cela que je voulais parler. En effet, le narrateur emploie, à un moment du récit, la structure comparative "more good", ce qui est possible quand good est un substantif ("He has done more good than he is ready to admit" : il a fait plus de bien qu'il n'est prêt à l'avouer), mais absolument pas quand good est un adjectif, ce qui était le cas dans le passage concerné. Cela m'a beaucoup perturbé, car, évidemment, lorsqu'on s'est habitué à considérer comme une faute grave, dans les copies d'étudiants, l'apparition (rare, au demeurant) de more good en lieu et place de better, on se sent plutôt mal à l'aise face à de telles occurrences sous la plume d'un maître.
Ce matin, bien entendu, il n'y a pas moyen de retrouver le passage en question. Comme la nouvelle n'est, semble-til, pas disponible sous format électronique (j'ai vérifié sur le site Online Books mais aussi sur New Platz), il faudrait la relire dans le volume emprunté à la bibliothèque (il s'agit de l'édition des nouvelles complètes de 'The Library of America'). J'ai aussi fait de nombreuses recherches dans les sept volumes de la grammaire de Jespersen, mais sans succès.
Par ailleurs, comme j'avais été très impressionné par la description de Marian Everett qui ouvre la nouvelle, j'ai cherché comment la traductrice française de l'édition "Pléiade", Nicole Moulinoux, avait su rendre
In complexion, she was a genuine blonde - a warm blond; with a midsummer bloom upon her cheek, and the light of a midsummer sun wrought into her auburn hair.
Comme le dit mon ami Eric, lui-même auteur d'une traduction de l'édition 1855 de Leaves of Grass, et qui, à ce titre, beaucoup pratiqué cet exercice : "il n'y a rien plus de bête que la critique de traduction". Assumant pleinement mon penchant pour la bêtise, j'écrirai tout de même ici que je ne trouve pas très heureuse, pour cette phrase, la traduction française :
Sa carnation était celle d'une blonde naturelle - d'une blonde chaleureuse ; ses joues offraient l'incarnat du plein été et ses cheveux auburn les reflets moirés d'un soleil estival.
Il me semble indispensable de rendre, dans une traduction, l'allitération triple en bl : blonde / blond / bloom. Plus importante encore me semble la variation blonde / blond, caractéristique du goût de James pour l'inconcinnitas, la légère asymétrie. Accessoirement, Nicole Moulinoux choisit un registre lexical trop archaïsant : complexion est beaucoup plus banal, en anglais, que carnation en français. Même remarque pour bloom / incarnat.
Je cherche encore...
11:39 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Traduction, Anglais, Littérature
samedi, 01 décembre 2007
L’égaré
C’est un timbre de l’année 1985, peut-être ma première approche – mon premier souvenir de Dubuffet. En 1985, on m’a offert mon premier “Pléiade”, le tome 1 des œuvres d’Eluard, avec le poème pour « Monsieur Dubuffet », mais je doute de m’être beaucoup renseigné sur le peintre à cette occasion-là.  (De plus, en y songeant bien, je me dis que le poème en question doit se trouver dans le tome 2, qui couvre les années 1945 à 1953.)
(De plus, en y songeant bien, je me dis que le poème en question doit se trouver dans le tome 2, qui couvre les années 1945 à 1953.)
Aujourd’hui, cette image mélancolique quoique chargée d’une joie profonde suggère le plaisir que j’éprouve toujours à lire – et à traduire, si tant est qu’un éditeur un jour veuille bien de ma proposition de traduction de The Witch Herbalist of the Remote Town – les romans d’Amos Tutuola. En se perdant, en s’égarant, en suivant le flot (comme pour Saint-Simon) ou les ressassements (comme avec Thomas Bernhard), on signe sa propre lecture, son oubli profond, sa terrible reconnaissance, sa vraie jouissance.
11:47 Publié dans Un fouillis de vieilles vieilleries | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Art, écriture, Littérature
mercredi, 28 novembre 2007
Pierre écrit
Comme je lis Corée l'absente, le journal 2004 de Renaud Camus, je constate, en me reportant à la chronologie des événements qui figure sur le site de l'écrivain, que, vers l'automne, c'est Pierre, son compagnon, qui rédige les entrées de l'agenda. Ainsi, on trouve, sous sa plume, un joli néologisme : "Petit déjeuner tôtif dans un autre hôtel après approches du château de Zuloaga".
Comme, d'autre part, j'apprends, en lisant Corée l'absente, que c'est Pierre qui a transcrit une bonne partie du monumental Journal de Travers (1976-77) publié au printemps dernier, je me demande si son nom ne devrait pas, dans certains cas, figurer à côté de celui de Renaud Camus ! (Je galèje, bien sûr : ils font comme ils le souhaitent...!)
05:55 Publié dans Corps, elle absente | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature
dimanche, 25 novembre 2007
Palilalies de Huntington
Entre autres chantiers multiples, dans mes deux carnétoiles ou ailleurs affaissé dans l'écriture, il y a les Mots sans lacune, vieille et maigre rubrique de ce site-ci. Elle me revint sous la plume à l'heure même où je lus, hier soir, cette phrase :
Les murs ocre qui entourent le domaine et les toits qui dépassent d'eux ne me sortent pas plus de l'esprit que Coré l'absente ou Corée l'absente, ce qui prouve bien que l'architecture peut être un objet de battologie au même titre que la poésie, et qu'il existe une palilalie visuelle autant que langagière.
Renaud Camus. Corée l'absente. Paris : Fayard, 2007, p. 249.
Pour le substantif battologie, le Robert culturel propose une citation, tout à fait réjouissante d'ailleurs, de Raymond Queneau, alors que, pour palilalie, la définition n'est pas accompagnée :
PALILALIE. n.f. < 1908, A. Soques ; du grec palin "de nouveau" et lalein "parler", cf palikinésie >
Pathol. Répétition involontaire d'un ou de plusieurs mots, observée dans la maladie de Parkinson et dans d'autres maladies du système nerveux.
Il se trouve que, sans être involontaire, la palilalie (du simple rabâchage au style itératif) est une figure essentielle de l'écriture de Renaud Camus, notamment dans les Eglogues (au secours, Madame de Véhesse !), mais plus généralement dans le reste de l'oeuvre. Ainsi, les pages 229 à 241 de Corée l'absente en présentent plusieurs cas ; par exemple : "Il a fait toute la journée un temps magnifique. Il a fait toute la journée un temps magnifique. Je croyais avoir facilement le vertige, mais Pierre est bien pire que moi." (p. 229)
10:10 Publié dans Corps, elle absente, Lect(o)ures, Mots sans lacune | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Langue française
samedi, 24 novembre 2007
Pageries d'automne
Il y avait déjà, en cours, Moby Dick (à petites doses, d'autant plus impressionnantes), In the American Grain (j'ai lu ce matin, dans le jardin, "Red Eric", quatre pages d'une durable puissance), Bruno Schulz (qui m'ennuie), les premiers mois de Corée l'absente, sans compter les lectures en vue du colloque Poets & Theory (Lew Welch, Sylvia Plath, Philip Larkin) et désormais, puisque C. travaille sur Le Tour d'écrou, se pencher sur les deux traductions empruntées mardi dernier (donc se replonger dans la novella en V.O.), et lire en anglais les nouvelles de jeunesse qu'elle lit en français, moi qui connais surtout, de Henry James, les nouvelles des années 1880-1910.
Tout cela explique pourquoi je n'ai pas encore écrit une ligne au sujet des Drift Latitudes, dernier roman paru de Jamal Mahjoub (en 2006).
17:47 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, écriture, Ligérienne
L'Esthétique de la résistance
"Finalement, j'appartiens bien à la littérature française contemporaine : je fais du surplace."
(François Bon, hier soir au Livre).
Présentation émouvante, avec la lecture de beaux passages de son Bob Dylan. Les anecdotes que François a racontées ensuite ouvraient des chemins digressifs infinis, à grands renforts de phrases interrompues. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu un malentendu, car Martin Arnold lui a bien posé cinq questions, mais François n'avait pas compris qu'un temps, dans la soirée, était réservé aux questions du public. Toutefois, peu importe... il semble que, s'il évoque aussi peu les deux dernières décennies de la comète Dylan, c'est qu'il est moins convaincu par ce versant de l'oeuvre, mais aussi qu'il avait déjà écrit 450 pages et était, de toute manière, en retard pour rendre son manuscrit ! Good enough reasons... point taken !
Au cours de sa présentation, François a dit, avec une lueur de malice dans le regard, qu'il faudrait que quelqu'un écrive un livre intitulé Esthétique de la résistance. Comme il avait fait la même vanne avec le rhizome et le pli un quart d'heure auparavant ("mais c'est Deleuze, non ?" me glissa, déconcerté, mon voisin), j'en ai conclu qu'il y avait effectivement un livre qui se nomme ainsi. Ignare que je suis ! (J'ai pu vérifier cela sur les rayonnages de littérature allemande*, au cours du vin d'honneur qui s'en est suivi.)
Quand faut y aller, faut y aller... (D'autre part, on peut s'interroger, avec François Bon, sur le rire de résistance et la question des droits réservés à l'ère du Web 2.0..)
* Tiens, j'en profite pour écrire ici que je ne suis pas d'accord avec François Bon quand il se moque (gentiment) de Laurent Evrard et Martin Arnold parce que leur librairie est la seule de France où les rubriques ne sont pas signalées au-dessus des rayonnages. Je préfère, moi, être momentanément désorienté, car c'est ainsi que l'on flaire des archipels inattendus. Une librairie n'est pas une bibliothèque. (A bookshop is not a library.)
12:01 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Ligérienne, Littérature
vendredi, 23 novembre 2007
Léger excès de bleu

P.-H. de Valenciennes (1750-1819). L'Orage au bord d'un lac.
Le léger excès de bleu dans la couverture de Sommeil de personne ne frappe que moi, apparemment. (Corée l'absente, p. 136).
You can say that again.
La couverture est un détail du tableau. Les couleurs du tableau ne sont en rien si bleutées, ni la nuée entre terre et ciel si verdâtre, ni la forêt si violette. Ou est-ce la reproduction du site de la RMN, ci-dessus par moi reproduite, qui n'est pas assez bleue / verdâtre / violette ?
19:50 Publié dans BoozArtz | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Art, Littérature
mercredi, 21 novembre 2007
Tasmanie alphabets

............ il épingla telle une médaille sur ma poitrine une Tasmanie rose, flamboyante comme le mois de mai,  et un Haidarabad où fourmillaient des alphabets étranges, enchevêtrés ...................
et un Haidarabad où fourmillaient des alphabets étranges, enchevêtrés ...................
Bruno Schulz. "Le printemps", IV. In Le sanatorium au croque-mort, traduction de T. Douchy.
23:20 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature
Araucaria à la dérive
Aucun des quatre billets publiés le 21 novembre 2006 n'a reçu de commentaire : il y a des jours où même les quarterons n'attirent pas les foules.
Ce matin, dans l'ouvrage d'entraînement à la version et au commentaire de traduction de Sébastien Salbayre et Nathalie Vincent-Arnaud, j'ai lu un texte dElizabeth Jane Howard, extrait de son roman Confusion (que je ne connaissais pas) et où se trouvait l'expression monkey puzzle, que je ne connaissais pas non plus et qui désigne, semble-t-il, l'araucaria.
Le soleil a fini par se lever, le feignant des bureaux d'obsèques. (Cette apodose ferait, pour Bruno Schulz, un bon titre. Jean Dubuffet me souffle que c'est l'essentiel, quoique je sache désormais que je dois me méfier de ses dires, et plus encore de ses pinceaux ou de son fil à tailler le polystyrène.)
Dans The Drift Latitudes, le fils de Rachel saute sur une mine. (C. n'a pas aimé la troisième partie ; je me tâte.)
......... où Villandry signe blanc .........
15:15 Publié dans Comme dirait le duc d'Elbeuf, Le Livre des mines, Lect(o)ures, Moments de Tours, Un fouillis de vieilles vieilleries, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Ligérienne, Photographie, Littérature
lundi, 19 novembre 2007
Considérations sur la clepsydre des cercueils
Figurez-vous qu'on approche du 5555ème commentaire... Grâce à Zvezdo, j'ai pu me plonger avec délices dans la longue histoire d'une phrase complexe, qui peut servir tant en sémantique qu'en sémiotique ou en traductologie. (Bien entendu, il n'y a pas de traduction possible de la phrase aux dix bisons en français, pour une seule raison : l'absence, en syntaxe française, du pronom relatif elliptique.)
Tout ça pour dire que, si j'ai relié ça à l'approche feutrée du 5555ème commentaire, c'est que ça m'a rappelé le débat oulipien autour de l'alexandrin le plus court. Perec (ou Roubaud (mais je crois tout de même que c'était Perec)) avait suggéré
WWWW
et j'ai échafaudé de mon côté, il y a déjà longtemps (dix ans ? ça passe !)
!?
avec diérèse sur le premier hémistiche.
Rassurez-vous : quand j'aborderai (si ce maudit blocage prend un jour fin) God's Grandeur et Le Gallienne en séminaire de sémiotique, we won't go to such lengths.
En attendant, je suis patraque. Dans le même état, peu ou prou (météo humide et nuageuse comprise), que lorsque je lisais Wasabi d'Alan Pauls. Les livres sont des états, comme les êtres : je fais à l'aise (à lire à haute voix, syncopé). Là, c'est Le sanatorium au croque-mort qui m'accompagne (avec Moby Dick toujours et The Drift Latitudes, bientôt terminé), et je n'ai pu m'empêcher de remarquer que, à en croire le titre original de ce livre, croque-mort se disait klepsydra en polonais, ce qui est bien étonnant. Aussi remarqué que, s'il y avait quatre traducteurs, ils s'étaient partagés les 13 textes de ce roman composite. (Quand je songeais à cela, tout à l'heure, dans le faux Voltaire, je me suis souvenu de mon lointain désir d'écrire un article sur la tentation du composite novel en Afrique du Sud : Breytenbach, Wicomb, Tatamkhulu Afrika. Il faudra y revenir.)
Quatre traducteurs, pourquoi pas ? Mais, dans le cas d'un roman composite (ou d'un cycle de récits, cycle de nouvelles (la Chaminadour de Jouhandeau peut servir d'approximation première)), ne risque-t-il pas d'y avoir une dissolution des motifs. Le risque est que, si les traducteurs sont sérieux, ils passent plus de temps à se concerter et à traduire l'ensemble que si le recueil avait été confié à un seul bon traducteur dès le principe...
Tout ça vasouille, c'est le temps humide. Retenu la description très frappante du joueur d'orgue de Barbarie dans le premier texte ("Le Livre"). Curieux comme l'évocation de l'exaltation rituelle et singulière du Livre avec un L majuscule débouche sur la vision de l'enfant perdu dans les feuilles éparses et déchirées d'un trivial catalogue publicitaire, plus du côté de Rimbaud que de Mallarmé.
23:00 Publié dans Ruses de Sioux | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, écriture, Ligérienne
mercredi, 24 octobre 2007
... ce que tu as ...
L'ami raccompagne Nolot en lui disant, exaspéré : Vraiment, ce que tu as bonne mine.
Il y aurait ces dizaines de phrases de Linda Lê, démineuse devant l'éternel. Ici au moins je prends date. On attend aussi The Return of the Killer Tomatoes.
{ ... ce que nous voyons, ce qui nous regarde ... } Une valse lente, Mingus toujours.
17:50 Publié dans Le Livre des mines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Fiction, Littérature
dimanche, 14 octobre 2007
La Femme des sables
Je sors comme hébété mais aussi ravi – peut-être transformé – de la lecture de La Femme des sables. La 2ème et la 3ème parties sont brûlantes, fortes. Le récit devient plus intense, mais le côté un peu anodin, mystérieux mais léger, des soixante premières pages, renforce certainement cette impression progressive d’enfermement. Un démarrage un peu vacillant, pour mieux river le clou ensuite... ?
Le plus étonnant, dans ce récit, c’est l’ambiguïté fondamentale entre résistance et abandon. Par là j’entends bien sûr la tension constante, dans l’esprit et les actions du protagoniste, entre acharnement et désir de laisser filer, mais aussi la façon dont le narrateur ne cesse de lâcher la bride pour mieux et plus vigoureusement tirer dessus quelques pages ou quelques paragraphes plus loin. Ainsi, si les lectures allégoriques possibles du roman sont multiples, l’une d’entre elles consisterait à voir dans La Femme des sables un miroir déformé, criblé, de la relation entre un texte et son lecteur, entre un récit de l’enfermement et l’enfermement du lecteur lui-même. La métaphore centrale est évidemment celle des insectes pris au piège du sable, mais elle se double de nombreux aspects secondaires qui la minent.
L'hébétude et le ravissement du lecteur occupent les postes opposés de la résistance et de l’abandon. (On laisse filer le sable entre les doigts, car on ne peut, de toute façon, le retenir.) Le dernier chapitre est très énigmatique : quel rapport de fond entre la grossesse extra-utérine et l’évasion forcée de la femme, qui ne voulait pas s’échapper (et, de fait, s’échappe sans doute vers sa mort) ? tout empreint d’ambiguïté qu’il soit, le désir de l’homme de rester, en fin de compte, pour faire part de sa découverte à « la clique », relève-t-il, de la part de l’auteur, d’une célébration de l’esprit d’invention humain – dans toute sa persistance – ou d’un retournement ironique visant à montrer que la faculté d’auto-aveuglement de l’espèce ne connaît pas de limites ? À cette deuxième question, on serait tenté de répondre « les deux, mon commandant », au risque de se retrouver, en tenant les divers degrés de l’échelle de corde, de nouveau – avec le protagoniste – au fond du trou.
-------------------------------
C’est un ami qui nous a offert ce livre. Je n’avais, de l’œuvre d’Abe Kobo, qu’un souvenir précis de La face d’un autre (lu vers 1993, récit fantastique très bien mené mais qui souffre – à l’inverse de La Femme des sables – d’un essoufflement sur la fin) et le souvenir plus vague d’avoir parcouru le Cahier kangourou, emprunté à la médiathèque de Beauvais. E. – l’ami – m’a dit que le film, primé à Cannes dans les années soixante, était très décevant. De fait, La Femme des sables court le risque, transposé à l’écran, d’un net aplatissement. Si le réalisateur n’est pas imaginatif, l’échec guette.
10:40 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, Japon
samedi, 13 octobre 2007
9840 cauchemars (tant et plus)
Le 12.
Imaginez qu’il y aurait, qu’il pourrait y avoir 9840 textes, et même qu’à partir des titres alternatifs non retenus, on pourrait écrire plus de dix mille textes, lesquels, même à supposer qu’ils fussent brefs, composeraient au bas mot un corpus de deux ou trois mille pages. Or, si, en deux ans et demi, je suis parvenu à écrire – en ne tenant compte que de mes deux carnétoiles ou blogs principaux – un peu plus de trois mille textes sur des sujets divers – en me donnant la liberté de baguenauder, de bayer aux corneilles, de prendre tel chemin de traverse –, il faudrait donc, au minimum et en suivant ma méthode passée des sauts et gambades, voire des abandons ou des lassitudes temporaires, peut-être douze ou quinze ans pour venir à bout de ce texte dont j’ai commencé il y a quelques jours l’écriture et qui s’intitule Un fouillis de vieilles vieilleries.
D’aucune manière je ne sais si je renoncerai. (Pourquoi l’image du roncier m’obsède-t-elle ces temps-ci ? Ai-je rêvé de ronces ?)
*
Le 13.
Mes heures nocturnes furent lourdes de La Femme des sables. Le long rêve final qui me cueillit, me retourna en tous sens, me tourneboula à l’aurore, était une transposition de ce récit piégé que j’ai dû, pris par le sommeil, interrompre hier soir à un moment crucial. Terré dans un trou d’où il a chassé un chien errant, le protagoniste est en train de s’enfuir après s’être encordé. Dans mon rêve, j’étais prisonnier sur la planète Mars, dans un garage de guimbardes bousillées, à ne pouvoir prendre l’ascenseur-fusée susceptible de me libérer du cauchemar.
11:59 Publié dans Un fouillis de vieilles vieilleries | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Art, Littérature, Ligérienne, Japon, écriture
jeudi, 11 octobre 2007
Aber wo ist doch Nathan der Weise ?
Le Prix Nobel de Littérature vient d'être attribué à Doris Lessing.
Loin d'être au rang des "sceptiques", je trouve souvent les choix de l'Académie suédoise justes ou, à tout le moins, dignes du débat. Là, il n'y a pas photo : le jury s'enfonce dans le train-train ridicule qui consiste à attribuer le Prix à un écrivain de langue anglaise une année sur deux, comme si l'hégémonie de la langue anglaise dans le monde interdisait de récompenser un Turc, une Allemande, une Japonaise, un Mexicain ou un Portugais plus d'une année de suite (!) ; de surcroît, il s'agit, comme avec Coetzee, de décerner la prestigieuse médaille (& le pognon qui va avec) à un(e) représentant(e) du mainstream White writing, quand Breytenbach, LaGuma, Bessie Head ou Zoe Wicomb n'auront jamais été même shortlisted. (Mille pardons pour le mélange de langues, but I'm thinking all this in English...)
Le pire de tout, c'est que l'on pouvait encore considérer qu'avec Coetzee, on tenait, à peu près, un écrivain, même si son oeuvre est souvent fade, compassée, exsangue. Lessing, elle, est une chichiteuse infatuée bourrée de tics et dont la langue sue l'académisme le plus poussiéreusement pense-petit qui soit. Imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, que ses romans puissent servir de modèle des écritures contemporaines, cela revient à placer Eugène Sue devant Flaubert, Rimbaud ou Hugo... autant dire, une ignorance fondamentale de ce qui fait la force de la Littérature.
(Je songe aussi à ce que Renaud Camus dit de sa surprise en découvrant que l'artiste choisi par Tzvetan Todorov, pour figurer la seconde moitié du 20ème siècle, était... Jeanclos !)
------------------
Ajout de 18 h 05. Voici ce que Le Monde nous apprend ce soir à ce sujet :
Interrogée à son arrivée devant sa maison dans le nord-ouest de Londres, Doris Lessing s'est dit "ravie" d'avoir reçu cette récompense. "Cela fait trente ans que ça dure. J'ai remporté tous les prix en Europe, tous ces foutus prix, alors je suis ravie de les avoir remportés. C'est un flush royal", a-t-elle ajouté.
Voilà qui en dit long sur la profondeur de vision de cette marchande de soupe, impératrice ès imposture...
14:15 Publié dans Indignations | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature
lundi, 08 octobre 2007
Incréments
François Bon signale, sur son blog, la parution imminente, dans la collection qu'il dirige au Seuil, de deux volumes, dont l'un, celui de Jérôme Mauche, semble obéir à un principe structurel dont, pour séduisant qu'il soit, j'avais énoncé les limites dans le cas d'Eric Meunié. Depuis, j'ai moi-même écrit des centaines de pages selon des principes incrémentiels, et ne cacherai donc pas mon intérêt pour ce type d'entreprise.
19:50 Publié dans Ecrit(o)ures | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Littérature, écriture, Ligérienne
Arracher des récits
Sur la première photographie marque-page je t'ai photographiée, près de la poignée de porte, fond de peinture bleu ciel, et tu arbores la casquette à carreaux de mon grand-père, que nous avions dérobée furtivement et temporairement, à seule fin de claquer ces deux clichés.
Mon père s'arrêta et se passa la main sur le front ou se le pressa presque, avec quatre doigts, comme s'il voulait en arracher quelque chose, des images peut-être, peut-être des récits. (Javier Marias. Ton visage demain II. Danse et rêve. Traduction de Jean-Marie Saint-Lu. Gallimard, 2007, p. 280.)
Sur la seconde photographie marque-page tu m'as photographié, près de la grande reproduction d'une toile d'Odilon Redon, et j'arbore la casquette à carreaux de mon grand-père, que nous avions dérobée furtivement et temporairement, à seule fin de claquer ces deux clichés.
18:50 Publié dans Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Ligérienne, Photographie, Littérature
Mise en tropes
..... Où il fut question de théâtre .....
07:35 Publié dans Comme dirait le duc d'Elbeuf | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : Ligérienne, Littérature
dimanche, 30 septembre 2007
Andrew Varney strikes again
" After this glowing description of my beloved 18th century, I will now be honest and add a footnote."
(Andrew Varney. References here.)
--------- On pourrait en dire long, sur cette analogie métaphorique entre l'honnêteté et l'ajout d'une note de bas de page. ----------
05:00 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Ligérienne, Littérature
samedi, 29 septembre 2007
Roderick Random for Dummies
" He gets into bed with about any woman stupid enough to get into the book." *
(Andrew Varney. References here.)
* Il se retrouve au lit avec toutes les femmes qui sont assez idiotes pour se retrouver dans le livre.
(Embarras traductif : comment rendre le jeu de mots, doublé d'une symétrie, que constitue get into ? La traduction ci-dessous est un peu curieuse, gauche. Surtout, ça efface en partie le côté "macho" du narrateur : se retrouver au lit avec une femme n'est pas la même chose que la culbuter, la sauter, etc. J'avais pensé aussi à employer le verbe fourrer, avec une variation actif/pronominal : Il fourre dans son lit toutes celles qui ont été assez idiotes pour se fourrer dans le livre. Mais on ne se fourre pas dans un livre ; on s'y fourvoie, à la rigueur, au sens où l'entendait Varney. J'ajoute que je n'ai pas relu Roderick Random depuis mes années oxoniennes, une poutre.)
20:10 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Ligérienne
vendredi, 28 septembre 2007
Surtout
Je ne lis pas comme je voudrais.
Cette phrase a au moins trois sens possibles. (Mais surtout un.)
22:50 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Littérature, Langue française
dimanche, 23 septembre 2007
Better this than Uriah Heep !
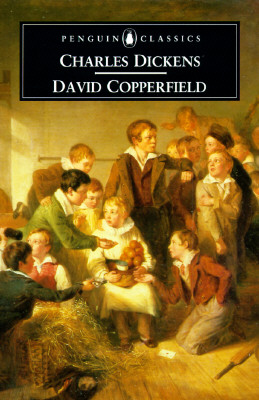
You're David Copperfield!
by Charles Dickens
Coming up from a childhood that felt abusive, you have risen through hard work to gain a place of stature in your life. You've spent altogether too much time in factories and end up misspelling a fair number of words. But in general you are seen as a beacon of hope for others who might not be as fortunate. Lots of people keep mistaking you for a magician and are waiting for you to disappear.
Take the Book Quiz at the Blue Pyramid.
10:00 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : Littérature

