lundi, 16 janvier 2006
Solde, au masculin depuis 1784
Oui, le substantif solde, au sens d’“action de solder”, comme son pluriel, au sens de “marchandises vendues légalement à un prix inférieur”, est masculin, mais depuis 1784 seulement ; auparavant, il était féminin, et, comme il est apparu dans notre langue en 1675, les plus contre-révolutionnaires d’entre nous peuvent toujours prétendre qu’ils sont plus royalistes que le roi en employant le féminin (alors qu’ils font une faute, bien sûr).
De la bathmologie, encore et toujours…
10:30 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (1)
Espagnolette
Ça ne va pas fort. J’en veux pour preuve que, n’ayant rien avalé depuis hier midi, j’ai lu, par ailleurs, les quatre tomes du Chat du Rabbin. Vous dire si ça ne va pas fort.
Faut se garder des bandes dessinées pour les jours de maladie… Oui, mais moi, à dix heures et demie, fac inévitable.
Construisons un château de sable. Pour l’Espagne, on verra demain.
09:12 Publié dans Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (6)
Recoins méconnus d'Amboise, 4

02:30 Publié dans Autoportraiture | Lien permanent | Commentaires (2)
dimanche, 15 janvier 2006
Dualité
Il faut que je donne quelques précisions sur les deux photographies qui illustrent une sorte de poème en prose écrit et publié samedi dans ce carnet, “Hymne”.
L’une, qui a pour titre « Bibliothèque municipale » représente le ciel nuageux et couvert au-dessus de la Loire, avec le haut du monument aux morts proche de la place Anatole-France (sa statue dorée), le dôme adamantin de la bibliothèque, et un pylône qui fend l’air pour redresser sa course en un point invisible de nous. C’est un lieu (une vue) bien connu(e) des Tourangeaux.
L’autre, intitulée « Trinité », représente, encadrée par un creux dans le mur des jardins du Musée des Beaux-Arts, un horodateur et un lampadaire, notre Renault Clio, garée vendredi à cette place après un créneau somptueux. Cela peut paraître trivial, d’autant qu’il vous faut me croire sur parole : au moment du créneau, il y avait, devant et derrière, des véhicules très proches, et la place de stationnement était un trou de souris. Ce n’est qu’une demi-heure après que je me suis avisé que la proximité de l’horodateur pouvait faire un cadrage intéressant. Après rognage des parties de droite et de gauche pour ne pas avoir à subir la vue de pare-chocs disgracieux, voici l’image. (D’ordinaire, je ne retouche pas. (Diable ! je vous demande bien de la confiance sur parole aujourd’hui !)
17:00 Publié dans Où sont passées les lumières? | Lien permanent | Commentaires (3)
Recoins méconnus d'Amboise, 3

M. Gauvreau fait du très bon pain.
13:55 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (3)
Recoins méconnus d'Amboise, 2
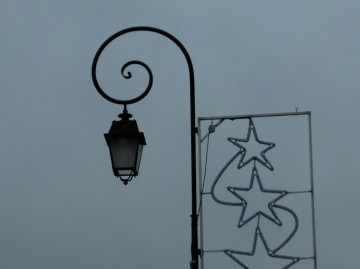
Deux étoiles en ferraille, et trois branches,
pour un point d'interrogation
lent, terne.
10:50 Publié dans Où sont passées les lumières? | Lien permanent | Commentaires (3)
Recoins méconnus d'Amboise, 1

Sur le panneau :
"Cet orme, dernier d'un ensemble qui fit longtemps la beauté du mail, fut planté aux environs de l'année 1623. En 1972, hauteur 39 mètres, circonférence 5m70."
Il n'y a plus d'orme sur le mail.
[Image prise à Amboise le 8 janvier 2006.]
07:45 Publié dans Sites et lieux d'Indre-et-Loire | Lien permanent | Commentaires (8)
samedi, 14 janvier 2006
Arétin dans toute sa bouffissure ?
"Ah ! il aurait fallu nous montrer, dans toute la beauté de sa honte, dans toute sa bouffissure sanglée de velours blanc, glorieux et obscène, pourri de débauches et de talent, commodément installé dans le mépris pour insulter, donnant le premier exemple d'une de ces situations d'infamie qui s'affermissent en durant parce que la boue durcit, bravant et bavant, polygraphe et pornographe, ruffian de tableaux et courtier de filles, cet Arétin si complet que les plus parfaits gredins de notre tout dernier bateau suivent encore le sillage de sa gondole : car il ne leur a rien laissé à trouver, ni la goujaterie historiée, ni les grâces stercoraires; car il a tout inventé, depuis le système de faire crier ses articles dans la rue avec des titres sensationnels jusqu'à celui de toucher aux fonds secrets, depuis l'art de faire resservir les vieilles chroniques en les démarquant jusqu'à celui de ne jamais applaudir un homme que sur les joues d'un autre ! " (Edmond Rostand. Discours de réception à l'Académie Française, le 4 juin 1903)
21:55 Publié dans Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (2)
Daumier, ou les bouffissures

"La charge de Daumier est féroce. Les trognes exsudent les bouffissures de la vanité. Une cravate bourgeoisement nouée compresse le menton renfrogné, la fausseté d’un regard luit dans l’oeil mi-clos sans que jamais le détail n’égare."
(Dominique Widemann. L'Humanité du 30 octobre 1999)
19:55 Publié dans BoozArtz | Lien permanent | Commentaires (0)
Bouffissures
Sans doute le mot bouffissure ne se donne-t-il pas, de prime abord, sous son aspect froidement lexicologique, et n’entend-on pas nécessairement, la première fois, l’adjectif bouffi sous la meringue ou la crème chantilly cotonneuse de ces trois syllabes lourdes. C’est un mot lourd et doux, complexe, où s’entendent les biffures (sans la housse protectrice, pourtant, des petits traits rageurs ou appliqués du palimpseste), les fissures, mais aussi le jeu verbal des bouts-de-ficelle. Imaginez quelques instants combien la face du monde francophone en eût été changée si, d’aventure, la série la plus célèbre s’était composée comme suit : marabout, bouffissure, surimi, mikado, dominion, mignonnet, onéreux, etc.
Quand le sens, malgré nos résistances, finit par l’emporter, la bouffissure rime avec la farcissure – si ce n’est que l’une s’emploie plutôt au sens figuré, pour parler de l’arrogance d’un sot (ou de la fatuité d’un vaniteux), alors que le second, plus concret, donne à voir de délicieux festins, de lourdes et langoureuses successions de plats somptueux en un banquet interminable. Qu’elle se rapporte au physique ou au moral, voire au comportement social, la bouffissure engage alors un bras de fer amical avec la boursouflure. Mais elle a, sur sa camarade, l’avantage considérable de ne point trop s’imposer, de fuir, d’échapper au sens, et même à la charpente de la voix – ni bourse ni soufflerie ni enflure pour moi, je vous prie ; je me contente d’allusions discrètes, au ratage, à la surcharge, à la faille… et au précipice.
Au jeu de la transposition néologénique, le synonyme exact de bouffissure est tuladissure. Rares sont ceux à employer cette variante précieuse et un rien désuète.
……………………………………………………..
Enfin, il ne serait point séant à l’emphase de ce billet de ne le farcir d’au moins une citation, curieusement physique d’ailleurs, et où peut se lire, à mes amis qui aiment la science-fiction, un hommage :
« Obèse et blême, il vacillait sur ses jambes enflées. Ses yeux disparaissaient dans les bouffissures de son visage et il était plus qu'à moitié chauve. Elle ne le reconnut pas. Un client parmi d'autres, et pas plus répugnant que beaucoup d'autres. D'ailleurs, ce n'étaient pas les plus hideux qui lui faisaient le plus peur… » (Michel Jeury. « Les Vierges de Borajuna ». In Horizons fantastiques. N° 30, 1974.)
17:55 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (3)
Audité
Me lassant des statistiques de H&F, qui, pour être informatives, ne me donnent aucun renseignement sur les recherches qui conduisent – assez aléatoirement – les visiteurs imprévus dans les sentiers de mon carnet de toile, je me suis inscrit auprès d’une autre institution statistique, qui “audite” mon site depuis avant-hier, et confirme à peu près le nombre de visiteurs, qui se stabilise en ce moment autour de 450 visites quotidiennes pour 200 à 250 « visiteurs uniques ».
L’une des nombreuses rubriques rapidement parcourues (et après, je sais que, comme pour le fade joujou des statistiques maison, je m’en serai lassé et ne les consulterai qu’épisodiquement) m’indique que, après la France (88%) et les Etats-Unis (6%), les deux pays d’origine (ou plutôt : de connexion) de mes lecteurs sont la Suède et la Suisse. Si j’avais su… Je vois assez qui sont les Helvètes, mais je suis très surpris par ce 1,6% suédois, qui ne saurait être seulement lié à de récents pinaillages sur l’adjectif norvégien apposé, ès les pages du Robert culturel, au très suédois Strindberg.
Quiconque voudra éclairer ma lanterne, en particulier d’une profonde et hivernale nuit scandinave, est le bienvenu.
16:55 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles | Lien permanent | Commentaires (3)
Hymne

Les grandes orgues résonnent au cœur de la morgue. Près du calvaire, sans paupières, un homme mort dort les yeux ouverts. Où est passée mon écharpe ? La fureur des cris redouble, et l’angoisse qui me saisit les cils connaît des soirs moroses.
Rome ne s’est pas bâtie en un jour. La peau parcheminée, le vieillard s’en va, car les coups de sang ne sont plus de son âge ; la jeune femme lui aura tapé sur les nerfs, avec sa vénération.
Oh ! comme on respire mal dans vos cicatrices !

15:55 Publié dans Ecrit(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
Eléments d’un dîner, vendredi 13
Convives
Ceux qui pieusement… : Trois messieurs et trois dames.
Mets et boissons
Pruneaux au bacon, dés de gruyère, rôties à la tapenade.
Huîtres de Cancale. Champagne Fleury père & fils.
Confit de porc & tomates à la provençale.
Château La Fleur Peyrabon 1999.
Fromages divers, dont Saint Félicien, Pont-l’Evêque, Epoisses.
Château Liversan 1996.
Galettes à la frangipane. (Irène a eu la fève.)
Excellent armagnac proposé mais refusé – heure tardive ou activités du lendemain ? – par les convives. Café. Tisane au sureau.
Types de discussions
Universitaires.
Personnelles.
Moqueuses.
Inavouables.
Quelques sujets de discussion
Vaut-il mieux se faire refourguer des responsabilités de vice-doyen ou de directeur de département ? (Composition de philosophie en six heures.)
Eric Rohmer et les films de SF américains.
Les professeurs d’E.P.S. férus de didactique.
Pieds d’appel.
La Thaïlande et le processus de Kyoto (Là, j’ai peut-être mal noté).
Il était une fois l’homme.
13:55 Publié dans Ex abrupto, Moments de Tours, Où sont passées les lumières? | Lien permanent | Commentaires (2)
Vendredi 13, à tant la statue
Je croyais rencontrer quelqu’un que je n’avais jamais rencontré. Cendrine Nirdre, qui avait publié deux romans sous un pseudonyme (on comprend pourquoi, car son nom n’est guère facile à prononcer, voici au moins l’une des commodités de l’écrit), venait à Tours pour visiter l’exposition Lorenzo Veneziano avec quatre autres écrivains et une attachée de presse. Comme nous correspondions depuis quelque temps déjà, elle m’avait prévenu de sa venue. « J’aurai une heure de liberté, et vous serez mon escapade », m’avait-elle écrit de son écriture déliée et grave.
Je l’attendais devant la cathédrale. Aucune photographie n’existait, dans nul magazine, de cette mystérieuse plumitive. Son masque rehaussé d’un grand florilège de mèches noires, je ne pouvais l’imaginer. J’attendais donc, curieux comme impatient de connaître enfin le visage de la dame de lettres.
Cendrine Nirdre, me répétai-je trois fois, comme une formule magique, quand je vis que l’heure tournait. C’est alors que je vis arriver, par enchantement, une collègue, éminent professeur de littérature britannique dans mon université. Manteau gris et chapeau bleu roi, d’une élégance bourgeoise jamais démentie, elle eut un sourire étonné en me voyant.
« – Mais que fait donc notre jeune collègue ici, dans le froid ?
– Ah, j’attends quelqu’un… qui tarde à venir, d’ailleurs.
– Profitant de ma venue à Tours pour surveiller les examens, je suis allée faire un tour à l’exposition Veneziano. C’est très intéressant.
– Oui, c’est bien. Un peu bref, vite vu, mais j’aime beaucoup les toiles du maître de Lorenzo.
– Paolo, c’est ça ?
– Oui… Bon, ce n’est pas Paolo Uccello ni Lorenzo Lotto. Mais certains visages sont magnifiques.
– Nous aimons bien les prénoms, vous et moi, n’est-ce pas…
– Oui, vous les chérissez plus que moi encore.
– Bien ; je dois y aller. J’ai encore une surveillance cet après-midi. »
Cendrine Nirdre, à vrai dire, n’est pas venue. J’ai hanté les rues du vieux Tours, les galeries, les librairies. Je n’ai pas trouvé trace d’une attachée de presse, ni des écrivains qu’elle remorquait. Si quelqu’un lève le voile pour révéler le visage de l’écrivain célèbre, ce ne sera pas moi.
11:40 Publié dans Ecrit(o)ures | Lien permanent | Commentaires (5)
Vendredi 13, la fête latente
Etait-ce un malentendu ? Elle n’était pas là, assise devant l’une des niches vides, depuis très longtemps. Deux policiers montés sur de fringants chevaux passèrent. Il y avait des fleurs, de douces fureurs dans son regard.
Elle attendait un monsieur, vieux déjà, poudré, drapé de noir, osseux et décalcifié ; un mythe vivant… un ancien maire – très controversé – de la ville. C’était pour sa thèse (ils disent tous ça, non ? c’est pour ma thèse… – avec cet air rêveur, plein de certitude et de mensonges mal dissimulés). Elle disait, à qui voulait l’entendre, qu’elle n’était pas historienne, et pourtant la méthodologie des sciences sociales ou des sciences politiques ne l’attirait pas du tout. Elle allait rencontrer ce vieux monsieur poudré, drapé de gris, ossifié dans son mythe, comme elle aurait donné rendez-vous à Jean Jaurès (saviez-vous que Jean Jaurès lit mon blog ? avait-elle lancé à la cantonnade un soir, et tous de l’admirer), et elle était – non pas émoustillée, mais plutôt joyeuse, sûre de son fait, ne voulant pas lui poser des questions comme l’eût fait un journaliste ou une étudiante.
Je suis dans le bassin de Latone, et je l’observe. Quand le vieux pontifiant arrive, elle est tout sucre, tout miel. Oui, c’est moi, Johanna. Un petit sourire pincé se dessine sur le visage parcheminé. Un rai de soleil s’échappe des cheveux de la jeune femme.
Ce n’est rien, lui dis-je. Tout vient à point à qui sait entendre.
09:40 Publié dans Ecrit(o)ures | Lien permanent | Commentaires (6)
vendredi, 13 janvier 2006
Vendredi 13, ou l’Inattendu
Il avait rendez-vous avec elles, devant la cathédrale Saint-Gatien, c’est-à-dire sur le parvis. Une grive mauvis passa dans le ciel encore brun de nuages et de nuit, à quelques encablures pourtant de midi. Il ne les vit pas venir. Il avait connu l’une des deux dans un monde que les ignorants disent virtuel, et ne la connaissait pas de vue ; l’autre était l’amie de la première, et il la connaissait moins encore.
Il faisait les cent pas, variant les itinéraires avec plaisir, choisissant la première esplanade, ou la deuxième, s’immobilisant quelques minutes près des niches vides de leurs saints, les scrutant comme si ces évidements détenaient le secret de ce qui fait toute notre joie : l’évidence et le mystère. Parfois, il tirait son appareil photographique pour saisir qui sait quel détail de pierrerie, ou tel fragment de rue ; ou encore, je le vis, à midi déjà passé, alors que le froid devait lui engourdir le manteau, empeser ses lunettes aux verres rectangulaires et d’un noir martial, dur, acéré, se prendre en photo, à bout de bras, mais non sans s’être au préalable caché le visage derrière le livre de poche (il attendait cette Eurydice de fortune) qu’il avait emporté avec lui.
Oui ; il faut dire qu’il lisait parfois, comme dans un bréviaire, de son air monacal, un petit livre curieux, à couverture grise à peine marquée du rouge d’un visage et de caractères d’imprimerie (titre et nom d’auteur, certainement). Je l’observai. Je me disais qu’il était curieux qu’il eût ainsi prévu tous les accessoires d’une attente interminable et vouée à l’échec, à l’absence de rencontre. Jouait-il la comédie de l’attente ? Et qui était-il ?
Il lisait. N’est-ce pas faire des manières – lire ainsi, comme dans un bréviaire, en faisant les cent pas devant une cathédrale ?
Vers midi et quart, un homme l’aborda, lui demanda assez sauvagement « Vous êtes Guy ? », à quoi il lui fallut répondre par la négative, d’un air d’abord surpris, puis amusé. Moi aussi, je trouvai cela amusant que lui, qui attendait depuis quelque temps déjà deux femmes qu’il ne connaissait ni d’Ève ni d’Adam, se vît de la sorte aborder. A midi vingt, un jeune couple que nous avions vu, lui et moi, entrer dans la cathédrale un bon moment auparavant, sortit par le portail de gauche. Se jetant dans la Loire (n’a-t-il pas, comme tout un chacun, une montre ou un téléphone portable faisant office d’horloge ?), il leur demanda l’heure.
Il les avait entendu, avant, parler des saints absents de leur niche, de modillons, de façades polychromes que restitue, de nos jours, un savant jeu de lumières. « À Chartres », avait dit la jeune fille, mince lame de couteau rousse – j’avais été tenté de m’immiscer dans leur conversation, en leur disant que c’était surtout la cathédrale d’Amiens qui était réputée pour son éclairage polychrome. Je m’étais retenu – et là, lui, il sautait le pas, quelle banalité, pour leur demander l’heure…
Il ne traîna pas longtemps à débiter pieusement ses patenôtres, à lire ses fadaises, à prendre ses photos loupées, à émincer sa silhouette. Il fila, sitôt l’heure (midi vingt) annoncée par le jeune homme. De toute son attente, il ne s’était absenté qu’une minute, vers 11 h 50, pour aller rôder devant l’entrée du Musée des Beaux-Arts, anxieux – sans doute – d’avoir fait fausse route et de s’être trompé sur le lieu du rendez-vous… sans jamais perdre de vue le parvis de la cathédrale. Son autre absence, ce fut vers midi dix, pour aller rendre hommage au gisant si émouvant des jeunes enfants de Charles VIII – attribué tantôt à Michel Colombe tantôt à son neveu Guillaume Régnault – mais si furtivement, une minute à peine, qu’il pensait ne pas courir de risque.
Je suis seul à savoir si, pendant cette minute, deux dames ne se sont pas présentées sur le parvis, ont scruté un à un les trois portails, ni si l’une d’entre elles ne se sera pas exclamée « C’est sûr, avec un tel retard, il n’aura pas attendu… » Seul à le savoir, je le laisserai dans le doute. Cela lui apprendra à faire les cent pas.
16:00 Publié dans Autoportraiture, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (2)
Fait tapisserie au château de Chenonceau, 6

15:15 Publié dans BoozArtz | Lien permanent | Commentaires (1)
Fait tapisserie au château de Chenonceau, 5

14:53 Publié dans BoozArtz | Lien permanent | Commentaires (0)
Note n° 1010 : Un poème d'Emile Verhaeren...
... offert par Joye (dont j'ai traqué les contributions au site Langue française, mais aussi les idées de Gifts for teachers...) dans le cadre du jeu des pierres blanches :
Les menus faits, les mille riens
Les menus faits, les mille riens,
Une lettre, une date, un humble anniversaire,
Un mot que l'on redit comme aux jours de naguère
Exalte en ces longs soirs ton coeur comme le mien.
Et nous solennisons pour nous ces simples choses
Et nous comptons et recomptons nos vieux trésors,
Pour que le peu de nous qui nous demeure encor
Reste ferme et vaillant devant l'heure morose.
Et plus qu'il ne convient, nous nous montrons jaloux
De ces pauvres, douces et bienveillantes joies
Qui s'asseyent sur le banc près du feu qui flamboie
Avec les fleurs d'hiver sur leurs maigres genoux,
Et prennent dans la huche, où leur bonté le cèle,
Le pain clair du bonheur qui nous fut partagé,
Et dont, chez nous, l'amour a si longtemps mangé
Qu'il en aime jusqu'aux parcelles.
En écoute (paradoxale) : "Le Roi" de Georges Brassens
12:50 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
Fait tapisserie au château de Chenonceau, 4

11:40 Publié dans BoozArtz | Lien permanent | Commentaires (0)
Chenonceau par les croisées, 4

10:05 Publié dans Où sont passées les lumières? | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 12 janvier 2006
À corps écrit
Il y a, ces derniers temps, une raréfaction des textes, en ce carnétoile, au profit des seules images. Heureusement, la fréquentation accrue de nouveaux lecteurs apparemment survoltés ou inspirés compense cela, car vos commentaires, à tous, enrichissent ces pages de mots, de réflexions, de remarques, de formules souvent bien trouvées, judicieuses, et qui y mettent du baume.
Je lisais hier la fin du chapitre « Alphabet » dans Biffures (Michel Leiris toujours !), et remarquais comment mon rapport aux mots est à la fois très proche et totalement distinct de celui du grand maître. Serais-je maniaque sans la rédemption du mysticisme ?
L’influence de mes lectures entrefiliennes * sur mes pensées et mes raisonnements commence à devenir inquiétante, et je me dis qu’il faudrait que je restreigne le temps quotidien consacré à ces carnets : en effet, tel passage me semblait mériter d’être cité ici dans telle perspective – tel autre, relatif au triangle, instrument de musique dont il est rarement question en littérature, me rappelait une note publiée par Simon à ce même propos naguère.
Pour ce qui est du temps englouti par mes arachnéens titubements sur la grande toile électronique, cela est, depuis une semaine, plutôt préoccupant. (Ecrivant ces mots, je suis plus encore absorbé.) Je dois constituer – je pense – une sorte d’emploi du temps de mes tâches, me tenir à l’une, rébarbative et comptable, que je diffère depuis trop longtemps, avant de reprendre plus avant et plus massivement l’écriture ici – puis partager harmonieusement mon temps entre mes activités professionnelles, au ralenti ce semestre, mon grand projet à achever avant l’été (la traduction du dernier roman de Nuruddin Farah (le contrat est signé)), et ces carnets. Pour la traduction, j’établirai un emploi du temps qui commencera au lundi 23 janvier. D’ici là, je dois encore rencontrer moult étudiants pour divers problèmes, régler des questions d’emploi du temps (l’enfer recommence), assurer une permanence au Salon d’Information des Lycéens de Rochepinard le vendredi 20, etc.
Autant dire qu’il vous faudra, quelque temps, vous contenter surtout de photographies, notamment les chenonciennes, dont je n’ai pas fait le tour.
* néologisme stupide pour ne pas dire « sur Internet ».
18:00 Publié dans Ecrit(o)ures, Lect(o)ures, Moments de Tours, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (3)
Touraine nerveuse...?
Des lycéens âgés de moins de vingt ans ont employé avant-hier un mot d'argot que ma compagne ne comprenait pas et qu'elle n'a pas retenu : "le père, c'est celui qui utilise le -----". Comme elle leur expliquait qu'elle ne comprenait même pas à quoi ils faisaient allusion, ils lui ont rétorqué qu'elle était sans doute une enfant sage.
Il s'est avéré, à la dissipation du malentendu, qu'ils parlaient de martinet. Ni elle ni moi ne parvenons à croire que des enfants aient pu subir, dans les années 1990, des coups de martinet. Cela paraît inconcevable. La Touraine est-elle plus arriérée qu'elle ne semble ?
J'attends, affolé, vos témoignages.
16:25 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (6)
Jazz de janvier : Print à Auxerre
Si des Auxerrois s’égarent de par ces pages (et qu’il soit bien dit qu’ils sont les bienvenus, d’autant qu’Auxerre est une très jolie ville, que je visitai à l’automne 2000, alors que ma compagne était enceinte de pas même un mois, et nous n’en savions rien encore (bon, il a fini de nous raconter sa vie, ç’ui-là ?)), qu’ils sachent que l’excellent quintette de jazz français Print leur rend visite ce vendredi 20 janvier. J’aurai – je l’espère – l’occasion de parler du seul disque que je connais de ce groupe vraiment novateur ; dans l’immédiat, cela me fait plaisir de faire leur promotion ès ces pages arrachées à la voilure carnétoilesque (mais qu’est-ce qu’il raconte ?).
Vendredi 20 Janvier
Théâtre d'Auxerre, Le Studio
Organisé par le Jazz Club Auxerre
Premier set
P R I N T- 5
Sylvain Cathala - saxophone ténor, composition
Stéphane Payen - saxophone alto
Fabian Fiorini - piano
Jean-Philippe Morel - contrebasse
Xavier Rogé - batterie (en remplacement de Frank Vaillant)
Deuxième Set
P R I N T + D' de Kabal
Sylvain Cathala - saxophone ténor, composition
Stéphane Payen - saxophone alto
Jean-Philippe Morel - contrebasse
Xavier Rogé - batterie (en remplacement de Frank Vaillant)
+
D' de Kabal (voix, texte)
********************************
Il n’y a pas d’heure indiquée, mais le mieux est peut-être de leur écrire. Vous pouvez même, de leur musique, écouter des échantillons de taille respectable sur leur site.
14:50 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
Ça ne s’invente pas, 3 : Cellule 64
La cellule spéciale d’enquête mise en place à la suite de plusieurs tentatives d’enlèvement d’enfants aux sorties d’écoles des Landes et des Pyrénées-Atlantiques s’appelle Cellule 64. La dernière tentative a eu lieu à Biscarrosse, soit à cent kilomètres environ au nord du département des Pyrénées-Atlantiques. On savait que, pour les journalistes, les météorologues, etc., le département des Landes n’existait pas ; pour la justice et la police, c’est nouveau.
12:20 Publié dans Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0)
Ça ne s’invente pas, 2 : Plantade en beauté
Jean-Marc et Yidir Plantade sont les auteurs, aux éditions Bourin, d’un livre sur la Chine contemporaine. Quitte à ruer dans les brancards, ça sent l’échec.
11:00 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (5)




