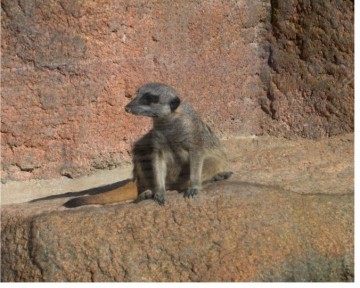jeudi, 06 octobre 2005
Coco Texèdre aux Bons Enfants
Suite des coïncidences? Je reçois aujourd'hui même de la galerie des Bons Enfants l'annonce suivante:
15:09 Publié dans BoozArtz | Lien permanent | Commentaires (1)
L'insomnie étend
13:30 Publié dans Ecrit(o)ures | Lien permanent | Commentaires (7)
Note de tout bois
11:48 Publié dans Ex abrupto, Où sont passées les lumières? | Lien permanent | Commentaires (0)
Avishai Cohen : Lyla (Nocturne NTCD 343)
Vous souvient-il, bien-aimés et fidèles lecteurs, d’un quiproquo doublé d’une coïncidence tous deux jazzistiques, qui se produisit cet été en ce carnet de toile, à propos d’une mienne note consacrée à un disque du trompettiste Avishai Cohen, et ce au moment où, en vacances dans le Sud-Est de la France, Livy se rendait au concert d’un autre Avishai Cohen, bassiste, pianiste et chanteur, alors en formation trio?
Eh bien, cette histoire connaît un infime rebondissement, à faire se pâmer ceux qui, en nombre toujours grandissant, réclament à hauts cris que je tienne enfin ma promesse d’écrire un roman-feuilleton interactif (merci, la Jeune Divorcée), oui, un rebondissement, car ce mercredi, à la médiathèque de La Riche, j’ai emprunté Lyla, disque sorti en 2004 sous le nom du bassiste.
(Pour ceux qui n’auraient pas encore cliqué sur les six liens ci-dessus, sachez qu’ils ont pour seul but de gonfler artificiellement les statistiques du blog en augmentant le nombre de pages différentes consultées. Une sorte de Viagra carnétoilé, si vous voulez. Voyez à quoi j’en suis réduit.)
La musique de cet Avishai-là est bien séduisante, me fait penser à mon cher Leon Parker, dans son caractère polyrythmique et son inventivité constante, son croisement de modes de jeux et de genres musicaux multiples, sans qu’il y ait pour autant de dissolution de l’harmonie sonore, ou de la cohérence. La COHérENce est là*, n’en doutez pas.
Tout d’abord, Avishai Cohen est souvent présenté comme un bassiste qui a d’autres cordes à son arc. Hum, c’est vite dit. Si vous écoutez le solo de piano qui sert de centre à cet album, Structure in emotion, vous ne manquerez pas de remarquer que bien des pianistes de jazz aimeraient avoir ce touché, ce phrasé, cette suggestion de spectres, et aussi (comme accessoirement) ce talent pour la composition.
Les morceaux qui me convainquent moins (mais c’est plus lié à mes goûts et à mon indécrottable préférence pour le jazz acoustique) sont les morceaux où s’entremêlent échantillonnages électroniques, comme Handsonit, ou The Watcher, composition d’ailleurs signée Dr. Dre. Handsonit est un assez beau morceau toutefois, dans les solos de basse électrique, mais aussi les volées de trompettes (Diego Urcola et Alex Norris), et c’est certainement celui qui réjouira le plus les amateurs de St Germain, par exemple. Pour moi, la vraie beauté de la musique d’Avishai Cohen est ailleurs, et, sans aucun doute, dans Eternal child, duo entre le contrebassiste et un Chick Corea magistral, ou Ascension.
* Si je prolongeais le jeu de mots, je pourrais noter que Cohen crée est l’anagramme de cohérence. Mais je ne le fais pas, n’est-ce pas (prétérition?).
10:40 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1)
Prix Nobel de Chimie
Une fois n'est pas coutume, je copie-colle une dépêche de l'A.F.., faute d'avoir mieux à dire. Mais c'est une information importante.
*******
Un Français obtient le Nobel de chimie
Le prix Nobel de chimie 2005 a été attribué, mercredi 5 octobre, au Français Yves Chauvin et aux Américains Robert H. Grubbs et Richard R. Schrock pour leurs travaux sur la métathèse en synthèse organique qui ont ouvert "des possibilités fantastiques" pour la fabrication de médicaments
"Les prix Nobel de chimie de l'année ont développé la métathèse pour en faire l'une des réactions les plus utiles en chimie organique", a précisé l'académie royale suédoise des sciences en décernant le prix au Français Yves Chauvin et aux Américains Robert H. Grubbs et Richard R. Schrock. "Leurs travaux ont ouvert des possibilités fantastiques pour, entre autres, la fabrication de médicaments. La création de nouvelles molécules n'est bientôt plus limitée que par notre imagination !", a souligné l'académie. La métathèse est, selon la définition élégante qu'en donne l'académie suédoise, "une danse avec changement de partenaire". Elle est couramment utilisée dans l'industrie chimique, surtout dans la production de médicaments et de matériaux plastiques élaborés.
"Les substances organiques contiennent du carbone élémentaire. Les atomes de carbone peuvent former de longues chaînes ou des anneaux, se combiner à d'autres éléments tels que l'hydrogène et l'oxygène, former des liaisons doubles, etc. Toute vie sur terre est fondée sur de tels composés carboniques mais on peut également les créer artificiellement, ce qu'on appelle synthèse organique", a expliqué l'académie. "Métathèse signifie changer de place. Dans les réactions métathèse, les liaisons doubles entre les atomes sont rompues et recomposées d'une façon qui provoque le changement de place de groupes d'atomes. On obtient ce réarrangement grâce à l'action de molécules catalytiques spécifiques qui permettent la réaction sans subir de modification chimique. Ainsi, la métathèse est un peu comme une danse au cours de laquelle on changerait de partenaire", selon le communiqué explicatif.
C'est en 1971 qu'Yves Chauvin, né en 1930, directeur de recherche honoraire à l'Institut Français du Pétrole (IFP) de Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), a réussi à expliquer en détail le fonctionnement des réactions. Les premiers furent Henri Moissan en 1906 et Marie Curie en 1911. Dans la phase suivante, les chercheurs s'efforcèrent d'appliquer la "recette" pour développer, dans la limite du possible, les catalyseurs. Richard Schrock, né en 1942, professeur en chimie au Massachusetts Institute of Technology (MIT), fut, en 1990, le premier chercheur à "produire un composé métalloïde jouant un rôle efficace de catalyseur dans les métathèses". Deux ans plus tard, Robert Grubbs, professeur au California Institute of Technology, a mis au point un catalyseur encore plus performant, stable dans l'air et qui s'est donc révélé d'une grande utilité pratique. Les trois scientifiques se partageront un tiers chacun du prix, doté de 10 millions de couronnes suédoises (1,1 million d'euros). Le prix leur sera remis le 10 décembre, date anniversaire de la mort en 1896 de l'inventeur de la dynamite et industriel suédois Alfred Nobel, lors d'une cérémonie à Stockholm suivie d'un dîner de gala en présence de la famille royale de Suède. Yves Chauvin, est le huitième scientifique français à être récompensé par le Nobel de chimie. "Je suis plutôt embarrassé, parce que je n'ai pas le vrai profil", a-t-il déclaré, peu après l'annonce de la récompense, sur les ondes de la radio publique suédoise. "Je suis âgé, j'ai 75 ans. (...) c'est pas tout jeune ! Et puis ce que j'avais trouvé, je l'avais trouvé il y a 40 ans! Alors ça fait très ancien". M. Chauvin a déjà prévenu qu'il ne prévoit pas, en raison de son âge, de se rendre à Stockholm afin de chercher le prix.
08:45 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (2)
Pierres blanches
Je ne sais à quand remonte ni à qui je dois cet honneur, mais je découvre ce jour, au début du cinquième mois d'écriture de ce carnétoile, qu'il (le carnet de toile) est répertorié dans l'annuaire de sites non automatisé DMOZ. Par ailleurs, le site de la SLRC a commencé à publier en ligne, depuis trois jours, les entrées quotidiennes du Journal romain de Renaud Camus, précisément vingt ans après leur écriture. Vous trouverez ici l'entrée du 6 octobre 1985. L'entrée du 3, elle, est passionnante dans sa théorisation de l'écriture intime.
07:10 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
Lever matinal
Tombé du lit quoique couché ou endormi fort tard et ma première pensée ou presque va à ce carnet de toile pourtant j'ai bien mieux à faire même avec cet ordinateur ce qui m'inquiète le plus bien sûr c'est d'entendre un peu tousser ou bouger peut-être mon fils une heure avant son réveil habituel l'aurais-je dérangé mauvaise conscience du père blogueur d'autant que je dois aussi mettre plusieurs textes et commentaires en ligne sur le blog Cours 2005 non vraiment j'ai mieux à faire et si j'avais repris sur la table de chevet avant de me lever dans l'obscurité le livre que je lis en ce moment et pour lequel depuis deux jours j'ai retrouvé un peu de temps l'histoire se mettant en place j'en ai aussi trouvé meilleur le goût plus entraînante la lecture il s'agit du dernier Lobo Antunes bien sûr sinon pourquoi écrirais-je en ce torrentiel style?
06:27 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (3)
mercredi, 05 octobre 2005
Henry Céard, pas moins de 122 ans après
Après avoir occupé pendant deux semaines le poste d'attaché au cabinet du préfet de la Seine Charles Floquet, Henry Céard fut nommé, le 5 octobre 1883, sous-bibliothécaire de la Ville de Paris à l'Hôtel Carnavalet.
************
Lettre de Zola à Céard (22 mars 1885)
22:25 Publié dans Célébrations improbables | Lien permanent | Commentaires (1)
Saint Esprit
Je me rends compte que je n'ai jamais donné suite à la note dans laquelle j'"assassinais" (in metaphorical terms) un exégète malheureux (ou: mal inspiré, mal informé, bien hâtif) du roman de Coetzee, Elizabeth Costello. Il se trouve que le rédacteur en chef de l'excellente revue Esprit m'avait répondu, que sa réponse remonte au 5 septembre... et que la voici:
Cher lecteur,
En effet, la méprise est impressionnante! Désolés d'être tombés si bas ! Faut-il esquisser une défense ?
Votre mot est plein de compréhension malgré votre légitime consternation. Il faut avouer que l'auteur est plutôt connaisseur de littérature allemande... personne n'est parfait ni, surtout, "spécialiste" au sens universitaire du terme.
Cela dit, on peut y voir un hommage involontaire à la puissance créatrice du romancier qui fait croire entièrement à sa fiction et qui sème l'indistinction aux marges du réel et du fictif. Un dernier mot en faveur de l'auteur, qui ne prétend pas d'ailleurs connaître parfaitement Coetzee ni la littérature anglophone, son centre d'intérêt est ailleurs : dans la réflexion sur le mal, qui n'est pas centralement remise en cause, me semble-t-il, par cette erreur.
Je n'essaie pas de nous justifier d'avantage, d'autant plus qu'une simple vérification de notre part aurait permis de nous rendre compte de la méprise, et vous prie de transmettre nos excuses à M. Paul West (le vrai !) à l'occasion.
Merci de votre fidélité,
Marc-Olivier Padis
Rédacteur en chef
Revue Esprit
J'avais répondu, immédiatement, à M. Padis, en lui certifiant que je maintenais ma confiance à sa revue, que c'était surtout l'auteur de l'article qui était à blâmer, que je ne connaissais pas Paul West... et que je publierais sa réponse. Mieux vaut tard que jamais, dit l'adage.
20:37 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
Le prieuré Saint-Cosme
Mercredi, 12 h 15
Aussitôt dit, aussitôt fait… Je promets une note, et une fois encore je faillirais à ma promesse ? Ah non, pas de ce pain-là, hein…
Le prieuré Saint-Cosme, à La Riche, est un lieu que je trouve, pour ma part, touché par la grâce. Il ne reste pas grand-chose, certes, des bâtiments conventuels du seizième siècle, mais le réfectoire, par exemple, vaut à lui seul la visite. Les fragments qui restent de l’église sont aussi très émouvants.
Bien entendu, le prieuré est surtout réputé car Ronsard l’a immortalisé dans plusieurs poèmes, en fut prieur de 1565 à 1585, y écrivit quatre chants de la Franciade.
Puis dès le poinct du jour redoublant le marcher,
Nous vismes dans un bois s’élever le clocher
De Saint Cosmes prè Tours où la nopce gentille
Dans un pré se faisait au milieu de l’isle.
Voilà de beaux vers, assurément. (Ce qui vous remet en mémoire, fidèles lecteurs, que j’ai laissé naguère en plan la série annoncée Un beau vers. Je me demande si, velléitaire comme je le suis, je me tiendrai, avec la masse de travail qui m’attend jusqu’en février au moins, à mon projet de roman publié dans ce carnet de toile. C’est une autre histoire, non?)
Ce sont de beaux vers. J’aime ce quatrain, car, outre la douceur de la scène champêtre, la gaieté si bien transmise, il y a cette métamorphose discrète, de vers à vers, du poinct en un bois, puis de prè en pré. Par ailleurs, ce quatrain indique que la commune (ou paroisse) devait, à l’époque, s’appeler Saint Cosme, et non La Riche. D’où est venu ce nom, et quand ? Quel est le lien avec l’église Notre-Dame de La Riche, qui se trouve, de fait, à Tours, dans un quartier très voisin de La Riche ? Autant de questions dont je chercherai les réponses… Quelle prétention de vouloir tenir un carnet qui parle aussi des sites et lieux d’Indre-et-Loire, quand je suis si nouvellement arrivé et si peu informé de tant de choses…
18:35 Publié dans Sites et lieux d'Indre-et-Loire | Lien permanent | Commentaires (3)
Coco Texèdre… à suivre…
Je reviens, avec mon fils, de la médiathèque de La Riche, où sont exposées, comme souvent, des œuvres d’artistes locaux, dont il vaut mieux, généralement, se dispenser de parler. (C’est le genre d’œuvres dont nous parlons, avec C., en employant l’expression palette fléchoise en souvenir d’une mémorable exposition de croûtes vue à La Flèche l’été 1994). Toutefois, ce matin, il y avait, le long de l’escalier qui permet d’accéder à l’espace adultes du 1er étage, deux grandes plaques de verre en partie sculptées et recouvertes de peinture rouge ou bleue, et d’inscriptions dans un style voisin d’Alechinsky ou Opalka, toutes proportions gardées. La documentaliste du bureau de prêt m’a dit qu’il s’agissait d’œuvres de Coco Texèdre (?). Je ne suis pas certain de l’orthographe de ce nom, et je vérifierai en cherchant sur la Toile plus d’informations. En tout cas, voilà un nom d’artiste qui ne laisse rien présager de très captivant, et pourtant, l’alliance d’une technique complexe et d’un graphisme subtil m’a tapé dans l’œil.
A consulter: le site de Coco Texèdre.
17:25 Publié dans BoozArtz | Lien permanent | Commentaires (3)
Atelier mode d’emploi: Ségolène Garnier et Cécile Cluzan
Mercredi, 11 h 40
Dimanche dernier, en début d’après-midi, dans le cadre d’une manifestation culturelle appelée Atelier mode d’emploi et qui consistait, pour les artistes tourangeaux, à accueillir le public dans leurs ateliers respectifs, nous nous sommes rendu, mes parents, ma compagne, A. et moi, au 32, rue Delpérier, où demeure Ségolène Garnier, qui avait exposé certains de ses mobiles tridimensionnels, et une série fort longue de figures rouges sur supports imprimés retravaillés. C’est, de ses œuvres, cette série que j’ai préférée. J’ai aussi remarqué, sur les rayonnages de sa bibliothèque, qu’elle avait lu Le sujet monotype de Dominique Fourcade, dont j’avais promis de parler mais que j’ai dû rendre, entre-temps, à la Bibliothèque Universitaire (ou S.C.D.).
Auparavant, nous avions été accueillis, dans la courette de l’immeuble, et pendant une battante averse, par l’invitée de Ségolène Garnier, Cécile Cluzan, qui avait édifié une sorte de tente-igloo entièrement constituée de pull-overs et de chandails décousus puis recousus les uns aux autres, dans une sorte de sarabande colorée très insolite. J’ai photographié le reflet, dans la théière, des visiteurs et hôtes assis autour d’un thé fumé sur ce fond multicolore.
Je ne sais si Ségolène Garnier m’autoriserait, elle, à inclure dans ce carnet de toile une ou deux images volées à ses figures rouges ; je vais essayer de retrouver sa trace, afin de lui signaler, au moins, l’existence de cette note.
Après cette incursion dans l’atelier de ces deux jeunes artistes, nous avons profité du soleil revenu pour flâner avant de conduire mes parents à la gare de Saint-Pierre des Corps. Je leur ai montré les bâtisses de style art nouveau de la rue Jules Charpentier ; nous avons visité, dans ces parages-là, un autre atelier dont je préfère éviter de parler.
16:15 Publié dans BoozArtz, Moments de Tours, Où sont passées les lumières?, Sites et lieux d'Indre-et-Loire | Lien permanent | Commentaires (0)
Revue de presse
Quelle peut être la valeur d’une note de blog par rapport à la presse spécialisée et imprimée, celle qui, par son imprimatur, se voit investie, justement, d’une vraie légitimité ? Je repense au commentaire de la mystérieuse et si gentille Carole. Sans doute, Julien Duthu et Rémi Panossian, qui forment, je le rappelle ici, un duo admirable, seront très contents de lire la recension que j’ai écrite, à mon modeste niveau. Mais peuvent-ils vraiment citer Touraine sereine dans un press book ? Pourtant, ce carnétoile peut s’enorgueillir d’une moyenne de 300 visiteurs quotidiens, ce qui n’est pas rien : après tout, si je devenais assez gourou pour inciter mes lecteurs réguliers à acheter les disques (ou les livres, etc.) que je recommande si chaudement, ce ne serait pas négligeable pour les artistes concernés, non ?
15:05 | Lien permanent | Commentaires (0)
La Riche
Mercredi, 11 h 55
Je ne connais pas très bien cette commune limitrophe de Tours, où je me rends désormais avec une certaine régularité, depuis que nous avons pris un abonnement à la médiathèque. Jusqu’alors, je connaissais surtout la petite place qui se trouve derrière le Jardin botanique, mais aussi, pour y être allé une fois, seulement, un quartier résidentiel construit dans les années 1980, vraiment pas beau et où habite un collègue pour qui j’ai, a demeurant, la plus vive estime et l’admiration la plus profonde (moi-même, je ne vis pas dans le coin le plus beau de Tours, c’est un bel euphémisme d’écrire cela!). Je connaissais aussi, et j’y suis retourné trois fois depuis notre installation ici, le prieuré Saint-Cosme, qui méritera une note à lui seul.
Il y a actuellement, derrière la médiathèque, un grand chantier de construction dont je suis les progrès avec régularité, car A. est fasciné par les machines et les grues. Je remarque que ce chantier avance à vitesse V, ce qui n’est pas le cas de celui qui nous empoisonne l’existence à l’université (extension du site Tanneurs).
Il y avait, ce matin, un enterrement à l’église de La Riche, qui est, à n’en pas douter, l’une des plus laides du département. De quand peut-elle bien dater ? de 1923 ? 1891 ? (Tiens, je devrais reprendre l’écriture de mes célébrations improbables, mais aussi y ajouter une série de conjectures inactuelles.)
Preuve de plus que cet automne 2005 sera richois (la-richois ? la-richien ?) ou ne sera pas, je viens de réserver deux places pour le concert de Mathieu Boogaerts à la Pléiade.
13:55 Publié dans Sites et lieux d'Indre-et-Loire | Lien permanent | Commentaires (2)
Yvette encore
Je ne sais pourquoi ma compagne a choisi Yvette comme nom de plume, ou pseudonyme internautique. C’est le prénom de sa tante paternelle, but that’s hardly a hint when you happen to know the aforesaid aunt!!! Ah la la, comme si ce carnétoile n’était pas assez compliqué avec les journalistes de la NR, les jeux de Livy, les questionnaires de Fuli, les agaceries des faux Newbie… et les bluesmen québécois (à qui je dois encore une note, j’y songe, et elle se prépare).
12:36 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (5)
L'auteur
L'auteur des textes de ce carnet de toile, unless otherwise specified, c'est moi... Assurément, cela me ferait plaisir d'avoir, de temps à autre, des remarques positives de la part des nombreux artistes que j'encense, et pas seulement des fort rares que je fustige. Si vous connaissez, chère Carole, Julien Duthu et Rémi Panossian, dites-leur en effet que je suis très admiratif de leur oeuvre, de ce disque de duo absolument splendide.
Pour ce qui est de la réaction de Yann Kerninon, je ne pense pas que l'on puisse me taxer de malhonnêteté, puisque j'ai justement critiqué le prière d'insérer en précisant que je n'avais pas lu le livre. Il s'agit donc d'une réaction à la présentation d'un livre. De même, si je vois annoncer un film "comique" avec Christian Clavier et Michaël Youn, je me doute, connaissant mes goûts, que je trouverais cela lamentable, et je ne cherche pas à voir le film. Cela s'appelle un pré-jugé, et même si les préjugés ont mauvaise presse et si une démarche intellectuelle profonde doit chercher à interroger les préconceptions, il existe aussi, bien souvent, une vérité des préjugés. En l'occurrence, mon pré-jugé se fonde sur une connaissance préalable du jeu des acteurs cités ci-dessus, ou, dans le cas de la présentation de l'ouvrage de M. Kerninon, sur une connaissance assez bonne de la critique littéraire et philosophique contemporaine, notamment américaine, pour laquelle les noms de Nietzsche, Deleuze, Heidegger ou Stirner ont valeur de tic d'écriture qui dispense souvent les universitaires de réfléchir. Cela étant posé, votre livre, M. Kerninon, échappe peut-être à ces travers, auquel cas j'aurai eu tort, et déjugerai mon pré-jugé.
11:30 Publié dans Jazeur méridional, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (3)
En vitesse
L'insecte net s'étire et devient moins aveugle, moins avare, plus avide. Des pulsations dans les fossés, des éphèmères coincées contre les fenêtres. Une course à tout casser, le coeur à rompre, une corde tendue, je danse sur un fil.
09:27 Publié dans Ecrit(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 04 octobre 2005
777, c'était ce matin
Juste un petit mot en quatrième vitesse, depuis l'ordinateur de la salle des professeurs du site Fromont (ah, Flaubert eût aimé ce triple génitif...), pour vous informer que j'ai lu vos nombreux commentaires, que j'y répondrai plus tard (ah ah ah...), et que l'auteur du 777ème commentaire n'est autre que... Livy, pour sa remarque sur les jouets et les jeux inventés et dirigés par son fils.
13:51 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles | Lien permanent | Commentaires (4)
On approche...
... du 777ème commentaire. A vos plumes & claviers....
08:53 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (1)
Les Musiciens de Brême, version plastique
07:40 Publié dans Où sont passées les lumières? | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 03 octobre 2005
Petit jeu sous Word
Avez-vous essayé ceci...? Ouvrez un document Word; écrivez =rand(100,1); appuyez sur la touche ENTER. Le résultat n'est pas le même selon la version de Word que vous utilisez.
21:05 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (7)
Yvette
Il y eut, ponctuellement, ces derniers temps, certains messages laissés sur ce carnet de toile par une énigmatique Yvette, "voisine" disait-elle et que j'ai enfin démasquée.
18:35 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (9)
Au questionnaire de Fuligineuse
Fuligineuse me/nous pose sept questions.
Dont voici, me concernant, les réponses:
1) J'écris presque tous les jours, et je publie tous les jours.
2) Les deux, mon commandant. J'aime la publication spontanée (qui se repère aisément grâce aux chiffres non ronds dans le module "heure" sur H&F) et la publication programmée (avec, de ma part, de savants calculs dans l'échelonnement des publications au cours d'une seule et même journée). Cette note, en cours d'écriture à 13 h 50, quand la publierai-je?
3) Jamais de brouillon dans le site lui-même, mais des brouillons sous Word, oui, pour les plus longues notes, ou quand je n'ai pas d'accès à la connexion.
4) Je conserve les documents Word matriciels, et parfois fais des copies .html des pages du carnet de toile.
5) Les deux, mon adjudante.
6) J'essaie de répondre, et il m'arrive d'écrire de longues notes en réponse aux commentaires les plus complexes (n'est-ce pas?).
7) Ah, Guillaume et les images... That's a long story...
***
Addendum du 5 octobre: Fuligineuse publiait hier un bilan de l'enquête.
17:45 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles | Lien permanent | Commentaires (0)
Connaissez-vous les suricates
15:35 Publié dans Où sont passées les lumières? | Lien permanent | Commentaires (9)
Not a dream
La pastourelle débuta. Quelques gouttes de pluie, quelques flaques d'ennui. Que faisiez-vous dans ces parages, ô mainte Hélène au beau plumage? Une sirène s'envola, ainsi, délaissant ses écailles. Je ne rêve pas, je me caille. Ô cantique de la canaille, un arbre nous barre la route. C'est le baobab. Un serpent s'en déroule, y délaisse sa peau muée; c'est le boa qui nous sourit. Et nous avec lui, tant pis. La pastourelle virevolte. Dans le fond, un enfant, malmené puis câliné, détourné du droit chemin, rencogné dans le mur, renfrogné, sanglote.
Où allions-nous, mes camarades, porteurs de faux?
14:15 Publié dans Ecrit(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)
Romans
J'ai envie d'écrire un roman-feuilleton dans ce carnétoile, un chapitre par semaine, et de demander à mes lecteurs de décider de la suite. (Il pourrait y avoir un système de choix en fin de chapitre et une procédure de vote...) Mais je crains de manquer de temps pour cela ce trimestre-ci.
Idée à conserver pour une période creuse?
.....................
C'est bien, quand même, quand mes étudiants ne viennent pas massivement à l'heure de rendez-vous; j'ai plus de temps pour ces fariboles!
14:01 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (1)