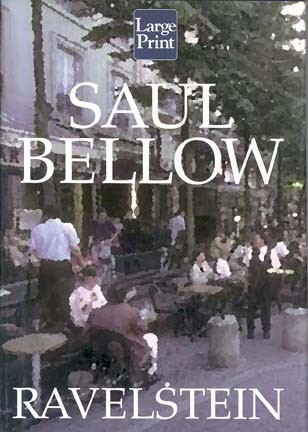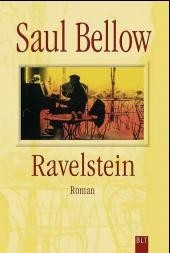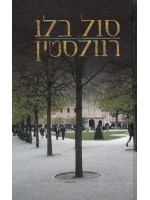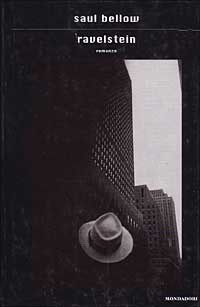jeudi, 10 novembre 2005
Insolite?
Autre léger détail: ce "couple" n'avait, malheureusement, rien d'insolite. Il était tristement banal, au contraire.
15:55 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
Planche à roulettes?
Pourquoi ai-je écrit cette note? Peut-être pour rappeler quelques notions de savoir-vivre, dans un monde où les codes les plus élémentaires de la politesse et de l'attention aux autres ont quasiment disparu... Oui, c'est cela... Ce faisant, j'ai aussi livré un autoportrait de moi en vieux râleur impénitent et grognon. C'est cela aussi... je l'admets et l'assume volontiers.
Je m'aperçois aussi que je n'ai pas hésité une seule seconde à employer, par trois fois, le franglais skate-board. Je ne sais pas si le très linguistiquement correct "planche à roulettes" a pris racine, ou non; au temps de mon adolescence, nous disions tous skate-board.
Pourtant, le terme de "planche à roulettes" aurait présenté un intérêt non négligeable: celui d'infantiliser un peu cet étudiant, car, franchement, cet accessoire donne une bien piètre idée de sa mâturité, et de sa motivation pour le travail. Quelle image veut-il donner de lui-même? Aucune, sans doute, et c'est bien là le problème.
13:50 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (1)
Le faux Tourangeau n'a pas lu Ravelstein
Russie éternelle, ou encore grimaces.
Âtre où folâtrent des pigeons,
vide, éteint, sans embrasement.
Est-ce cette planète, ou ce roi
lucide, en sa danse de la pluie,
sereinement conquis?
Terreur, apothéose!
Est-ce, de sons, une overdose?
Il paraît que je ne suis rien,
non, au chaud sous les couvertures.
mercredi, 09 novembre 2005
Eglise d'Azay

13:00 Publié dans Où sont passées les lumières?, Sites et lieux d'Indre-et-Loire, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 01 novembre 2005
Les Trois Rois
18:15 Publié dans Ecrit(o)ures, Moments de Tours, Où sont passées les lumières?, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 31 octobre 2005
Bibliothèque portative en anglais
Pour ceux qui lisent l'anglais (et qui deviennent indûment favorisés ces derniers temps), je conseille la lecture de ce chapitre 3 de The Road to Wigan Pier, qui, outre de belles considérations minières et charbonneuses, peut suggérer la réponse à l'énigme posée plus tôt ce jour.
(Mais si, vous savez bien, dans un message publié à 12 h 55, et qui proposait de relier le texte d'un conte et le titre d'une précédente note.)
(Ce qu'on s'amuse.)
22:35 Publié dans Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (3)
Oups, je l'ai fait encore...
Ayant dû subir, au moment du café, en cet aimable troquet où je déjeune le lundi, un pot-pourri de Britney Spears (et jamais le mot "pourri" n'eut autant de signification), je vous livre la traduction, par l'intermédiaire du traducteur automatique de Google, d'une chanson intitulée Oops I did it again :
Oops, je l'ai fait encore
J'ai joué avec votre coeur
Obtenu perdu dans le jeu
Bébé de bébé d'Oh
Oops, vous pensez que je suis dans l'amour
Que je suis envoyé d'en haut
Je ne suis pas celui innocent
(Texte original ici. (But don't you dare go and check!!!))
14:00 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (6)
Tom Pouce et la Table Ronde
Si vous choisissez de lire The True History of Sir Thomas Thumb, d'une certaine Flora Annie Steel, vous découvrirez peut-être l'expression anglaise qui relie ce conte à une note publiée précédemment ce jour.
12:55 Publié dans Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (1)
dimanche, 30 octobre 2005
I médiuscule
A lire, un bel article de William Safire.
22:05 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
Milquetoast
Si je connaissais bel et bien le nom mollycoddle avant de lire Henry James, je ne connaissais pas milquetoast avant d'écrire la note publiée hier. C'en est un synonyme.
Un certain H.T. Webster a publié en 1931 un ouvrage intitulé The timid soul; a pictorial account of the life and times of Casper Milquetoast... D'après le site Answers.com, c'est ce personnage (de bande dessinée, apparemment) qui est à l'origine du nom commun.
Mais, bien évidemment, le plus frappant, c'est qu'il existe un journal intime en ligne ainsi intitulé.
A chaque jour suffit sa peine.
13:46 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (2)
samedi, 29 octobre 2005
Mollycoddle, 2
J’ai narré la mésaventure qui m’arriva hier matin, dans la salle des professeurs du site Fromont. La note perdue commençait par un paragraphe qui traitait de mon amour des mots, the clear fact that I’m a wordaholic. (Mais cette formule date de l’instant même…).
Lors de l’invention, en juillet, des catégories pour ce carnet de toile, j’ai aussitôt créé une rubrique Words Words Words, que j’ai failli intituler WWW, ce qui eût permis autant et plus encore d’ambiguïté que pour la catégorie WAW. Mais cette catégorie n’a été alimentée que sporadiquement, peut-être parce que ma lecture de nombreux ouvrages lexicographiques aussi ludiques qu’instructifs, mais aussi la consultation de sites (principalement ceux de Michael Quinion et d’Anu Garg), m’ont montré qu’on ne pouvait explorer les mots d’une manière systématique qu’en y passant la totalité de ses journées. L’exemple littéraire de Michel Leiris a aussi de quoi décourager d’emblée les émules.
Toujours est-il que la lecture simultanée (comme toujours : je ne survis pas avec moins de quatre ou cinq ouvrages en parallèle) de Roderick Hudson et de Travelling with Djinns, qui sont, chacun dans leur style, de confondantes ciselures de la langue anglaise, m’a incité à reprendre cette catégorie et à consacrer des notes plus régulières à des mots précis, pas nécessairement rares d’ailleurs. Le premier mot sera, pensai-je, mollycoddle. C’est un nom, et, par extension ou conversion, un verbe.
Voyons ce qu’en dit sommairement le Roget’s Thesaurus :
NOUN: A person who behaves in a childish, weak, or spoiled way: baby, milksop, milquetoast, weakling. Idioms: mama's boy (or girl) . See YOUTH. <br>VERB: To treat with indulgence and often overtender care: baby, cater, coddle, cosset, indulge, overindulge, pamper, spoil. See TREAT WELL.
Dans Main Street, Sinclair Lewis l’emploie dans un sens très clair connotant le caractère efféminé : "They say he tries to make people think he's a poet — carries books around and pretends to read 'em, says he didn't find any intellectual companionship in this town…. And him a Swede tailor! My! and they say he's the most awful mollycoddle—looks just like a girl. The boys call him Elizabeth…."
Mais c’est l’occurrence de ce nom dans une très belle phrase jamesienne, une réplique de Roderick lui-même, qui a stimulé l’écriture de cette première particulière note.
"The trouble is," he went on, giving a twist to his moustache, "I 've been too great a mollycoddle. I 've been sprawling all my days by the maternal fireside, and my dear mother has grown used to bullying me."
Or, l’édition que je lis reprend le texte de 1909, révisé par James plus de trente ans après l’écriture du roman, le second de son auteur. Le texte que proposent les éditeurs du projet Gutenberg donne le texte original de 1875, qui ne comprend pas le mot. Ce que disait Roderick dans la première édition, c’est « I’ve been too absurdly docile », ce qui revient à dire qu’il en veut à son entourage plus qu’à lui-même. En se traitant, en 1909, de mollycoddle, il s’impute la plus grande part de culpabilité : de docile, il est devenu imbécile ou plutôt, s’est convaincu d’être « dans les jupes de sa mère ». Peut-être le mot était-il moins fréquent en 1875, ou s’agit-il d’un anglicisme dont James ne s’était pas encore rendu maître lors de l’écriture du roman.
Pour vérifier tout cela, il me faudrait le sacro-saint OED, ou comparer des dictionnaires américains et anglais. Comme je le disais en ouvrant cette note, je ne compte pas passer mes journées à écrire les notes de cette rubrique ; parfois, je me contenterai de recopier une phrase d’écrivain particulièrement belle, ou de présenter sommairement le mot. (Un coup d’œil rapide à The Maven’s Word of the Day semble indiquer que ce fut d’abord un anglicisme avant de pénétrer aux Etats-Unis, donc j’aurais deviné juste.)
17:40 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (5)
Voyage avec les djinns
Mardi, huit heures vingt.
Tout dort dans la maisonnée. Les angines, la claustration, ont-elles abattu tout le monde ?
Avant-hier soir, je voulus furtivement me relever pour écrire une (sans doute longue) note sur mes lectures du moment, Wasabi que j’avais fini la veille, et surtout les trois autres livres que je mène de front. Soucieux de me reposer un peu, je ne l’ai pas fait, et me suis contenté d’éteindre la lampe sur les minuit*. Hier soir, je voulais passer la soirée avec ma compagne, à l’issue d’une semaine éprouvante pour elle et épuisante pour moi.
La lecture de Roderick Hudson, qui m’enchante comme à chaque fois que je reprends le fil dénoué de mes fréquentations jamesiennes, m’a, presque à elle seule, convaincu de redonner du lustre à la catégorie Words Words Words, d’où l’essai infructueux (pour cause d’incurie informatique) d’une note consacrée au mot anglais (nom et verbe) mollycoddle, hier vers neuf heures et demie à Fromont.
Ce n’est pourtant pas de ce livre-là, ni de son compagnon baroque et de fortune, L’Amant bilingue de Juan Marsé, que je voulais surtout parler**, mais de ma relecture (pour la quatrième fois) de Travelling with Djinns, le dernier roman paru (en 2003) de Jamal Mahjoub.
Il est rare, pour moi, qu’un livre distille ses charmes de manière toujours plus audacieuse, plus insidieuse, à chaque nouvelle lecture – pourtant, tel est le cas de celui-là, que je trouvai, lors de ma première lecture il y a deux ans et d’un certain point de vue, plus « facile » que les précédents***. Entre-temps, j’ai co-organisé un colloque dont Jamal était l’invité d’honneur (“Fantasmes d’Afrique/Fantasizing Africa”, 18 et 19 novembre 2005), j’ai étudié le roman dans le cadre d’un cours de troisième année (en parallèle avec The God of Small Things d’Arundhati Roy), je l’ai relu aussi dans la perspective d’un article de bilan sur mon travail en littérature comparée... bref, ce qui n’aurait pu, comme dans bien des cas, n’être que relecture de circonstance (car, une fois encore, je le relis car je dois intervenir la semaine prochaine à son sujet dans un colloque), s’avère être plus foudroyant, ou plus fascinant que je ne l’aurais pensé.
J’ai découvert l’œuvre de Jamal en 1999, je crois, sur les conseils de son traducteur, qui est aussi un éminent collègue à présent retraité, Jean Sevry. Jean a traduit, avec sa femme, les cinq romans de Mahjoub, sauf le premier, qui a paru aussi chez Actes Sud, pourtant, et le second, à ma connaissance inédit en français (et l’un de mes préférés pourtant : Wings of Dust). Bien ; je m’aperçois que cette phrase est fort mal construite, car il vaudrait mieux dire que Jean a co-traduit les trois derniers romans de Mahjoub ; cela semblerait moins ridicule. Je ne connais pas la traduction de Travelling with Djinns, parue en 2004 sous le titre Là d’où je viens. Pour cette note, il m’a paru préférable de traduire plus littéralement, d’autant que l’image de la hantise (des djinns persans ou nisses danois, créatures qui, comme les soucis, accompagnent le voyageur) est essentielle, et, surtout, plus distinctive, plus originale que le choix du thème des origines. Mais ce doit être là, encore, l’influence de l’éditeur, donc je ne me permettrai pas de critiquer Jean, ni son épouse. Ce sont, d’ailleurs, de très bons traducteurs.
L’an dernier, lors d’un mémorable dîner de fin de colloque à la Rôtisserie tourangelle, Jamal nous avait confié qu’il avait presque achevé le tapuscrit de deux romans, l’un qu’il devait soumettre à son éditeur anglais, l’autre qu’il voulait essayer de faire paraître d’abord en traduction française, afin de profiter du succès de ses livres en France, et d’aiguillonner un peu, justement, son éditeur anglais. A ma connaissance, rien depuis – mais je n’ai pas osé le recontacter par courrier électronique. Peut-être devrais-je.
Travelling with Djinns (dont Livy, qui l’a lu sur mon conseil, a fort bien parlé) est un livre extrêmement émouvant, très bien écrit, souvent drôle ou grinçant, mélancolique et mordant, une forme de bilan en point d’interrogation, et, assurément, le plus autobiographique des romans de Jamal Mahjoub. L’intrigue n’est pas si simple que cela. Le roman raconte le voyage, du Danemark vers l’Espagne, de Yasin, un homme qui approche la quarantaine, avec son fils de sept ans, Leo. Yasin vient d’apprendre que sa femme veut divorcer, et sait qu’il ne verra plus son fils chaque jour. Il décide, à l’improviste, de prendre son fils sous son aile (ou plutôt, dans sa vieille Peugeot 504 déglinguée) et de partir à l’aventure (they hit the road, in a way that is not dissimilar from Kerouac’s On the Road or road movies from the 1970s). Le récit fait alterner la succession des étapes de ce voyage sans but apparent et les réminiscences de Yasin : vie conjugale avec Ellen, discussions avec son beau-père, petite enfance de Leo, voyage à Khartoum pour présenter femme et fils à ses parents, découverte du cancer de sa mère, décès de ses parents à Londres, détérioration de sa relation avec Ellen…
Le voyage n’a pas de but apparent, mais il les conduit toutefois (non sans qu’ils aient passé auparavant plusieurs jours en Provence, chez Dru, l’ex-maîtresse de Yasin, et son compagnon, Lucien) sur la côte méditerranéenne, en Espagne, à la rencontre du frère de Yasin, Muk, que celui-ci avait perdu de vue depuis des années. Le plus étonnant, dans ce roman qui regorge de scènes pathétiques et de situations douloureuses, c’est combien Mahjoub évite de tomber dans le pathos. En ce sens, ce roman est quasiment sans exemple, d’après moi.
De même, Mahjoub n’évite pas (et c’est même l’un des thèmes principaux du roman) les réflexions sur l’origine, sur le déracinement, les identités métisses, la rencontre des cultures européennes et non-européennes, le fanatisme, et le concept si galvaudé (et si ironiquement remis en perspective) de l’Autre (avec un A majuscule). Eh bien, il parvient à proposer un récit qui n’est pas seulement subtil, mais qui est également marqué au coin de la sincérité et du bon sens, sans raccourcis idéologiques ni envasements bien-pensants.
Bref, la grande qualité de cet écrivain, c’est sa justesse : belles phrases qui ne sont jamais gratuites, infinie perspicacité dans le portrait qu’il brosse de ses personnages, choix de détails extrêmement parlants…
* Le correcteur de grammaire refuse les minuit, mais c’est faute je pense de connaître l’expression « sur les minuit », que je ne me verrais, pour autant, pas accorder au pluriel. Bon. Je vérifierai.
** L’autre jour, à la radio : « c’est de cela dont il va être question ». Mais la langue française, enfin, ce n’est pas leur métier ???
*** J’anticipe d’emblée sur les réserves des uns ou des autres. J’ai mis l’adjectif facile entre guillemets, afin de signaler que je n’ai rien contre les œuvres abordables. Ce que je veux dire ici est très différent : le cinquième roman de Mahjoub m’avait semblé, à première lecture, plus conventionnel, plus adapté à un lectorat déjà existant, oui, en un sens, plus démagogique. (Et là encore, le plus ne veut pas dire qu’il m’a semblé, à aucun moment, démagogique. Plus démagogique que les autres romans, oui. Mais voilà tout.)
11:30 Publié dans Lect(o)ures, WAW, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (1)
vendredi, 28 octobre 2005
Mollycoddle 1
Il vient de se passer quelque chose d'extrêmement désagréable: l'ordinateur a égaré une note que j'avais pratiquement fini d'écrire (et qui était fort longue). Sacré PC de Fromont...
Il y était question, en long et en travers, du mot anglais mollycoddle.
Je note ici cette béance, pour reprendre plus tard (dans la journée, si possible) la mise au net de mes considérations.
10:35 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (1)
mercredi, 26 octobre 2005
Aphone you later
Les réveils sont difficiles, douloureux, déchantent. Cette nuit, la toux et les pleurs de mon fils, malade, lui, depuis cinq jours, et je n’ai pas pu me rendormir, secoué de quintes, gorge brûlante. L’aphonie toujours au rendez-vous. Au moins, j’aurai fait rire la secrétaire du département, hier ; elle me disait en plaisantant qu’il avait été décidé que les personnes souffrantes devaient rester chez elle cette année, à cause de la grippe aviaire, et je lui ai rétorqué que, si je n’avais presque plus de voix, cela n’avait tout de même rien à voir avec l’aphone sauvage. (Avec avifaune, le calembour était plus difficile.)
Dans l’après-midi, j’aurais pu souffler à mes groupes d’étudiants que c’était l’après-midi d’un aphone, mais ce genre d’humour littéraire (ou, à la rigueur, musical) ferait, je le crains, un four.
Aujourd’hui, je vais essayer de travailler un peu at home, même si je dois garder A., car ma compagne, coincée ici pendant trois jours entre son père et A. qui doit rester au chaud, va vouloir, je pense, prendre un peu l’air, et je la comprends… De plus, comme je ne suis pas fréquentable, avec mes microbes et mes remuements laryngiques, et comme je dors, depuis trois nuits (aussi afin de ne pas réveiller la maisonnée quand je partais à la fac hier et avant-hier), au rez-de-chaussée, à la salle de jeux, c’est elle qui s’est levée cette nuit pour donner, je pense, un verre d’eau et son médicament à A. Il semble, après presque une heure de toux, s’être rendormi. Incapable de réprimer et de supporter mes quintes, je me suis levé et je pianote. (Failli écrire : « je pinaille »)
08:22 Publié dans Moments de Tours, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 24 octobre 2005
Malédiction
Ce doit être une joyeuse malédiction. M'apprêtant à rendre, à la bibliothèque d'anglais sise au troisième étage de la tour du S.C.D. (Service Commun de Documentation), un volume de The Library of America reprenant les trois premiers romans publiés de Paul Bowles, écrivain dont je n'ai jamais lu une ligne et dont j'avais emprunté ces textes à l'intention de ma mère, qui les a d'ailleurs lus tous trois au cours de l'été, j'ouvre une page presque au hasard (en fait, il s'agit du début de The Spider's House) et, lisant ce prologue, je me sens attrapé, capturé, apprivoisé déjà par les phrases de l'écrivain... et j'aimerais maintenant garder le livre pour le lire. Oui, ce doit être une forme de malédiction, l'épuisant désir de ces choses.
15:50 Publié dans Lect(o)ures, Moments de Tours, WAW, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 23 octobre 2005
Le feu sacré et vide de valeur
Glané dans le journal 1943-45 de Julien Green :
26 avril 1944 – Un critique canadien m’envoie son dernier livre avec une dédicace dans laquelle il affirme que je suis « un des plus grands romanciers de ce temps ». Je feuillette le livre et y trouve un éreintement en règle de Varouna. « Ces pages, dit mon critique, valent le feu. » En traduisant librement, je suppose que cela veut dire que le livre mérite d’être brûlé. (p. 108)
Cette page donne l’envie irrépressible d’aller y voir. La phrase citée n’est pas claire, est tout à fait ambiguë, car que peut bien signifier ce valent ? De fait, s’il n’y avait pas l’“éreintement” dont parle Green, on ne pourrait, en rien, comprendre qu’il s’agit d’un appel à l’autodafé.
15:00 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 20 octobre 2005
Peter Bowler, lexicographomane
Depuis six mois, je fais mes délices infinies de la lecture des trois volumes du dictionnaire de Peter Bowler, dont le prmeier tome s'intitule The Superior Person's Book of Words, et les suivants de même manière, avec adjonction des adjectifs second et third avant l'adjectif superior. Jamais un auteur ne m'a fait autant rire, et avec quel savant dosage!
Je me suis donc mis en quête de quelques pages Web où il serait question de ces ouvrages. J'ai découvert, à cette occasion, qu'un site universitaire en donnait de très larges extraits, au mépris (je pense) des droits d'auteur.
L'excellent site World Wide Words de Michael Quinion, ressource presque inépuisable, propose une recension du troisième tome.
L'un des éditeurs, Bloomsbury, présente le premier tome avec deux sample entries.
Peter Bowler est australien, ce qui se ressent, de manière fort plaisante d'ailleurs, dans le premier tome, et moins dans les deux autres. L'expression "Superior Person", qui sert de fil conducteur et qui repose sur l'idée que l'emploi de mots rares ou inconnus des interlocuteurs met le locuteur en position de force, est une reprise très ironique de certaines formulations victoriennes. Ainsi, dans un roman peu connu, My Flirtations, de Ella Heptworth Dixon (1893), cette expression se retrouve, dans un extrait très savoureux:
Of course there were lots of people, even when he was at Cambridge, who knew nothing of the Deodoriser. But it always hung, like a modern sword of Damocles, over poor Gilbert's head. It made him diffident where he should have been at ease; it made him malicious when it would have been to his social advantage to appear kindly. But even at Cambridge he had given unmistakable signs of being a Superior Person. He could repeat, to a nicety, the shibboleth of Superior People. He knew when to let fall a damaging phrase about the poetical fame of Mr. Lewis Morris, and when to insinuate a paradox about the great and only Stendhal. In art, he generally spoke of Velasquez and Degas; in music, only the tetralogies at Bayreuth were worth discussion.
On peut aussi songer au poème de Francis Bret Harte, Lines to a Portrait, by a Superior Person. C'est aussi le titre de la biographie que Kenneth Rose consacre à George Curzon, qui fut, au tournant du siècle, vice-roi d'Inde. (Le sous-titre de la biographie est très éclairant: "A Portrait of Curzon and His Circle in Late Victorian England".)
Il ne fait aucun doute que Bowler, lexicographe-humoriste australien publié principalement aux Etats-Unis, a choisi cette expression en connaissance de cause: sa trilogie émane d'une conception intentionnellement et hyperboliquement réactionnaire de la langue. Il est souvent, dans son désir de ne pas être politiquement correct, d'une mauvaise foi tout à fait hilarante.
15:40 Publié dans Lect(o)ures, WAW, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (1)
Je pars déjeuner...
... en quatrième vitesse avant l'atelier de traduction d'André Markowicz. Je dois déjeuner avec E*** et F.T., deux collègues que j'apprécie beaucoup. Il y a du remuement au Département d'Anglais.
More on that later...?
13:15 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 18 octobre 2005
Pour Moi Uniquement?
Ce soir, à sept heures, rentrant de l'université où je travaillais d'arrache-craie depuis ce matin à huit heures et demie, j'ai entendu, comme souvent, les résultats des courses de chevaux. Il faut savoir que c'est une de mes manies d'inventer des faux noms de chevaux car je trouve parfaitement ridicule la soi-disant "inventivité" des éleveurs. Ce soir, mon attention a été attirée par les noms suivants: Emily Brontë (c'est pas une honte, de donner un nom de grand écrivain à un canasson dopé?), Bilingue et Money-Box.
Il se trouve que Money Box est le nom de la maison de mes parents, où j'ai passé de merveilleuses années, entre six et seize ans.
Bilingue est l'adjectif employé par un étudiant dans sa fiche en début d'année: "j'aimerais devenir bilingue". (Rêve tendre mais naïf: on ne peut pas devenir bilingue à l'âge adulte. On peut s'aguerrir, acquérir une grande compétence, même exceller dans une langue étrangère, mais bilingue, cela se décide très tôt, dès la petite enfance. Le nombre de personnes qui sont choquées si on leur dit que, professeur d'anglais, à l'université de surcroît, on n'est pas bilingue... C'est que, pour la majorité des Français, le mot "bilingue" est employé comme un équivalent vague de "très bon dans une langue étrangère", alors que cela n'a, en fait, rien à voir.)
Enfin, ce soir, les résultats du P.M.U. semblaient avoir été annoncés pour moi uniquement.
22:00 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 16 octobre 2005
Tout ou partie
Dimanche, onze heures vingt.
Toutefois, pour être aussi complet que possible, je dirai aussi que, lisant le premier (fort bref et d’une beauté époustouflante) chapitre, je pensais :
aux rapports entre ce texte et L’Âge d’homme
à ma lecture, il y a un an et demi, de Kotik Létaïev de Biély
à mes longs et oiseux développements du mois dernier à propos de la phrase « Je rêvais corne de taureau »
au rapport entre le suspens offert par la première phrase, toute en méandres et parenthèses, et la phrase faulknérienne, telle que, notamment, nous avons pu l’explorer mardi dernier dans un cours d’analyse de textes littéraires
au sujet de composition philosophique auquel j’ai consacré une note plus tôt ce matin, pendant que mon fils lisait seul, assis sur le canapé, un album de Où est Charlie? (Where’s Waldo? en anglais)
à tant d’autres choses encore, dont ce texte si bref appelle la pesée (le clavier m’échappant, j’écris pesée au lieu de pensée et je laisse cette coquille, ce lapsus significatif)
à l’écriture même de cette note, dans ce mouvement si habituel qui consiste, lisant une œuvre inspirante, à vouloir l’abandonner, à regret mais irrépressiblement.
19:25 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
Le langage est-il le déguisement de la pensée?
N.B.: Une précédente version de cette note a été publiée plus tôt dans la journée, avec une horrible coquille dans le titre (elle au lieu de il (j'avais d'abord écrit langue au lieu de langage et je n'ai pas harmonisé...)). Que Tinou, qui a attiré mon attention sur cette erreur imbécile, mais dont le commentaire a, du coup, disparu, soit vivement remerciée de sa remarque.
********
Ce très beau sujet de philosophie, donné en composition par un professeur (une professeure ? (voilà justement une alternative qui masque bel et bien une idéologie)) de Sainte-Ursule, n’est pas seulement une variation sur le dualisme langage/pensée. C’est aussi une réflexion sur la damnation, sur la chute de l’âme conçue comme immortelle dans un corps fugace et voué à disparaître. Il faudrait sans doute voir du côté de Platon et Descartes, et certainement chez certains théologiens, car, d’autre part, « le Verbe s’est fait chair ».
Cette déchéance de l’expression par rapport à la conception intellectuelle, de la réalité corporelle par rapport à l’âme, est assez bien résumée dans une belle formule du Journal de Julien Green : « La pensée vole et les mots vont à pied. Voilà tout le drame de l’écrivain. » (4 mai 1943).
Ce n’est qu’un aspect de la question. Il y a aussi le déguisement, bien sûr, troisième terme à ne pas négliger, charnière centrale de l’énoncé et lien entre les deux concepts. Cette métaphore du déguisement appelle une personnification implicite des deux instances (langue et pensée), une sorte d’allégorie dans le style des formules rabâchées comme la vérité toute nue. Dans déguisement, il y a bien sûr la guise, c’est-à-dire « ce qui tient lieu de » (en anglais, in the guise of signifie « sous les traits de »). Le Robert historique nous apprend que guise vient du germanique wisa qu signifiait « manière, façon ». Le déguisement est, à cette aune, un maniérisme, une manière, un style : répondre oui à la question posée dans le sujet revient à formuler implicitement une supériorité de la pensée sur le langage, ou, à tout le moins, que la pensée précède toujours la mise en mots, que le langage est une pure expression, une mise en forme du sens (une traduction?).
Bien entendu, cela va à l’encontre de la plupart des philosophies du langage, qui postulent au contraire que c’est la mise en forme par le langage qui conditionne le sens. Il suffirait pour cela de reprendre certains exemples de Benveniste (je pense au célèbre exemple des couleurs de l’arc-en-ciel), mais sinon, on peut s’attaquer à Wittgenstein ou à L’écriture et la différence de Derrida ! (En terminale, j’en doute, quand même…)
Je me permets de divaguer sans structure (Marione, you know that you’re not allowed that, don’t you?), et cela me fait penser, par libre association, au très beau poème d’Aragon « Tous ceux qui parlent des merveilles… », joliment mis en musique par Ferrat sous le titre (justement) des Oiseaux déguisés. Ce poème, me semble-t-il, reprend le mythe de l’artiste aux dons supra-humains, dont l’essence est éternelle, et qui a l’allure d’un homme ordinaire : “ce sont des oiseaux déguisés”.
Enfin, autre piste possible, le déguisement est une dissimulation : si la pensée est condamnée à échouer, à déchoir dans le langage, si sa pureté abstraite se ternit au contact de l’accoutrement des mots, il y a le risque, selon l’expression familière, que « les mots trahissent la pensée ». En déguisant, le langage dérobe, pervertit le sens, trahit. Ce serait ma suggestion pour une troisième partie : justement, cette hypothèse rejoint celle des philosophies du langage, car c’est toujours la langue, évidemment, qui a le dernier mot, et la pensée ne peut se concevoir hors des mots. Déguisement, peut-être, mais déguisement inévitable… Toutes les tentatives littéraires qui ont consisté à remonter à la pensée, à la manière dont les pensées se forment et s’élaborent dans le cerveau, in petto, dans le for intérieur, se sont justement traduites en mots ; je pense au stream of consciousness de Virginia Woolf, qui passe par le monologue intérieur – ou encore aux écrits de Nathalie Sarraute (le si beau et si drôle Ouvrez!, par exemple), ou le torrent de mots de Lobo Antunes.
Mais voilà : la philosophie n’est pas la littérature. Et les exemples que je viens de donner, outre qu’ils démontrent le peu de souvenirs que j’ai de mes lectures philosophiques, posent aussi la question du style des philosophes. Si la pensée se travestit dans les mots, comment accéder aux Idées par le langage? Comment un philosophe peut-il écrire sans s’abaisser? Il me semble que l’on en revient à Platon, et, à l’oppose du spectre, à Nietzsche, pour qui le formalisme de l’expression philologique, puis poétique, est au cœur de la question du savoir.
17:18 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (7)
Malsomnie
Dimanche, huit heures et demie.
Il faudrait inventer un autre mot qu’insomnie pour une nuit comme celle qui vient d’avoir lieu. Ayant du mal à m’endormir, et me souvenant surtout que je n’avais toujours pas mis en ligne, dans mon carnet Cours 2005, de note concernant l’hétéroglossie (ou le bivocalisme, ou le polylinguisme, depending on the translations from Russian into French), je me suis relevé, ai passé une demi-heure à faire le point, à publier la note en question. Il était minuit passé, et, trop nerveux pour me recoucher immédiatement sans lire de nouveau, je me suis installé dans la buanderie attenante à la chambre de mon fils, ai passé presque une heure à lire le Journal absurde de Harry Laus, puis m’y suis allongé. J’ai mis du temps à m’endormir, et, à trois heures et quart, ai été réveillé par la lumière sur le palier, ma compagne qui se levait, réveillée elle-même par le plic ploc du robinet mal fermé à la cuisine, qui s’égouttait dans une tasse placée au-dessous. Après avoir réglé son compte au bruyant fuyard, je me suis repieuté, cette fois-ci dans le lit conjugal, où j’ai mis un temps infini à me rendormir, pour être éveillé par mon fils, qu, à sept heures moins le quart, avait le nez bouché et n’arrivait pas à respirer. Lui s’est rendormi, mais pas moi, évidemment.
(Pour ne pas accabler ce pauvre enfant, et à titre statistique, c’est la deuxième fois qu’il nous réveille depuis notre retour à Tours, il y a bientôt deux mois, et encore ne peut-on pas parler d’un réveil en pleine nuit… (Quand je pense qu’au même âge, je me réveillais toutes les nuits, parfois deux fois par nuit, taraudé par d’atroces cauchemars, oui, toutes les nuits sans exception dixit ma mère, de trois à six ans, sans faute, dixit ma mère, jusqu’à notre emménagement à Cagnotte, à la campagne (jusque-là, nous vivions dans une petite maison au bord de la route de Bordeaux, à Saint-Paul lès Dax), aussi ne puis-je me plaindre des fort rares éveils nocturnes de mon fils, tout de même…)) (La phrase de la seconde parenthèse, celle qui commence par « Quand je pense… », n’a pas de verbe principal, ou plutôt il y a une rupture de construction (asyndète) avec la seconde partie (apodose), qui, commençant par « aussi ne puis-je », ne correspond en rien à la première (protase).)
Ayant réussi à écrire un long paragraphe exclusivement composé de parenthèses, je poursuis mon sillon, et mon propos initial, qui était de dire qu’il faudrait parler, en anglais, d’illsomnia plutôt que d’insomnia, ou de restlessness en un sens nouveau, plutôt que de sleeplessness. Et, en français, de malsomnie, de “mauvais sommeil”…?
Ce qui me fait penser que, donnant, jeudi dernier, à André Markowicz la liasse des textes que j’ai soumis à la sagacité de mes étudiants du cours d’analyse de textes littéraires (il doit intervenir lors de la dernière séance du semestre et proposera un travail autour dela traduction d’un de ces textes), il a « tiqué » (favorablement, me semble-t-il) en voyant le très beau poème de Tatamkhulu Afrika, Insomnia, que je dois étudier en semaine 5, soit, précisément, le mardi 25 octobre. Il se trouve que j’avais choisi ce texte longtemps avant la note de Livy relative à l’insomnie, et longtemps aussi avant la mince torrentielle prose publiée dans ce carnétoile et intitulée L’insomnie étend. André Markowicz a « tiqué » car il ne connaît pas Tatamkhulu Afrika (who does, indeed?), et j’ai le secret espoir, s’il aime ce poème, qu’il le choisisse, car il est extrêmement difficile et j’aimerais confronter mes vues aux siennes, en l’espèce.
11:55 Publié dans Moments de Tours, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (4)
lundi, 10 octobre 2005
Le néologisme du jour: s'autorétrolier
Suivez, je vous en prie, mon raisonnement. Peut-être avez-vous remarqué que certains hébergeurs de blogs, plus soucieux de trouver des équivalents au franglais que mon cher hôte Haut & Fort, proposaient de traduire trackbacks par rétroliens, ce que je trouve très astucieux. Eh bien, ce matin, écrivant la première note de mon nouveau carnet de toile, I have, without being aware of it, trackbacked myself, or done a self-trackback, ce qui n'est possible que dans le cas d'un auteur possédant plusieurs blogs, et que je propose de traduire par "s'autorétrolier". Comme il s'agissait de la première note, qui s'intitule Lancement, et comme je viens de me renvoyer la balle dans le lien situé au début de la phrase que vous lisez en ce moment même, comment appeler ceci? Un rétr-autolien? Un autorétrolien double? Un rétrolien au cube? Les mots me manquent.
Enfin, bref, sachez que, ce vertigineux petit jeu mis à part, je vous invite à consulter, dans un futur proche, mon nouveau site, où figurera bientôt le premier chapitre d'Avril déjà dérape, grand roman interactif promis à une merveilleuse destinée littéraire.
13:25 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 08 octobre 2005
Caractères spéciaux
Dans une note que je viens d’écrire, j’ai voulu, pour écrire une phrase en portugais (langue que je ne parle ni ne comprends, mais que je peux lire un peu et surtout que je sais prononcer (ce qui est très important pour la poésie)), recourir aux caractères spéciaux de Word, et n’y ai trouvé le u accent aigu (ú) qu’avec peine, alors que j’ai tout de même la possibilité d’insérer les bestiaux suivants :
û
ü
ũ
ū
ŭ
ů
ű
ų
ư
ǔ
ǖ
ǘ
ǚ
ǜ
En écoute : « Lulu » (Pierre-Stéphane Michel, album Bayahibe)
(Ce n’est pas Lülû ni Lůlű ni Lũlǖ…)
16:00 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
Midi pile, ou presque...
Une matinée bien studieuse, pour ma compagne aussi, pensais-je, mais je vois qu'elle a pris le temps de m'expliquer par écrit une règle de grammaire que j'eusse dû savoir. Toutefois, le doute a surgi en raison d'un revirement final provoqué par mon amour de l'euphonie (oui, VS, that is the question).
12:08 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (1)
vendredi, 07 octobre 2005
Fous de librairie, I
Vendredi, 15 h 50
Hier matin, entre l’instant où je commandai, sur l’un des postes informatiques prévus à cet effet dans le magasin de photos spécialisé dans les tirages numériques de la rue des Halles (waooow, Flau-bert…!*), des tirages à partir de ma clé USB, et le moment où je pouvais récupérer les dits tirages, je suis allé faire un tour (onéreux) à l’excellentissime libraire de la place du Grand Marché, Le Livre. Je me suis retrouvé à discuter avec les deux libraires, pourtant occupés, et, brandissant sans m’en apercevoir le dernier livre de Savitzkaya que j’étais venu y chercher (il s’intitule Fou trop poli), je les écoutai me raconter deux histoires de clients fous. Elles (les histoires) suivent. (Et, pour l’anecdote, j’ai lu hier soir, quoique fourbu, le Savitzkaya.)
* Doit se retrourner** dans sa tombe : that’s the gist of the parenthesis.
** Chouette lapsus de clavier : retrourner… Jarry eût adoré!
19:20 Publié dans Lect(o)ures, Moments de Tours, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (1)