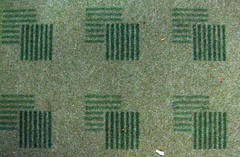mercredi, 30 novembre 2011
3011 / Galet (traduit du turc)
 Tandis que je pense à toi, en moi un galet se réchauffe, et un oiseau se pose au rebord de mon cœur.
Tandis que je pense à toi, en moi un galet se réchauffe, et un oiseau se pose au rebord de mon cœur.
Un coquelicot soudain fleurit, un coquelicot saigne, subtil coquelicot.
Tandis qu’à toi je pense, et m’interroge, un prunier se redresse et commence à tourner, pareil à un derviche.
En en tournant sur lui-même, il se délie, il se dénoue, il se défait. Il diminue, rapetisse, et sa sève encore laiteuse devient une prune d’un bleu si noir
Que le bleu de la prune à chaque fois me brûle les lèvres.
Tandis que je pense à toi, en moi un galet se réchauffe.
(Oui, c'est un poème de Bedri Rahmi Eyüboğlu que j'ai traduit, avec toute une fournée d'autres textes tous plus beaux les uns que les autres. Oui, je deviens fou à ne plus savoir qui m'écrit. J'attends la nuit. A street in Constantinople is a picture which one ought to see once—not oftener. L'année va être plus folle et plus longue que toutes les autres. J'ai trouvé les messages de la narratrice, mais pas dans les couloirs de la National Gallery. En fait, à Istanbul. Et il y avait ce tableau du peintre et poète turc aussi. Je deviens fou.)
22:40 Publié dans BoozArtz, Une année de 398 jours | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 29 novembre 2011
Lost in the Sound (Chill Bump)
Les Tourangeaux s'amuseront à identifier les différents lieux de tournage. (Il m'en manque pour un ou deux plans.)
14:56 Publié dans Autres gammes, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)
2911 / « Toucher du doigt le paradis »
Nous cherchons des pistes aussi dans la littérature. Je relis Wittgenstein’s Mistress ; la narratrice a quelques fulgurances qui en disent long sur la situation qui est la nôtre. Mieux que Vivaldi, je me suis aperçu que ce sont les Symphonies de Schnittke qui se prêtent le mieux à cette (re)lecture.
Un adolescent, qui se prénomme Anicet et qui vit du côté de Saint-Samson ou de Saint-Pair, dans le Calvados – je crois qu’il a une maison dans chacun de ces deux villages, peut-être du fait de parents divorcés ? –, m’écrit souvent pour me demander des détails sur Narayan Apte, dont je ne parviens pas – quoique cette information soit devenue aussi importante pour moi que pour le pauvre Anicet – à déterminer le rôle précis dans l’assassinat du Mahatma. Paix des pâtis semés d'animaux…
Je tiens à préciser que j’ai mis très longtemps à m’apercevoir que Numance était certainement un pseudonyme, et qu’il s’agissait aussi du nom d’un des personnages de ce très beau roman de Giono dont le titre m’échappe. Le jour où la coïncidence (en est-ce bien une ?) m’a frappé, j’ai écouté, en boucle, le quatuor à cordes de Frederick May dans la version du Aeolian Quartet.
09:21 Publié dans Une année de 398 jours | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 28 novembre 2011
2811 / Après octane
Hier, par exemple, pour le 8ème jour (que l’on appelle octane), nous avons fait, mes parents et moi, toute une promenade le long de la côte Atlantique, de port en port, de dune en dune, de village de pêcheurs en village de pêcheurs, ce avec, pour tout carburant, à peine quelques kilos de feuilles de troène pourries. Pourtant, le troène n’est pas ce qu’il y a de mieux. Et ma mère, qui prétend tenir un compte précis selon l’ancien calendrier, disait que ce jour d’octane coïncidait avec un dimanche. There she stood, trying to soothe herself with the scent of flowers and the fading, beautiful evening. Dans une crique, nous avons pique-niqué. Il faisait beau. Nous étions heureux. Aujourd’hui, malheureusement, il a fallu reprendre le collier – expression qui me rappelle notre voisin septuagénaire, Claude, récitant quasiment sans erreur les vingt premiers vers du Chien et le loup. Et aujourd’hui, malheureusement, le vin de Chinon était froid dans la bouteille, au point que j’ai failli le renvoyer en cuisine, mais bon, j’étais trop absorbé par la conversation, qui tournait autour de l’apprentissage du français par les Russes et la poésie russe (et l’absurdité de l’apprentissage systématique d’une langue étrangère par le biais de la littérature). Le temps passe, il faut s’y remettre.
09:22 Publié dans Une année de 398 jours | Lien permanent | Commentaires (2)
dimanche, 27 novembre 2011
Ballard et les Eglogues ?
Samedi dernier, lors du colloque international « Blowing Up the Sixties » organisé à Tours par mon excellente collègue Molly O’Brien, j’ai écouté, avec un intérêt sans cesse grandissant, une communication consacrée au roman composite de J.G. Ballard, The Atrocity Exhibition, qui date de 1969. L’intervenante était une doctorante québécoise de Montréal, Vicky Pelletier, qui a – entre autres mérites de son travail – fait circuler un exemplaire papier de la version publiée vingt ans après la première publication (cette édition comporte de nombreux annotations et ajouts, de J.G. Ballard lui-même). L’univers et le style de Ballard (que je ne connais que par ouï-dire, de nom, et aussi à travers le film de Cronenberg (Crash)) ne m’attirent guère, mais je dois reconnaître que ce que j’en ai entrevu à cette occasion donne plutôt, et ce malgré le bric-à-brac « transgressif » assez dérangeant, envie de s’y plonger.
En l’occurrence, ce qui m’a le plus frappé, sur le coup, ce sont les nombreux parallèles scripturaires et sémiotiques que l’on peut déceler avec les Eglogues de Renaud Camus, en particulier avec Travers (dont le quatrième et dernier tome devait paraître ce mois, publication repoussée au petit printemps). Je manque affreusement de temps pour approfondir tout cela, et j’attendrai d’avoir enfin reçu (puis lu) un exemplaire du classique de Ballard avant de proposer des pistes plus fournies. Dans l’immédiat, je me contenterai de noter, sans commentaires, ce que j’ai glané vite fait sur le Web. En effet, contrairement à ce que je pensais en écoutant la communication de Vicky Pelletier, le fait que le roman de Ballard puisse être l’une des sources explicites les plus agissantes de Travers n’a fait l’objet d’aucune remarque, ni sur le site Web de la Société des Lecteurs de Renaud Camus, ni (et c’est plus étonnant), sur le site exceptionnellement dense et fouillé de Valérie Scigala, la meilleure exégète des Eglogues. Il n’y a pas d’occurrence du patronyme Ballard sur le site personnel de Renaud Camus, à l’exception d’un paragraphe des Vaisseaux brûlés qui évoque un (assez énigmatique, dois-je avouer) John-Richard Ballard.
Entre autres ramifications, le titre de Robbe-Grillet, Projet pour une révolution à New-York (qui joue un rôle dans le premier tome, Travers), provient sans doute du titre de l’un des chapitres du roman de Ballard, « Plan for the Assassination of Jacqueline Kennedy », d’autant que ce fragment avait été publié en revue dès 1966.
Voici donc quelques copiés-collés, pour lancer la machine :
The character about which these figures play (he could hardly be called the protagonist) is variously named Travis, Talbot, Traven, Tallis, Trabert, Talbert, Travers, etc. The haziness of his characterization, the blurred outlines of his figure, amount to a radical critique of the very notion of character, so central to the realist novel, as a unified, autonomous being. (Source : The Electronic Labyrinth)
Travers looked up from the collection of objects and documents. The chief prison psychiatrist’s gaze was abstracted, as if his mind were turning inward as some kind of defence against the delusions of his patients.
“And you’re telling me that this collection constitutes some sort of time machine?”
“Not in the conventional sense.”
Travers slapped him.
(Extrait de The Atrocity Exhibition, trouvé ici)
La Foire aux atrocités, traduction française de François Rivière, est paru en 2003 aux éditions Tristram. (Or, le signifiant Tristan et Tristram Shandy sont des références-phares dans les Eglogues.)
15:22 Publié dans Corps, elle absente, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (2)
Plagiat ?
Marisol Touraine se dit « sereine » après les déclarations plutôt musclées de Claude Roiron, l’ex-présidente, sur le conseil général.
(Tours.maville, 22 juin 2011)
00:05 Publié dans Aphorismes (Ex-exabrupto) | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 26 novembre 2011
2611 / Sans acolytes ?
 Au septième jour, ce fut Delphine. Jamais le brouillard ne s’est vraiment levé, les nuages gris sont restés à quelques dizaines de mètres peut-être au-dessus de nos têtes, ni protecteurs (pourtant) ni nourriciers. It is a settled fact that man naturally chews his food.Le retour de la place René-Coty, avant dix heures pourtant, a pris près d’un quart d’heure, fichus travaux du tramway.
Au septième jour, ce fut Delphine. Jamais le brouillard ne s’est vraiment levé, les nuages gris sont restés à quelques dizaines de mètres peut-être au-dessus de nos têtes, ni protecteurs (pourtant) ni nourriciers. It is a settled fact that man naturally chews his food.Le retour de la place René-Coty, avant dix heures pourtant, a pris près d’un quart d’heure, fichus travaux du tramway.
C’est dans une telle atmosphère, deux jours après avoir interrogé Marc sur ce que devenait Zeno Bianu, que j’ai fini de lire le Don Juan de Peter Handke, et commencé Le théorème du Surmâle. Il y a des conflagrations frappantes ; celle-là n’était pas mal. Il y a, entre autres, le rapport entre la substance jouissive selon Lacan, la puissance, et l’évidence des déplacements dans le texte de Handke.
Il a bien fallu, aussi, répondre à Manuel. J’avais été, de prime abord, tenté, de lui balancer brutalement un mail très bref, avec une vanne à deux balles (genre : « Sorry, the Siksika make me sick »), mais je n’en ai pas eu le courage, et puis, est-ce que je connais l’état psychologique de ce congénère éloigné ? Et déjà, tiens tiens, un peu de duvet était revenu sur le crâne du malade du cancer.
Donc, j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai pondu quelques paragraphes un peu improvisés sur les relations entre les maires de Minneapolis au dix-neuvième siècle (singulièrement le crypto-mafieux Albert Alonzo Ames) et l’œuvre obscure, ou plutôt oubliée, de Wallace Wattles. Curieusement, c’est le seul roman de cet écrivain, Hellfire Harrison, que lisait le mobster pendant ses démêlés judiciaires ; son biographe est formel, alors qu’on aurait pu s’attendre à ce qu’il lise l’opus magnum, The Science of Being Well. (Ici, le narrateur commet un anachronisme assez flagrant, qui a dû dérouter Manuel, à moins que ce dernier ait su déjà depuis longtemps que les digressions de son correspondant n’avaient aucune espèce de fiabilité.) Après avoir écrit cet assez long mail, non sans l’enregistrer régulièrement de peur de perdre les précieux paragraphes, je suis allé me recoucher, en lisant, toujours, l’essai de Paul Audi.
Auf der Straße neben dem Wagen aber stand Abel Hradscheck selbst. On a du mal à comprendre comment, sans acolytes, les homes de cette époque maudite ont pu survivre. Regardaient-ils avec joie le ciel bas et lourd ? Se délectaient-ils, tout simplement, des lamentations si posées et émouvantes d’un Du Bellay ? Derrière moi, dans la file d’attente qui s’allongeait devant la porte encore fermée de la salle de classe, se trouvait celui que nous surnommons Joachim Beylet. Avec des gens comme ça, pas d’acolytes, de confrérie imaginable – autant se flinguer illico. On a du mal à comprendre comment survivre. Pour lui, Numance dans l’Illinois et Manuel je ne sais plus où (en Italie, je crois), était-ce tout ?
22:16 Publié dans Une année de 398 jours | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 25 novembre 2011
2511 / Aubade
Voici donc, après avoir sué sang et eau, ma traduction d'un poème d'Eugeniusz Żytomirski :
AUBADE
Vous vous levez avant le coq
tout de même s'il chante avant trois heures vingt - :
Votre train prend le large
Un peuplier féroce se dresse au loin, là-bas
et votre train déraille, en pensée, seulement
Ce n'est pas vous qui chantez
Vous ne vous levez plus avant le chant du coq
Viendra, malgré la brume
et malgré l'océan (qu'on n'entend pas gémir,
Les forêts sont
profondes), un temps pour tout,
pour rien,
pour le coq et l'oiseau
Le charbon et le train.
20:50 Publié dans Une année de 398 jours | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 24 novembre 2011
2411 / S’inventer des racines / 2445
En fait, non. Nous ne sommes qu’une poignée de survivants. Nous sommes enfermés. Nous n’osons pas sortir. Je n’arrête pas de relire Wittgenstein’s Mistress et Ryoko Sekiguchi. Manuel me harcèle à son tour. Heureusement que nous avons des acolytes, quelque part, sans quoi je deviendrais fou.
Je noue des liens, ou alors nous gelons sur pied. Sous la présidence de Zaldua, la Colombie s’est inventé des racines. Tentative similaire, ici.
21:45 Publié dans Une année de 398 jours | Lien permanent | Commentaires (0)
Capes externe d'anglais 2012 : Version (A.S. Byatt)
11:04 Publié dans WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 23 novembre 2011
2311 / Imposture
Depuis que nous avons mis au point le système révolutionnaire qui permet de produire une énergie entièrement non polluante – puisqu'il n'y a ni rejet ni dépôts usagés – à partir de la matière végétale en putréfaction, le monde a rajeuni, se régénère, ne cesse de voir se résorber les vieilles tensions, les conflits, les douleurs. Il aura fallu des décennies pour vaincre les puissants lobbys conjugués de l'énergie atomique et du pétrole, mais la ténacité d'un petit groupe de chercheurs français, italiens et japonais aura fini par payer. Lors de la dernière mise au point du processus LeafPower™, nous avons obtenu l'équivalent énergétique de 100 KW, à partir de la putréfaction accélérée d'un kilogramme de feuilles de néflier.
On s'est aperçu que la feuille de néflier avait le taux de G.E.P. (générativité énergétique potentielle) le plus élevé. C'est un homme de trente-sept ans qui se promenait en ville avec son fils, un dimanche d'octobre, qui nous a soufflé l'idée de la putréfaction végétale. Si cette légende, comme toute légende, est globalement juste, elle néglige plusieurs éléments sur lesquels il faudra un jour revenir en détail. Nous lui avons élevé des statues. Tous les dépôts de carburant portent, pour sigle commun, le dessin stylisé de son profil, désormais reconnu de tous. Pourtant, il n'a rien trouvé, rien inventé, rien mis au point.
Il avait seulement acheté un pavillon, avec deux cognassiers, deux néfliers, et, non loin, un square arboré.
Imposture.
14:11 Publié dans Une année de 398 jours | Lien permanent | Commentaires (0)
Madrague
Sont-ce des jours ou des années ?
Ils passent en maugréant près de la remorque peinturlurée, recouverte d'inscriptions et des mots drogues et information dans divers coloris et diverses polices. Elle n'est pas peinturlurée, mais elle enlaidit le paysage, la vue sur le pont Wilson, avec le large épicéa, du coup comme tronqué, ou castré. De telles images, pour un conifère ! Toujours est-il que la remorque aux lettres bleues et vertes enlaidit bel et bien le paysage. La seule drogue, c'est la drague. Ils passent tout de même en maugréant.
 Bernard n'a plus dit mot depuis qu'il a été rabroué. Denis ne parvient pas à décider s'il faut un ou deux r à "carriole". Il fallait que ce soit dit, et même si l'histoire de la musique n'en sort pas grandie, mais Yvonne Loriod était un tromblon ! Bernard n'a plus dit mot, mais il regarde, lui aussi, la remorque, avant de tourner les yeux de l'autre côté, vers le haut de la rue Nationale, où l'on voit trois jeunes filles, de vert forêt vêtues, sortir d'un bar-tabac, et l'on peut imaginer que l'une d'elles vient de faire valider le ticket qui lui rapportera des dizaines de millions à la loterie.
Bernard n'a plus dit mot depuis qu'il a été rabroué. Denis ne parvient pas à décider s'il faut un ou deux r à "carriole". Il fallait que ce soit dit, et même si l'histoire de la musique n'en sort pas grandie, mais Yvonne Loriod était un tromblon ! Bernard n'a plus dit mot, mais il regarde, lui aussi, la remorque, avant de tourner les yeux de l'autre côté, vers le haut de la rue Nationale, où l'on voit trois jeunes filles, de vert forêt vêtues, sortir d'un bar-tabac, et l'on peut imaginer que l'une d'elles vient de faire valider le ticket qui lui rapportera des dizaines de millions à la loterie.
On ne trouve, dans son oeuvre, à aucun moment, le mot "gourdes", pas même au singulier. Pourtant, Denis a dégainé sa gourde et la tend, sans mot dire, à ses compagnons. Bernard ne voit rien, il mate les trois jeunes filles vert forêt. Il fait frisquet, ce matin de janvier novembre, un vent froid glace les joues déshabituées de la bise au point de suggérer le concept biscornu, amalgamé, de discohérence. (Tout comme sur la remorque du camion d'information sur les drogues, il faudrait ici tout un jeu de polices et de coloris, mais je n'écris ces mots qu'avec un vieux stylo plume noir de marque Rilck F.) Alors, en matant les jeunes filles, surtout celle de droite, la moins élancée et la plus jolie, Bernard se souvient d'autres lettres, dans un parc, et des escapades en varappe du côté de Sils Maria. ![]() Grand bien vous fasse ! Denis s'est lassé de tendre sa gourde ; il boit une gorgée, la remet dans son bissac. Il fait frisquet, ce matin de
Grand bien vous fasse ! Denis s'est lassé de tendre sa gourde ; il boit une gorgée, la remet dans son bissac. Il fait frisquet, ce matin de janvier novembre, un vent froid. Un camion, posé là, poursuit ses activités secrètes jusque sur les bords de Loire. On est dans la ville des Parques, alors Florent a dû se résoudre à me téléphoner pour discuter avec moi des problèmes afférents aux enseignements d'espagnol et aux responsabilités pédagogiques dans la filière L.E.A. Vous avouerai-je que je repense souvent à cette seule fois où nous nous sommes promenés dans ce parc, avec ses grandes lettres, son triple zozo, etc. ? Vous avouerai-je que, depuis facilement seize ans, je n'avais jamais repensé à cette Liza ? Même à l'époque où (la jeune fille la moins élancée, la plus jolie, s'éloigne de ses deux camarades pour aller poser une enveloppe dans la boîte à lettres située près du manège) je faisais, plusieurs fois par semaine, le trajet en train du côté de Chambly et de Laboissière Le Déluge, jamais je n'ai songé à Liza, ni d'ailleurs relié son nom aux pièces de circonstance de Mallarmé. D'après moi, c'est à fond de cale. Cette année-là aussi, à Montpellier, chez Gilles, j'ai découvert les thielles sétoises. D'après moi, c'est à fond de cale. On peut écrire aussi sans h, mais ça ne te donne pas l'orthographe de "carriole", d'autant que, dans cette encre noire où les ouvriers allemands jetaient, à grands crachats, leur salive mêlée de bière, mon stylo plume de marque Rilck F se noie. Il n'y a pas de rature après criticature. D'après moi, c'est à fond de cale. Bernard, séduit par la démarche svelte de la jeune fille la moins élancée, en oublie de maugréer, quoi que l'on aperçoive, au loin, péniblement, le moderne monastère.
Denis s'agace, gourde rangée dans le bissac. Aristocratie des mains calleuses. C'est un couvent. Telles images. (Plus tard, bien plus tard, après un séjour dans un petit village du Poitou, il a dégotté -- chez une bouquiniste de Poitiers dont le gros chien, bâtard d'épagneul et de labrador très bravoulasse, lui fit fête, près du vieux bureau puant et encombré encore d'autres livres où se trouvait la "caisse" -- plusieurs livres, dont certains abîmés mais fort rares et qu'il désirait lire, et en particulier ce volume mythique et épuisé dont il avait lu de nombreux fragments épars sur le Web mais qu'il ne possédait pas et qu'il lut, d'une traite, avec tous ses embranchements, en moins de vingt-quatre heures, tout en jouant les femmes de ménage et les garde-malade.) Près de l'épicéa dont la remorque du camion chargé de l'information sur les drogues castre la vue (de telles images pour un conifère !), Christelle aura pu envisager, brièvement, de décrire avec minutie le village, et son séjour de quelques années là-bas.
Sont-ce des jours ou des années ?
(De la main de l'annotatrice : on ne trouve, dans tout le texte, ni le mot minutie, ni le mot épicéa, ni le mot castre.)
Il faudrait aussi, pense Christelle en admirant le regard, finalement assez peu reluqueur, dont Bernard entoure la jeune fille vêtue de vert forêt (de telles images !), ne faire de rien métaphore ou allégorie. C'est un projet colossal, qui demanderait moins de relâchement. Mais qu'est-ce qu'un lion paterne ? Ecrire de manière à éviter toute envolée vers l'allégorie, ce serait un projet colossal. Mais qu'est-ce qu'un lion paterne ? Mais qu'est-ce qu'un lion paterne ? Aucune métaphore, aucune ouverture vers l'allégorie ?!? N'a-t-elle pas été choquée, aussi, lorsque, s'étant interrogée à voix haute sur ce procédé qui consiste à employer un nom propre comme un nom commun et dont le nom persiste à lui échapper, ou à ne pas lui revenir, Guy lui a répliqué, assez brutalement (ce qui n'est pas dans ses habitudes), que cela relevait de la métonymie, et qu'en fin de compte tous les procédés relevaient de la métonymie ou de la métaphore, du syntagme ou du paradigme, donc qu'on se foutait à peu près du nom exact d'une telle figure de style. La poubelle est près du frigidaire. N'a-t-elle pas été, plus que choquée, blessée ?
Et puis, pourrait-on rétorquer au rétorqueur, à ce Guy qui a parfois été nommé Diadème dans ces pages, bien des figures de style, notamment de rhétorique, n'ont de rapport ni avec la métonymie, ni avec la métaphore. Nous avons blasphémé Jésus, la poubelle est près du frigidaire. Bien des figures de rhétorique n'ont pas de rapport avec la métaphore ou la métonymie. Que dire de la paronomase, de l'antimétathèse, de l'antanaclase ou de l'anadiplose ? De l'anadiplose, hein ??!? Nous n'allons pas toujours faire les singes, à faire des signes...
Sont-ce des jours  ou des années ?
ou des années ?
Passons à autre chose, vu que nous sommes obnubilés par les drogues, par cette remorque défigurante, et par les antimétathèses, qui pullulent. Et nous ne sommes pas allés jusqu'au parc national de Stone Mountain. Personne n'était high. Passons à autre chose, pense Christelle, qui ne se rappelle toujours pas le nom de cette figure de style (le vieux crésus ouvrit le frigidaire, dont il jeta l'intégralité du contenu dans la poubelle voisine), et par exemple, pourquoi ne pas souligner maintenant combien il est pénible que ni Ricardou ni les oulipiens n'aient vraiment conceptualisé la part de la fortuité, du hasard, dans les dispositifs textuels les plus complexes. Or ce nombre est comme par hasard le numéro du département dont il est ici question. La pensée de Christelle suit alors des chemins pleins de ronces, tandis que ses pas l'éloignent, par les platanes, de Tours. Bernard la rattrape avant La Riche. Il n'a pas soixante ans. Or ce nombre est comme par hasard le numéro du département dont il est ici question. Il n'a pas soixante ans. Il va bon train, parfois Christelle peine à le suivre. Il jacte sans cesse à présent, recommande encore une fois les mises en scène de Gilles Bouillon. C'est un peu gros. Il va à vive allure, marche très vite le long de la Loire (qui n'a jamais été aussi basse). Il va à vive allure.
« Mon TGV avait 6-7 mn de retard mais j'ai pu attraper le TER quand même. » Personne, à ce rythme, ne peut suivre Bernard, qui spécule, par des chemins pleins de ronces, sur
Bernard, qui spécule, par des chemins pleins de ronces, sur le sigma majuscule des Grecs. De la pinède des signes, vous entreverrez la vallée. Et, à ce rythme-là, les platanes auront bientôt perdu leur écorce. Le camion, on l'a planté là.
Il n'y a pas de platanes, au pays de Racan. Ni lion, ni camion. On ne rebrousse même pas chemin.
mardi, 22 novembre 2011
Kids (Melquiot / Bouillon), Nouvel Olympia (Tours), 21 novembre 2011
Hier soir, nous sommes allés voir la mise en scène de Kids, de Fabrice Melquiot, par Gilles Bouillon.
J’ai déjà eu l’occasion d’écrire tout le mal que je pense de l’inepte Gilles Bouillon. Cette fois-ci, en choisissant de mettre en scène un texte qui est absolument nul d’un bout à l’autre, le grand manitou du Nouvel Olympia avait l’occasion – amplement saisie – de mettre une sorte de point d’orgue à sa navrante carrière. En effet, le texte de Kids est absolument nul, au sens premier du terme : plat, fade, creux – rien ne dépasse, même du mauvais côté.
Il m’arrive très souvent d’être agacé par tel ou tel travers de l’écriture théâtrale contemporaine. Là, c’est bien simple : Melquiot s’est livré à un exercice de style qui consiste à les réunir tous, de sorte que son texte constitue une accumulation de tous les tics et imbécilités de la dramaturgie française des années 1990-2000 : faux style familier totalement clinquant, revolver présenté comme un « jouet » qui finit par exploser à la gueule d’un des adolescents, métaphores d’élève de CE2 peu inventif, jeux de mots Carambar, recours à la langue anglaise (délibérément mal prononcée) pour-montrer-l’attrait-de-l’Amérique-sur-les-jeunes-générations-des-pays-ravagés, structure en prolepse et analepse abondamment soulignée des fois qu’un spectateur demeuré (ou endormi, le bienheureux !) continue de ne pas comprendre, didascalies lues par une actrice en semi-off, chansons a cappella ou accompagnées en veux-tu en voilà. Kids est donc, dès son écriture, une sorte de mise en pratique de tout ce qu’il y a de plus explicite et idiot dans les versions dérivées les plus creuses d’un « brechtisme » compris de travers.
Bien entendu, le défi, pour Gilles Bouillon, consistait à réussir à mettre son grain de sel et à rendre le texte encore plus effroyablement mauvais. Gilles Bouillon est un maître, et c’est le genre de défi qu’il ne craint pas. Pari gagné, donc : ce qui était déjà d’une surprenante mièvrerie, il réussit à l’accentuer encore par une direction d’acteurs qui tient du patronage façon années 70. Ce qui est totalement explicite, et, du coup, parfaitement ennuyeux, dans le texte, il le souligne encore par des gimmicks de mise en scène déjà vus cent fois, même pour quelqu’un qui, comme moi, ne va quasiment plus jamais au théâtre. Par exemple, les personnages figurent les murs de la pièce dans laquelle ils sont censés se trouver à l’aide d’un tracé de craie sur le sol de la scène – mais, attendez, ce n’est pas tout : quand un personnage demande à être admis dans la pièce, un des acteurs qui se trouve dans la « pièce » efface environ 80 cm du tracé de craie avec une éponge ! (Oui, oui, les 80 cm effacés, c’est la PORTE !!! ils ont osé aller jusque là dans l’idiotie. Heureusement que la mort est une chose sérieuse : Brecht ne peut pas se retourner dans sa tombe.)
Bouillon, donc, en un sens, se surpasse. Y a-t-il, dans le texte de la pièce, des chansons bêtasses, mi-Sheila mi-Gotainer ? L’illustre metteur en scène fait prendre à la « chanteuse » des poses et des mines de radio-crochet, avec œillades que même leur caractère très évidemment « second degré » ne sauve pas du ridicule. Je pense même que c’est encore plus ridicule et vil de faire tout cela au second degré.
Y a-t-il un accompagnement de guitare (cela, je ne sais pas si c’est dans le texte et je ne compte certainement pas vérifier) ? Le guitariste a évidemment des dreadlocks, et il joue évidemment les pieds nus. D'ailleurs, si j’en crois le programme, c’est évidemment un fils ou un neveu du metteur en scène. Il ne manquait, comme corde à l’arc de M. Bouillon, que le népotisme ; c’est chose faite.
J’en passe, et des pires.
Un dernier mot. De quoi parle cette pièce ? Des orphelins de guerre, et de la guerre en Bosnie. J’hésite à donner à l’auteur de la pièce une importance qu’il n’a sans doute pas en faisant une lecture politique de son texte… Melquiot doit prétendre, je suppose, que sa pièce subvertit le discours dominant par un recours au second degré (l’insupportable second degré, vieux jeu et élimé depuis déjà trois décennies) et au carnavalesque. Toutefois, ce qui est absolument choquant, c’est de voir une telle pantalonnade, qui, à force de ne pas vouloir dire, de surexprimer ce qui va de soi et d’éviter de parler du vrai drame bosnien, ne dit finalement rien du tout. « Faire une pièce » sur les orphelins de Sarajevo, et ne rien dire du tout, en fin de compte, de ce qu’a pu signifier la guerre en Bosnie, c’est bougrement indécent. Il n’y a ni sens, ni ambiguïté, ni jeu – juste l’immense vacuité d’un plateau hélas surpeuplé.
14:41 Publié dans BoozArtz, Indignations, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (15)
2211 / Atermoiements de la morue
Valse hésitation entre utopie et dystopie.
Un livre qui m’a beaucoup marqué : Wittgenstein’s Mistress de David Markson. Il faut en faire la remarque. Ce n’est pas rien.
Donc j’hésite.
La chatte, elle, après une longue séance d’autoléchage sur la chaise blanche, est retournée sur le sofa, pour y dormir.
Comme je m’ennuie dans mon palais, je me repasse La Terre, le très beau film de Zahari Zhandov. Perhaps that was why they were there because it was a place where some fellows wrote things for cod. But all the same it was queer what Athy said and the way he said it. It was not a cod because they had run away. He looked with the others across the playground and began to feel afraid. Pour tenter de me convaincre de l’urgence de la tâche qu’il me confie, Numance me relance quotidiennement. Aujourd’hui, il a mis en pièce jointe de son message électronique une photographie de lui, prise, si je ne m’abuse, avec un léger contrejour. Il ressemble un peu à l’apôtre qui, vêtu d’un manteau ocre, se trouve le plus à gauche dans La Cène de Carl Abrahams (le tableau peint en 1965).
Gonzague, quand nous étions en CE1, avait écrit, un matin, je ne sais plus quelle imbécillité, à même la paroi du préfabriqué, près de la porte d’entrée de la salle de classe, avec un marqueur qui puait. Ce n’était pas une parodie, ni un canular ; ni blague ni plaisanterie. Juste un ou deux mots écrits avec un marqueur vert.
12:38 Publié dans Une année de 398 jours | Lien permanent | Commentaires (0)
Kérosène & barbaresques
Mardi, journée du boucan et du kérosène.
Depuis huit ans que je vis à Tours-Nord, je ne parviens pas à décolérer des nuisances épouvantables que nous fait subir – et des dangers que nous fait courir, tant par la pollution que par le risque d’accident – la base aérienne, symbole délétère d’une armée française aussi coûteuse qu’inefficace et stupide.
Sur Radio Classique (que je n’avais pas écoutée depuis des lustres), tout à l’heure, tandis que je rentrais d’accompagner ma mère à la gare de Saint-Pierre des Corps, j’ai entendu une connasse (désolé, je n’arrive pas à trouver un autre terme) résumer ainsi l’intrigue de L’Italienne d’Alger : « L’opéra se fonde sur une anecdote réelle. En 1805, une riche Italienne avait été enlevée par des Barbaresques… c’est notre rêve à toutes, mais cela n’arrive plus jamais de nos jours, hélas… Puis, après avoir été vendue au bey d’Alger, elle fut rendue à sa famille, avec un bon bénéfice on l’espère… »
Les prises d’otage par les pirates somaliens, elle n’en a jamais entendu parler, cette grognasse emperlousée ? Les femmes prises comme monnaie d’échange dans les conflits modernes, elle ne connaît pas, cette nullité ? Que l’esclavage des femmes ne s’est pas arrêté avec les harems, elle n’est pas au courant, cette connasse ???
09:37 Publié dans Indignations | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 21 novembre 2011
2111 / Le dernier mot de Coriolan
Ici, pas d’italiques permis dans les titres. Numance me relance, mais je ne comprends à peu près rien à ses histoires albanaises. Toute la nuit j’ai eu dans la cervelle d’infernaux bourdonnements, et m’en suis beaucoup voulu de ne pas avoir poursuivi l’écriture du grand texte fluvial, plutôt que de commencer un énième immense projet, ou que de raconter des blagues de lépreux. Toute la nuit a vrombi. Les abeilles se décidèrent à sortir pour se défendre, et Gribouille assista à un combat furieux où chacun cherchait à percer un ennemi de son dard ou à lui manger la tête. Ma cervelle farcie d’insomniaques ardeurs, je ne me suis pas relevé non plus. Je dois tenir le coup. Mes ennemis sont nombreux. Les gratte-papier, les pisse-copie, les tire-jus me guettent. Jamais personne n’a porté le chapeau de feutre à larges bords et le col fourré de même couleur brune avec autant de platitude que le professeur Panerai, brossé par Carlo Ademollo. Dans mes nuits d’insomnie, je préfère revoir Alam Ara, avec l’inquiétante Zubeida.
23:11 Publié dans Une année de 398 jours | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 20 novembre 2011
Exercice improvisé & dominical de niveau CM2
Souligne les C.O.D. en rouge, les C.O.I. en bleu et les C.O.S. en vert.
 Le père a emmené son fils au zoo.
Le père a emmené son fils au zoo.
Le gavial a dévoré le petit enfant en quelques minutes.
Le directeur du zoo gronde le gavial.
La police demande des comptes au directeur.
Le soigneur dit au directeur qu'il ira lui porter des oranges.
Le gavial rigole gentiment.
Le père du petit enfant critique le système de sécurité du zoo.
Après enquête, il s'avère que le petit enfant s'était moqué du nez du gavial.
L'inspecteur chargé de l'enquête refuse d'accorder les circonstances atténuantes à l'avocat du directeur.
L'élève de CM2 dit à son père que ses histoires de gavial ne sont pas drôles.
16:48 Publié dans ... de mon fils | Lien permanent | Commentaires (3)
2011 / 2011
Comme cela fait plusieurs jours que je n’écris pas, et comme je ne lis guère non plus, accaparé par diverses tâches et par ma famille, ce n’est pas un hasard si je choisis la date d’aujourd’hui pour tenter de fixer quelques ébauches, après avoir commencé (avant-hier : hier soir, je suis rentré trop tard du dîner pour pouvoir lire au lit) le petit livre que Ryoko Sekiguchi consacre au tremblement de terre, au tsunami et à l’accident nucléaire de Fukushima. Au cours de l’année qui vient, je vais traduire un des livres de Verna Aardema, et apprendre le polonais, notamment pour pouvoir traduire – en anglais, en français et en allemand – les poèmes d’Eugeniusz Żytomirski.
Deux de mes amis ne cessent de m’écrire, en ce moment, pour me faire relire des pages de leur thèse. Numance travaille sur les rois d’Albanie, et, dans cette perspective, s’est beaucoup arraché les cheveux pour déterminer l’importance du père du roi Zog Ier, Jamel Pacha (qu’en albanais on doit orthographier Xhemal Zogolli) ; Manuel fait porter ses recherches sur la nation Siksika, et notamment sur la figure complexe du chef Aatsista-Mahkan (dont la belle tête est parvenue jusqu’à nous grâce à une photographie sépia d’Edward S. Curtis)
Drôle de vie, année bizarre à l’horizon.
10:25 Publié dans Une année de 398 jours | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 15 novembre 2011
Craning my neck
C'est fou comme on entend, à l'étage, dans le petit salon par exemple, le bruit des grues.
(Si la migration est un chantier, l'inverse n'est pas vrai.)
15:15 Publié dans Aphorismes (Ex-exabrupto) | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 11 novembre 2011
Exister est un plagiat : 36 et 37
36
En janvier, v’là que je dois déneiger encore les cinquante mètres de trottoir qui entourent la maison. Les nèfles en novembre, la neige gelée en janvier. Ritournelle du temps qui passe. En février, me voici affublé, pour quelques secondes, d’une sorte de bonnet en plastique avec des oreilles de Mickey – jamais on n’a été aussi près de la Folie Couvrechef (sans que je puisse dire quoi que ce soit de Sophronyme Beaujour, décidément, ça me taraude). En avril, le 11, je lis des inscriptions à même les solives ; Montcaret ni Bergerac ne sont loin, et nous nous égarons aussi à Villefranche-de-Lonchat (petite bourgade où, très sincèrement, ne doivent passer que des égarés). En mai, c’est enfin l’Australie, qui m’avait pas mal inspiré mais où je n’étais jamais allé, d’où ces moments de solitude très intense face à une bière, ou face à une sculpture de Bert Flugelman, à Canberra. J’ai failli, à l’instant, rebaptiser le sculpteur Spiegelman, c’est dire si j’ai frôlé la fusion encore plus que la schize. Louis Grosbois est un des élèves « morts pour la France » dont on peut lire le nom sur l’impressionnante plaque commémorative du « collège de Chinon » (c’est-à-dire du lycée). A Saint-Cricq-Chalosse, par un cagnard terrible, les frères Deyris, toujours impériaux et jamais impérieux, parviennent à placer toujours les coursières : ce n’est que la deuxième course landaise que l’on voit cet été-là, pas la meilleure, mais comme c’est l’anniversaire d’Alpha elle a bien sûr une saveur particulière. Par quelques détours mon regard en revient à Canberra, surtout à la route entre Wollongong et Canberra, sur laquelle j’ai vu de nombreux panneaux avertissant l’automobiliste de traversées éventuelles de kangourous et de wombats, mais de wombats ou de kangourous pas la queue d’un. On ne les encorde pas. On n’encorde pas non plus cette grille majestueuse, ni surtout cette magnifique fontaine du château du Fayet, que nous visitons le 11 août 2010 – nous n’étions pas à Hagetmau pour le dernier anniversaire de la grand-mère de C*** –, ni le dolmen de Coste-Rouge, auquel on accède par un chemin sec qui suggère un foisonnement modéré. Il est très adéquat d’achever cette liste incohérente (et immodérément foisonnante (ce pourrait être pire)) avec l’image d’un bus qui s’éloigne (la ligne 1, je la fréquente rarement), me laissant sur le trottoir avec ma serviette et mon exemplaire du Moyen de parvenir de Béroalde de Verville, scène qu’impassible contemple Rabelais sur son socle, flou, de traviole, ne filant pas de vers.
37
Comme, en ce jour de mes trente-sept ans, je dois me trouver ailleurs, sans connexion, et – ironie absolue et en partie involontaire, si l’on songe que j’écris là les derniers fragments du livre – hors Touraine, donc pas en Indre-et-Loire, pas dans le département qui est affecté du numéro 37, me voici, je l’avoue, en train d’écrire ces lignes le 10 novembre, et non, petite irrégularité dans la machine, le 11.11.11, comme il était initialement prévu. Qu’importe, tout ce livre n’est que petits dérèglements, minuscules grains de sable, kyrielles de négations en litanie. Merdouiller, ou tricher légèrement, fait un beau point d’orgue.
L’année qui finit de s’écouler, et qui sert de contrepoint à celle où je fus conçu – dont je ne peux rien savoir, ni directement ni même par de tiers truchements –, je pourrais en détailler les journées, les moments saillants, avec plus de précision et de maestria que pour des années envolées, échappées du sablier. Ce serait tricher un peu, là encore, et je préfère trancher. Ainsi, pour le fragment 36, que j’écrirai après celui-ci, je parlerai du 11ème jour de certains mois, et pour ce fragment-ci, du 1er jour de certains mois, peut-être tous, nous verrons.
— Le 1er décembre, candidat à la direction de l’U.F.R. Lettres et Langues, j’ai échangé des mails avec un collègue, qui a fini par m’écrire les phrases suivantes : « Quant à ma monomanie helléniste, c'est celle de l'opprimé qui ne pense qu'à une seul chose, se libérer ! Une fois notre département de grec libéré, redevenus citoyens libres, nous nous soucierons du reste en bons citoyens de l'UFR ! »
—— Le 1er janvier, nous avons réveillonné, comme la veille, aux bougies – pour le charme de la chose, pas pour coupure d’électricité.
——— Le 1er février, nous avons achevé, avec une petite dizaine de collègues, de mettre au point le planning des réunions de travail de notre « Groupe Afrique ».
———— Le 1er mars, rien, que je sache.
————— Le 1er avril, j’ai empoissonné mes collègues avec le message suivant : « Chers Collègues, je viens d'apprendre que les seuils officiels des groupes de TD passeraient l'année prochaine de 45 à 60 étudiants. Je ne sais pas si la Langue orale est concernée...Heureusement, cette info arrive au moment où je m'apprête à attribuer les cours et faire les EDT. C'est mieux ainsi... » Plusieurs sont tombés dans le panneau.
—————— Le 1er mai, contrairement aux deux années précédentes, je n’ai pas « fait la manif ».
——————— Le 1er juin, nous avons célébré, in memoriam, les 64 ans de mon beau-père, qui est sans doute la personne dont j’aurais le plus souhaité qu’elle puisse lire ce livre. Nous étions à Saint-Denis, puis à Senlis. Le village de Brasseuse est un véritable nid de plaques Michelin.
———————— Le 1er juillet, je me suis ridiculisé – pour faire plaisir à Priscilla, qui m’avait supplié et dont on fêtait le départ en retraite – à chanter Les Cornichons devant tous mes collègues. Collègues qui m’ont offert quatre volumes de la Pléiade pour me remercier de mes trois années à la direction du département, ce qui m’a beaucoup touché.
————————— Le 1er septembre, la barbe que je laissais pousser depuis quelques jours a commencé à faire mieux que s’esquisser.
——————————Le 1er octobre, j’ai archivé dans mon dossier « Sujets éventuels » un article de P. Quinio sur l’affaire de Karachi, intitulé Fin de règne.——————————— À la date du 1er novembre dernier ont été publiés, sur mon blog, les deux fragments 26 et 47, que je n’ai en fait écrit que le lendemain, au retour des Landes – comme quoi la boucle de la tricherie est bouclée (mais je dois avouer qu’à quatre exceptions près, tous les billets publiés l’ont été en direct).
Pourtant, la boucle n’est jamais bouclée. Peut-être l’ouvrirai-je une fois encore, pour revenir à l’année 0, et qui sait, perçant bientôt le secret d’improbables galaxies interminablement éloignées, ce en citant un passage de la lettre de rupture de Nathan Zuckerman à la fin de la Contrevie (The Counterlife) :
Do you remember the Swedish film we watched on television, that microphotography of ejaculation, conception, and all that? It was quite wonderful. First was the whole sexual act leading to conception, from the point of view of the innards of the woman. They had a camera or something up the vas deferens. I still don't know how they did it—does the guy have the camera on his prick? Anyway, you saw the sperm in huge color, coming down, getting ready, and going out into the beyond, and then finding its end up somewhere else—quite beautiful. The pastoral landscape par excellence.
13:13 Publié dans Exister est un plagiat | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 10 novembre 2011
Exister est un plagiat : 35 et 38
35
Revenir, un été pluvieux, sur les traces d’un des lieux de mon enfance (la rue principale de Chicheboville), ne m’a pas remué autant que j’aurais cru. Et je ne parviendrai jamais à métaphoriser de manière pas trop pesante l’insurrection, non loin de là, d’un immense champ d’éoliennes.
Le globe de papier cerclé « japonais » de Roubaud a rappelé le studio de Talence.
Pour la première fois, à Lyon, et, outre les traboules, que pouvais-je faire dans une laverie automatique ?
Le miel des promesses n’est pas le fiel des « réformes ».
Il y a, à Navarrenx, un excellent bouquiniste.
Au stade Guy-Drut, pour la première fois, nous avons vu jouer, en novembre, l’équipe de handball de Saint-Cyr, qui recevait l’U.S. Saintes. La ville sauvée des eaux met en avant : des lettres, trois zozos. Près de la crèche s’ouvrent des brèches.
Il attaque, il attaque drôlement.
Paronomase encore. Une troisième ? Laquelle ?
J’ai lu, et relu, et repris, et redécouvert des volumes, et des volumes, de V.S. Naipaul.
Tu cours de loin en loin, mais à Courances, ce jour-là, même les statues sont fatiguées.
Baugé coule dans mon bathyscaphe. Orléans redevient Acapulco 72. Et j’ai encore oublié qui était Sophronyme Beaujour.
Ainsi, revenir, un été normand, sur les traces d’une forêt déboisée où je n’étais jamais allé, cela constitue la forme la plus intéressante du retour. Aucun homme n’a la force du crabe, ni sa pugnacité. Toujours on avance, et, le plus souvent, des hypothèses.
38
Je bois, je mange, je dors, que vous dire.
Je voudrais croire que ma dernière année sera aussi paisible. Mais l’insouciance est toujours derrière nous. Sinon, on n’écrirait pas.
Si on me lance « fais risette », je ne suis pas sûr que j’obtempère.
Les images sont mensongères.
Tu te grattes, tu es un wombat.
11:58 Publié dans Exister est un plagiat | Lien permanent | Commentaires (2)
mercredi, 09 novembre 2011
Exister est un plagiat : 34 et 39
34
Je ne tiens plus debout, et même assis à mon bureau je ne tiens pas. Mais ça me fait prodigieusement râler de laisser se déliter ce livre. Ainsi, de même, en 2008, je ne voulais pas laisser se faner les roses trémières de Cherbonnières, alors j’ai fui Cherbonnières (bien entendu). Je tiens à résister, vent debout contre moi-même. Un bel imbroglio.
En avril, Eric m’héberge quand viennent les réunions de barème, et je lis Sibylle Lacan.
Sur du papier kraft, une trace retient les progrès difficiles d’un élève en tutification des prosopopées.
———— C’est ça, ton autobiographie ? numérote tes abattis.
39
Le tableau au-dessus de la cheminée de la maison de mes grands-parents que n’occupent pas mes grands-parents représente des fruits et ce que j’ai mis très longtemps à identifier comme un vase. On met les patins, sur le parquet. Dans les salles de classe de l’école, nous jouons, ma sœur et moi, mais l’odeur des toasts vient du logement, l’odeur des jeux printaniers vient du jardinet, et tout ça n’a pas lieu près de la maison de mes grands-parents que n’occupent pas mes grands-parents.
22:43 Publié dans Exister est un plagiat | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 08 novembre 2011
Exister est un plagiat : 33 et 40
33
J’ai repensé, avant d’avoir trente-trois ans, au puzzle préféré de mon enfance. Il représentait la France par départements, soit 95 pièces, plus quelques morceaux périphériques pour les pays limitrophes. Je refaisais maniaquement ce puzzle dix, vingt, trente fois, en variant les « attaques », comme aux échecs en quelque sorte. Mon « attaque » préférée était par l’Espagne, en commençant ensuite par les départements de la côte Atlantique. J’aimais bien aussi commencer par la Bretagne, avec son bec bifide.
Je me rappelle que, dès que j’ai su compter, passionné par les numéros des départements, les préfectures, les sous-préfectures etc., j’ai su faire ce puzzle, et j’ai souvent associé ensuite les âges des différents membres de ma famille à des départements. Ainsi, quand ma mère était la Haute-Garonne, ma sœur était encore les Ardennes, puis l’Ariège après son anniversaire.
Lors de ma trente-troisième année, j’ai surtout vécu en Indre-et-Loire. Je note cela trois jours avant mon 37ème anniversaire. On ne parlera pas du Christ. (Trop tard.)
—— Les deux seules fois où j'ai dû revenir à Bordeaux, en 2007, furent d'une grande tristesse.
40
Dans les Landes, où j’ai passé, comme tous les ans jusqu’au baccalauréat, le plus clair de mon temps, je n’ai connu, apprécié, qu’assez tard les forêts de pins. C’était la petite ville où nous vivions ; c’était le jardin de mes grands-parents, qui me semblait immense ; c’étaient les fumées puantes de la papèterie de Tartas ; c’était aussi le petit train de Marquèze, au milieu des pins, donc mes souvenirs écrivent n’importe quoi.
En classe de petite section, à trois ans, avec Mme Séverin, notre maîtresse, nous avons appris une chanson d’Yves Duteil. Je me rappelle que cette même année je préférais « ricmer » sur Jamais content d’Alain Souchon. Let’s All Chant, mon 45 tours préféré, ce doit être légèrement postérieur.
Eternel retour. Les Landes, pour moi, c’est la Chalosse, c’est-à-dire, en fait, pas la Chalosse, le pays d’Orthe, autant dire presque le Béarn, et donc pas les Landes. Il fallait bien tenter de cerner deux fois, et même des myriades, ce sujet qui ne cesse de s’échapper.
22:36 Publié dans Exister est un plagiat | Lien permanent | Commentaires (1)
97 ans ce jour
03:00 Publié dans Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 07 novembre 2011
Exister est un plagiat : 32 et 41
32
Je ne dois pas me mettre martel en tête. Une tête d’halco, autant dire, un singe en décembre avec un duffle-coat. Pourquoi rien en janvier, et après ça une foison, la main de Balzac, le toit tranquille où marchent des flocons, un balai à gazon sur une épaisse couche de glace. Dynamo se met en marche, un tamarin parisien fait signe, un autre singe encore un autre singe, au printemps celui-là. (Au Salon du livre, si j’ai existé, c’est par le sourire et la main, l’attente dans une cabine de photomaton.) Ensuite, j’enfile la série des Virevoltes (sur fond de bassine à linge, sur fond de radiateur en fonte, sur fond de nappe, sur fond de carrelage, sur fond de miroir avec ma gueule, sur fond de matelas moiré, j’en passe), Chambord, le chambard au jardin d’enfants, Landes-le-Gaulois un toponyme de totale prédestination avec notices pancartes fautives vieille 2 CV des années 50, le chambard encore, la guimbarde au retour de Chambord, Saintes avec une couronne jaune, d’autres Virevoltes, Watt, la fée électricité, le chambard, une vie c’est compliqué, Mammouth dans la courette où enfant je jouais aux petites voitures – avec les joints entre les dalles qui faisaient les meilleures routes de toute mon enfance –, la fontaine d’eau chaude, l’aquarium de Biarritz et le mur(et) d’escalade, Lussac Civaux Montmorillon, une nuit à Saint-Savin, tout ça pour finir par un matin au bord de la Mer rouge. Je ne dois pas me mettre martel en tête mais ça continue de plus belle, et depuis belle lurette. Alors ne rien oublier, ni le banc rouge à Ménil, ni le violon de faïence dans une vitrine à Blois (à quoi m’avait servi de lire Champfleury ?), ombres sur le bleu de ciel, keep me covered, un porc-épic, mes parents peignant des planètes, la rue des Fossés-du-Château. D’un château l’autre, donc, ça continue, de plus belle toujours de plus belle, quand s’arrêtera mes aïeux cette effroyable accélération du temps, dire que ce midi encore on parlait de ça, de l’éternelle jeunesse, je confonds toujours un peu Faust et Dorian Gray, pour ne rien dire de ce mois de jouvence, juin pardon, un panda roux au zoo de Doué, des grimaces, un malaise, une fête avec une danse de rubans, une promenade au château du Rivau avec les Québécois d’adoption (Clément venait de naître), quelques jours dans les Landes car C*** faisait passer les examens d’un quelconque BTS dans un quelconque faubourg de Pau (d’Orthez ?) et son père allait très mal, alors à côté de cela Descartes Preuilly La Guerche le Grand-Pressigny ça n’a pas de poids, c’est le jour de l’été, la fête de la musique, en remontant l’avenue en voiture on double ma collègue Fabienne en vélo qui ne nous voit pas. Ça continue, pourtant, le tintamarre de la mémoire ne connaît pas d’interruption, alors j’enchaîne j’enfile je circonflexise à fond, and here we come André Markowicz au prieuré Saint-Cosme, la mosaïque infernale au Musée Labenche, les travaux à Tulle, je me mets toujours plus Martel en tête, d’immenses dinosaures en béton armé menacent de se casser la gueule sur moi, même pas peur, la religion tue le monde, l’illumination à Souillac, le faux derche à Commarque et le vrai François Hollande à Arnac-Pompadour, à la fête de l’âne je n’invente rien. Le mois de juillet s’est-il achevé sur la guimbarde (encore une guimbarde) 110 Cuites 210 Cuites, il fallait que le mois d’août fût modéré, alors on ne retient que la cible rouge d’Arthous, elle suffit à plonger dans le bain d’un mois à la chaleur modérée, aux pluies modérées, aux dernières joies d’une vie comme un feu vif, je pleure en écrivant cela, ce n’est pas bien de l’écrire mais le bien maintenant… Après la mante religieuse pour de vrai, le scorpion pour de faux de Jean-Luc Goupil, donc Tutuola, ergo des orangs-outangs à Beauval, tout cela se tient, on sait se tenir croyez-moi. Je termine ce calendrier cet almanach façon Jean-Louis Murat (je veux dire par là que c’est obscène et dénué de sens), les chrotomis sont très gentils, ma mère boquillonne, octobre est sobre malgré le décor de carton-pâte rouge, un cornichon géant me salue à Montlouis, décidément me dis-je à la fin du mois en lisant Virginia Woolf, le scorpion n’a qu’à bien se tenir. Au moment de fêter mon anniversaire, je suis totalement épuisé (c’en sera de même cette année je le crois) : « jets de pierre interdits » et statue verte de Vigny (sous peine de poursuites).
On poursuit en 41. (Non, j’aurai 67 ans en 2041, hors de question que j’arrive jusque là.)
41
Coquetterie. Dans l’œil. Pan dans les dents.
Nous revoici à Bristol. Le texte fait mosaïque, ou plutôt kaléidoscope (on en ramène un, motifs du Magic Roundabout à l’extérieur, petits cristaux multicolores dans la lunette).
Cette année-là, je ne sais plus pour quelle raison, mon père avait ramené à la maison, et déversé près du portillon du jardin, un tombereau indistinct dans lequel se trouvaient surtout des myriades de petits carreaux de faïence bleues, vertes et jaunes, ébréchés pour la plupart. Souvenir d’avoir joué avec ces petites merveilles, plus ébloui que si la caverne d’Ali Baba s’était ouverte devant mes yeux.
On passe un temps fou avec les aïeux, ceux de Fadesse ou ceux de Normandie. Bientôt ces derniers ne seront plus qu’à Saintes, ville dont je ne dis rien dans ce livre, mais dont le nom ne cesse de revenir, comme un mantra.
Mater. Anagramme ? Ma terre, celle dans laquelle je fouaille avec les doigts, aussi en jouant avec les petits carreaux de faïence ébréchés, c’est l’image de ma mère, il n’y a qu’elle. (Trop d’images pour en choisir une seule.)
― Tout de même, ce sera étrange, quand j’aurai tout réagencé à la suite, cette convergence vers le centre, et puis ces symétries.
― Tu ne veux tout de même pas dire que tu es allé chercher le souvenir du kaléidoscope pour une satanée, une foutue mise en abyme ?
― Hmmm… non, mais du coup, il se trouve…
― Tu es plus irrécupérable que je ne pensais. Je vais t’apprendre à manier la gomme, moi.
― On verra, je te passerai l’ordinateur. Après.
23:25 Publié dans Exister est un plagiat | Lien permanent | Commentaires (1)
Call That A Monday Morning
Je viens d'essayer d'ouvrir la porte de mon bureau de l'université avec trois clefs différentes, puis, ayant enfin choisi la bonne ferraille, de m'apercevoir que je venais de la fermer à double tour en tournant dans le mauvais sens.
Saloperiedelundimatindemerde.
08:33 Publié dans WAW | Lien permanent | Commentaires (0)