jeudi, 15 juillet 2010
Grand débordement d'activité, I
[Ferré et Thiéfaine sont les deux chanteurs que je connais qui parlent du Chambertin.]
Arrivée à Hagetmau, divers rangements, ménage etc.
Samedi 10. La Ceinture de jade d’Anatoli Kim. Jackie McLean. Déjeuner sous les arbres.
6 h du soir, course d’Audignon (Deyris) aux arènes de St Sever, aux 9/10 vides (avec Richard). Marty vainqueur, belle prestation du local Plassin, frères Vergonzeanne décidément en déclin. Courtiade use du coudrier sur le cuir des dames. Lalanne pas veinard sur la sans corde. Du beau linge dans le callejon, dont la Zahia des coursayres (Mme Vincent Muiras, il semble). Pointeur débutant archinul, maintes broncas vers la pitrangle.
Soir, petite finale.
Dimanche 11, anniversaire d’A. 10 à table, parents, grands-parents, Mamie J. et V.
Matin, ballons et tronçonneuse. Midi, sangria infecte mais le reste impeccable. Cadeaux en nombre pour A., « yes ! » à chaque coup ! Discussions post-prandiales et vaisselle.
5 h, course de St-Cricq (Dargelos), très moyenne (euphémisme), arènes mi-pleines. Bien placés, presque pas au soleil. Même pointeur gamin nul que la veille, en progrès sauf au moment de la comptabilisation finale individuelle (Lapoudge, 19 écarts globalement convenables, totalement oublié, même derrière Dumecq). Lendresse vainqueur. Frères Deyris suprêmes, surtout J.-F. muselant la sans corde après tumade sur Dumecq. Un tourniquet parfait de Lapoudge, capturé sur vidéo.
Soir, finale lamentable à la télé avec bocadillos et victoire de l’Espagne aux forceps.
Lundi 12. Mrs Dalloway, en bribes, juste le premier tiers (du moins à 6 h 30 du soir, heure à laquelle j’écris ces bribes elles-mêmes). Boogaerts. Pas de course, mais Défis & Champions en DVD à la télé en guise de quatre-heures, avant bonne promenade au Louts. [Crapaud mort gonflé de vermine en plein soleil au milieu du boulodrome. O. n’a pas compris, A. dégoûté.]
Matin, achat de déshumidificateurs car la moisissure a gagné trop de terrain.
« Quelques enduits et je termine. »
Mardi 13. Sur la vieille bécane, toujours (combiné du clavier Fujitsu de 2002 et de l’écran Philips de 2000). Continue Mrs Dalloway. Passage de voitures en trombe sur la route de Monségur. Ratatouille. Saturnin, pour O. (au-delà du ridicule). Acheté le guide vert du Languedoc-Roussillon chez Caldéra. Signe le plus évident, pour moi, de « la grande déculturation », la disparition de guides détaillés, et en particulier des Guides bleus. Regret de ne pas en avoir acheté une pleine fournée quand la collection existait encore, ou de n’en trouver qu’usés, jaunis ou cornés chez les bouquinistes ou les antiquaires.
Furieux de voir le grand cercle où « ils » avaient fait brûler des feuilles et des branches ne pas se remettre de son état calciné – toujours grand pourfendeur in petto (et à haute voix) de l’écobuage. Pas de course aujourd’hui, j’écris ces lignes à onze heures moins dix.
Mrs Dalloway, de Peter Walsh avant midi au dîner de Peter Walsh (‘Bartlett pears’).
Hélicoptères en permanence (avant le 14 juillet ?). Que de remue-ménage aujourd’hui.
Premières idées pour le cours de M1. Different from (/ to, than) → les constructions prépositionnelles après les adjectifs. Autres constructions en from. Utilisations de from dans les textes théoriques (philosophie, littérature, histoire). [Oui, tout juillet dans un seul document.]
7e compagnie, le soir, pour A. – plié de rire à plusieurs endroits. Moins nanard que dans mon lointain souvenir. On a dû pouvoir dire ou écrire, à l’époque, que ça réinventait complètement le comique troupier. Au lit, commencé Underworld, pas longtemps. [La barre d’espace, peu réactive, me fait des blagues, composant des agglutinés.]
Mercredi 14. [Neuf heures et demie.] Poursuivi quelques pages d’Underworld, je ne comprends rien aux règles du baseball donc une partir du tour de force stylistique m’échappe. Cela sent un peu le tour de force, dès le départ. À suivre… Vais lire les 25 pages restantes de Mrs Dalloway.
Désintoxication de café presque totale (juste une petite tasse milieu de matinée). Pas de thé, du tout.
Max Roach & Clifford Brown.
Au lever on a cru au beau, et puis : vent, soleil par intermittences – ça peut donner tout et son contraire.
Après-midi et soirée : Concours de la Corne d’Or à Nogaro. Foule. Belles vaches, sorties festival des sauteurs distrayantes (dont un tout à fait inédit et épatant triple saut périlleux avant et sur la vache par Louis Ansolabéhère), et triomphe de Thomas Marty, tenant du titre et auteur d’un intérieur absolument époustouflant. Le garçon devient meilleur chaque année. Côté trophées, triplé et carton plein de l’Armagnacaise : Barrouillet cordier d’argent ému aux larmes, Ibañeza indétrônable et Baronne vache de l’avenir.
D’où vient la passion et surenchère de Virginia Woolf pour les points-virgule ?
Plus d’hélicos (c’était donc ça).
Jeudi 15. Record de la coiffeuse la plus abrutie & la plus inculte pulvérisé. (Jocelyne, dite « Joss », à Hagetmau.) Avouez que la concurrence est rude…
Continué d’ébrancher des gaules – activité essentielle de ce début d’été – au point de devoir manier le sécateur de la main gauche (triple ampoule à l’index de la main droite (mon père avait raison : « mets des gants de jardinage, Guillaume ! »)).
Pas d’Underworld.
Bassine de 6 kilos de prunes quasi achevée (en 4 jours). Pas besoin de faire des confitures, une famille de quatre estivants suffit amplement à la Cause.
Underworld, 100-122.
14:45 Publié dans Autoportraiture, Hors Touraine, Jazeur méridional, Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 14 octobre 2009
Double Sunrise Over Neptune
Ma myopie est si faible (apparue à l'âge adulte, elle n'a jamais "progressé") qu'aujourd'hui j'ai décidé de ne pas porter de lunettes, ce dont personne ne s'est encore aperçu, ou ce que personne n'a jugé bon de remarquer à haute voix. Cependant, par les oreilles j'écoute en boucle l'album en medium band de William Parker, Double Sunrise Over Neptune, dans lequel le génial contrebassiste-compositeur ne joue pas de la contrebasse, mais, si j'en crois les notes de pochette, du doson'ngoni (dont je présume qu'il s'agit d'une sorte de luth n'goni) et des "double reeds" (ce qui signifie, très vaguement, "anches doubles") : cela signifie-t-il que William Parker joue de tous les instruments à anche double sur cet album, et donc du contrebasson autant que de la chalemie, et du sarrussophone ainsi que du guanzi ?
Passons... Pour la première fois de la journée, face aux caractères trop petits de la fenêtre de saisie H&F, je plisse légèrement des yeux. Le linge s'envole au soleil. J'ai refermé la double fenêtre à cause des odeurs de kérosène. Mes yeux se plissent.
=======>
Pareils aux figures d'une tapisserie, les chevau-légers ondoient, flottent, courent, se plissent, s'étendent, s'éclipsent devant l'horizon lointain et bleu, reparaissent, voilent le soleil.
L'instabilité des continents voisins, dont les rochers se plissent, s'élèvent et s'abaissent en vagues, modifie de cycle en cycle la ligne des côtes.
Par l'eau tremblante du canal,
Tournant leurs coques vers l'aval
Muets, les chalands glissent...
Les nénuphars se plissent,
Des zébrures s'esquissent...
Ces lèvres, qui ne débitaient que maximes austères, se plissent et s’avancent comme pour des baisers.
M. Tatin a pensé que c'était par le carpe qu'il fallait commander le mouvement de torsion venant s'éteindre graduellement près du corps, et pour obtenir avec toutes ses transitions, il avait substitué aux ailes de soie qui se plissent, des ailes entièrement construites en plumes très fortes, disposées de telle façon qu'elles arrivassent à glisser un peu l'une sur l'autre pendant les mouvements de torsion: la fonction de cette nouvelle voilure était parfaite; mais, adaptée au grand oiseau, ces ailes ne donnèrent que des résultats médiocres.
<=======
À quel moment ai-je laissé échapper la proie pour l'ombre ? Même ouvrir un vieux fichier me tire des soupirs. Les conceptions me réjouissent, mais les mettre en oeuvre me fait bâiller. Tout ici est déplacé, confisqué, sans heurt mais sans gloire. Comme une daurade je frétille d'aise.
14:31 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (2)
dimanche, 13 janvier 2008
Omégalomanie trombonesque
Le lecteur sourcilleux, insomniaque, ou peut-être – simplement – attentif et doué d’une bonne mémoire, se souvient peut-être qu’un lointain lundi de blocage, à la suite d’une séance particulièrement longue à battre le pavé de la rue des Tanneurs, pour finir par ne pas voir s’ouvrir l’université en partie saccagée par les insurgés d’opérette, l’auteur de ce carnétoile (lequel avoisine, au bout de trente-et-un mois d’existence, les 2000 textes publiés) s’était retrouvé face à un verre de succulent vin de myrte chez un collègue dont un certain froid par ailleurs le sépare, ce qui est d’autant plus dommage qu’il partage, avec ce collègue, des goûts musicaux, dont la découverte, chez ledit collègue, de l’enregistrement original en vinyl de la longue et belle composition d’André Hodeir Anna Livia Plurabelle n’est pas la moindre. Or, ayant siroté son vin de myrte en suivant le texte de Joyce sur l’exemplaire photocopié que le collègue sus-cité avait tendu à ses invités – l’auteur du carnétoile et une collègue parisienne très gentille –, le héros verdoyant s’en retourna chez lui et commanda illico, via la fière Amazone, la version disponible en CD d’Anna Livia Plurabelle, qui s’avéra être l’enregistrement de septembre 1993 sous la férule de Patrice Caratini (avec du beau monde, certes, Marc Ducret, Denis Leloup et Sylvain Beuf en tête). C’est cette version qu’il écoute en écrivant ces lignes – le temps d’une vaisselle, d’un peu de ménage et d’écrire les deux phrases qui précèdent, c’est déjà le septième des 13 morceaux (‘By earth and the cloudy...’). Il semblerait que la version originale, du début des années 1960, ne soit absolument pas disponible en CD, soit qu’il n’y ait pas eu d’effort commercial en ce sens, soit que la version de 1993 – pilotée aussi, semble-t-il par Hodeir, et qui devait donc bénéficier de son consentement – n’ait évincée la première. Le projet, très clairement énoncé par Laurent Cugny dans le texte du livret, consistait, pour le big band réuni sous la houlette de Patrice Caratini, à reprendre très précisément la partition d’André Hodeir et les arrangements d’origine, soit une démarche assez inhabituelle dans la galaxie jazz, plus habituée aux reprises libres, fût-ce de standards archi-rebattus. (L’auteur de ce carnétoile, qui compose ici à la troisième personne pour saluer le retour, dans la blogosphère, du Vrai Parisien, longtemps disparu sous les traits de l’Amateur, renonce temporairement aux paragraphes, à la manière d’Olivier B.) Ce qui frappe, dans Anna Livia Plurabelle, plus que la prédominance des cuivres et saxophones (et, en particulier des plus mâles d’entre eux : sax ténor, trombone), c’est l’équilibre étonnamment juste entre les deux voix (soprano et contralto) : ici, ce sont Valérie Philippin et Elisabeth Lagneau qui font vibrer le texte de Joyce, peut-être avec moins de clarté dans l’élocution que les deux de la version princeps, Monique Aldebert et Nicole Croisille – mais ce peuvent être aussi les déformations myrtoyantes de la mémoire qui jouent des tours à l’auteur de ces lignes. (Omega s’étant affalé sur le canapé, sans protester pour autant, il fallut aller le remettre d’aplomb, tandis que la partie la plus douce du dixième fragment (‘No more ?’) s’écoulait des baffles. Sur le ventre, bientôt, Omega ne manqua pas d’ajouter ses trilles vibrantes à la jazz cantata, non sans force couinements caoutchouteux de Sophie la girafe.) Accessoirement, tandis que ça scatte frénétiquement, est-il nécessaire de préciser que le héros tourangeau de ces parages s’est trouvé, à l’occasion de cette écoute, replongé dans Joyce – Finnegans Wake et même les occurrences de bun dans Ulysses – ce dont, accaparé déjà par Neige d’Orhan Pamuk, Impératif catégorique de Roubaud et les textes critiques de Lyn Hejinian, il se serait dispensé, si son démon plurabelliste avait pu lui lâcher la grappa.
10:54 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Jazz, Musique, écriture
jeudi, 10 janvier 2008
Jackie McLean, Consequence.
Un quintette solide pour six morceaux de grande tenue. Lee Morgan à la trompette dépasse presque le leader. Impossible de savoir de qui sont les compositions (j’aime beaucoup Tolypso). Il s’agit d’enregistrements du 3 décembre 1965, sortis en album pour la première fois en 1979 seulement (inexplicablement). La musique – comme la photographie de Ron Leighton qui se trouve en couverture – oscille entre l’abstraction chaleureuse et l’éclat glacial de la figuration. Nous sommes dans le même navire des draps dépliés, chiffonnés. L’introduction somptueuse de Harold Mabern (parfait inconnu pour moi) sur Slumber suffit à pousser la note grave de l’insomnie créatrice.
 Ce vinyle du saxophoniste Jackie McLean, je l’ai découvert, comme tant d’autres, depuis la mort de P. Lui qui m’a initié au jazz, ne m’avait, je crois, jamais parlé de ce saxophoniste dont il possédait pourtant deux doubles albums, et celui-ci. Sur les deux premiers solos de Bluesanova, on se dit qu’en matière de splendeur, McLean n’a pas grand chose à envier à Coltrane. (En consultant la vieille édition du dictionnaire du jazz qui se trouve ici, je me dis que j’ai déjà dû croiser la route de McLean, via Mingus toujours. Speaking of which je m’y perds et je découvre aussi que le Mahavishnu Orchestra avait enregistré un album qui s’intitulait Good Bye Pork Pie Hat ; dans la collection des vinyles de P., il y a cet album de Joni Mitchell que je n’ai toujours pas osé écouter, et également consacré à Mingus.)
Ce vinyle du saxophoniste Jackie McLean, je l’ai découvert, comme tant d’autres, depuis la mort de P. Lui qui m’a initié au jazz, ne m’avait, je crois, jamais parlé de ce saxophoniste dont il possédait pourtant deux doubles albums, et celui-ci. Sur les deux premiers solos de Bluesanova, on se dit qu’en matière de splendeur, McLean n’a pas grand chose à envier à Coltrane. (En consultant la vieille édition du dictionnaire du jazz qui se trouve ici, je me dis que j’ai déjà dû croiser la route de McLean, via Mingus toujours. Speaking of which je m’y perds et je découvre aussi que le Mahavishnu Orchestra avait enregistré un album qui s’intitulait Good Bye Pork Pie Hat ; dans la collection des vinyles de P., il y a cet album de Joni Mitchell que je n’ai toujours pas osé écouter, et également consacré à Mingus.)
Le finale de Slumber, dans le dialogue cuivres/section rythmique, emporte loin du navire, sur la mer maintenant refermée des draps qu’aucun ciel n’a froissés.
[Hagetmau, 31 décembre 2007]
10:10 Publié dans Hors Touraine, Jazeur méridional, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Jazz, Musique, écriture
lundi, 07 janvier 2008
Abattis
[ 5 janvier 2008 : aujourd'hui, le 7, pas une minute.]
Ce ne sont pas les nouveaux disques qui manquent ; pourtant, à peine de retour, je replonge dans l’intégrale des enregistrements live de Bill Evans en trio au Village Vanguard, qui m’a accompagné tout l’automne, au soleil comme aux nuages. La version d’Emily enregistrée le 23 août 1968 avec Gomez à la contrebasse et Jack DeJohnette à la batterie me tirerait presque des larmes. A Sleepin’ Bee (13 décembre, avec Marty Morell à la batterie), et je danse la gigue dans le ciel. Je m’amuse du clin d’œil à la Marche turque dans un énième Someday My Prince Will Come (15 septembre, avec John Dentz à la batterie). Curieux, les batteurs de Bill Evans semblent interchangeables, sans personnalité, se fondre dans les harmoniques du leader. (Un compliment pour chacun d’entre eux, je suppose.)
16:39 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jazz
dimanche, 02 décembre 2007
Aux flammes sombres de Djibouti
Nouvelle écoute, après des mois d'abandon, de Dark Flame, le disque d'Uri Caine inspiré de compositions et lieder de Mahler. Toujours pas convaincu. Il faudrait réussir à oublier qu'il y a Mahler derrière, et ne l'écouter que comme un disque de Caine... et encore, serait-ce suffisant ?
Pourtant, j'avais adoré le double album inspiré des Variations Goldberg : c'était en 2002 ; on me l'avait prêté. Si ça se trouve, j'aimerais moins aujourd'hui.
-----------------------------------------------------
La conférence que je dois prononcer cet après-midi à l'Espace Vinci, dans le cadre du Festival des Langues et des Cultures, est prête. Il s'agit d'une sorte de déblayage pour néophytes, de quoi donner envie au public (sans doute peu nombreux) de découvrir certains écrivains djiboutiens. Je vais surtout lire des extraits d'Abdourahman Waberi. J'ai (pompeusement) intitulé cela Djibouti, l'écrit abouti.
10:40 Publié dans Affres extatiques, Autres gammes, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Ligérienne, Jazz, Afrique
lundi, 15 octobre 2007
B.S.S.L.
Tout écouter, chaque note de The Black Saint & the Sinner Lady, et puis rendez-vous au grand pylône ! On entre en transes sur ces morceaux de bravoure, et puis rendez-vous au grand pylône !
(On n'en parle plus, et puis boufniouze...)
16:40 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jazz, écriture
samedi, 06 octobre 2007
Chainsaw at Sousa's Funeral
" I am wearing an apron and I'm on teenage cost containment program ! " *
C'est du jazz, ressers-moi ce jazz. (198 messages indésirables en 35 heures, ça fait beaucoup.) Entre '91 et '93, tandis que je pinçais les lèvres et allais me faire vérifier le sang tous les quinze jours, les trois acolytes Horn, Kendig et Dickey bricolaient de tous instruments ici et là, en marge bien sûr, où naissent les nuages farouches. L'album Screwdriver !, ressorti en 1999 sur le label Leo Records Lab, est fort de cet acide pas poseur, claviers désaxés, clarinette stridente et force beaux bidouillages. Certains moments à l'orgue vont jusqu'à rappeler, dans leur recherche même, mélopées tziganes et mélodies lancinantes soufies.
Resserré dans le manteau qui m'envole, j'écoute cheveux fermés.
* Je porte un tablier et on m'a placé sous tutelle financière.
11:05 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jazz, Ligérienne
samedi, 29 septembre 2007
Il fait toujours beau
Soleil sur les vitres, je voulais profiter de la douceur de cette belle après-midi de septembre finissant en ouvrant justement les fenêtres. Le disque qui se lance n'est autre qu'Il fait toujours beau du tentette de Stan Laferrière, musique finement cuivrée et on ne peut plus opportune. Malheureusement, les bricoleurs du samedi (qui sévissent aussi le dimanche, le mercredi, etc.), cette engeance maudite, font résonner dans le quartier, qui les crissements de sa perceuse, qui les raclements de son kärcher. On referme alors les fenêtres.
 L'autre jour, en voiture, je suis retombé dans une cuve de Dexter Gordon (les enregistrements en quartette, avec Bobby Hutcherson au vibraphone en surnuméraire pour certains titres). Grande bouffée de bonheur, non seulement (comme toujours) en me remémorant l'époque où j'écoutais cette musique joyeuse, mais aussi par la grâce même de ces arrangements d'un bop sans complexes, sans pointillisme, sans finasseries, et pourtant diablement beau. Le titre qui me donne le plus envie de m'époumoner, de profiter des heures heureuses ici-bas, est, par bien des côtés, l'un des plus "datés" (Le coiffeur).
L'autre jour, en voiture, je suis retombé dans une cuve de Dexter Gordon (les enregistrements en quartette, avec Bobby Hutcherson au vibraphone en surnuméraire pour certains titres). Grande bouffée de bonheur, non seulement (comme toujours) en me remémorant l'époque où j'écoutais cette musique joyeuse, mais aussi par la grâce même de ces arrangements d'un bop sans complexes, sans pointillisme, sans finasseries, et pourtant diablement beau. Le titre qui me donne le plus envie de m'époumoner, de profiter des heures heureuses ici-bas, est, par bien des côtés, l'un des plus "datés" (Le coiffeur).
Pendant quelques bons moments, au début de cette redécouverte, je ne pouvais m'empêcher de comparer défavorablement, dans mon for, les versions de Dex avec celles de Miles & Trane (un sommet, il faut avouer). Puis, en fin de compte, lentement, langoureusement, Dexter Gordon et ses acolytes m'ont fait oublier les fulgurances de Davis et de Coltrane, et j'ai pu apprécier notamment cette autre vision, lecture, version de Love for sale.
Tandis que j'écris ces lignes, Stan Laferrière se démène au Fender sur Grolomelematch, troisième titre mi-joyeux mi-torturé de l'album cité ci-avant (cela entre l'alto d'Olivier Zanot et le ténor de Thomas Savy). Il fait toujours encore beau. Ah, se promener dans la rue en s'époumonant, sur tant de démesures...
15:56 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jazz, Ligérienne
samedi, 15 septembre 2007
Frank Woeste Trio à Montlouis, 14 septembre
En général, ça commence toujours par un peu de lecture (ce qui est tombé sous la main / crépuscule superbe sur les rives de la Loire / puis attente du concert).

Ensuite, au "jazz club" de Montlouis, dans l'affreux hangar du Saule Michaud, ça chauffe.
Frank Woeste emmène un trio dont on peut dire qu'il n'est pas d'une folle originalité. Rien à redire aux qualités musicales des trois comparses, ni de leur travail ensemble. Seulement, les compositions du pianiste manquent de mordant, ses lancements au Fender sont plutôt conventionnels, et ça dégaine autrement dès que le trio met Strayhorn ou Monk sur orbite.

Mathias Allamane est parfois étouffé entre deux, problème probable de balance. (Pour ne rien arranger, mon verre de blanc de Montlouis "Cuvée du Festival" s'avère être une horrible piquette, pour parler comme l'autre.)

Matthieu Chazarenc se démultiplie, vrai plaisir de jouer. Un peu trop démonstratif peut-être (il penche assurément plus du côté Max Roach que du côté Kenny Clarke (clin d'oeil à Paul)).

Saluts après le bis. Rien d'inoubliable. On a retenu Naked Moon, composition de Woeste inspirée par un poème de Ginsberg, et surtout Rare Days (Spare Days ?), piste ou voies à explorer.
17:15 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jazz, Ligérienne
mardi, 03 juillet 2007
Pentacle
 Là encore, il s’agit d’un de mes disques préférés de jazz contemporain. Toutefois, là, je pense le connaître par cœur – ou, disons, je le connaîtrais par cœur si j’avais quelque connaissance de solfège, composition, etc. Pour rabattre de mes prétentions, je pourrais écrire plutôt que je connais vraiment par cœur le premier titre, “Vestiges”, et serais dans le vrai.
Là encore, il s’agit d’un de mes disques préférés de jazz contemporain. Toutefois, là, je pense le connaître par cœur – ou, disons, je le connaîtrais par cœur si j’avais quelque connaissance de solfège, composition, etc. Pour rabattre de mes prétentions, je pourrais écrire plutôt que je connais vraiment par cœur le premier titre, “Vestiges”, et serais dans le vrai.
Dans cet album d’une rare beauté tant cuivrée que cordée, la pianiste Sophia Domancich, aux commandes, s’est entourée du bugliste Jean-Luc Cappozzo, que l’on connaît bien quand on vit à Tours et pour peu que l’on fréquente les bœufs du Petit Faucheux, de Michel Marre à l’euphonium, de Claude Tchamitchian à la contrebasse et de Simon Goubert à la batterie.
Pentacle : le titre général de l’album semble idéalement choisi, car le quintette propose – sur des compositions de Domancich – une musique qui dose à merveille spiritualité et abstraction géométrique. C’est cela qui me plaît : quand l’avant-garde, sans renoncer à ses recherches les plus poussées, ni à ses hommages parfois dissonants, chante, oui, merveilleusement chante et module.

(Oui, le ciel est plus gris chaque jour. / Non, le son de l'euphonium n'est plus celui d'un veau affamé.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À l’exception du premier morceau, déjà évoqué, l’album est entièrement constitué d’une suite de huit pièces, intitulée Pentecôte. Titre en clin d’œil au titre, sur une dangereuse pente sémiotique ? Quintette qui parle en langues ? Frénésie qui happe l’oreille, jappe en douceur et rappelle Babel ? C’est la sagesse incarnée.
13:55 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Jazz, Photographie
dimanche, 01 juillet 2007
Eiffel
Cet album a dû faire son apparition, entre mes mains puis, comme souvent, dans la pile à côté de moi sur le siège, alors que le train pour Beauvais (ou, parfois, pour Creil) s’élançait – j’en défaisais le blister, en décollais soigneusement l’étiquette jaune Gibert Occasion, puis consultais la pochette – et nous dirons 1998, pour fixer une date. C’est un de mes disques de jazz favoris, et il me semble pourtant ne pas l’avoir écouté depuis très longtemps. Non que je le connaisse trop bien, comme il arrive parfois pour ces musiques que l’on ne passe plus sur la platine, tant l’on peut (ou pense pouvoir) les recomposer entièrement, à l’accord et au décroché de cuivre près, dans sa tête. En effet, certaines mélodies ici ne me disent à peu près rien.

C’est l’un de mes disques favoris, dans l’un de mes formats préférés : le duo proche. Jimmy Giuffre, au sax soprano et à la clarinette basse, y donne la réplique à André Jaume, au ténor. Eiffel a été enregistré en direct à Paris, le 8 novembre 1987 (au soixante-treizième anniversaire de ma grand-mère paternelle (et alors ?)). Dans cette suite de dialogues, sur des compositions qui sont principalement du Français, on trouve un Giuffre géant, aussi beau et magistral que dans le double album du trio avec Paul Bley et Steve Swallow.
Boire du thé vert très infusé en écoutant cette musique si douce, qui s’emporte même avec suavité, offre un contraste frappant. L’attaque de Stand Point est à donner pour modèle ; toutefois, chaque phrase le dit, qu’il n’y a jamais de modèle. C’est un point de vue.
16:16 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Jazz, Photographie
dimanche, 22 avril 2007
Vi/sites
Midi. Je viens de passer deux heures à écrire et publier, sur le blog privé familial (l'un de mes cinq ou six blogs), des récits de visites récentes et des photographies en grand nombre. Peut-être expurgerai-je certains de ces billets des références privées et en donnerai-je ici, pour la rubrique Sites & lieux d’Indre-et-Loire, une version plus documentaire (ou topographique). À cette occasion, j’ai découvert (car je cherchais des sites qui parleraient du prieuré Saint-Cosme) que Tinou a mis en ligne tout un album dédié au site du grand Ronsard.
En écoute : « Marcello » (Jean-Pierre Como/Trio. Padre. Bleu citron, 1989.) [C’est un album que j’aime beaucoup, pas du tout frénétique, très chantant, hautement mélancolique. Il m’accompagne depuis six ou sept ans. (Après nos débuts dans la vie, je suis devenu père.)]
14:04 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Ligérienne, Jazz
mercredi, 18 avril 2007
Under a Blanket of Blue
La chaleur s'est levée tard ce matin, et, sur le chemin du bus, sur les trottoirs à l'ombre, on supportait la veste. Mon fils voulait revoir l'exposition sur la planète Mars au Muséum ; les étages sont en travaux, mais nous avons pu voir, arrivé hier tout juste et installé aussitôt, haut, impressionnant, l'ours Willy empaillé, qui naguère s'ennuyait à mourir dans la fosse minable du Jardin botanique. Aujourd'hui, seule sa compagne lui survit, plus malheureuse que jamais, triste comme les pierres, et lui a été "naturalisé" (affreux mot mensonger).
-----------
Dans un coffret de Coleman Hawkins que j'écoute rarement (F.B.-S., l'ami fou de jazz des années Beauvais, perdu de vue désormais, aurait dit "ça, c'est du vieux jazz"), il y a de nombreuses gemmes, dont je me demande si certaines pourraient vraiment être jouées par les musiciens de jazz les plus déjantés / avant-gardistes de notre époque. Certains standards se prêtent à des reprises dissonantes, électriques, toutes de stridences et de ruptures de mélodie, mais franchement... Salt Peanuts ? Stompin' at the Savoy (dont j'ai toujours cru qu'il s'agissait d'une composition de Duke Ellington et dont je m'aperçois que l'auteur en est Benny Goodman) ? Just one of those things, de Cole Porter, ou On the Bean, sont, de ce point de vue, plus prometteuses.
12:41 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Ligérienne, Jazz
samedi, 14 avril 2007
Petit Faucheux, 13 avril : Lighting Up
Hier soir, au Petit Faucheux, deux quartettes proposaient leur lecture sonore de photographies de Jürgen Schadeberg. Musiciens non connus de moi, mais nous avions vu une belle exposition de Schadeberg lors de l’Été photographique de Lectoure, en 2005 (le jour même de la visite à Plieux).

Face à une salle où s’extasiaient des relents de cuisine (d’oignon peut-être), le batteur du Workshop de Lyon, Christian Rollet, arborant un t-shirt Vilnius Jazz Festival, présenta le projet, né de la rencontre entre le quartette Heavy Spirits et le sien autour du travail de Schadeberg, puis créé dans plusieurs clubs ou salles sud-africains avant de s’exporter vers la France, comme ici. Comme il a hésité ensuite sur le nom du bassiste de Heavy Spirits, on a pu supputer que ce n’était pas avec lui que les deux groupes avaient tourné jusqu’à peu.
Les quatre musiciens de Heavy Spirits (Gershwin Nkosi, remarquable à la trompette ; Paul Vranas puissant au sax ténor ; Vincent Molomo calme à la basse ; Garland Selolo plein de résonances à la batterie) ont joué un premier morceau seuls, puis le Workshop de Lyon (Rollet, donc, tout en doigté ; Jean-Paul Autin, sax sopranino et clarinette basse (très peu, trop peu cette dernière) ; Jean Aussanaire aux saxes alto et soprano ; Jean Bolcato à la contrebasse) a joué une composition en quattrosolo aussi, avant que les huit lurons ne passent au plat de résistance, autour d’un montage vidéo réalisé par Jürgen Schadeberg lui-même et de films brefs du même (notamment une longue séquence montrant le président Mandela serrant les mains de dizaines d’adolescents).
Les compositions étaient belles, plutôt simples, très rythmées, lorgnant très gentiment (c’est-à-dire sans risque d’effrayer les béotiens) du côté de l’avant-garde (Gershwin Nkosi soufflant dans le pavillon de sa trompette, voix pseudo-chamaniques dans le dernier morceau, stridulences diverses). Une rencontre très assurée, dialogue entre plusieurs cultures musicales, assez surprenant par certains côtés, car, dans plusieurs compositions, c’est le Workshop qui s’enferrait (s'encuivrait plutôt, d'ailleurs) dans des citations de musique populaire sud-africaine des années 50.
Pour le bis, Rollet a invité un habitué des lieux, le trompettiste Jean-Luc Capozzo, à rejoindre l’octuor. C’était un peu décevant, car ils ont repris une des compositions déjà jouées, en la diluant un peu (pour l’introduction de Garland Selolo notamment). J’aurais préféré un bis dans un style différent, peut-être une reprise de standard : il me semble que l’univers sonore diffracté qu’avaient su créer les deux quartettes aurait fort habilement trouvé à se résumer dans une composition comme Caravan, par exemple.
Cela dit, tout cela ne manquait pas d’intérêt, et les images de Schadeberg n’y sont pas pour rien ; elles ne gagnent pas forcément à la mise en mouvement. Certaines photographies se présentaient successivement par un détail, puis par l’ensemble, puis par un zoom avant pointant vers un autre détail, etc. Or, ces photographies sont toujours merveilleusement construites, et ne requièrent pas tout ce cinéma (au sens technique & au sens figuré péjoratif).
Reste que Schadeberg doit bien signifier montagne de la désolation… et que des musiciens prénommés Gershwin et Garland, ça n’est pas rien non plus. J’ai bien « craqué » aussi pour le jeu tout en nuances de Jean Bolcato, le contrebassiste, qui avait une pêche de pandémonium et tenait la baraque de tous les belzébuths (d’autant que les quatre souffleurs du pupitre d’avant faisaient une jolie brochette de diablotins).
11:15 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Jazz, Ligérienne
lundi, 09 avril 2007
Pêchez des arêtes chez votre rétameur
Totalement rétamé : rien avalé de la journée, mal au bide, e tutti quanti. Raconterai plus tard, donc, cette superbe journée Traduire Bob Dylan. On peut tout de même dire que la superbe photo en contre-jour qui ouvre le récit de François Bon représente mes collègues Fabienne Toupin et Stephen Romer, accompagnés (dans le bureau 44) de quatre étudiants, dont Tony et Maud. Tony nous a éblouis en fin de journée avec ses guitare & harmonicas.
Donc, patraque. (Pas une fois cette année, et ça tombe toujours au plus mauvais moment.) Je n'arrivais pas à dormir, alors j'essayais de lire, mais j'avais mal aux yeux, aux os, usw. Will someone stop me / From thinking all the time, comme dirait M. (qui n'est pas, ici, l'agaçantissime fils de Louis Chedid).
En attendant de nouvelles dylaneries (voire d'autres rinaldo-camuseries ou aussi extended Pynchoniana), je voulais vous faire écouter "Lexicon", un morceau du quartette de David S. Ware, dont j'ai parlé il y a quelque temps (mais tout le monde observa alors un silence poli ou gêné ou les deux).

18:36 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Ligérienne, Jazz
dimanche, 25 mars 2007
Petit Faucheux, 22 mars 2007 : David elsewhere
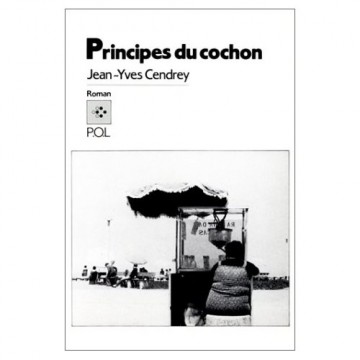 Cette fois-ci, je suis arrivé trop tard – mais quand même avec dix minutes d’avance – pour pouvoir m’asseoir derrière le photographe gesticulant (dont je devais m’apercevoir, quelque temps après, au cours du concert, qu’il a une odeur de sueur vraiment âcre, car il s’était assis sur une marche derrière ma place en bord d’allée, et, si je ne l’avais pas vu, mon attention fut attirée par une subite odeur de musc chaud que, me retournant, je ne manquai pas de lui attribuer).
Cette fois-ci, je suis arrivé trop tard – mais quand même avec dix minutes d’avance – pour pouvoir m’asseoir derrière le photographe gesticulant (dont je devais m’apercevoir, quelque temps après, au cours du concert, qu’il a une odeur de sueur vraiment âcre, car il s’était assis sur une marche derrière ma place en bord d’allée, et, si je ne l’avais pas vu, mon attention fut attirée par une subite odeur de musc chaud que, me retournant, je ne manquai pas de lui attribuer).
J’ai rêvassé en lisant la liste impressionnante des invités du festival Europa Jazz du Mans, lu les vingt premières pages – décidément c’est une habitude – d’un curieux roman, Principes du cochon de Jean-Yves Cendrey.
N’ayant, ce me semble, jamais entendu d’enregistrement du saxophoniste David S. Ware, je partais sans a priori, si ce n’est que je possède (et aime) deux disques du pianiste Matthew Shipp, qui l’accompagne en ce quartette. Aussi m’attendais-je peu au choc de ce concert exceptionnel. Jamais, même lors du concert de la Mingus Dynasty, à l’automne dernier, ou de la soirée consacrée à l’Instant Composers Orchestra en 2005, je n’étais sorti d’un concert organisé par le Petit Faucheux dans un tel état d’enthousiasme entre douceur et transe.
Il est difficile de parler de musique – d’écrire, mettre en mots une telle expérience, surtout lorsque, comme moi, on n’a aucune espèce de compétence. Suffirait-il de dire que pas une seconde les musiciens n’ont donné l’impression de faire du remplissage ? Non, car, si c’est déjà énorme, là n’était pas l’essentiel.
Dès l’entrée dans la salle bondée, le sax ténor de David S. Ware nous accueillait, posé au centre de la scène, sur le devant, et de l’instrument émanait déjà un je-ne-sais-quoi de rêveusement cosmique. Lorsque les quatre musiciens sont arrivés, la stature de David S. Ware marquait déjà l’entrée dans un autre monde. Otherworldly, as the English say. Il boite fortement, se déplace avec difficulté, mais jamais ne renvoie l’image de quelqu’un de diminué : au contraire, il semble le plus fort, dans tous les sens de l’expression.
Le quartette a joué quatre morceaux, plus un bis à couper le souffle. David S. Ware a annoncé les noms des musiciens juste avant le premier salut, pendant que le trio de ses acolytes continuait, sur la quatrième composition, de se livrer à des dialogues périlleux et envoûtants. En quittant la scène cette première fois, il a lancé : As we come in peace we go in peace. Après le bis, il a lancé : Namasté ! namasté ! J’ai su qu’il n’y aurait pas de ter.
 On pourrait dire – cela a dû être dit – que David S. Ware est un fils spirituel de Coltrane. Assurément, son jeu doit beaucoup au dernier Coltrane, celui des First Impressions et de Transition. Mais il y a là tout autre chose aussi : un désir de pousser plus avant certaines audaces ; un refus de l’élévation immédiate, de l’envol spirituel for the sake of it. Alors, on se dit que, si Coltrane jouait surtout sur les possibilités de l’air, David S. Ware joue de tous les éléments, et fait se rencontrer – dans son phrasé, dans ses déhanchements sonores – le feu et la terre, l’eau et l’air. Quelque bachelardien piqué de musicologie pourrait développer… Dans les influences, on sent aussi l’ombre bienveillante d’Ayler, mais à mille lieues des déconstructions savantes d’un Anthony Braxton (que j’admire aussi, dans un autre style).
On pourrait dire – cela a dû être dit – que David S. Ware est un fils spirituel de Coltrane. Assurément, son jeu doit beaucoup au dernier Coltrane, celui des First Impressions et de Transition. Mais il y a là tout autre chose aussi : un désir de pousser plus avant certaines audaces ; un refus de l’élévation immédiate, de l’envol spirituel for the sake of it. Alors, on se dit que, si Coltrane jouait surtout sur les possibilités de l’air, David S. Ware joue de tous les éléments, et fait se rencontrer – dans son phrasé, dans ses déhanchements sonores – le feu et la terre, l’eau et l’air. Quelque bachelardien piqué de musicologie pourrait développer… Dans les influences, on sent aussi l’ombre bienveillante d’Ayler, mais à mille lieues des déconstructions savantes d’un Anthony Braxton (que j’admire aussi, dans un autre style).
Mais il ne faut pas parler du leader saxophoniste seul. Déjà, ses temps de jeu sont inférieurs à ceux du pianiste, du contrebassiste ou du batteur, ce qui ne signifie pas qu’il s’épuise plus vite (il n’en donnait aucunement l’impression, en tout cas) mais que les modulations de son sax poursuivent leurs résonances en ramifications dans le jeu des autres musiciens. Matthew Shipp est un pianiste fabuleux, autant dire de légende en dépit de son jeune âge : à l’aise dans une multitude de modes de jeu (art de la ballade, tripotages de harpe à l’intérieur du piano et plaqués véhéments entre autres), il ne cède jamais à la facilité, ni ne roule des mécaniques. Chaque note, chaque cluster, chaque proposition se trouve là pour donner consistance à l’univers en création, pour lancer le batteur, tendre une ligne à son leader, entrer avec le bassiste dans un dialogue de cordes.
Que dire, alors, du contrebassiste, William Parker ? Dans les modes de jeu avant-gardistes (archet sul ponticello ou à l’extrême altitude, avec étirement des cordes), son instrument rendait des sons d’une grande pureté, ce qui, chez bien des contrebassistes experts, ne va pas de soi. Même sous les furies emportées énergiques du ténor, il laissait entendre ses propres envols, concomitants mais jamais simplement supplétifs.
Enfin, quoi qu’il porte, à peu près, mon prénom, j’ai été moins convaincu par le batteur, Guillermo E. Brown, plus enclin – à de rares moments toutefois – à la débauche gratuite, voire au m’as-tu-vuisme. Il faut dire, à sa décharge, qu’on aurait l’air vite pâle à côté de tels lascars, mais aussi que, dans tous les moments de dialogue (soit avec le bassiste soit – moment d’anthologie du troisième morceau – avec le pianiste, en litanies et répons), il livrait sa partie avec justesse et brio.
Aucune photo tourangelle pour accompagner ces quelques paragraphes ? * Il faudra que je me jette à l’eau (de toilette) et ose aborder le photographe pour lui proposer de m’en envoyer quelques-unes, moyennant paiement, à mon adresse électronique. Pour ce qui est de vous faire découvrir la musique de ce quartette, il me suffit de vous conseiller d’aller l’écouter en concert s’il passe près de chez vous, ou d’en acheter les disques.
* La photographie en noir et blanc de David S. Ware
qui illustre ce billet a été publiée par John Rogers sur FlickR.
12:10 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jazz, Ligérienne
samedi, 24 mars 2007
Que hume le jaseur…
Tiens ! je croyais l'avoir publiée en son temps, celle-ci :
9 mars. Sur l’album enregistré en 2000 par le quatuor de Jim Black, il y a une composition intitulée “Auk and Dromedary”. Ford Madox Ford n’appelait-il pas le roman qui l’a fait passer à la postérité, The Good Soldier, « my great auk’s egg » ? Ce sont bosses de dromadaire, seules éloignées, isolées. Je continue de préférer, encore et toujours, The Rash Act et Parade’s End.
Hier matin, au réveil, j’avais quatre livres en cours de lecture ; hier soir, deux seulement. Entre-temps, j’en avais fini trois, et commencé un autre. Cet autre est bientôt terminé, et j’en parlerai bientôt : il s’agit du récit de Michèle Laforest, Tutuola mon bon maître, préfacé par Alain Ricard.
Heureusement, d'ailleurs, car j'ai fini de lire le roman de Michèle Laforest il y a quinze jours, et je n'en ai toujours pas soufflé mot.
15:05 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Jazz, Landes, Afrique, Littérature, écriture
mercredi, 14 mars 2007
Petit Faucheux, 13 mars 2007
Cédric Piromalli / Patrice Grente / Pascal Le Gall
John O' Gallagher Trio
Huit heures et demie.
Je me suis assis derrière le photographe. À chaque fois, si je le peux, je m'assieds derrière le photographe, toujours le même photographe, qui gesticule, couvre son colossal objectif avec son écharpe ou son pull, et se contorsionne parfois à même le sol. Et lu trente pages de ce livre laconique acheté l'après-midi même. Lu en entendant le murmure des voix et la rumeur monter, comme arrivaient les spectateurs. D'ordinaire, je ne lis, ni n'écris. Me contente de regarder, observer aux alentours, écouter, ou quand je ne suis pas seul discuter. Ce soir lisant, je m'imaginais la scène en fonction de mes observations des autres fois. Devais être d'autant moins loin du compte que ce sont toujours peu ou prou les mêmes habitués ici. Une agglomération de 200.000 habitants, et toujours dans la salle de jazz de 200 places plus ou moins les mêmes visages.
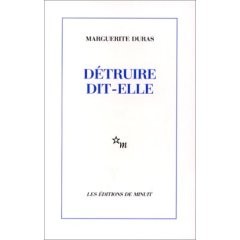
--- Dis, tu le connais, toi ?
--- Pas du tout.
--- Tout le monde le connaît pas du tout.
**************
Ce mercredi matin, les phrases d'hier soir recopiées, je veux tracer quelques signes pour fixer ce concert dans ma mémoire. J'étais déçu. Pas parce que ça n'était "pas bien", ou parce qu'un des deux sets était mauvais, non. Pour des raisons différentes, chaque set m'a laissé sur ma faim.


Piromalli (voir photo ci-contre) est un pianiste remarquable, qui, s'il a su montrer qu'il maîtrisait les facettes les plus classiquement virtuoses de son instrument, a surtout joué des poings, du dos des mains, brutalisant avec doigté son Steinway qui, tout en se demandant ce qui lui arrivait, déployait une vraie palette d'harmonies tumultueuses. (Voyez, je trouve quand même d'autres adjectifs.)
D'où alors vint ma déception ? du peu de résistance de mes oreilles, tout simplement. C'était trop intense, trop long, par rapport à la sursonorisation, travers de l'époque & surtout défaut récurrent du Petit Faucheux. À la pause (entr'acte ? entre-deux-sets ? mi-temps ?), j'ai mis trois bonnes minutes à me remettre les acouphènes en ordre de marche. Peut-être suis-je vieux jeu, un vieux râleur monotone, mais je ne vais pas au concert par hâte ardente de rapprocher le moment où je devrai porter un sonotone.
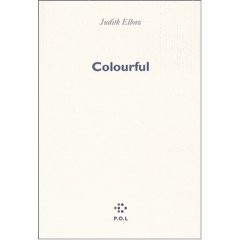
Pour ce qui est de la deuxième partie, elle était, quoique plus colorée, plus chromatique, franchement frustrante. John O' Gallagher est certainement un excellent saxophoniste, qui n'est pas sans rappeler Steve Lacy (ce qui, pour moi, est un compliment), mais il n'a rien à raconter. Rien de rien à dire. Toutes ses interventions se ressemblaient, et son phrasé toujours identique a fini par faire fuir la plupart des spectateurs avant même la fin du set. C'est dommage, d'ailleurs, car Jeff Williams est un très bon batteur, pas très inspiré, malheureusement, par la soupe fadasse de son leader.
Seul le contrebassiste, inconnu de moi, s'en tire with flying colours. Il s'appelle Masa Kamaguchi, ne doit pas être bien vieux, a déjà un CV long comme le bras, et sait (qu'il accompagne, métronome aux effets imprévus, ou qu'il parte en cavalier solitaire) faire ce qu'O'Gallagher a jeté aux orties : raconter, de ses cordes tendues, une histoire. Si Patrice Grente avait, au cours de la première partie, montré tout ce que l'on peut faire, en frénésie, d'une contrebasse, jusqu'à faire tomber son archet à trois mètres de lui et à manquer chuter lui-même, Masa Kamaguchi a, de ses doigts seuls, distillé des notes tenues, retenues, subtilement relâchées, toujours au point d'équilibre et jamais loin du point de rupture. Un musicien à suivre...
11:30 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Ligérienne, Jazz, Littérature, écriture
jeudi, 22 février 2007
Scrapple from the Apple
S'il faut reprendre, peu à peu, pied dans l'écriture,
ne faut-il partir du réel le moins tragique, le plus heureux ?
Ce midi, au Cap Ouest (où je n'avais pas remis les pieds depuis des semaines), tandis que j'attends mon plat du jour, une des habituées, assise sur un tabouret au zinc, fait remarquer qu'il y a un insecte au sol. Le frère du patron dit que c'est une punaise. Faut pas l'écraser, sinon ça pue. Il prend un sous-bock et, d'un geste prévenant, ramasse la punaise que, plus vivement, la porte de bois et de verre ouverte, il expulse. La punaise retombe sur le dos. De ma place, je la vois se démener. Je suis très impressionné par ses talents pour la reptation, dans cette inconfortable posture c'est rare. Je la regarde. Des secondes passent. Une éternité. Je finis par me décider, saisis un prospectus du Clos Lucé et sors, me penche, redresse la punaise que, assis de nouveau et scrutant le trottoir, je vois s'envoler.
À mon retour dans le bistrot, j'ai vu la jeune femme du comptoir me lancer un regard amusé. Le ridicule ne tue pas, et je sais que je n'étais pas pleinement ridicule. Je suis même rasséréné, car je ne supportais pas de voir la punaise se démener ainsi sans parvenir à se remettre d'aplomb.
Le miles gloriosus, lui, serait sorti, éméché, et l'aurait écrasée d'un coup de talon imbécile.
12:50 Publié dans Jazeur méridional, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Ligérienne
jeudi, 08 février 2007
Synesthésies / nostalgies
Parfois, quand je travaille, Pandora m'accompagne, et de son tonneau des Danaïdes où sans fin on puise sans s'épuiser, m'envoie des musiques que je ne connaissais pas avant. Ainsi, des différentes "stations" que j'ai créées, plusieurs, évidemment, sont principalement consacrées au jazz.
Sur la chaîne John Zorn, par exemple, se succèdent différents morceaux de différents groupes/ compositeurs/ interprètes, tout cela dans la joyeuseté du bazar imprévu. Tout d'un coup, j'entends des notes, un instrument indien, et, avant même de dire que je connais ce morceau, je revois le papier peint de notre studio, à Talence, en 1996 ; je marche le long des cours bordelais ; nous sommes, toi et moi, dans le bus qui nous conduit au cinéma. Dans la cuisine exiguë nous mangeons en discutant de tout et de rien. Je fais réparer cette maudite latte en verre de la fenêtre d'aération. Il fait grand soleil, chaud près du parc Peixotto. Allongés dans l'herbe, nous regardons des bambins près d'une poussette.
Je ne saurais pas retrouver le titre du morceau, mais je sais que c'est un album de John McLaughlin. Je n'ai guère dû écouter The Promise depuis ces années-là.
10:10 Publié dans Hors Touraine, Jazeur méridional, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Ligérienne, écriture
jeudi, 25 janvier 2007
Ce que dit le pagure Kenny Craig
Cavere, par le Zeena Parkins Pan-Acousticon, ça déménage ; méfiez-vous des cabots et plus encore des demoiselles qui les promènent. Il y a des livres à un euro à la Boîte à Livres de l'Etranger ; des livres qui valent le coup. Harpe et violoncelle, piano qui se disloque. Il doit faire moins cinq à Tours demain matin. Après une matinée passée à régler des subtilités d'emploi du temps, je vais aller faire le guignol au lycée Jean-Monnet, pour un déjeuner de travail (comme je crois qu'on dit). En revenant de la Poste, j'ai croisé une étudiante qui, me voyant le nez coulant, les yeux injectés, les mains violacées*, m'a souhaité bon courage pour mon rhume, ce qui était très gentil (mais l'hiver seul est coupable). Maudit soit ton nom, Salamine ! Un ami m'a écrit qu'il aurait bientôt, peut-être, un poste à Tours. * On se croirait dans Dracula, ou, allez savoir, dans les Récits de la Kolyma (où les crachats gèlent en vol). Formons des souhaits. À huit heures, sur le pont Mirabeau, la vitre côté conducteur a finalement accepté de se baisser**. Peasant Boy par le trio de Bob James, ce n'est pas mal non plus ; on est sur la route, maintenant, à regarder le rideau de pluie, les affaires empilées à l'arrière du camion (bâché, bien sûr). Dormez tous, je le veux. ** Je sais, il ne faudrait jamais démarrer sans avoir conscieusement raclé les vitres et dégelé l'ensemble des points de vision. Look into my eyes, not around the eyes, look into my eyes. Vous repartez au charbon, mais c'est l'engrais qui ici culmine.
10:45 Publié dans Jazeur méridional, Le Livre des mines, Moments de Tours, WAW | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Ligérienne, écriture
lundi, 22 janvier 2007
... die Mantis wieder im Magen...
Jeudi soir, au Petit Faucheux, première des trois soirées "Carte blanche à François Couturier". En première partie, duo et trio du pianiste avec le clarinettiste Jacques Di Donato et le violoniste Dominique Pifarély. En deuxième partie, sans le clarinettiste, violon et piano s'accrochaient aux mots chantés par le haute-contre Dominique Visse.
Si l'on excepte ce dernier, je connaissais les musiciens, dont je possède quelques enregistrements. La première partie était de l'ordre de ce que, pour rétorquer aux puristes du jazz (un paradoxe, cette expression), l'on appelle souvent "musiques improvisées contemporaines", mais la seconde était entièrement écrite, jouée sur partition, avec même trois lieder très académiques de Toru Takemitsu.
Peut-être était-ce le sérieux guindé des interprètes, leur système pileux, l'ambiance actuelle qui ne se prêtait guère à écouter un spectacle aussi avant-gardiste, ou encore l'impression d'assister à un concert tel que les ont mille fois parodiés les gens qui veulent se moquer de la musique contemporaine... toujours est-il que je n'ai pas accroché.
(Et dire que lors du précédent concert au Petit Faucheux (Paradigm + Riccardo del Fra et ses p'tits jeunes), je n'ai pas publié de billet, alors que j'avais tant aimé...)
Entendu ce soir-là (à vous de deviner laquelle des phrases ne provient pas des textes chantés par le haute-contre mais fut entendue lors de l'entracte) :
... plus d'air encore que l'air ...
... die Mantis wieder im Magen des Wald...
... comme par une dénudation de la montagne...
... toiser le bleu qui éraille...
... mais la deuxième partie, ça sera pareil ? ...
08:00 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Ligérienne, Jazz
vendredi, 19 janvier 2007
Ferraillons ferme

Il y a un moment, dans la septième partie du disque mythique d’Anthony Braxton For Alto, où le saxophone s’approche du son d’une whistling kettle, et tout ce qui suit, tout ce qui précède, justifie totalement cette stridence ponctuelle. Not so yesterday, mais tout le monde n’est pas Braxton.
*********************
Là, je reviens, lessivé, du S.I.L., qui ne s’appelle plus comme ça. Le Salon d’Information des Lycéens (comme naguère il s'appelait) se tient à Rochepinard, l’une des plus hideuses fertiles friches urbaines de l’agglomération tourangelle. Lessivé je suis, car brouhaha, et redire cinquante voire cent fois la même chose. Toutefois, en discutant avec l’étudiante qui nous aidait – et que je n’avais jamais rencontrée –, j’ai appris qu’un(e) collègue était surnommé(e) Capitaine Crochet, et, quoique je n’aie pas réussi à découvrir l’identité du ou de la collègue, l’idée que les étudiants donnent encore des surnoms aux professeurs, pratique pourtant en constant recul depuis trois décennies, m’a réjoui. Me reste à cogiter.
Entre-temps, une étudiante de troisième année est venue souffler à l'oreille de G.I. qu'il y avait des filles peu vêtues en pleine démonstration d'épilation au stand des formations d'esthéticienne. "Ta réputation, lui ai-je soufflé, n'est plus à faire." Comme j'apprenais, toujours par l'étudiante "cafteuse", qu'un autre encore de mes collègues était surnommé l'Obsédé, cela m'a surpris, car, étant donné le désarroi évident (voire les gloussements incrédules et puérils) des étudiants dès que, lors d'une analyse littéraire, l'on cherche à s'interroger sur les connotations sexuelles implicites d'un texte, je pensais que tous les enseignants de littérature passaient pour des obsédés.
*********
À l’aller, cinq chansons de Dylan, dans les confitures de circulation, et au retour deux seulement, filons sur le pont Mirabeau (embourbé ce matin, pas permis). Je ne fais pas les soldes, mais un beau pull coloré tout neuf m’est tombé tout rôti dans le bec. Même quand je mens, c’est vrai (titre de Stomy Bugsy, excusez la référence).
16:55 Publié dans Autres gammes, Jazeur méridional, Moments de Tours, WAW, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Ligérienne, Photographie, écriture
mardi, 16 janvier 2007
Out Right Now
La journée commence évasive, chaloupée, chancelant entre les embarcadères. Quelques frissons frustes qui parcourent l'échine, et le trottoir slalome doucement, comme si c'était le soir, tard, le pas incertain d'un qui aurait éclusé ses trois bouteilles de champagne (on ne lésine pas). Ansgar Ballhorn est tout ouïe, et, le casque vissé sur les oreilles, une cigarette aux lèvres, ne quitte des yeux ni les doigts fragiles du violoniste ni la balance des graves. À la marge, quelques grammes de gaz s'échappent du flambeau, mais c'est encore autre chose, quand le bois s'éveille et met au monde ses loups, ses monstres, des manteaux de brouillard. Bien sûr, il y aura d'autres ruses, dans le futur, mais ce ne sera jamais plus ces notes ténues non tenues, ces flûtes absentes, ce sentiment de râpé dans les brisements.
Oui, d'autres décalcomanies sonores, des forces souterraines. Aujourd'hui, l'épiphanie, comme en 1995, n'éveille pas de torpeurs malsaines.
18:00 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Poésie, Jazz, écriture
lundi, 15 janvier 2007
The Gig
Entends cette mélodie J'entends donc cette mélodie Je l'écoute me laisse absorber
Décrochages de piano Fusées cymbales Une des lignes a tout d'une carioca
..........................
Quand même tout cela est inclassable Cette mélodie l'écouter
Puis, je découvre que c'est The Gig dans la version originale de son compositeur Herbie Nichols, avec (peut-être) Max Roach à la batterie. Il y a quelques jours, j'ai découvert ce morceau tout à fait génial sur un album du trompettiste Dave Douglas avec son Tiny Bell Trio. Dois-je l'avouer (à ma courte honte (mais pourquoi courte, d'ailleurs ?)), je ne connais pas du tout Herbie Nichols, pianiste surtout actif dans les années cinquante. Eh bien, ça m'a l'air d'être un oubli à réparer de toute urgence.
En écoute : "I've Got My Love to Keep Me Warm" (version non datée de Dick Hyman, pianiste que je connais moins encore (très Erroll Garner quand même))
14:15 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jazz



