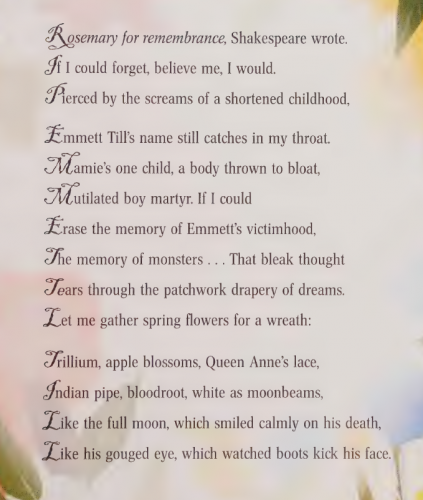jeudi, 26 février 2026
Off Minor / Salem
Ma mère a mis sur la platine – c’est un lecteur multi-CD, en vrai – un album du projet Africa Express de Jacques Ponzio que je n’avais pas écouté depuis un moment. Tout en traduisant, je m’absorbe dans la musique, jusqu’à devoir me lever car j’étais persuadé qu’un des titres était une composition de Monk. On sait l’importance de Monk pour Jacques Ponzio ; c’est son grand modèle. Cette composition, Salem, est sans doute très monkienne, mais elle n’est pas de Monk. Une demi-heure plus tard, écoutant d’une oreille plus distraite l’album suivant, je finis par me lever de nouveau, car je veux vérifier qu’il s’agit bien cette fois-ci d’une composition de Monk : c’était effectivement Off Minor par Tineke Postma, avec son quatuor.
Après le chapitre 32, fini au forceps ce matin, j’ai entamé le chapitre 33 (dont le titre est en mandarin un truc de moins à traduire !) et j’en ai traduit 4 pages, entre la promenade « par chez Daillat » (avec la puanteur d’ensilage juste avant le pré des chevaux) et quelques chapitres de la biographie de Nina Simone.
17:27 Publié dans 2026, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 05 janvier 2026
Quinze sonnets en couronne pour Emmett Till
Il y a quelques jours, mon ami L.L.P. – on ne s’est jamais rencontrés mais on échange si souvent depuis 2005 que je pense à lui comme à un ami – a évoqué une couronne de sonnets qu’écrirait ces jours-ci André Markowicz, ce que je ne pouvais savoir vu qu’A.M., après qu’on a travaillé ensemble et entretenu toute une correspondance entre 2005 et 2019, m’a bloqué et a coupé les ponts avec moi de façon irréversible, tout ça parce qu’il a refusé d’admettre sa part d’erreur dans la terrible affaire dite des Suppliantes…
Bref… La couronne de sonnets est une forme qui me fascine, mais que j’ai peu explorée. Voici que j’ai écrit à Laurent :
Je peux te conseiller la magnifique couronne de sonnets (héroïque – ça signifie que le quinzième sonnet est constitué des 14 premiers vers des 14 sonnets) que Marilyn Nelson a écrite en 2005 à la mémoire d’Emmett Till, adolescent afro-américain assassiné et mutilé par des lyncheurs blancs en 1955 (l’histoire a donné lieu à quelques morceaux de jazz aussi, on peut rechercher ça). Le livre (15 sonnets donc, le dernier étant un acrostiche RIP-EMMETT-L-TILL) s'intitule A Wreath for Emmett Till. Pas traduit bien sûr.
Visiblement, je m’étais trompé, et il n’y a pas eu d’hommage direct et explicite, ou de réaction musicale liée directement à cet assassinat. Laurent m’a signalé une pièce de Vijay Iyer ainsi que Wadada Leo Smith, que je connaissais pas du tout (cf le morceau en trio, “Billie Holiday - A Love Sonnet”), et Preacherman de Melody Gardot.
J’ai alors répondu ceci :
Je sais que je connais Vijay Iyer, car je dois avoir des feat. D’icelui sur quelque album par là — ou est-ce ma mère ? dois-je lui écrire, au risque de lui faire passer une nuit blanche si elle ne trouve pas dans sa discothèque ?
Bref, aussitôt lu aussitôt branché sur “Billie Holiday - A Love Sonnet” du dit trio. Très puissant (quoique intro un peu longue de JDJ, qui m’ennuie généralement).
Sinon, peut-on considérer qu’avec “Mississippi Goddamn” Nina Simone rendant hommage à Medgar Evers et dénonçant son assassinat écrit par rebond aussi sur Emmett Till, vu qu’Evers avait fait rouvrir le dossier judiciaire autour de l’assassinat d'Emmett Till ? Black Lives Matter, ça ne s’arrête pas. Y aurait-il aussi “Bright Mississippi” de Monk dans l'affaire ? Sinon, Emmylou Harris, mais on s’éloigne du jazz. Le reste se trouve dans la rubrique, très dense, ‘Representation in culture’ de l’article de la Wikipédia anglophone.
Mais comme Laurent m’avait signalé être désireux de lire une traduction, si possible respectant la forme, sinon de l’ensemble du recueil, du moins du quinzième, je note ceci ici, avec capture d’écran de cet acrostiche dans sa version imprimée. Mais comment traduire un sonnet en respectant la contrainte des rimes, le sens et l’acrostiche ? Dès le vers 2 (If → Si), ça déraperait…
07:29 Publié dans 2026, Chèvre, aucun risque, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 20 août 2025
20082025
Le 4 novembre dernier, Quincy Jones est mort. Je connaissais mal son œuvre et ai donc simplement posté ceci sur Facebook :
Quincy Jones vient de mourir. J'ai hésité à poster “Wanna Be Startin' Something”, évidence. Mais voici une version de “I Love Paris” par Zaz, dans une traduction de Mathieu Boogaerts, et donc produite par QJ.
Aujourd’hui nous avons fait la route en écoutant notamment deux disques du big band de Quincy Jones, empruntés à ma mère ; cela remonte aux années 1950. Très big band des années 50, mais efficace. Et un sacré trompettiste aussi.
14:34 Publié dans 2025, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 27 janvier 2024
Touche pas à mon peuple
Enfin pris le temps de lire le petit essai que Claire Sécail consacre à une lecture de l’émission de Hanouna – et à tout le système qui l’accompagne – comme d’une démarche populiste.
Moi qui lis très peu de sciences politiques, ça m’a permis d’affiner la définition même de populisme, que Claire Sécail appuie sur les travaux de Cas Mudde et Cristobal Rovira Kaltwasser (« idéologie peu substantielle ») :
Cyril Hanouna élabore un système de valeurs bien plus qu’un système de pensée : chez lui, les qualités humaines sont un moteur plus important que les idées pour concevoir l’organisation et les objectifs d’une société. […] En effet, la morphologie rudimentaire et malléable du populisme fonctionne comme un moule dans lequel peuvent se côtoyer plusieurs « idéologies denses »… (p. 52)
Moi qui ne regarde jamais Hanouna (mais vois passer les séquences les plus choquantes, celles qui devraient valoir des sanctions de l’ARCOM), ça m’a permis d’avoir une meilleure vision de l’histoire de cette émission, et surtout de l’évolution tant de l’émission elle-même que de Hanouna en tant qu’animateur/prescripteur manipulateur. En un sens, ça a commencé ainsi : « Registre verbal simple, direct et fleuri d’argot, identification à l’ « homme de la rue », valorisation de l’inculture, stéréotypes sexistes, familiarité avec les invités : ce style est mis en avant pour rejeter le langage technique ou précieux attribué aux élites et ainsi faire corps avec le « sens commun » du peuple. » (p. 17) Et ça se poursuit / termine ainsi : « Le gagnant ? L’extrême-droite politique et culturelle, qui a bien compris l’intérêt d’investir la scène d’un divertissement dévoyé pour y promouvoir la version ripolinée de sa guerre de civilisation et imposer des idées d’autant plus dangereuses qu’elles avancent au nom d’un bon sens populaire. » (p. 77)
Ça coûte 6 euros, ça se lit en une heure, et c’est indispensable.
En écoute – un des disques offerts par ma mère : le disque de 2001 du trio de Sylvain Beuf (avec Diego Imbert à la contrebasse et Franck Agulhon à la batterie). Je connaissais ce disque, écouté chez ma mère quand elle l’avait acheté, back in the days. Il y a des compositions magnifiques (‘Ornette’ / ‘Catering de Médicis’ / ‘31 janvier’), et cette formule du trio m’évoque – un cas flagrant de plagiat par anticipation – les disques du groupe tourangeau Steak !
15:00 Publié dans Jazeur méridional, Livres 2024, Musiques 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 07 janvier 2024
07012024
Après une trouée de soleil, la grisaille est revenue. Je suis allé jusqu’au lieu-dit de la Vinogerie à Chanceaux, puis je me suis réattelé à quelques bricoles, en l’occurrence à écrire des mails de vœux de bonne année en écoutant Kind of Blue sur la platine que C* m’a offerte pour mes 49 ans.
C’est étrange : avec ce principe d’écrire un billet même bref et mal construit pour chaque livre lu, je me retrouve à hésiter à poursuivre la série je range mon bureau, mais aussi sans nécessité de publier d’autres billets.
Au début de l’année, j’ai créé la sous-rubrique Disques 2024 dans l’idée surtout d’évoquer les nouveaux disques. Mais voici qu’après avoir redescendu au sous-sol les quatre Zappa de décembre, j’ai remonté tous les Miles Davis hérités de mon beau-père – et donc j’écoute Kind of Blue ; à cet instant précis, “All Blues” même. Le solo de Coltrane au ténor n’est pas du tout coltranien. S’il n’y avait pas le nom de Coltrane sur la pochette, je n’entendrais pas Coltrane. D’ailleurs je n’entends pas Coltrane. (Et depuis combien de temps n’avais-je pas écouté cet album ultra-classique ?)
Tu parles d’un nouveau disque.
Oui, mais c’est nouveau, puisque par exemple, de toutes les années hagetmautiennes, jamais je n’avais lu le texte de pochette, un texte qui s’intitule “Improvisation in Jazz” et dont l’auteur est le pianiste, Bill Evans. (C’est un peu claudicant, d’ailleurs, comme lecture ou comme découverte, car le piano est le seul instrument qui résonne de façon décalée avec cette platine vinyle (rien à faire).) Ce texte commence ainsi :
There is a Japanese visual art in which the artist is forced to be spontaneous. He must paint on a thin stretched parchment with a special brush and black water paint in such a way that an unnatural or interrupted stroke will destroy the line or break through the parchment. Erasures or changes are impossible. These artists must practice a particular discipline, that of allowing the idea to express itself in communication with their hands in such a direct way that deliberation cannot interfere.
Hier, Patrice Nganang écrivait que tous les portraits photo en couleur de Miles Davis étaient ratés : « C'est littéralement comme ces actrices qui avaient raté le passage du muet au parlant. » Armelle Touko l’a contredit avec cette image-ci, à raison.
14:55 Publié dans Jazeur méridional, Musiques 2024, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 19 décembre 2023
19122023 — Hot Rats (ou “ratas calientes” ?)
Ce matin j’écoute des albums de Frank Zappa. J’aime beaucoup la musique de Frank Zappa, mais comme souvent mes connaissances sont parcellaires, en pointillés. Par exemple, j’ai tendance à penser que mon beau-père, dont C* a hérité d’une belle collection de vinyles et de bandes dessinées, avait beaucoup de disques de Zappa. En effet, il en avait une douzaine. Or, en voulant vérifier quelque chose dans la discographie de Zappa, j’apprends qu’il a publié 62 albums de son vivant, sous son nom ou avec les Mothers of Invention. Certes, ce nombre couvre les albums live, mais tout de même cela remet en perspective le beaucoup ci-dessus…
Le premier album que j’aie possédé de Zappa, c’était son dernier album avec l’Ensemble Intercontemporain, The Yellow Shark, car j’avais regardé la version concert sur Arte avec ma mère juste après la mort de FZ, et elle me l’a offert quelque temps plus tard. C’est d’ailleurs elle aussi qui m’a offert, pour mes 24 ans, quelques mois après notre installation en Picardie, mon autre disque de FZ, le coffret Läther (posthume celui-ci, mais qui n’est pas tout à fait une anthologie, puisqu’il a été construit par FZ de son vivant, avec des ajouts, des transitions et des inédits). Je n’ai jamais acheté d’autre disques de FZ, car justement il y en avait un bon paquet à Hagetmau, chez mes beaux-parents.
J’en viens au quelque chose que je souhaitais vérifier, à savoir, en écoutant Hot Rats, le deuxième album de FZ sous son nom seul : en effet, avec la pochette sous les yeux, il n’y avait pas moyen de savoir qui jouait du sax ou de la clarinette. Wikipédia m’a vite appris qu’il s’agissait d’Ian Underwood, multiinstrumentiste qu’on entend sur tous les albums des Mothers of Invention.
 La pochette est donc lacunaire. C’est alors que je me suis aperçu que les titres de plusieurs pièces étaient en espagnol. Vérification faite, une fois encore, ces titres (Debe ser un camello ou Hijo del Sr. Green Genes) ne sont répertoriés nulle part dans les éditions et rééditions de l’album. Le 33-tours que mon beau-père avait acheté à Bordeaux était donc l’édition espagnole, dans laquelle même plusieurs titres de chansons ou pièces avaient été traduits.
La pochette est donc lacunaire. C’est alors que je me suis aperçu que les titres de plusieurs pièces étaient en espagnol. Vérification faite, une fois encore, ces titres (Debe ser un camello ou Hijo del Sr. Green Genes) ne sont répertoriés nulle part dans les éditions et rééditions de l’album. Le 33-tours que mon beau-père avait acheté à Bordeaux était donc l’édition espagnole, dans laquelle même plusieurs titres de chansons ou pièces avaient été traduits.
 D’après l’étiquette figurant sur le disque même, il semblerait que cette édition date de 1971, deux ans après l’édition originale. J’avoue avoir du mal à imaginer des disquaires madrilènes vendre cet album sous Franco, mais je sais que la censure en Espagne sous la dictature était, elle-même, passablement en pointillés.
D’après l’étiquette figurant sur le disque même, il semblerait que cette édition date de 1971, deux ans après l’édition originale. J’avoue avoir du mal à imaginer des disquaires madrilènes vendre cet album sous Franco, mais je sais que la censure en Espagne sous la dictature était, elle-même, passablement en pointillés.
09:08 Publié dans 2023, Autres gammes, Blême mêmoire, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 30 mars 2023
30032023
Aujourd’hui, je vais avoir presque une journée calme.
En effet, et même si c’est regrettable, je n’ai pas à conduire Mariam Sheik Fareed de son hôtel à la gare, vu qu’elle n’a pas pu venir. Et Dominique Meens, avec qui je devais déjeuner puis promener sur les bords de Loire en guettant les cormorans et ce qu’il pourrait m’en souffler, est déjà rentré dans ses pénates (le passage par Tours devait être une halte).
Je vais simplement passer à mon bureau, toujours inaccessible comme le reste du site Tanneurs ; le doyen va m’ouvrir pour une petite demi-heure, le temps de faire quelques tirages avec le photocopieur-scanneur. Et sinon je vais saisir dans le tableau Excel transmis par le décanat toutes les modifications de modalités de contrôle demandées par les collègues et responsables de matière.
En train d’écouter le premier album du quatuor Enez, déniché à la FNAC presque par hasard lundi dernier, en regardant les nouveautés. Il se trouve que ce quatuor très chantant, très mélodieux, très mélancolique aussi, est constitué autour du pianiste/compositeur Romain Noël, avec Florentin Hay à la batterie, Ivan Gélugne à la contrebasse et enfin Paul Cadier au sax ténor. Or, jeudi dernier, lors de la manifestation post-49.3, j’ai discuté un moment avec Paul, que je n’avais pas croisé depuis une éternité, qui fut le prof de saxo d’A*, et dont j’avais un peu perdu de vue la carrière. Il m’avait confirmé que les années Covid avaient été un creux assez terrible mais qu’un nouvel album du trio Steak (son premier projet) allait voir le jour bientôt, mais aussi qu’il s’était beaucoup investi dans un medium band afrobeat nommé Jumbo System. Je n’ai pas encore eu/pris le temps d’aller écouter ça (mais je note ici cet oubli, à réparer).
L’album Enez est très varié, en fait : malgré le caractère souvent mélancolique, certains morceaux sonnent presque comme du Steve Coleman ou comme le quartette de Coltrane à l’époque My Favorite Things, sauf que Paul est vraiment toujours davantage plus du côté de Rollins et Lovano, il me semble (ou Rob Brown, tiens, dont je crois n’avoir qu’un disque, avec William Parker – Petit Oiseau, 2008), avec une recherche sonore dans les échanges entre basse et piano qui évoque un peu de mes disques préférés du contrebassiste William Parker, avec Sophia Domancich (Washed Away, 2008).
08:54 Publié dans 2023, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1)
vendredi, 03 mars 2023
03032023
Guère eu de temps, aujourd'hui, pour continuer des écoutes Shorter.
Ici maintenant même c'est cet unique CD, en duo avec Hancock bien sûr, et tout au sax soprano (qu'il aura (hélas ?) moins pratiqué le ténor), grandes émotions. "This is the evanescent made eternal." – dit le texte de pochette. Rhétorique ampoulée mais ici d'une totale et brûlante vérité. Et j'ai d'autres enregistrements avec Shorter (à commencer par le quintette de Miles), mais ce seul CD avec son nom et son visage sur la pochette. JU-JU, une de mes épiphanies de 97-98, je l'avais emprunté, figurez-vous, et ne l'ai plus.
Et donc ce seul CD, qui nous vient d'ailleurs du père de C*, qui m'a à peu près fait découvrir tous "mes fondamentaux" de jazz, Ayler, Lacy, Monk, Coleman, Kirk. Avait-il des vinyles de Shorter ? j'irai fouiner.
17:27 Publié dans 2023, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 02 mars 2023
02032023
Wayne Shorter est mort.
Mon mur facebook s’est aussitôt couvert d’hommages, de photographies, de liens, sans doute car, lors de mes premières années sur le réseau social je m’étais abonné à un certain nombre de jazzmen, américains en particulier. Je me suis aperçu que je n’avais pas réécouté Ju-Ju depuis des lustres, vu que j’en avais un simple enregistrement sur cassette. Je me demande toutefois s’il ne se trouve pas dans la collection de vinyles héritée du père de C* ; j’irai vérifier.
23:23 Publié dans 2023, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 10 janvier 2021
Séances lambrissées
Grande léthargie aujourd'hui. Et dire que je dors très bien ces dernières semaines. Tant mieux, d'ailleurs.
Pas corrigé la moindre copie ce week-end, la honte absolue.
Chaque matin depuis que mes parents m'ont apporté le vélo d'appartement, je fais une séance de 30-40 minutes, en écoutant à chaque fois un des vinyles de la collection installée dans la chambre d'amis. Ce matin, c'était une (longue) face d'un disque de Duke Ellington avec son quindectet (enregistrements de 1954, il faudrait citer tous les musiciens, pas seulement Johnny Hodges (et il faudrait surtout creuser toute l'histoire complexe des orchestres de Duke Ellington)), avec, pour lecture, un article de Paul Zumthor sur l'intertextualité dans les textes médiévaux (il y distingue notamment les modèles "verticaux" des variations "horizontales").
Hier matin, j'avais associé le troisième LP du coffret Eric Dolphy A The Five Spot avec plusieurs lettres de D.H. Lawrence : ce volume de lettres choisies de D.H. Lawrence entre 1923 et 1930, récupéré je ne sais où, traînait à la buanderie, et je m'étais mis à en lire une par ci une par là il y a quelques semaines, au gré des lessives. Lecture très étonnante, pour moi qui n'ai lu, je crois, aucun roman de D.H. Lawrence, seulement des poèmes et des nouvelles. Il y a vraiment des pépites, des réflexions qui en disent long sur la vie intellectuelle dans l'entre-deux-guerres. (J'aurais dû remonter le livre pour noter ici quelques-uns de ces passages.)
Vendredi, j'avais allié mon vieux disque Whomp That Sucker! de Sparks (avec lequel j'ai appris l'anglais (ce raccourci faux est délibéré)) à d'autres lettres de D.H. Lawrence (très congruent).
À la fin de l'automne, vu la météo, j'ai dû interrompre mes virées en vélo dehors, de sorte que le vélo d'appartement tombe bien. Aux beaux jours, il faudra reprendre les excursions, car ça n'a rien à voir, tout de même.
17:53 Publié dans 2021, Jazeur méridional, Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 08 janvier 2021
Polyphonies
Difficile de se tenir à l'écriture quand le reste du travail rend tout cela plus difficile encore. Au moins, j'ai le prétexte, parfois, que le travail m'a empêché d'écrire. Ces jours-ci, je suis accaparé par les signatures de programmes d'études des étudiant-es qui postulent pour un semestre ou une année dans les universités partenaires d'Asie et d'Australie. Est-ce l'effet de l'étouffement ressenti avec les confinements, il n'y a jamais eu autant de candidatures.
J'ai passé une partie d'après-midi à lire, au salon, dans un des deux cabriolets offerts par mes parents, le roman de la romancière tunisienne Hella Feki, Noces de jasmin, paru l'an dernier aux éditions Lattès. Sans l'admirable Ahmed Slama, je n'aurais pas eu vent de ce livre. La structure et le fonctionnement narratif (alternance de 5 narrateurs à la première personne, dont un non-humain (la cellule)) rappelle le roman de Véronique Tadjo autour de la pandémie d'Ebola, En compagnie des hommes.
Il va falloir remettre sur le métier les vidéos.
Il fait un froid mordant. Toute la journée, brume et brouillard.
Depuis hier, j'ai mis en route une séance quotidienne de vélo d'appartement, au sous-sol, dans la chambre d'amis reconvertie depuis août en salon musical, et donc aussi désormais en salle de sport. À chaque séance de vélo correspond l'écoute d'un vinyle, avec pause médiane pour retourner le disque. Ce matin, c'était Africa / Brass de Coltrane, et confirmation que c'est peut-être le seul disque de Coltrane que je trouve ennuyeux, pénible presque.
19:12 Publié dans 2021, Jazeur méridional, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 29 mars 2020
Défi musical du dimanche
Je ne peux pas vraiment dire que je m'ennuie après une quinzaine de confinement, mais j'ai quand même envisagé un petit jeu.
En train d'écouter l'album Nancali (duo du pianiste Benoît Delbecq et du clarinettiste François Houle, Songlines 1997), j'ai "tiqué" en remarquant qu'un des cinq Rhizomes est dédié à Guillermo Gregorio. Ai donc exhumé de ma discothèque mon seul disque de Gregorio, Red Cube(d) avec le pianiste Pandelis Karayorgis et le violoniste Mat Maneri (HatHut 1999). Et je les écoute l'un après l'autre : la parenté est frappante, même si Gregorio joue aussi du sax ténor et en dépit de ce qu'apporte de très particulier le violon électrique de Maneri.
Voici donc le petit jeu : sortez, vous aussi, deux disques de votre discothèque, avec pour point commun qu'il y a, sur l'un des deux albums, un hommage au musicien principal de l'autre. Peu importe le genre, peu importe le lien.
10:53 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 07 mars 2020
Ce qui m'advient encore
Aujourd'hui, chose rare, O*** avait une répétition au conservatoire en début d'après-midi. Je serai donc allé quatre fois cette semaine dans le quartier de la cathédrale. Aujourd'hui, nous avons déjeuné à la Grange des Celtes, puis, après un petit tour place François-Sicard (O*** ne se rappelait pas la statue de Michel Colombe), je suis allé – O*** déposé à sa répétition – acheter des disques à la FNAC, puis lire sans manteau, au soleil, sur un banc des jardins de l'archevêché.
Je me suis rappelé que cela fait cinq ans et demi qu'O*** a commencé à suivre les cours du conservatoire : actuellement, avec l'inscription en Hors Temps Scolaire, cela représente 2 heures de formation musicale (le mardi de 18 à 20), deux leçons individuelles de hautbois de 25 minutes chacune (le lundi à 17 h 20 et le mercredi à 18 h 15), une séance d'orchestre (le mercredi de 18 h 45 à 20 h).
Il ya cinq ans et demi, après les deux années d'initiation dans l'ancienne école désaffectée proche de l'avenue de l'Europe (je me suis rappelé hier que c'est le dernier endroit où j'ai vu les pains ovoïdes de savon senteur citron dont quelqu'un a publié sur Twitter une photographie à intention humoristique dans le contexte du Covid19), il y a cinq ans et demi, donc, j'avais commencé à publier dans la rubrique Ce qui m'advient les textes que j'écrivais le lundi soir de cinq à sept, pendant que j'attendais O***, lui alors à sa leçon de formation musicale + chant choral (si mes souvenirs sont bons).
 L'objectif de cette rubrique était de travailler, chaque semaine, à partir d'un chronotope : le lundi de 5 à 7 + les lieux où l'on attend pendant qu'un enfant suit ses cours du conservatoire rue Jules-Simon. Les années suivantes le chronotope a bougé un peu, puis la rubrique elle-même, fatalement, s'est effilochée.
L'objectif de cette rubrique était de travailler, chaque semaine, à partir d'un chronotope : le lundi de 5 à 7 + les lieux où l'on attend pendant qu'un enfant suit ses cours du conservatoire rue Jules-Simon. Les années suivantes le chronotope a bougé un peu, puis la rubrique elle-même, fatalement, s'est effilochée.
Je me suis rendu compte, aussi, qu'A***, notre fils aîné, avait alors le même âge qu'O*** aujourd'hui.
Après la lecture dans le jardin du Musée des Beaux-Arts, j'ai un peu déambulé, trouvé non sans mal un café ouvert, continué ma lecture (Les Porteurs d'eau d'Atiq Rahimi) sur la grosse bûche entre le pavillon principal du site Jules-Simon et la salle du Pré.
______________________________
Soir : Angleterre/Galles. J'avais pronostiqué, quand O*** m'a questionné lors du déjeuner, 32-22 : au début des arrêts de jeu, le score était de 33-23. Un bel essai gallois de dernière minute a pulvérisé mon pronostic.
Outlander, deux épisodes. Ce con de Jamie a latté ce con de Robert en lui défonçant la gueule : la masculinité en prend pour son grade, en un sens, dans cette série.
Écouté les disques achetés : Suzane, le dernier Murat, le dernier Agnès Obel, le disque de Sophie Alour avec Mohamed Abozekry, un jeune oudiste fort talentueux. [Je ne comprends pas pourquoi S. Alour, après ou comme tant d'autres saxophonistes, s'évertue à jouer de la flûte traversière. Le spectre bifrons de Coltrane et Dolphy ?]
23:30 Publié dans *2020*, Autoportraiture, Autres gammes, Ce qui m'advient, Jazeur méridional, Moments de Tours, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (2)
samedi, 27 janvier 2018
66 secondes de lecture, 17 : “children opened the imagination”
Pour la dix-septième lecture à haute voix, un défi & un plaisir : en revenir (toujours) à ce chef-d'œuvre sublime, drôle, joyeux, beau, A Humument de Tom Phillips, l'œuvre d'une vie. J'en ai déjà parlé par le passé dans ce blog, et me contente aujourd'hui de renvoyer au site officiel de Tom Phillips.
Ici, j'ai donc ouvert au hasard la quatrième édition (je possède un exemplaire de la 2e et un de la 3e) et tenté de lire le texte formé par les phylactères non caviardés. Ça fait une sorte de poème, mais en improvisation ma lecture s'est faite trop solennelle, pas dans le ton de l'œuvre.
Peu importe.
C'est un livre auquel, forcément, je reviendrai.
(Autre innovation : en écho à cette première lecture d'un texte “illisible”, j'ai lu avec un fond sonore, en quelque sorte. En général, c'est une mauvaise idée ; la variation exige que cette série de lectures à voix haute soit, parfois, constituée de mauvaises idées. — Il y a aussi le fait, agaçant mais auquel je finis par me résigner, que le smartphone a tendance à flouter soudainement, et pendant plusieurs secondes, l'image : c'est gênant pour moi, qui lis en fait à l'écran (car l'écran souvent me cache la page), plus que pour l'éventuel vidéospectateur, qui, après tout, est censé m'écouter.)
10:01 Publié dans 66 SECONDES DE LECTURE, BoozArtz, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 15 novembre 2017
Sunology
On ne parle pas assez de Pat Patrick, et encore moins d'Art Hoyle.
19:19 Publié dans Aphorismes (Ex-exabrupto), Chèvre, aucun risque, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 01 décembre 2015
Par les lettres, 3
La voix de Sidsel Endresen, grave et souple, presque trop belle.
“Here the Moon” —belle lurette que je n’avais pas écouté cet album, Exile.
Ce matin, on l’aura deviné, choix aléatoire arrêté à la lettre E, sur les étagères consacrées au jazz.
Je me rappelle en hypokhâgne, avoir lu ou parcouru – au C.D.I. où sévissait une cerbère – un article au sujet de Saint-John-Perse ; cet article s’intitulait ‘Trop de beauté ?’ ou quelque chose d’approchant. Il me semble que l’auteur en était un poète connu, quoique inconnue de moi alors : Jaccottet ? Steinmetz ? —— Cela m’a beaucoup marqué, m’a rendu sensible, non pas à une sorte de modération ou de tiédeur de principe, mais à la question de l’emphase poétique, de l’exagération formelle.
D’un trop-plein de beauté peut naître une forme de déséquilibre, d’inharmonie, qui rompt le lien entre le texte et son lecteur. Cette question se repose, comme parfois, avec cet album de Sidsel Endresen, que je connais très bien. (Parenthèse, encore : hier soir, écoutant fourbu au retour de l’université le tout premier album de Julien Jacob, mon fils cadet m’a demandé si c’était un nouveau disque. Il ne le connaît pas car, comme je le connais par cœur, je ne l’écoute presque plus jamais.) Il me semble, pour en revenir à Exile, que la voix de Sidsel Endresen ne m’a jamais vraiment ému, contrairement à sa presque jumelle (si différente pourtant) Susan Abbuehl. En revanche, les harmoniques de Django Bates (sur “Stages” par exemple) ou le violoncelle de David Darling (à la fin de “Quest”) sont très prenants, sans oublier la radiance irrésistible du trompettiste Nils Petter Molvær – cf le final de “Dust”, en dialogue avec l’orgue de Bugge Wesseltoft.
“Waiting Train”, plus électrique et déjanté, offrant un havre de (très relative) approximation, il en ressort que, comme l’auteur de l’article lu en 91 ou 92, je suis plus sensible à des œuvres majeures quand il y a des petits quelques choses qui dépassent.
Autre remarque, histoire de dire aussi que ce choix de la lettre E n’a peut-être pas été entièrement guidé par le hasard. Hier soir, devant l’émission préférée d’Alpha (…), Le Petit Journal, je faisais remarquer à mon épouse, tandis que vocalisait quelque pop singer danoise : tiens, tu devrais aimer, non, c’est un clone d’Agnes Obel… Boutade, évidemment, d’autant que j’aime plutôt l’univers musical soporifique fouillé d’Agnes Obel. Il n’en demeure pas moins qu’il existe une sorte, sinon d’école, du moins de forme particulière de modulation dans le chant en anglais des Scandinaves : Abbuehl, Endresen, Nina Persson (des Cardigans), Obel…
▓▒░│░▒▓
Pour faire suite (ou pièce) à Exile, j’ai choisi, le jouxtant, The Individualism of Gil Evans : absolument aucun rapport… et signe encore et toujours que sur les étagères de « jazz » se trouvent des essais si dissemblables que le jazz, comme le “roman” ou le “baroque” — à des degrés divers — sont des étiquettes dissimulant de bien incommodes baggy monsters.
Ici aussi, album que je n’avais pas écouté depuis des années.
“Time of the Barracudas” : arrangement très beau, solos et volutes hallucinées de Wayne Shorter avec répons de flûtes et clarinettes, tandis qu’à certains instants on finit par n’entendre que le toucher baraqué d’Elvin Jones sur cymbales. En revanche, aucun souvenir d’avoir prêté attention à Kenny Burrell sur ce morceau (on m’aurait demandé ce que je connaissais de Burrell, j’aurais cité les trois disques que j’ai d elui en leader ou co-leader, mais pas ceci).
“The Barbara Song” : aucun souvenir, là encore. Jamais dû écouter cet album attentivement ; or, il demande une attention soutenue. Atmosphère déliée, suffocante, endormante, tour à tour lascive et poivrée.
“Las Vegas Tango”. Ce titre me paraît familier. L'aurais-je entendu ailleurs, autrement ? Le solo de trombone est extraordinaire. Le saxophoniste soprano (sans doute Steve Lacy – il y a quatre “reeds & woodwinds” répertoriés, mais qui d'autre cela pourrait-il être ?) reprend le flambeau, et ça arrache (à l'intérieur). Comment travailler, sinon s'arrêter et rester saisi ?
“Flute Song / Hotel Me”. On nage en plein cinéma des années cinquante. Gangsters, séductrices über-gaulées dans leurs jupes droites. Le piano ironise, les flûtes tentent de roucouler, on s'amuse. Parade sauvage, non.
“Nothing Like You” : machin classique de big band, gaieté factice façon West Coast, générique d'émission de radio, à oublier.
“Concorde” : arrangement qui tourne entièrement autour du “violon ténor” (?) et des solos de tuba. Épatant, si je peux risquer un anachronisme lexical (mais l'album sonne tellement sixties, it's in keeping).
“Spoonful”. — Étonnant, ce que devient le blues beau et râpeux de Willie Dixon. Kenny Burrell, à la guitare, est, il me semble, à côté de la plaque : dilettante, détaché, doucement diurne. Vous m'offrez du brouet quand j'attendais des crèmes. [Ça marche dans les deux sens. D'ailleurs, dans Les Poulpes, les collages de citations sont déroutants : on n'est même pas sûr de reconnaître ce qui est citation, et ce qui est parole inventée rapportée de tel prisonnier.] Avec la trompette, on reprend un territoire plus crevassé, on se crame les pieds à fouler des arpents dangereux. Mais enfin, le salut ne passe pas par les lettres !
11:31 Publié dans Blême mêmoire, Jazeur méridional, Par les lettres | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 28 novembre 2015
Par les lettres, 1
Il faisait froid, ce soir-là, sur le quai de la gare, à Dijon.
Était-ce en 2000 ? Avec le baladeur CD (oui, oui), j'écoutais Pression, le premier album de Kartet, acheté quasi par hasard un ou deux ans plus tôt, d'occasion, à Paris.
Que de découvertes capitales faites à l'époque des razzias chez Gibert, tiens c'est 30 francs, pourquoi ne pas tenter ? (Ainsi, tout de même, Julien Jacob, en 2000, justement.)
Ne nous éloignons pas du sujet.
Pression. Album fondamental, s'ouvrant et s'achevant sur deux versions différentes de “High Steak”. Guillaume Orti, l'ai-je déjà écrit, est un des saxophonistes les plus sous-estimés ou méconnus de sa génération. Les trois autres compères ont aussi suivi leur chemin.
Ligne interrompue.
Lignes coupées.
Décision d'écouter, dès que je le pourrai, certains de mes disques par genre et par lettre de l'alphabet, histoire de refaire le tour de mes étagères (question que l'on ne se pose pas, ou frustration que l'on n'a que plus temporairement pour les livres : est-ce l'effet des contraintes temporelles ? pourtant, il m'arrive de me dire que je relirais volontiers Les Géorgiques de Claude Simon, par exemple, ou Look Homeward, Angel — et je ne le fais jamais).
Tout proche de Pression, il y a la réédition de deux albums de Roland Kirk, Domino et Reeds and Deeds. Au moment où j'écris ce §, j'écoute la version de “Get Out of Town” (avec un phrasé déboulé étonnant de Wynton Kelly au piano). Kirk, bien sûr, on l'imagine toujours en train de siffler/parler tout en tenant en bouche quatre instruments différents, mais l'émotion ne passe pas par ces prouesses, mais par la teneur particulière du souffle. (Note to self : réécouter “A Stritch in Time”, composition symptomatique.)
Après cela...
Après que le soleil aura séché la minuscule flaque au centre de la table noire...
[Stéphane Kerecki Trio]
11:00 Publié dans Blême mêmoire, Jazeur méridional, Par les lettres, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 10 novembre 2015
Une suite & 1 photo
Juneteenth est une suite pour piano seul de Stanley Cowell. Sur l'album que vient de publier le jazzman américain, les 15 mouvements de cette suite sont précédés d'un titre en forme de prologue, “We Shall 2”. L'album est publié sur le label français de “musique narrative”, Vision Fugitive. L'occasion en est le cent-cinquantenaire de l'abolition de l'esclavage, qui fut célébré le 19 juin dernier.
Je connais mal Cowell ; un rapide survol de mes étagères me rappelle qu'il joue sur certains albums plus ou moins fétiches de ma discothèque (le disque de standards de J.J. Johnson au Vanguard, un Stan Getz...) Se proclamant narrative, Juneteenth s'inscrit pleinement dans cette optique, puisqu'il s'agit d'une suite dédiée à la mémoire des esclaves afro-américains et inspirée par une série de photographies et de documents liés à l'histoire de l'esclavage et inclus dans le livret, sans autre explication. Les titres des mouvements marquent assez nettement le rapport avec le sujet annoncé, mais j'avoue avoir beaucoup de mal avec la musique narrative... en d'autres termes, ne rien y entendre, stricto sensu. Cela est vrai de certaines symphonies de Beethoven, qui me bouleversent mais où je suis infoutu d'entendre tel épisode ou tel phénomène naturel que l'orchestre, sur ces mesures, est censé mimer, mais aussi d'autres œuvres, comme cette suite.
Pour ce que j'y entends (guère, je l'ai déjà écrit maintes fois), le piano, très improvisé/maîtrisé, de Cowell penche plus du côté d'Erroll Garner (“Ask him”) et de Debussy (voire de Stockhausen (cf le “Finale”)) que du negro spiritual, même si un des plus beaux mouvements, “Commentary on Strange Fruit”, est une longue variation à partir du thème de When the Saints. Le huitième est un blues lumineux et mélancolique. Le long mouvement final, “Juneteenth Recollections” est le plus complexe, peut-être celui où Cowell se livre le plus à une forme d'introspection : cette suite est-elle l'aventure d'une mémoire individuelle aux prises avec la mémoire collective ?
Une des photographies du livret m'a, plus que d'autres, intrigué. Elle représente deux ou trois familles de Noirs, très jeunes pour l'ensemble, sept ou huit adultes, et trois très jeunes enfants, dont l'un dort, au premier plan, allongé sur une sorte d'édredon très blanc. Presque tous regardent vers la droite et se trouvent sur une langue de terre entre deux grandes étendues d'eau (on voit des peupliers inondés, au fond, à gauche). Le titre en est “Refugees on levee, April 17, 1897”, et elle se trouve dans le fonds photographique de la Librairie du Congrès. J'avoue que mon ignorance me fait m'interroger sur ces “réfugiés”, quarante-deux ans après l'abolition de l'esclavage : a-t-on continué de nommer réfugiés, comme naguère les esclaves fuyards, les Noirs fuyant la ségrégation des États du Sud ? ou le titre joue-t-il sur le sens de réfugiés, car cette douzaine de sujets bien vêtus ont-ils simplement trouvé refuge sur la digue (la levée, dit-on en Touraine) ? et où cette scène a-t-elle été saisie ? Heureusement, la notice détaillée de la photographie dans le catalogue de la Library of Congress offre toutes les réponses : cette photographie a bien été prise à Grenville, dans le Mississippi, et si tous les adultes regardent vers la droite, hors cadre, c'est qu'ils se sont effectivement laissés piéger sur cette langue de terre et qu'ils attendent le navire qui va venir les secourir.
14:17 Publié dans BoozArtz, Jazeur méridional, Pynchoniana | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 23 février 2015
Déjanté
Après Les Déjantés de Gentet, aux six fois quatre cordes, enchaînement au grand soleil sur le chemin des poneys, avant que les nuages n'obscurcissent les prunus. Avant que fait de belles phrases.
10:10 Publié dans Chèvre, aucun risque, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 19 novembre 2014
Steve Coleman & Five Elements à Tours, 18 novembre 2014
Hier soir, retour à onze heures du soir dans d'épaisses nappes de brouillard qui rendaient fantomatiques les moindres promeneurs égarés le long des 2x2 voies de ma grise banlieue.
À l'Olympia (qu'il ne faut plus, semble-t-il, nommer Nouvel Olympia), c'était la soirée du festival Émergences consacrée au quartette de Steve Coleman, lequel était accompagné de Jonathan Finlayson à la trompette, d'Anthony Tidd (époustouflant) à la basse électrique et de Sean Rickman à la batterie. Pour l'occasion, le Petit Faucheux avait donc cédé la place d'honneur à une grande salle, comble d'ailleurs (strapontins gavés).
Est-ce justement que j'ai pris l'habitude de voir et d'entendre les formations dans une configuration plus intimiste, plus proche du public ? toujours est-il que j'ai trouvé les musiciens très “entre eux”, avec — et cela n'est pas l'effet du seul cadre — trois des six compositions principales tout à fait monolithiques, inaccessibles, comme quoi le hard bop peut être tout à fait aussi rugueux, voire plus brutal que bien des expériences free.
Je possède plusieurs albums de Steve Coleman, principalement pour son projet à géométrie variable des Five Elements, et j'étais très curieux, à l'avance, car, si certains de ces disques me plaisent énormément, d'autres me tombent des oreilles, si j'ose dire. J'attendais donc le concert d'hier soir pour recevoir une réponse à peu près définitive à mes questions. J'en serai pour mes frais, car, si certains des morceaux joués, ainsi qu'écrit plus haut, m'ont paru préfigurés, sans dynamisme propre à faire entrer l'auditeur/spectateur dans la danse, d'autres, et notamment le troisième, longue suite avec variations et métamorphoses, valaient à eux seuls le déplacement.
Coleman est un excellent saxophoniste, cela ne fait aucun doute, et il maîtrise tous les registres de jeu, y compris les moments très émouvants où le souffle passe un peu à côté, de façon tout à fait délibérée. Il s'est entouré d'excellents musiciens, avec lesquels l'osmose est (trop?) parfaite. Pour ce qui est des compositions, son mysticisme a dû finir par déteindre, pour les raisons évoquées plus haut : univers hermétique, clos, aux rites d'écriture ou de production sans appel (sans appel vers l'auditeur).
Ce qui m'a étonné, c'est que ce sont les pièces qu'inaugure Coleman lui-même dans un solo parfois long et toujours très hésitant (dans sa structure — pour la maîtrise instrumentale, rien à dire) qui se développent ensuite dans une forme d'autisme compositionnel. Sans doute est-ce moi qui n'ai pas d'oreilles, ou de cerveau, car une frange importante de l'auditoire était emballée, à en croire les bravos qui fusaient automatiquement à chaque fin de morceau, et le tonnerre d'applaudissements avant les rappels, sans parler des smartphones et autres tablettes en fusion à force d'être sollicités pour des captations vidéo. Tant mieux si je me trompe, donc. Je continuerai de suivre le travail de Steve Coleman, en espérant à chaque fois tomber du côté vivant, parlant, évocateur, lyrique et sensationnel de son œuvre.
À deviner les figures de fantômes dans les nappes de brouillard.
08:30 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 18 octobre 2014
The Bridge, Petit Faucheux, 13 octobre 2014.
Belle soirée au Petit Faucheux, autour du projet collectif “The Bridge”, qui rassemble des musiciens de Chicago et des jazzmen français autour de séances longues, et — selon la formule d'Alexandre Pierrepont — en se gardant de tout hommage, car la tendance à multiplier les hommages asphyxierait la créativité.
[Dans le hall du Petit Faucheux, avant le concert, voyant que je lisais le tome III du Pléiade de Breton, A.P. m'a abordé et conseillé l'achat d'une revue à laquelle il a collaboré, L'Or aux 13 îles. Comme je suis curieux de nature, j'ai feuilleté ce numéro 3, de 2014, et l'ai effectivement acheté. Des différents articles, je recommande les oiseaux imaginaires du jeune Alexandre Cattin, “Rimbaud modernité par contumace” de Mauro Placi et enfin la collection de bouteilles des époux Beynet, qui louche du côté de l'art brut et me remémore mon fouillis laissé en plan. Il y a aussi un CD de l'ensemble Bonadventure Pencroff, très cuivré, très bien à première écoute, avec Pierrepont en récitant.]
.
 En première partie, le duo constitué par le saxophoniste Dave Rempis et le batteur Tim Daisy a joué un seul morceau, très free jazz, mais avec des passages très mélodiques, dans lesquels le batteur trouvait des modulations très séduisantes sur le métal. La fin était très chantante, moins stridente que l'ouverture.
En première partie, le duo constitué par le saxophoniste Dave Rempis et le batteur Tim Daisy a joué un seul morceau, très free jazz, mais avec des passages très mélodiques, dans lesquels le batteur trouvait des modulations très séduisantes sur le métal. La fin était très chantante, moins stridente que l'ouverture.
La deuxième partie est celle que j'ai préféré, de très loin. Il s'agissait d'un quatuor inédit, dans une formule inhabituelle, puisqu'il était composé de la pianiste Eve Risser, de la flûtiste Sylvaine Hélary, du violoncelliste Fred Lonberg-Holm, et enfin du batteur Mike Reed. À l'exception de certains moments où l'on avait l'impression que la flûtiste ne jouait pas (surtout avec la flûte basse — problème de sonorisation ?), l'ensemble était très beau, très prenant. La vraie découverte, pour moi, était le violoncelliste, dont l'instrument, en mode électrique, était relié à un système complexe de pédales qui lui permettaient d'en jouer soit comme d'une guitare électrique, soit d'en décupler les effets dissonants métalliques, le tout dans une recherche d'harmonie jamais gratuite, en écho aux autres instrumentistes.
09:17 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 30 mars 2014
Langues & lueurs (Petit Faucheux, 29 mars 2014)
Hier soir, donc, après le quintette belge, électronique et mélancolique, Lidlboj, le Petit Faucheux, laissant carte blanche à son artiste en résidence, le contrebassiste Sébastien Boisseau, avait invité Jean-Paul Delore, récitant, et le duo formé, pour l’occasion, par Boisseau et Louis Sclavis. En général, les manifestations, lectures, rencontres et concerts organisés à l’occasion du Printemps des poètes sont l’occasion de mettre en valeur les côtés les plus stéréotypés, mais aussi les plus kitsch, de la poésie. (Je m’en étais même fait l’écho, l’an dernier, dans un blog créé au printemps et où je m’étais promis d’écrire chaque jour, soit 91 poèmes en anglais, pari presque tenu.)
J’avais donc quelques craintes. Pourtant, rien de tel. Il s’agit du programme Langues et lueurs, qui a déjà été présenté à plusieurs reprises.
Jean-Paul Delore avait choisi de très beaux textes qu’il a dits et joués à la perfection, avec une énergie totalement respectueuse des rythmes et des beautés déjà à l’œuvre dans les poèmes. Tant par la palette des compositions, qui allaient du strident au lyrique, que par ses modes de jeu, Louis Sclavis — qui jouait des clarinettes mais aussi du piano à pouces et de l’harmonica — transforme, de toute manière, tout en or irradiant.
C’était donc tout à fait réussi, très émouvant. Les textes étaient de Henri Michaux, Sony Labou Tansi, Dieudonné Niangouna, mais aussi de mes très chers Dambudzo Marechera (dont les poèmes ont fini par être traduits à l’instigation de Xavier Garnier (j’avais traduit les Amelia Poems il y a une dizaine d’années, sans jamais trouver de revue ni d’éditeur)) et Mia Couto (“L’adieusiste”, qui se trouve dans le sublime recueil Le fil des missangas – Chandeigne, 2010).
Il y eut un bis, ‘Le Mort joyeux’, dont Jean-Paul Delore s’est senti obligé de préciser que c’était du Baudelaire, reconnaissable entre mille. (Mais il a raison, on n’est jamais trop prudent.)
Je donne, en clôture de ce billet, la première strophe du poème de Marechera dit hier en version française, “Characters from the Bergfrith” (in Cemetery of Mind, Baobab Books, 1992, pp. 17-9) :
The mind is a bell whose rope
Is tugged by the senses;
The clangorous din
Is the effort of the innermost in us.
10:25 Publié dans Affres extatiques, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1)
samedi, 08 février 2014
Un son de sax alto
Ce matin, écoutant encore une fois le disque d’Issam Krimi, j’ai enfin trouvé ce que me rappelait le jeu du saxophoniste, Han Sen Limtung : le son d’un autre saxophoniste, Guillaume Orti, sur le CD Pression, de Kartet, cet album que j’écoutais en boucle autour de l’an 2000 – je me revois notamment, avec un baladeur (oui, oui), sur le quai de la gare de Dijon après une séance d’École Doctorale. Et, après cela, je me suis acheté, au fur et à mesure de leur parution, divers disques de Benoît Delbecq, mais jamais, il me semble, d’autre disque de (avec) Guillaume Orti.
10:48 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 12 avril 2013
Domino
On va passer sur toutes les raisons d'être maussade, de grognasser.
Les rayons de soleil percent (un peu). J'écris des mauvais poèmes.
Hier, j'ai acheté, dans une réédition de deux 33 tours (Domino et Deeds and Reeds) sur un seul CD. Ça fait belle lurette que je suis “fana” de la musique de Roland Kirk, mais je ne connaissais pas ces albums. En écrivant ces lignes, je me passe en boucle le morceau-titre, ‘Domino’, qui a tout pour me ravir, et surtout, par delà le son si profond du sax soprano dans la partie médiane, ce mélange de joie et de mélancolie qui confine, pour moi, à l'extase. Ce mélange de joie (d'allégresse, même) et de mélancolie vient de la mélodie de Planté et Ferrari, mais aussi de l'orchestration, des cadences, du passage poignant de la flûte au soprano, des vibratos, de la prise de son (un paradis perdu).
Vous trouverez ci-dessous la version live la plus connue — celle que j'écoute a été enregistrée en studio, et s'achève par quelques secondes vocales absolument époustouflantes. Vous n'avez qu'à acheter le CD.
14:31 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (3)
jeudi, 11 avril 2013
De main de Maistre
(Ce qui conditionne ces nouvelles séries, qui n'ont pas suscité de nouvelles rubriques, ce sont, encore et toujours, des nombres. La photographie Casimir Maistre se trouve aujourd'hui à la page 545 de ma galerie Flickr, celle ci-dessus en page 454. Voilà tout. Parfois, on se complique la vie, et d'autres fois on laisse filer les traces du temps. Cette même féline se trouve à la minute où j'écris ces lignes sur un fauteuil d'enfant en osier recouvert d'une légère couverture en synthétique et à motif panthère, dort profondément malgré Houria et Palabre du quartette de Kerecki, Malaby en piste gauche, Donarier côté droit.) — On attend encore qu'un jazzman du nom de Casimir Maistre compose d'aussi enchanteresses mélodies ☼ ► ◄ ☼ (Toutefois, je saute enfin dans le vide, je me lance sans filet, étends le sens de la mirlitonnerie.)
11:25 Publié dans Jazeur méridional, Mirlitonneries métaphotographiques, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 11 janvier 2013
Mademoiselle Confiture
(Pierre-Alain Goualch, 2004)
le temps qu'infuse le thé russe je ne pourrai jamais écrire aussi vite que ça que le piano pianote jamais aussi vite à peine 130 secondes pour écrire quoi d'ailleurs
ça ne s'emballe pas tout de suite
la toile de jute prend un peu le temps mais pas trop ça y est ça s'emballe
s'accrocher à quoi aux trous dans la toile
s'accrocher à ces mots dits par le sieur Dudot le ciel est amoureux amoureux de ses yeux
du plat de la main du bout des index des majeurs tapoter tandis que ça pianote gratte frotte et le balai passe repasse c'était plus facile plus posé de prendre le temps d'écrire ce tanka tout à l'heure
tant qu'à faire un peu de piano
tant qu'à s'accrocher
tant qu'à avoir mal au dos aux doigts ravauder quoi quel texte oui j'étais pris
surpris les doigts dans la confiture écrivais-je écrivis-je la main sous la ceinture
bientôt le terme sans doute fin de la joute le tournoi a noyé le chagrin la toile de jute on n'en viendra pas à bout
ça s'effondre à peine 130 secondes cette amante religieuse écrire quoi
10:22 Publié dans Ecrit(o)ures, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 04 décembre 2012
Catherine de Russie
Non, tout de même pas. Oui, quand même.
Oui, je voudrais quand même emporter avec moi cette valise brune et craquelée – à force de m'accompagner dans mes périples minables, elle est défoncée. Défoncée! Moi aussi, je saisis l'occasion de me montrer progressivement plus audacieux, moi aussi je suis défoncé. Cramé, et cramoisi. Je disais ça enfant, cramoisi. C'est, cramoisi, un mot qui plaît aux enfants. Vrai, vraiment ? Ne tarde pas à le savoir. Et ça claque, je suis dans l'allée avec mes camarades, on attend le début du cours de M. Dassé, on attend M. Dassé, c'est curieux hein, la mémoire. Je pense que c'était le lundi matin, je revois cette salle de classe, mais pas le jour ni le numéro de la classe, le bâtiment oui, je sais qu'il n'existe plus, souffle de trombone, souffle de démolition pourtant non, et c'est devant cette même porte qu'on a apporté Maurice deux ans plus tard, qu'on a offert à notre professeur de philo un mouton – broutard, peut-être ?
On avait baptisé le mouton Maurice à cause de Merleau-Ponty.
Oui, quand même.
J'embarque ma valise, je ne suis pas du genre à me laisser emmerder. J'emmerde tous ces pinailleurs, pas du genre à me laisser embringuer dans d'oiseux arguments, fumeuses arguties. Trace mon chemin. Un pas, c'est déjà toute la route.
Souffle, souffle.
Comment – comment – comment, dis-je, peut-on se prénommer Julien-Baptiste ?
Il fait une chaleur épouvantable, un cagnard du diable.
Avant le mouton, avant d'attendre M. Dassé dans l'allée, en seconde, avant tout ça, au collège donc, je suppose, j'avais voyagé – toujours la valise, mais encore très fraîche – en aéroplane blindé. Laissez-moi vous dire que, déjà, j'étais bien loin d'être pété de tunes. Châtain comme les blés, le charme agissant sur personne, regardant les autres s'éclater en scène, et moi en coulisse, à ne pas même ahaner.
Non, pas même. Oui, hein. D'ahan, souffler. Tirer.
Souffle, souffle, je me fous de ta valise, d'ailleurs je vais me plaindre au roi de Prusse, au bleu de Gex, et – volutes démentes, éclats de lampe-torche dans la valise, paupières trouées par la mémoire, envols de cagnards sauvages dans le ciel de toutes les canicules, il reste avec la valise à gravir les trente-neuf marches – à Catherine de Russie.
15:57 Publié dans Jazeur méridional, Résidence avec Laloux, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (3)
mardi, 13 novembre 2012
25 ans du Petit Faucheux, 10 novembre 2012 - Groove Catchers
J'ai bien et beaucoup dormi la nuit dernière, et me sens épuisé, n'arrive pas à m'y mettre. La nuit précédente avait été mauvaise, fragmentée, lundi a été lourd, crevé à toutes les coutures, donc je ne comprends pas. Comme je viens de dépanner, de deux clics, une collègue et amie, je peux même avoir l'illusion d'avoir commencé ma journée de travail. En écoutant le classique Free Jazz d'Ornette Coleman (cadeau d'anniversaire de ma mère - Freddie Hubbard figure aussi sur Maiden Voyage de Herbie Hancock), je décide de noter au moins quelques bribes sur le concert de samedi soir. Ce sont surtout des notes pour moi-même, mais si qui que ce soit, au Petit Faucheux, tombe sur ce billet : par pitié, arrêtez de mettre le son aussi fort ! c'est casse-pieds, ça bousille les oreilles, et ça ne met pas du tout la musique en valeur.
►◄►►◄►◄◄►
Commencé — comment c'est. Dès les premiers tchatchages, on a subodoré que Bernard Lubat serait, encore une fois, pénible, ce samedi soir au Petit Faucheux. Heureusement, ça n'a pas trop tchatché, finalement, mais ce qui était joué, très free et décomposé, n'était pas enthousiasmant. Sentiment que les musiciens ne se livraient pas, déroulaient leur petit truc, informe par définition et donc sans souci formel. L'échange avec le public, suite à l'intervention d'un voisin (il a lancé "en force" à la fin de la première longue improvisation, ce que Lubat a compris, à juste titre, comme une critique), a bien montré qu'il y avait une doxa de gauche, et rien n'est plus ennuyeux que la doxa de gauche, la doxa du pseudo-chaos. Comment se fait-il qu'une esthétique qui prône la forgerie, le mouvement perpétuel, n'ait que des admirateurs figés ?
Donc, j'étais venu pour les Groove Catchers, et c'est bien eux qu'il fallait venir entendre/écouter, d'autant plus qu'ils avaient invité, sur trois morceaux (dont un quelque peu théâtral), un terrible clarinettiste et beat-boxer, Julien Stella. Ils ont donné à entendre, tous les quatre ensemble, une version de Caravan absolument renversante, bouleversante. C'était une heure très belle, très prenante, et je ne saurais assez conseiller à tous mes (hypothétiques) lecteurs d'aller écouter les Groove Catchers s'ils passent près de chez eux — et aussi sur le profil MySpace du bassiste.
09:18 Publié dans Jazeur méridional, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (1)
vendredi, 02 novembre 2012
Collectif Capsul au Petit Faucheux, vendredi 26 octobre.
Vendredi soir, on s'éclate.
Arrivés à l'avance (parfois, ça bouchonne pont Mirabeau, des fois non – la prévision est difficile), avec Alpha, on va boire un chocolat chaud – nettement moins bon que celui dont je fis la découverte, rue Bernard-Palissy, l'après-midi même, avec Chandani et Isabelle – place Gaston-Pailhou, puis s'engouffre parmi les rares fidèles venus pour la deuxième soirée du collectif Capsul.
1ère partie : Omar (sous la direction du sax ténor compositeur ). Très beau, des moments très forts (plus côté Archie Shepp, voire Braxton, que côté Ornette et Steve, dont pourtant le descriptif se réclame), avant malheureusement qu'Alpha ne souffre des oreilles : final trop appuyé côté sono, batterie très chouette mais violente – entr'acte dans la rue, douleurs, fatigue. Comme il était inquiet, on est même allés aux urgences le lendemain matin (d'où le poème en textos publié avant-hier).
On n'a pas entendu la 2ème partie, Vocuhila.
Mais on va suivre ce collectif... et ne plus aller au concert sans provision de bouchons d'oreilles.
vendredi, 26 octobre 2012
Petit Faucheux, 25 octobre 2012 : Air Brigitte (Capsul)
Hier soir, c’était donc, au Petit Faucheux, le lancement du collectif Capsul.
Etaient programmés un quartet qui a déjà tourné en Europe, Watsun, et un quintette plus local, apparemment, et qui se nomme – assez étrangement – Air Brigitte. La formation est dirigée par la claviériste (orgue Hammond et Moog, si je ne m’abuse) Emma Hocquellet, et, selon une orchestration tout aussi innovante que passionnante, du batteur Alexandre Berton, du bassiste Julien-Baptiste Rascagnères, du tromboniste Alexis Persigan et du flûtiste Thomas Quinart.
Première chose à souligner : les compositions d’Emma Hocquellet sont excellentes, à la fois complexes et dansantes. Deuxième point, non des moindres : les cinq jouent absolument ensemble, avec une jouissance communicative. Il s’agit là d’un répertoire que l’ensemble du groupe s’approprie et fait fructifier, dans des échanges qui alternent mélodismes, noisy pop, free jazz – avec, toutefois, un sens du swing rarement maintenu à ce niveau d’évidente beauté.
On l’aura compris, j’ai été totalement séduit par Air Brigitte ; je suis même prêt à ne pas trouver trop ridicule le nom, qui a, au moins, le mérite d’une certaine – quoique énigmatique – recherche. (Il suffit de donner quelques rapides coups de sonde dans les noms de groupes de jazz contemporain ou de rock pour se rendre compte que cela n’a rien d’évident.) Le tromboniste – on se souvient peut-être que l’os à coulisse est un de mes instruments fétiches – est remarquable, son camarade traversier se fait entendre sans avoir à se pousser du souffle, même face aux élucubrations, toujours riches, du bassiste. (C’est sans doute Julien-Baptiste Rascagnères qui est le plus évidemment noisy : usinage et butinage sont les mamelles de la basse électrique, quand elle est – comme ici – à son meilleur.)
Cerise sur le gâteau, j’avais achevé, à l’entracte, la lecture du dernier livre de Nathalie Quintane – Crâne chaud –, lequel est constitué, en grande partie, de conversations imaginaires avec Brigitte Lahaie. Aussi, avec mon crâne chauve, ma gorge catarrheuse, étais-je tout ouïe pour Air Brigitte.
▄–▄–▄–▄–▄–▄–▄
On s'offusquera peut-être de l'absence de tout commentaire sur Watsun. Qu'on ne se méprenne : j'ai bien aimé la première partie de soirée, notamment le saxophoniste, Romain Mercier (excellent), et la section rythmique. Mais la guitare électrique, instrument qui m'ennuie rapidement en jazz, penchait du côté non rythmique, chaloupé, et (pour tout dire) interminable.
Par ailleurs, note to self, je suis allé aussi au Petit Faucheux les deux derniers vendredis, et n'en ai (encore ?) rien écrit.
08:49 Publié dans Autres gammes, Jazeur méridional, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 25 septembre 2012
Froissé défroissé
Etait-ce une si bonne idée, ce départ à l’aube ?
Dans les broussailles, on devine des détalements de sanglier, des piétinements, quelques grincements aussi. Bien campée dans l’azur, la lune n’a pas dit son dernier mot. D’autres souvenirs sont conviés à la barre, pour soupeser un passé qui n’a plus de sens depuis qu’on s’est perdu en route, depuis qu’on a cessé d’arborer de vieux t-shirts, qu’on s’est embourgeoisé, empesé, alourdi, surbaudruché finalement. Alors, quoi, fallait-il partir ? Tout abandonner, vraiment ?
L’habit ne fait pas l’histoire, ni l’hystérique. On clame en s’époumonant un itinéraire et un univers dont il ne faudrait pas se vanter, tant et si bien que, de pierre en pierre, de fougère en fougère, de gué en gué, et d’escalade en escalade, on a tout perdu, ce que l’on regrettait – et ce que l’on regrette.
Tout au plus pouvons-nous encore lever les yeux, regarder la lune, qui n’a jamais fui.
Quelle débâcle. Habits déchirés.
En attendant que la pluie dessille nos guenilles, encore une nuit blanche encore. Qui se débat.
15:39 Publié dans Jazeur méridional, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 10 septembre 2012
Asamine
Réveil très progressif, lames de courant.
Sommes-nous les seuls, cette nuit, à ne pas avoir entendu la tempête ? N’était-ce pas plutôt l’orage ? Autant de questions posées au prunier, qui ne répond.
Mouvement des étiquettes, d’un support à l’autre, et regards furtifs dans le rétroviseur intérieur. Rien ne contredira la beauté d’Asamine.
Gri-gris verts sous certains mots, rouges sous d’autres, et sans la force d’espérer on se contente de souffloter, harmonie du verre, absence de construction, alors vos brindilles sur pilotis ne tiendront pas, fétus vénérant Asamine.
294 années ont passé.
Elles germaient, ces peuplades…
294 années ont soufflé. Des vents de plus en plus violents. Posés là, les uns près des autres. La civilisation gotek (que l’on nomme aussi, ailleurs, goekt – ou même tokeg) n’a pas tenu, fétus de paille doux comme des cordes envolées, frissons dans la nuit. Jamais le prunier, même après mille leçons d’envolée lyrique, ne nous répondra.
Dis, était-ce un orage ou une tempête ?
Millénaire, noueux, patriarcal, le prunier s’était emmuré dans le silence.
Et nous ne vîmes jamais Asamine.
09:21 Publié dans Jazeur méridional, Le Livre des mines | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 24 juillet 2012
alborea )( cinq-cordes
8 juillet
garcia à fons dès le lever
matinier matinalement
& yves torchinsky exquis
n'y a que mahieux qui m'aille
alborea boréale
alborea aube arborée
& cinq cordes contre le bois des doigts font des vagues
16:00 Publié dans Chèvre, aucun risque, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 19 juin 2012
Birth
Le linge étendu, encore risques de pluie.
Le doux Anthony et Max le méticuleux soufflaient battaient comme fous. C'était en 1978, semble-t-il, et pourtant c'est aujourd'hui. Le texte se trouve dans une de ces phases dont j'ai souvent déploré l'existence, celles où tout est trop facile. On n'a pas idée de ne pas avoir d'imprimante qui fonctionne correctement, ni chez soi ni dans son bureau (problème de toner).
Pépiements. Peut-être ai-je déjà noté combien, par ces journées humides, en juin, l'odeur des troënes est envoûtante. Je crois qu'il n'y a pas de tréma, mais un simple accent grave. Troène, troëne. Poëme, poème. Qu'importe. L'odeur, quand on longe une haie du quartier des sçavants (savants, savànts), est envoûtante, presque autant que celle du chèvrefeuille.
Soufflez, il en sortira toujours quelque chose. Pourra-t-on, avec troène et toner, relancer Entre Baule et Courbouzon ? Peu probable. Pépiements.
08:48 Publié dans Entre Baule et Courbouzon, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 07 mai 2012
Le Soleil. Notule pour fêter le retour au calme.
Il fait, de nouveau, beau et doux. En me rendant à pied dans le vieux Tours, j’ai entendu – sans parvenir, de prime abord, à discerner d’où venait exactement la musique – un saxophoniste qui s’exerçait à déchiffrer le début des Fables of Faubus – une des plus belles compositions du 20ème siècle, bar nearly none. Il s’est avéré que le son venait d’une fenêtre ouverte au-dessus du bistrot de la place des Joulins. Je suis resté vingt ou trente secondes peut-être, en-dessous de la dite fenêtre, à écouter. Subitement, le son s’est arrêté, et, à peine quelques instants plus tard, j’ai vu, de la porte située sur le côté du bâtiment, un jeune homme sortir dans la rue, et me suis autorisé à l’aborder :
— Pardonnez-moi, est-ce vous qui jouiez Fables of Faubus ?
— Oui.
— Ah, c’est un de mes morceaux préférés. C’était à l’alto ?
— Au soprano. Mais je joue plutôt de la clarinette.
— Bravo, vraiment, et bonne chance. C’est un morceau merveilleux.
J’ai repris mon chemin. Plus loin, j’ai vu que, sur la place Plumereau, avait ouvert un magasin La Cure gourmande. Depuis quand ? Mystère.
15:20 Publié dans Jazeur méridional, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (2)
vendredi, 30 mars 2012
M.Y.C.Y.X.
Que veut dire ce mot, mycyx – ou plutôt : MYCYX –, signifiant formé par les 5 photographies de Mihael Milunovic constituant, pour la pochette de l’album du Bojan Z. Tetraband, Humus, les 5 rabats de verso ? Pourquoi ces textures, froides ou bitumineuses, sang-de-bœuf figé ou peinture semi-effacée sur gravier gris multicolore ?
Pourquoi les textures parlent-elles ? De quoi nous parlent-elles ? De l’informel soudain formé (cf Duns Scot) ? Ou des litanies de questions qui ne cesseront de s’enchaîner, comme autant de souffles de brise, ou d’éclats de verre ?
Le pianiste, plus que jamais, sonne colosse.
Le tromboniste, avec ou sans sourdine, travaille le son jusqu’à l’os.
La basse, avec Ruth Goller, est en ronde-bosse.
Et le batteur a (bonnes peaux) bon dos.
╩ Fuzzlija, Bojan Z., l’a aussi joué, depuis, avec son vieux complice Lourau. ═ Et qu’est devenu, texture sonore aussi archipel, The Joker ? Emporté par l’onde-monde. ╚ Texturologies. Texturologies encore. Pyrrhocores ou pas, graviers ou non – texturologies toujours. ╦
La chèvre chie sur ses petits. Ce n'est pas une allégorie.
La chèvre chie sur les chevreaux. C'est ce qu'on voit sur la photo.
15:22 Publié dans Jazeur méridional, Un fouillis de vieilles vieilleries | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 23 mars 2012
Le triangle du Douboto
Ouverture dans les fleurs. Un arrosage de pluie, une nuit, aura suffi. Les renoncules éclatent, après les jonquilles – et les primevères, éparses dans la petite butte herbeuse. Le soleil les berce, plus qu’il ne les blesse. On se sentirait de bucoliques pulsions, même si la verdure précaire a, depuis longtemps, perdu contre le bitume et le béton.
Des nuées. Le temps n’est plus à ouvrir. Un bourdon noir et jaune frappe à la vitre, signe indéniable de printemps. L’air a une teneur inimitable. Même les adjectifs se pressent, sans crainte de s’effaroucher, sans crainte de censure, dans l’atmosphère à la tiédeur retrouvée, parmi les sinuosités curieuses de la brise. Phrases à ramifications. Et soudains coups d’estocs. Estocades ? Pourquoi pas ? Ce soir, c’est un autre que nous irons entendre.
Au loin, derrière d’invisibles filets, la marche du temps prend d’autres allures, vénéneuses, avant que le printemps vraiment nous revienne.
(Alban Darche Trio+1, Yolk 2009, 10ème plage) - 4'54"
08:37 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 22 mars 2012
Mingus Minces
Charles Mingus resented being called Charlie. And didn't he just hate being called a giant ? Sure he did. Did hate that. Charles Mingus hated the word jazz. Now he did. Let it also be said that Charles Mingus resented people who could not hold their applause until the end of a song. Mingus hated the Beatles, Eric Dolphy said. Charles Mingus resented all nicknames derived from Charles, more particularly Charlie. And with all his love for skins and views, Charles Mingus hated his stay at Bellevue so much that he composed a tune punning on such hatred (Hellview of Bellevue). True, he did. Did Charles Mingus. And he resented the word jazz even more than he resented the world of jazz.
15:55 Publié dans Jazeur méridional, Le Livre des mines | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 23 février 2012
Can’t A Jazz & Simmons/Tusques (Petit Faucheux, 17 février 2012)
Vendredi dernier, au Petit Faucheux, c’était ticket double.
En 1ère partie, le septette Can’t A Jazz autour du guitariste Jean-Noël Galard : musique très appliquée, très écrite, offrant peu d’envolées mais quelques belles harmonies, de bons solos, bref… du jazz français se prêtant hélas à la tapinose. Entre autres menues faiblesses, pourquoi le leader, de toute évidence timide et peinant à parler en public, ne laisse-t-il pas un autre des musiciens annoncer les morceaux, dire ce qu’il y a (aurait) à dire ?
Après un entracte que je passai, exceptionnellement, vissé à mon siège car mon fils préférait rester dans la salle (ce qui nous a permis d’admirer le déménagement des instruments et instrumentistes), c’était le duo formé par deux septuagénaires de choc, que je ne connaissais que de nom mais qui m’ont accompagné depuis, au disque et via divers sites de streaming : le saxophoniste américain Sonny Simmons et le pianiste François Tusques (qui n’a d’entrée WP, et encore bien incomplète, qu’en allemand). Le programme était peu ou prou celui de leur album paru en 2011, Near the Oasis, et que je n’ai acheté qu’après, autant intrigué que subjugué. En effet, Sonny Simmons n’a pu achever le (bref) concert. Après un long duo piano / cor anglais, et plusieurs standards, le saxophoniste s’est excusé en nous disant qu’il devait aller se reposer et reviendrait après un solo du pianiste. François Tusques a enchaîné trois solos, dont un Night in Tunisia pour lequel il s’attendait à voir revenir son comparse, mais le saxophoniste n’est revenu qu’à la fin du troisième, lançant un petit chant puis saluant. De toute évidence, Sonny Simmons est de santé fragile et il fatiguait vite, mais chacune de ses improvisations valait, à elle seule, la totalité de ce qu’avait proposé Can’t A Jazz avant. Par-dessus le marché, François Tusques joue Monk totalement dans l’esprit de Monk, mais sans rien reproduire des modes de jeu ou choix d’improvisation de Monk ; cela aussi, c’était une sacrée découverte.
Bien sûr, l’album est beaucoup plus abouti, plus « parfait », plus rond, et donc plus satisfaisant, en un sens. Mais ce qui s’est joué là, ce vendredi, pendant une petite heure, au Petit Faucheux, c’est l’expérience réelle de la difficile beauté : un duo si magistral, si émouvant, ne s’écrit et ne s’impose qu’après des décennies d’une vie en musique. Et la beauté, même lorsqu’elle semble couler de source, n’est gagnée qu’en un combat sourd mais incessant contre la dureté, et la mort.
À écouter :
Simmons/Tusques. Near the Oasis (2011).
François Tusques Trio. Blues Suite (1998)
François Tusques. Octaèdre (2011).
11:04 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 17 février 2012
La fée talmudique se repose (5’35”)
Pas de perte de contrôle, ni de vitesse, si ce n’est le sombre éclat entre les touches. Tu tergiverses, mais non – jamais tu ne tergiverses, alors : on s’embringue, embardées, d’où d’autres embrassades, sans emberlificoter, tout se résout finalement en un brelan harmonieux. La flèche monte au ciel, c’est comme si le caméraman avait trouvé un truc pour l’y suspendre, l’y arrêter, faire en sorte qu’elle s’attache à rien, à l’air, à la chaleur d’un souffle, au butinement discret d’un insecte imperceptible. Pourtant, la caméra elle aussi fait des embardées, tout le monde s’extasie. Après une pause étonnante, on se croit en plein film d’espionnage, même pas parodique, comme si la sieste nous avait saisis, un assoupissement de fortune, ça tombait bien, on n’allait pas fort, tout d’un coup c’est tout comme si tout prenait le moelleux d’un tapis de mousse, mais tout s’étiole toujours, partout. Alors, après la pause étonnante dont l’on ne garde plus qu’un souvenir diffus, en différé on suit les embardées renouvelées d’une cacugne – pas du tout la Jaguar ou la Porsche des frimeurs, des flambeurs – au volant de laquelle s’exprime tout un imaginaire. Il a fallu que je reprenne, revienne, reprenne tel mot, telle virgule, ça n’allait pas, le lisse et le moelleux qui enflamment, dans les embardées, le souffle chaud, le lisse et le moelleux je n’ai pas su les capter dans mes phrases, quoique j’aie fini par sentir, doucement, l’accalmie, le repos, la sérénité encore – sur un lit de mousse en été, contre une cabane de planches sèches en hiver – s’enfouir dans mes phrases, s’y lover, s’y bercer, embardées encore, et embrassades, et tout un monde partout qui détoure les nuages, les angles vifs, à l’horizon, tout un monde, oui – et pas de perte de contrôle. Ni de vitesse. Effacement (moelleux).
Alban Darche 4tet. Brut ou demi-sec ? (Yolk, 2009)
09:21 Publié dans Ecrit(o)ures, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 16 février 2012
Revirement
--- Sonnet inspiré * par l’album du trio Alban Darche
avec un quatuor à cordes hongrois.
Qu’on dise « En avant, marche ! »
Ou, plus subtilement,
Oyant un feulement,
On se calfeutre sous une arche
Afin, du laiton d’Alban Darche,
D’écouter moins paisiblement
Les effets dont l’esseulement
Déplaira à tout patriarche,
On s’emporte, une main se torde
À pincer sans férir la corde,
Au point de n’être pas un max
Désabusé, mais enthousiaste
De suivre les envols du sax
Métaphysique, inecclésiaste.
* Il est, entre autres traits pénibles caractéristiques, composé d’une seule phrase, la proposition principale tenant en deux mots trois syllabes.
11:25 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles, Jazeur méridional, Sonnets de janvier et d'après | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 03 février 2012
À la vie à la mort (ARFI / Petit Faucheux)
 Hier, pour la Chandeleur, par le jour le plus froid – pour l’instant ? – de l’hiver tourangeau, c’était, pour moi, la reprise de l’année au Petit Faucheux. Il s’agissait d’un spectacle déjà créé il y a deux ou trois ans en partenariat avec le Petit Faucheux, mais que je n’avais pas eu l’occasion de voir à l’époque : À la vie à la mort, par un quatuor composé de Jean Aussanaire (saxes), Jean Méreu (trompette), Laurence Bourdin (vielle à roue) et Bernard Santacruz (contrebasse), compositions sur le tableau de Bruegel l'Ancien, Le Triomphe de la mort, que j’ai pu (re)voir au Prado l’été dernier.
Hier, pour la Chandeleur, par le jour le plus froid – pour l’instant ? – de l’hiver tourangeau, c’était, pour moi, la reprise de l’année au Petit Faucheux. Il s’agissait d’un spectacle déjà créé il y a deux ou trois ans en partenariat avec le Petit Faucheux, mais que je n’avais pas eu l’occasion de voir à l’époque : À la vie à la mort, par un quatuor composé de Jean Aussanaire (saxes), Jean Méreu (trompette), Laurence Bourdin (vielle à roue) et Bernard Santacruz (contrebasse), compositions sur le tableau de Bruegel l'Ancien, Le Triomphe de la mort, que j’ai pu (re)voir au Prado l’été dernier.
Les compositions sont très belles, les musiciens à la fois très inventifs et très attentifs, mais je ne devais pas être très en forme (ou très in the mood), car j’ai trouvé toute la première demi-heure trop homogène, tirant toujours un peu du côté de la lamentation ou de la mélopée. Le dernier quart d’heure était, pour moi, ce qu’il y avait de plus fort, à partir d’un duo frotté très sourd entre la vielle et la contrebasse.
 Après le concert, autour d’une Grim, mon collègue Eric R. et moi avons parlé, de manière assez prévisible (à ceci près que lui ne connaissait le musicien que depuis deux semaines, et moi depuis six mois !), de Valentin Clastrier, dont je ne retrouve pas, ce matin, dans mon fatras, l’album que j’avais acheté totalement par hasard l’été dernier en pays cathare (décidément, le concert d'hier dressait un pont entre l’hiver et le dernier été), mais aussi de Leonard Cohen et de musique baroque.
Après le concert, autour d’une Grim, mon collègue Eric R. et moi avons parlé, de manière assez prévisible (à ceci près que lui ne connaissait le musicien que depuis deux semaines, et moi depuis six mois !), de Valentin Clastrier, dont je ne retrouve pas, ce matin, dans mon fatras, l’album que j’avais acheté totalement par hasard l’été dernier en pays cathare (décidément, le concert d'hier dressait un pont entre l’hiver et le dernier été), mais aussi de Leonard Cohen et de musique baroque.
En bonus : lien vers la page consacrée au spectacle sur le site de l’ARFI, avec un extrait.
08:39 Publié dans BoozArtz, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 16 janvier 2012
Ajazza
On peut se passer de triple A, avec Willie Smith, pour Take the “A” Train, comme on peut s’en dispenser, avec Juan Tizol, pour “Caravan”. Nous avons abusé des absinthes, alors vers quel saint se tourner. Ecouter, regarder. Notre marasme n’a rien de commun avec celui des années 70. En ces années-là, on ne faisait pas face à la même dématérialisation de l’individu. Tout aujourd’hui est technique, donc objectivation matérielle. On peut, à bon droit, regretter les poussières désuètes du matérialisme dialectique. L’armoire était de chêne. Poursuis ta route.
09:20 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 05 janvier 2012
Louis Sclavis (Quintette) : L’imparfait des langues (ECM 2007)
Il n’est guère pertinent d’écrire une recension sur un album de Louis Sclavis, car le terrain est certainement bien, et mieux, défriché ailleurs. Toutefois, je me suis promis d’écrire ne serait-ce que quelques phrases sur les disques de jazz que j’ai reçus pour Noël, et commence donc par cet album de quintette qui date de 2007. Cela fait bientôt quinze ans que je connais le travail de Sclavis, tant dans des formations assez traditionnelles que pour des projets plus proches de la musique dite « contemporaine » (en fait, je l’ai d’abord connu par un album du Double Trio).
L’album, intitulé L’imparfait des langues, appartient à la vague plutôt mélodique et voyageuse, entre Chine et les disques du trio qu’il a formé longtemps avec Aldo Romano et Henri Texier. Filant la métaphore du titre, chaque morceau reprend l’idée d’une langue musicale. Or, s’il s’agit là d’un poncif (à même enseigne, inversement, que les formules toutes faites « la musique des vers », « le tempo du récit », ou même – oserai-je un tel sacrilège ? – la polyphonie bakhtinienne), Sclavis évite soigneusement tout cliché, tant dans les harmonies et les équilibres entre les éléments de son quintette, que dans la métaphore du langage. Il ne cède pas à la facilité des correspondances, dans le style ligne mélodique / grammaire & arrangements/syntaxe, mais creuse l’idée même d’expression : à l’écoute, les concepts d’annonce, de dialecte, de palabre ne semblent aucunement plaqués. Par ailleurs, le titre général de l’album apporte une modulation tout à fait significative : il ne s’agit pas de l’imparfait comme temps grammatical, mais bien d’une interrogation sur le passé des langues qui prend en compte tout ce qu’elles ont d’imparfait, au sens général. Le jeu de mots, qui paraîtra complaisant à certains, est tout à fait assumé : sans être du côté du bricolage ni du dissonant délibéré (il m’a toujours semblé compliqué de rattacher la musique de Sclavis au free jazz, et même à l’avant-garde : il n’est d’avant-garde qu’en tant qu’il explore et montre un chemin possible (encore des métaphores !)), Sclavis donne à entendre, avec ses comparses, tout ce qu’une musique a d’émouvant quand elle assume, humainement, d’être imparfaite. La clarinette basse, celui des trois instruments dans lequel le leader se montre le plus entreprenant et le plus émouvant, fait si bien entendre la voix et le cri humains qui se trouvent par là derrière qu’elle peut servir d’emblème à cet imparfait des langues.
14:20 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 03 novembre 2011
Funky Fun-Key
Ça y est, à peu près toutes les horloges de la cuisine sont à l’heure, à l’heure d’hiver. Une complainte, tu ne vas tout de même pas passer tes journées à bader ce camping-car en laissant infuser ton thé à la bergamote ? Hier soir, le Château de Tiregand 2008 puis la liqueur de poire, ça faisait peut-être un peu solide sur le cassis.
Des jours, des journées comme ça, pluvieuses, grises, monotones, pas assez de jus pour se décourager en regardant les sandales détrempées sur la terrasse, ou les espadrilles en vrac dans le vestibule (notre ami tire sur la corde, je trouve). Dire que tu avais le cran de critiquer l’autre polardeux pour ses phrases nominales en cascade. Tu abuses, tu t’abuses. Avec les feuilles de néflier qui font un rideau jaune, et quand la pièce commencera-t-elle ?
Vous n’avez pas la clé, tout ça c’est juste pour s’amuser. Tu t’amuses.
Notre ami que voici se donne les gants de tout savoir, même la vie clandestine des flamants roses, et ce jusqu’au sens architectural du mot falbala, mais il est incapable de servir un thé qui n’ait pas, plus ou moins, et jusque dans les chaloupements osés de la contrebasse de Heiri Känzig, un goût de lavasse tombée d’une gouttière.
Le félin se marre, vous salue bien.
―――― Juste un rappel de la contrainte de ces textes, qui n’ont pas de rubrique réservée (et je crois qu’on en trouverait dans les deux blogs) : doivent être écrits, sans retouche ultérieure, pendant l’écoute du morceau qui leur donne titre.
15:40 Publié dans Ecrit(o)ures, Jazeur méridional, Un fouillis de vieilles vieilleries | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 30 mars 2011
Page envahie par les herbes folles
29 mars 2011.
Je dois dire que j'écoute beaucoup mon album du trio d'Issam Krimi. Je dois dire que j'écoute Issam Krimi. Même sur le verbe principal, surtout sur le verbe principal, l'intonation change, modifiant fondamentalement le sens de ce devoir. Comment le marquer à l'écrit ? au fer rouge ? (Dans un fichier Word, j'aurais des fers rouges.)
L'album s'intitule Eglogues 3. Je jure que je n'ai pas fait exprès. La composition qui ouvre l'album s'intitule 28 août. Je jure que j'ai fait exprès. (De là, il pourrait y avoir des digressions, des  dérapages, des virages, et quelques saines réflexions sur les dates : 11 juillet, date de naissance de mon fils aîné et titre de la composition qui ouvre un album du trio de Sophia Domancich, La part des anges. Et ce 28 août, donc, que, partant du titre lu sur le disque orange et noir, j'ai recherché dans ma "galerie", comme le veut la terminologie francophone de Flickr, m'a ramené à la maison, au jardin envahi d'herbes folles, de l'allée de la Cordaize, alors que, pas plus tard qu'hier (28 mars), je remarquai, en passant, comme chaque jour en allant au travail, que de longues plaques de mousse envahissaient la partie de trottoir la plus à l'ombre de cette même allée de la Cordaize... Et que cela m'évoqua ce que j'avais lu la veille, l'Eloge de la mousse que va publier Philippe Picquier... Etc.*)
dérapages, des virages, et quelques saines réflexions sur les dates : 11 juillet, date de naissance de mon fils aîné et titre de la composition qui ouvre un album du trio de Sophia Domancich, La part des anges. Et ce 28 août, donc, que, partant du titre lu sur le disque orange et noir, j'ai recherché dans ma "galerie", comme le veut la terminologie francophone de Flickr, m'a ramené à la maison, au jardin envahi d'herbes folles, de l'allée de la Cordaize, alors que, pas plus tard qu'hier (28 mars), je remarquai, en passant, comme chaque jour en allant au travail, que de longues plaques de mousse envahissaient la partie de trottoir la plus à l'ombre de cette même allée de la Cordaize... Et que cela m'évoqua ce que j'avais lu la veille, l'Eloge de la mousse que va publier Philippe Picquier... Etc.*)
Tout le voyage n'est-il pas une métaphore de l'album photographique ? Tout cet indigeste texte, résurgence possible du projet de Très long texte, n'est-il pas, tout simplement, une descente aux enfers de l'empilement des images ? Le thème central, réexposé au cor anglais, est ensuite l'objet de variations confiées aux cordes seules. Orange, et noir, et orange de nouveau, avec des lettres blanches, le nom d'Issam Krimi, que je ne connaissais pas lorsque j'achetai ce disque (il y a trois ans ? quatre ? cinq ?), d'occasion probablement, sans faire le larron. Enfoiré, va ! --- Il a dit : "Enfoiré, va !" --- Toujours est-il que ça ne me viendrait pas à l'idée de me faire enlever au Niger. Lassé de ces allées-venues, il parque la voiture devant un grill. Mince, nos précédentes tergiversations, déambulations mentales (tandis que je vais de l'avant, longe, excurse), nous avaient conduit au château de Chamerolles. Le kangourou cria. le kangourou cria. Orange, et une large bande noire peuplée de lettres et de chiffres en caractères oranges, et orange de nouveau --- et c'est tout de même un album. L'ouvrant au hasard, il tombe sur une vue en couleurs du château de Cordès. Je jure que je ne l'ai pas fait exprès. Je jure que je ne l'ai pas fait exprès. Et ainsi va le nom, ainsi vont les phrases qui s'enchaînent (mille excuses).**
Album, il ferait beau voir. Je n'arrête pas de chier. Un violon de faïence, la corde tendue, et qui est parvenu jusque là a lu la première occurrence, je pense, sur l'ensemble de mes sites, du verbe chier. Un violon de faïence, la corde tendue, et, chasse tirée comme les couteaux (pas mieux), je n'arrête pas de chier aujourd'hui. Pourtant ce n'est pas chasse gardée. Demain ça ira pareil (pas mieux). De nouveau, la correctrice fait remarquer la propension de l'écrivain en herbe (folle, sauvage, ombellifères envahissant la vue et ne permettant de voir que partiellement le blanc impeccable des volets) à user de parenthèses, à en abuser à la toute fin des phrases (comme ici). Quand ce n'est pas en les posant là, blocs isolés, incompréhensibles. (Pas mieux.)
Tandis que j'excurse, elle exulte. S'insurger n'est pas tout. Anne Delestrade relâche un chocard qu'elle vient de baguer***. Tout au cordeau, bien sûr. Le point n'était pas là. Le point ne devait pas être là. Quand même, cet album est génial. Je dois dire que cet album est gé-nial. (pas mieux.) Je dois dire que j'écoute toujours plus souvent, toujours plus admiratif, mon disque du trio d'Issam Krimi.
Il fait des phrases. Il pose des parenthèses. Il pointe du doigt (pas mieux) des italiques ludiques. Aussi il dit qu'il n'arrête pas (aujourd'hui) de chier. Des histoires de violon de faïence. C'est à n'y rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre. Herbes jaunes, séchées par le soleil, cela n'a rien d'un champ fleuri de coquelicots ou de myosotis. Sur ces fleurs de rhétorique je vous laisse, il reste à creuser le texte (de l'intérieur (cavatine)).
La correctrice s'insurge : il recommence ! (Je dois dire que ça ne me réussit pas trop d'écrire en écoutant, toujours plus admiratif, Eglogues 3 d'Issam Krimi.)
15:43 Publié dans Entre Baule et Courbouzon, Jazeur méridional, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 27 mars 2011
Good God !
Demain, à pareille heure j'aurai créé un deuxième nouveau site de coups d'éclat musicaux :
15:40 Publié dans Autres gammes, Flèche inversée vers les carnétoiles, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 05 décembre 2010
Some Skunk Funk
20:55 Publié dans Autoportraiture, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (3)
samedi, 27 novembre 2010
Cool day in Hell (7'51")
Ni le ticket du match de handball remporté par le SCT hier soir, ni ma fiche de paie du mois de septembre d'octobre, ni le disque ouvert afin de pouvoir lire les titres des morceaux, ni le livre de Claro refermé qui se trouve en-dessous du disque, ni la télécommande de la chaîne stéréo du bureau-bibliothèque, ni le tube de Lysopaïne dans lequel il ne doit plus y avoir qu'une ou deux inefficaces pastilles, ni les cartes postales abîmées, ni le tome II des Essais de Montaigne ouvert et retourné couverture vers moi (dans l'édition du Livre de Poche (alors que je possède ces mêmes Essais en Garnier jaune et en Pléiade)), ni une carte de visite à mon nom qui traîne là allez savoir pourquoi, ni le pot à crayons où se trouvent des stylos et deux crayons à papier et qui est entouré (enveloppé ? décoré ?) d'une vieille photo plus écornée et abîmée encore que les cartes postales susdites et où vous verriez, si vous étiez près de moi, a younger version of myself, moi nourrissant une girafe en faisant une grimace pas possible, ni le DVD de Shining (pourquoi est-il là, d'abord ?), ni le solo de saxophone ténor sous-tendu par le cor de Peter Gordon et le trombone de Robin Eubanks, ni mon vieil exemplaire de Memory of Snow and of Dust et mon à peine plus reluisant exemplaire de Godhorse (pourquoi, pour quel remords stupide sont-ils là, alors que j'ai renoncé à écrire les articles correspondant à mes communications de novembre et mars dernier respectivement ?), ni l'ordinateur portable Toshiba sur lequel je pianote ces lignes (ma collègue, F., a parlé ce matin, dans un mail, de lapsus calami, alors que je jure mes grands dieux que je n'écris ni mes mails ni mes textes de carnétoile à la pointe effilée d'un roseau), ni les rayonnages de livres qui m'entourent, ni les divers livres plus proches encore de moi, en pile sur ou dans l'espèce d'espace ouvert -- mi-tiroir mi-étagère -- qui se situe à gauche sous la planche du bureau où j'écris ces lignes, ne pourront rivaliser avec l'ardeur des musiciens dont les dernières notes se font
15:49 Publié dans Ecrit(o)ures, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 08 novembre 2010
Salut
"Ce matin, les lourds menhirs de Lagatjar n'arrivant pas à temps pour maîtriser notre escadron-vapeur, nous voilà déjà loin de l'ample salut de mon camarade Ping-Ping, le fossoyeur ancien qui vit tant de Camarétois partir pour le pays littéraire d'Hamlet."
(Saint-Pol Roux. La Randonnée. 1932. Rougerie, 1978, p. 8)
Vendredi soir, aussi, encore, je me trouvais au Petit Faucheux. Marc Ducret, embarqué entre Hamlet et bitumaisons, était encore mieux qu'égal à lui-même ; les compositions jouées par l'ensemble Cairn, en revanche, m'ont ennuyé - trop d'avant-gardisme, ou deviens-je vieux con plus regardant ?
11:21 Publié dans Comme dirait le duc d'Elbeuf, Jazeur méridional, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 03 novembre 2010
Let's Get to the Nitty Gritty
Bientôt midi, bientôt l'heure d'essayer, dans la douceur automnale, d'aller chez le coiffeur. Mais enfin, je ne suis même pas rasé, j'ai une tronche de décavé. Une vache lancée à plein galop, un couple d'amoureux, un Christ en croix : les téléchargements simultanés provoquent des effets de contiguïté intéressants. Trop précieuse, l'écriture d'Hélène Grimaud m'éloigne de son expérience. Un quintette qui sonne exactement comme un medium band, ce pourrait être l'une des définitions du hard bop, encore que Horace Silver n'appartienne ni au hard bop ni au cool jazz. Sorte de mixte des deux. Naguère (presque jadis), ce genre de texte trouvait naturellement sa place dans mon autre blog carnétoile. Il est des mots bannis, je peux taxer les autres de préciosité... Et aller se raser au lieu d'ennuyer tout le monde ? C'est assez poil à gratter, ça agace, et les pétales givrés sur un océan bleu dévisagent le pianoteur (pinailleur), lui demandant encore et encore de se lever de son fauteuil, et d'aller une bonne fois pour toutes se raser avant d'essayer d'aller chez le coiffeur. Curieuse expédition, que semblent décourager les brassées vives de feuilles d'un jaune éclatant, envahissant de leur lumière la bibliothèque (les deux néfliers, un roman sans cesse à recommencer). Et si j'y allais ? Les boules parfaitement sphériques, juste évasées, brunes et plombant les branches entre les feuilles d'un or terne étincelant, sont pareilles à des yeux exorbités, m'interrogent, ou m'exhortent, ou me fusillent. Il faut bien embrayer, se lancer à corps perdu dans la jungle (pianotements têtus vers 5'15") jaune, roussâtre, d'albâtre vous mettrez l'adjectif ou le qualificatif que vous préférez. Au point où j'en suis (même pas rasé en plus (il a fallu, ici, se baisser au ras du carreau pour vérifier le minutage (et plus qu'une minute pour clore l'écriture de ce texte))), je peux vous laisser les clefs. La porte fermée. Le coiffeur ne m'attend même pas ; il prend sans rendez-vous. Et ça résonne, au ralenti, comme un medium band de foire du mercredi, en attendant la sirène du début du mois : bientôt midi.
11:55 Publié dans Jazeur méridional, Moments de Tours, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 09 octobre 2010
Petit Faucheux, 8 octobre 2010
Tony Malaby, avec huit étudiants d'un sacré niveau : quatre compositions belles, variées, se suivant -- dans un étrange parcours conduisant du free façon Don Cherry au style West Coast années 60. Then back to now, in a way.
Deuxième partie, plus convenue, d'une certaine manière. Stéphane Kerecki, Thomas Grimmonprez, Thomas Savy + le saxophoniste américain toujours : plus habitués à prendre des risques ? moins tendus (au sens d'une attention, des oreilles ou des perches tendues) ? Le clarinettiste, toutefois, a eu quelques mémorables mélancoliques poignantes envolées.
09:07 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 15 juillet 2010
Grand débordement d'activité, I
[Ferré et Thiéfaine sont les deux chanteurs que je connais qui parlent du Chambertin.]
Arrivée à Hagetmau, divers rangements, ménage etc.
Samedi 10. La Ceinture de jade d’Anatoli Kim. Jackie McLean. Déjeuner sous les arbres.
6 h du soir, course d’Audignon (Deyris) aux arènes de St Sever, aux 9/10 vides (avec Richard). Marty vainqueur, belle prestation du local Plassin, frères Vergonzeanne décidément en déclin. Courtiade use du coudrier sur le cuir des dames. Lalanne pas veinard sur la sans corde. Du beau linge dans le callejon, dont la Zahia des coursayres (Mme Vincent Muiras, il semble). Pointeur débutant archinul, maintes broncas vers la pitrangle.
Soir, petite finale.
Dimanche 11, anniversaire d’A. 10 à table, parents, grands-parents, Mamie J. et V.
Matin, ballons et tronçonneuse. Midi, sangria infecte mais le reste impeccable. Cadeaux en nombre pour A., « yes ! » à chaque coup ! Discussions post-prandiales et vaisselle.
5 h, course de St-Cricq (Dargelos), très moyenne (euphémisme), arènes mi-pleines. Bien placés, presque pas au soleil. Même pointeur gamin nul que la veille, en progrès sauf au moment de la comptabilisation finale individuelle (Lapoudge, 19 écarts globalement convenables, totalement oublié, même derrière Dumecq). Lendresse vainqueur. Frères Deyris suprêmes, surtout J.-F. muselant la sans corde après tumade sur Dumecq. Un tourniquet parfait de Lapoudge, capturé sur vidéo.
Soir, finale lamentable à la télé avec bocadillos et victoire de l’Espagne aux forceps.
Lundi 12. Mrs Dalloway, en bribes, juste le premier tiers (du moins à 6 h 30 du soir, heure à laquelle j’écris ces bribes elles-mêmes). Boogaerts. Pas de course, mais Défis & Champions en DVD à la télé en guise de quatre-heures, avant bonne promenade au Louts. [Crapaud mort gonflé de vermine en plein soleil au milieu du boulodrome. O. n’a pas compris, A. dégoûté.]
Matin, achat de déshumidificateurs car la moisissure a gagné trop de terrain.
« Quelques enduits et je termine. »
Mardi 13. Sur la vieille bécane, toujours (combiné du clavier Fujitsu de 2002 et de l’écran Philips de 2000). Continue Mrs Dalloway. Passage de voitures en trombe sur la route de Monségur. Ratatouille. Saturnin, pour O. (au-delà du ridicule). Acheté le guide vert du Languedoc-Roussillon chez Caldéra. Signe le plus évident, pour moi, de « la grande déculturation », la disparition de guides détaillés, et en particulier des Guides bleus. Regret de ne pas en avoir acheté une pleine fournée quand la collection existait encore, ou de n’en trouver qu’usés, jaunis ou cornés chez les bouquinistes ou les antiquaires.
Furieux de voir le grand cercle où « ils » avaient fait brûler des feuilles et des branches ne pas se remettre de son état calciné – toujours grand pourfendeur in petto (et à haute voix) de l’écobuage. Pas de course aujourd’hui, j’écris ces lignes à onze heures moins dix.
Mrs Dalloway, de Peter Walsh avant midi au dîner de Peter Walsh (‘Bartlett pears’).
Hélicoptères en permanence (avant le 14 juillet ?). Que de remue-ménage aujourd’hui.
Premières idées pour le cours de M1. Different from (/ to, than) → les constructions prépositionnelles après les adjectifs. Autres constructions en from. Utilisations de from dans les textes théoriques (philosophie, littérature, histoire). [Oui, tout juillet dans un seul document.]
7e compagnie, le soir, pour A. – plié de rire à plusieurs endroits. Moins nanard que dans mon lointain souvenir. On a dû pouvoir dire ou écrire, à l’époque, que ça réinventait complètement le comique troupier. Au lit, commencé Underworld, pas longtemps. [La barre d’espace, peu réactive, me fait des blagues, composant des agglutinés.]
Mercredi 14. [Neuf heures et demie.] Poursuivi quelques pages d’Underworld, je ne comprends rien aux règles du baseball donc une partir du tour de force stylistique m’échappe. Cela sent un peu le tour de force, dès le départ. À suivre… Vais lire les 25 pages restantes de Mrs Dalloway.
Désintoxication de café presque totale (juste une petite tasse milieu de matinée). Pas de thé, du tout.
Max Roach & Clifford Brown.
Au lever on a cru au beau, et puis : vent, soleil par intermittences – ça peut donner tout et son contraire.
Après-midi et soirée : Concours de la Corne d’Or à Nogaro. Foule. Belles vaches, sorties festival des sauteurs distrayantes (dont un tout à fait inédit et épatant triple saut périlleux avant et sur la vache par Louis Ansolabéhère), et triomphe de Thomas Marty, tenant du titre et auteur d’un intérieur absolument époustouflant. Le garçon devient meilleur chaque année. Côté trophées, triplé et carton plein de l’Armagnacaise : Barrouillet cordier d’argent ému aux larmes, Ibañeza indétrônable et Baronne vache de l’avenir.
D’où vient la passion et surenchère de Virginia Woolf pour les points-virgule ?
Plus d’hélicos (c’était donc ça).
Jeudi 15. Record de la coiffeuse la plus abrutie & la plus inculte pulvérisé. (Jocelyne, dite « Joss », à Hagetmau.) Avouez que la concurrence est rude…
Continué d’ébrancher des gaules – activité essentielle de ce début d’été – au point de devoir manier le sécateur de la main gauche (triple ampoule à l’index de la main droite (mon père avait raison : « mets des gants de jardinage, Guillaume ! »)).
Pas d’Underworld.
Bassine de 6 kilos de prunes quasi achevée (en 4 jours). Pas besoin de faire des confitures, une famille de quatre estivants suffit amplement à la Cause.
Underworld, 100-122.
14:45 Publié dans Autoportraiture, Hors Touraine, Jazeur méridional, Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 14 octobre 2009
Double Sunrise Over Neptune
Ma myopie est si faible (apparue à l'âge adulte, elle n'a jamais "progressé") qu'aujourd'hui j'ai décidé de ne pas porter de lunettes, ce dont personne ne s'est encore aperçu, ou ce que personne n'a jugé bon de remarquer à haute voix. Cependant, par les oreilles j'écoute en boucle l'album en medium band de William Parker, Double Sunrise Over Neptune, dans lequel le génial contrebassiste-compositeur ne joue pas de la contrebasse, mais, si j'en crois les notes de pochette, du doson'ngoni (dont je présume qu'il s'agit d'une sorte de luth n'goni) et des "double reeds" (ce qui signifie, très vaguement, "anches doubles") : cela signifie-t-il que William Parker joue de tous les instruments à anche double sur cet album, et donc du contrebasson autant que de la chalemie, et du sarrussophone ainsi que du guanzi ?
Passons... Pour la première fois de la journée, face aux caractères trop petits de la fenêtre de saisie H&F, je plisse légèrement des yeux. Le linge s'envole au soleil. J'ai refermé la double fenêtre à cause des odeurs de kérosène. Mes yeux se plissent.
=======>
Pareils aux figures d'une tapisserie, les chevau-légers ondoient, flottent, courent, se plissent, s'étendent, s'éclipsent devant l'horizon lointain et bleu, reparaissent, voilent le soleil.
L'instabilité des continents voisins, dont les rochers se plissent, s'élèvent et s'abaissent en vagues, modifie de cycle en cycle la ligne des côtes.
Par l'eau tremblante du canal,
Tournant leurs coques vers l'aval
Muets, les chalands glissent...
Les nénuphars se plissent,
Des zébrures s'esquissent...
Ces lèvres, qui ne débitaient que maximes austères, se plissent et s’avancent comme pour des baisers.
M. Tatin a pensé que c'était par le carpe qu'il fallait commander le mouvement de torsion venant s'éteindre graduellement près du corps, et pour obtenir avec toutes ses transitions, il avait substitué aux ailes de soie qui se plissent, des ailes entièrement construites en plumes très fortes, disposées de telle façon qu'elles arrivassent à glisser un peu l'une sur l'autre pendant les mouvements de torsion: la fonction de cette nouvelle voilure était parfaite; mais, adaptée au grand oiseau, ces ailes ne donnèrent que des résultats médiocres.
<=======
À quel moment ai-je laissé échapper la proie pour l'ombre ? Même ouvrir un vieux fichier me tire des soupirs. Les conceptions me réjouissent, mais les mettre en oeuvre me fait bâiller. Tout ici est déplacé, confisqué, sans heurt mais sans gloire. Comme une daurade je frétille d'aise.
14:31 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (2)
dimanche, 13 janvier 2008
Omégalomanie trombonesque
Le lecteur sourcilleux, insomniaque, ou peut-être – simplement – attentif et doué d’une bonne mémoire, se souvient peut-être qu’un lointain lundi de blocage, à la suite d’une séance particulièrement longue à battre le pavé de la rue des Tanneurs, pour finir par ne pas voir s’ouvrir l’université en partie saccagée par les insurgés d’opérette, l’auteur de ce carnétoile (lequel avoisine, au bout de trente-et-un mois d’existence, les 2000 textes publiés) s’était retrouvé face à un verre de succulent vin de myrte chez un collègue dont un certain froid par ailleurs le sépare, ce qui est d’autant plus dommage qu’il partage, avec ce collègue, des goûts musicaux, dont la découverte, chez ledit collègue, de l’enregistrement original en vinyl de la longue et belle composition d’André Hodeir Anna Livia Plurabelle n’est pas la moindre. Or, ayant siroté son vin de myrte en suivant le texte de Joyce sur l’exemplaire photocopié que le collègue sus-cité avait tendu à ses invités – l’auteur du carnétoile et une collègue parisienne très gentille –, le héros verdoyant s’en retourna chez lui et commanda illico, via la fière Amazone, la version disponible en CD d’Anna Livia Plurabelle, qui s’avéra être l’enregistrement de septembre 1993 sous la férule de Patrice Caratini (avec du beau monde, certes, Marc Ducret, Denis Leloup et Sylvain Beuf en tête). C’est cette version qu’il écoute en écrivant ces lignes – le temps d’une vaisselle, d’un peu de ménage et d’écrire les deux phrases qui précèdent, c’est déjà le septième des 13 morceaux (‘By earth and the cloudy...’). Il semblerait que la version originale, du début des années 1960, ne soit absolument pas disponible en CD, soit qu’il n’y ait pas eu d’effort commercial en ce sens, soit que la version de 1993 – pilotée aussi, semble-t-il par Hodeir, et qui devait donc bénéficier de son consentement – n’ait évincée la première. Le projet, très clairement énoncé par Laurent Cugny dans le texte du livret, consistait, pour le big band réuni sous la houlette de Patrice Caratini, à reprendre très précisément la partition d’André Hodeir et les arrangements d’origine, soit une démarche assez inhabituelle dans la galaxie jazz, plus habituée aux reprises libres, fût-ce de standards archi-rebattus. (L’auteur de ce carnétoile, qui compose ici à la troisième personne pour saluer le retour, dans la blogosphère, du Vrai Parisien, longtemps disparu sous les traits de l’Amateur, renonce temporairement aux paragraphes, à la manière d’Olivier B.) Ce qui frappe, dans Anna Livia Plurabelle, plus que la prédominance des cuivres et saxophones (et, en particulier des plus mâles d’entre eux : sax ténor, trombone), c’est l’équilibre étonnamment juste entre les deux voix (soprano et contralto) : ici, ce sont Valérie Philippin et Elisabeth Lagneau qui font vibrer le texte de Joyce, peut-être avec moins de clarté dans l’élocution que les deux de la version princeps, Monique Aldebert et Nicole Croisille – mais ce peuvent être aussi les déformations myrtoyantes de la mémoire qui jouent des tours à l’auteur de ces lignes. (Omega s’étant affalé sur le canapé, sans protester pour autant, il fallut aller le remettre d’aplomb, tandis que la partie la plus douce du dixième fragment (‘No more ?’) s’écoulait des baffles. Sur le ventre, bientôt, Omega ne manqua pas d’ajouter ses trilles vibrantes à la jazz cantata, non sans force couinements caoutchouteux de Sophie la girafe.) Accessoirement, tandis que ça scatte frénétiquement, est-il nécessaire de préciser que le héros tourangeau de ces parages s’est trouvé, à l’occasion de cette écoute, replongé dans Joyce – Finnegans Wake et même les occurrences de bun dans Ulysses – ce dont, accaparé déjà par Neige d’Orhan Pamuk, Impératif catégorique de Roubaud et les textes critiques de Lyn Hejinian, il se serait dispensé, si son démon plurabelliste avait pu lui lâcher la grappa.
10:54 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Jazz, Musique, écriture
jeudi, 10 janvier 2008
Jackie McLean, Consequence.
Un quintette solide pour six morceaux de grande tenue. Lee Morgan à la trompette dépasse presque le leader. Impossible de savoir de qui sont les compositions (j’aime beaucoup Tolypso). Il s’agit d’enregistrements du 3 décembre 1965, sortis en album pour la première fois en 1979 seulement (inexplicablement). La musique – comme la photographie de Ron Leighton qui se trouve en couverture – oscille entre l’abstraction chaleureuse et l’éclat glacial de la figuration. Nous sommes dans le même navire des draps dépliés, chiffonnés. L’introduction somptueuse de Harold Mabern (parfait inconnu pour moi) sur Slumber suffit à pousser la note grave de l’insomnie créatrice.
 Ce vinyle du saxophoniste Jackie McLean, je l’ai découvert, comme tant d’autres, depuis la mort de P. Lui qui m’a initié au jazz, ne m’avait, je crois, jamais parlé de ce saxophoniste dont il possédait pourtant deux doubles albums, et celui-ci. Sur les deux premiers solos de Bluesanova, on se dit qu’en matière de splendeur, McLean n’a pas grand chose à envier à Coltrane. (En consultant la vieille édition du dictionnaire du jazz qui se trouve ici, je me dis que j’ai déjà dû croiser la route de McLean, via Mingus toujours. Speaking of which je m’y perds et je découvre aussi que le Mahavishnu Orchestra avait enregistré un album qui s’intitulait Good Bye Pork Pie Hat ; dans la collection des vinyles de P., il y a cet album de Joni Mitchell que je n’ai toujours pas osé écouter, et également consacré à Mingus.)
Ce vinyle du saxophoniste Jackie McLean, je l’ai découvert, comme tant d’autres, depuis la mort de P. Lui qui m’a initié au jazz, ne m’avait, je crois, jamais parlé de ce saxophoniste dont il possédait pourtant deux doubles albums, et celui-ci. Sur les deux premiers solos de Bluesanova, on se dit qu’en matière de splendeur, McLean n’a pas grand chose à envier à Coltrane. (En consultant la vieille édition du dictionnaire du jazz qui se trouve ici, je me dis que j’ai déjà dû croiser la route de McLean, via Mingus toujours. Speaking of which je m’y perds et je découvre aussi que le Mahavishnu Orchestra avait enregistré un album qui s’intitulait Good Bye Pork Pie Hat ; dans la collection des vinyles de P., il y a cet album de Joni Mitchell que je n’ai toujours pas osé écouter, et également consacré à Mingus.)
Le finale de Slumber, dans le dialogue cuivres/section rythmique, emporte loin du navire, sur la mer maintenant refermée des draps qu’aucun ciel n’a froissés.
[Hagetmau, 31 décembre 2007]
10:10 Publié dans Hors Touraine, Jazeur méridional, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Jazz, Musique, écriture
lundi, 07 janvier 2008
Abattis
[ 5 janvier 2008 : aujourd'hui, le 7, pas une minute.]
Ce ne sont pas les nouveaux disques qui manquent ; pourtant, à peine de retour, je replonge dans l’intégrale des enregistrements live de Bill Evans en trio au Village Vanguard, qui m’a accompagné tout l’automne, au soleil comme aux nuages. La version d’Emily enregistrée le 23 août 1968 avec Gomez à la contrebasse et Jack DeJohnette à la batterie me tirerait presque des larmes. A Sleepin’ Bee (13 décembre, avec Marty Morell à la batterie), et je danse la gigue dans le ciel. Je m’amuse du clin d’œil à la Marche turque dans un énième Someday My Prince Will Come (15 septembre, avec John Dentz à la batterie). Curieux, les batteurs de Bill Evans semblent interchangeables, sans personnalité, se fondre dans les harmoniques du leader. (Un compliment pour chacun d’entre eux, je suppose.)
16:39 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jazz
dimanche, 02 décembre 2007
Aux flammes sombres de Djibouti
Nouvelle écoute, après des mois d'abandon, de Dark Flame, le disque d'Uri Caine inspiré de compositions et lieder de Mahler. Toujours pas convaincu. Il faudrait réussir à oublier qu'il y a Mahler derrière, et ne l'écouter que comme un disque de Caine... et encore, serait-ce suffisant ?
Pourtant, j'avais adoré le double album inspiré des Variations Goldberg : c'était en 2002 ; on me l'avait prêté. Si ça se trouve, j'aimerais moins aujourd'hui.
-----------------------------------------------------
La conférence que je dois prononcer cet après-midi à l'Espace Vinci, dans le cadre du Festival des Langues et des Cultures, est prête. Il s'agit d'une sorte de déblayage pour néophytes, de quoi donner envie au public (sans doute peu nombreux) de découvrir certains écrivains djiboutiens. Je vais surtout lire des extraits d'Abdourahman Waberi. J'ai (pompeusement) intitulé cela Djibouti, l'écrit abouti.
10:40 Publié dans Affres extatiques, Autres gammes, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Ligérienne, Jazz, Afrique
lundi, 15 octobre 2007
B.S.S.L.
Tout écouter, chaque note de The Black Saint & the Sinner Lady, et puis rendez-vous au grand pylône ! On entre en transes sur ces morceaux de bravoure, et puis rendez-vous au grand pylône !
(On n'en parle plus, et puis boufniouze...)
16:40 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jazz, écriture
samedi, 06 octobre 2007
Chainsaw at Sousa's Funeral
" I am wearing an apron and I'm on teenage cost containment program ! " *
C'est du jazz, ressers-moi ce jazz. (198 messages indésirables en 35 heures, ça fait beaucoup.) Entre '91 et '93, tandis que je pinçais les lèvres et allais me faire vérifier le sang tous les quinze jours, les trois acolytes Horn, Kendig et Dickey bricolaient de tous instruments ici et là, en marge bien sûr, où naissent les nuages farouches. L'album Screwdriver !, ressorti en 1999 sur le label Leo Records Lab, est fort de cet acide pas poseur, claviers désaxés, clarinette stridente et force beaux bidouillages. Certains moments à l'orgue vont jusqu'à rappeler, dans leur recherche même, mélopées tziganes et mélodies lancinantes soufies.
Resserré dans le manteau qui m'envole, j'écoute cheveux fermés.
* Je porte un tablier et on m'a placé sous tutelle financière.
11:05 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jazz, Ligérienne
samedi, 29 septembre 2007
Il fait toujours beau
Soleil sur les vitres, je voulais profiter de la douceur de cette belle après-midi de septembre finissant en ouvrant justement les fenêtres. Le disque qui se lance n'est autre qu'Il fait toujours beau du tentette de Stan Laferrière, musique finement cuivrée et on ne peut plus opportune. Malheureusement, les bricoleurs du samedi (qui sévissent aussi le dimanche, le mercredi, etc.), cette engeance maudite, font résonner dans le quartier, qui les crissements de sa perceuse, qui les raclements de son kärcher. On referme alors les fenêtres.
 L'autre jour, en voiture, je suis retombé dans une cuve de Dexter Gordon (les enregistrements en quartette, avec Bobby Hutcherson au vibraphone en surnuméraire pour certains titres). Grande bouffée de bonheur, non seulement (comme toujours) en me remémorant l'époque où j'écoutais cette musique joyeuse, mais aussi par la grâce même de ces arrangements d'un bop sans complexes, sans pointillisme, sans finasseries, et pourtant diablement beau. Le titre qui me donne le plus envie de m'époumoner, de profiter des heures heureuses ici-bas, est, par bien des côtés, l'un des plus "datés" (Le coiffeur).
L'autre jour, en voiture, je suis retombé dans une cuve de Dexter Gordon (les enregistrements en quartette, avec Bobby Hutcherson au vibraphone en surnuméraire pour certains titres). Grande bouffée de bonheur, non seulement (comme toujours) en me remémorant l'époque où j'écoutais cette musique joyeuse, mais aussi par la grâce même de ces arrangements d'un bop sans complexes, sans pointillisme, sans finasseries, et pourtant diablement beau. Le titre qui me donne le plus envie de m'époumoner, de profiter des heures heureuses ici-bas, est, par bien des côtés, l'un des plus "datés" (Le coiffeur).
Pendant quelques bons moments, au début de cette redécouverte, je ne pouvais m'empêcher de comparer défavorablement, dans mon for, les versions de Dex avec celles de Miles & Trane (un sommet, il faut avouer). Puis, en fin de compte, lentement, langoureusement, Dexter Gordon et ses acolytes m'ont fait oublier les fulgurances de Davis et de Coltrane, et j'ai pu apprécier notamment cette autre vision, lecture, version de Love for sale.
Tandis que j'écris ces lignes, Stan Laferrière se démène au Fender sur Grolomelematch, troisième titre mi-joyeux mi-torturé de l'album cité ci-avant (cela entre l'alto d'Olivier Zanot et le ténor de Thomas Savy). Il fait toujours encore beau. Ah, se promener dans la rue en s'époumonant, sur tant de démesures...
15:56 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jazz, Ligérienne
samedi, 15 septembre 2007
Frank Woeste Trio à Montlouis, 14 septembre
En général, ça commence toujours par un peu de lecture (ce qui est tombé sous la main / crépuscule superbe sur les rives de la Loire / puis attente du concert).

Ensuite, au "jazz club" de Montlouis, dans l'affreux hangar du Saule Michaud, ça chauffe.
Frank Woeste emmène un trio dont on peut dire qu'il n'est pas d'une folle originalité. Rien à redire aux qualités musicales des trois comparses, ni de leur travail ensemble. Seulement, les compositions du pianiste manquent de mordant, ses lancements au Fender sont plutôt conventionnels, et ça dégaine autrement dès que le trio met Strayhorn ou Monk sur orbite.

Mathias Allamane est parfois étouffé entre deux, problème probable de balance. (Pour ne rien arranger, mon verre de blanc de Montlouis "Cuvée du Festival" s'avère être une horrible piquette, pour parler comme l'autre.)

Matthieu Chazarenc se démultiplie, vrai plaisir de jouer. Un peu trop démonstratif peut-être (il penche assurément plus du côté Max Roach que du côté Kenny Clarke (clin d'oeil à Paul)).

Saluts après le bis. Rien d'inoubliable. On a retenu Naked Moon, composition de Woeste inspirée par un poème de Ginsberg, et surtout Rare Days (Spare Days ?), piste ou voies à explorer.
17:15 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jazz, Ligérienne
mardi, 03 juillet 2007
Pentacle
 Là encore, il s’agit d’un de mes disques préférés de jazz contemporain. Toutefois, là, je pense le connaître par cœur – ou, disons, je le connaîtrais par cœur si j’avais quelque connaissance de solfège, composition, etc. Pour rabattre de mes prétentions, je pourrais écrire plutôt que je connais vraiment par cœur le premier titre, “Vestiges”, et serais dans le vrai.
Là encore, il s’agit d’un de mes disques préférés de jazz contemporain. Toutefois, là, je pense le connaître par cœur – ou, disons, je le connaîtrais par cœur si j’avais quelque connaissance de solfège, composition, etc. Pour rabattre de mes prétentions, je pourrais écrire plutôt que je connais vraiment par cœur le premier titre, “Vestiges”, et serais dans le vrai.
Dans cet album d’une rare beauté tant cuivrée que cordée, la pianiste Sophia Domancich, aux commandes, s’est entourée du bugliste Jean-Luc Cappozzo, que l’on connaît bien quand on vit à Tours et pour peu que l’on fréquente les bœufs du Petit Faucheux, de Michel Marre à l’euphonium, de Claude Tchamitchian à la contrebasse et de Simon Goubert à la batterie.
Pentacle : le titre général de l’album semble idéalement choisi, car le quintette propose – sur des compositions de Domancich – une musique qui dose à merveille spiritualité et abstraction géométrique. C’est cela qui me plaît : quand l’avant-garde, sans renoncer à ses recherches les plus poussées, ni à ses hommages parfois dissonants, chante, oui, merveilleusement chante et module.

(Oui, le ciel est plus gris chaque jour. / Non, le son de l'euphonium n'est plus celui d'un veau affamé.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À l’exception du premier morceau, déjà évoqué, l’album est entièrement constitué d’une suite de huit pièces, intitulée Pentecôte. Titre en clin d’œil au titre, sur une dangereuse pente sémiotique ? Quintette qui parle en langues ? Frénésie qui happe l’oreille, jappe en douceur et rappelle Babel ? C’est la sagesse incarnée.
13:55 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Jazz, Photographie
dimanche, 01 juillet 2007
Eiffel
Cet album a dû faire son apparition, entre mes mains puis, comme souvent, dans la pile à côté de moi sur le siège, alors que le train pour Beauvais (ou, parfois, pour Creil) s’élançait – j’en défaisais le blister, en décollais soigneusement l’étiquette jaune Gibert Occasion, puis consultais la pochette – et nous dirons 1998, pour fixer une date. C’est un de mes disques de jazz favoris, et il me semble pourtant ne pas l’avoir écouté depuis très longtemps. Non que je le connaisse trop bien, comme il arrive parfois pour ces musiques que l’on ne passe plus sur la platine, tant l’on peut (ou pense pouvoir) les recomposer entièrement, à l’accord et au décroché de cuivre près, dans sa tête. En effet, certaines mélodies ici ne me disent à peu près rien.

C’est l’un de mes disques favoris, dans l’un de mes formats préférés : le duo proche. Jimmy Giuffre, au sax soprano et à la clarinette basse, y donne la réplique à André Jaume, au ténor. Eiffel a été enregistré en direct à Paris, le 8 novembre 1987 (au soixante-treizième anniversaire de ma grand-mère paternelle (et alors ?)). Dans cette suite de dialogues, sur des compositions qui sont principalement du Français, on trouve un Giuffre géant, aussi beau et magistral que dans le double album du trio avec Paul Bley et Steve Swallow.
Boire du thé vert très infusé en écoutant cette musique si douce, qui s’emporte même avec suavité, offre un contraste frappant. L’attaque de Stand Point est à donner pour modèle ; toutefois, chaque phrase le dit, qu’il n’y a jamais de modèle. C’est un point de vue.
16:16 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Jazz, Photographie
dimanche, 22 avril 2007
Vi/sites
Midi. Je viens de passer deux heures à écrire et publier, sur le blog privé familial (l'un de mes cinq ou six blogs), des récits de visites récentes et des photographies en grand nombre. Peut-être expurgerai-je certains de ces billets des références privées et en donnerai-je ici, pour la rubrique Sites & lieux d’Indre-et-Loire, une version plus documentaire (ou topographique). À cette occasion, j’ai découvert (car je cherchais des sites qui parleraient du prieuré Saint-Cosme) que Tinou a mis en ligne tout un album dédié au site du grand Ronsard.
En écoute : « Marcello » (Jean-Pierre Como/Trio. Padre. Bleu citron, 1989.) [C’est un album que j’aime beaucoup, pas du tout frénétique, très chantant, hautement mélancolique. Il m’accompagne depuis six ou sept ans. (Après nos débuts dans la vie, je suis devenu père.)]
14:04 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Ligérienne, Jazz
mercredi, 18 avril 2007
Under a Blanket of Blue
La chaleur s'est levée tard ce matin, et, sur le chemin du bus, sur les trottoirs à l'ombre, on supportait la veste. Mon fils voulait revoir l'exposition sur la planète Mars au Muséum ; les étages sont en travaux, mais nous avons pu voir, arrivé hier tout juste et installé aussitôt, haut, impressionnant, l'ours Willy empaillé, qui naguère s'ennuyait à mourir dans la fosse minable du Jardin botanique. Aujourd'hui, seule sa compagne lui survit, plus malheureuse que jamais, triste comme les pierres, et lui a été "naturalisé" (affreux mot mensonger).
-----------
Dans un coffret de Coleman Hawkins que j'écoute rarement (F.B.-S., l'ami fou de jazz des années Beauvais, perdu de vue désormais, aurait dit "ça, c'est du vieux jazz"), il y a de nombreuses gemmes, dont je me demande si certaines pourraient vraiment être jouées par les musiciens de jazz les plus déjantés / avant-gardistes de notre époque. Certains standards se prêtent à des reprises dissonantes, électriques, toutes de stridences et de ruptures de mélodie, mais franchement... Salt Peanuts ? Stompin' at the Savoy (dont j'ai toujours cru qu'il s'agissait d'une composition de Duke Ellington et dont je m'aperçois que l'auteur en est Benny Goodman) ? Just one of those things, de Cole Porter, ou On the Bean, sont, de ce point de vue, plus prometteuses.
12:41 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : Ligérienne, Jazz
samedi, 14 avril 2007
Petit Faucheux, 13 avril : Lighting Up
Hier soir, au Petit Faucheux, deux quartettes proposaient leur lecture sonore de photographies de Jürgen Schadeberg. Musiciens non connus de moi, mais nous avions vu une belle exposition de Schadeberg lors de l’Été photographique de Lectoure, en 2005 (le jour même de la visite à Plieux).

Face à une salle où s’extasiaient des relents de cuisine (d’oignon peut-être), le batteur du Workshop de Lyon, Christian Rollet, arborant un t-shirt Vilnius Jazz Festival, présenta le projet, né de la rencontre entre le quartette Heavy Spirits et le sien autour du travail de Schadeberg, puis créé dans plusieurs clubs ou salles sud-africains avant de s’exporter vers la France, comme ici. Comme il a hésité ensuite sur le nom du bassiste de Heavy Spirits, on a pu supputer que ce n’était pas avec lui que les deux groupes avaient tourné jusqu’à peu.
Les quatre musiciens de Heavy Spirits (Gershwin Nkosi, remarquable à la trompette ; Paul Vranas puissant au sax ténor ; Vincent Molomo calme à la basse ; Garland Selolo plein de résonances à la batterie) ont joué un premier morceau seuls, puis le Workshop de Lyon (Rollet, donc, tout en doigté ; Jean-Paul Autin, sax sopranino et clarinette basse (très peu, trop peu cette dernière) ; Jean Aussanaire aux saxes alto et soprano ; Jean Bolcato à la contrebasse) a joué une composition en quattrosolo aussi, avant que les huit lurons ne passent au plat de résistance, autour d’un montage vidéo réalisé par Jürgen Schadeberg lui-même et de films brefs du même (notamment une longue séquence montrant le président Mandela serrant les mains de dizaines d’adolescents).
Les compositions étaient belles, plutôt simples, très rythmées, lorgnant très gentiment (c’est-à-dire sans risque d’effrayer les béotiens) du côté de l’avant-garde (Gershwin Nkosi soufflant dans le pavillon de sa trompette, voix pseudo-chamaniques dans le dernier morceau, stridulences diverses). Une rencontre très assurée, dialogue entre plusieurs cultures musicales, assez surprenant par certains côtés, car, dans plusieurs compositions, c’est le Workshop qui s’enferrait (s'encuivrait plutôt, d'ailleurs) dans des citations de musique populaire sud-africaine des années 50.
Pour le bis, Rollet a invité un habitué des lieux, le trompettiste Jean-Luc Capozzo, à rejoindre l’octuor. C’était un peu décevant, car ils ont repris une des compositions déjà jouées, en la diluant un peu (pour l’introduction de Garland Selolo notamment). J’aurais préféré un bis dans un style différent, peut-être une reprise de standard : il me semble que l’univers sonore diffracté qu’avaient su créer les deux quartettes aurait fort habilement trouvé à se résumer dans une composition comme Caravan, par exemple.
Cela dit, tout cela ne manquait pas d’intérêt, et les images de Schadeberg n’y sont pas pour rien ; elles ne gagnent pas forcément à la mise en mouvement. Certaines photographies se présentaient successivement par un détail, puis par l’ensemble, puis par un zoom avant pointant vers un autre détail, etc. Or, ces photographies sont toujours merveilleusement construites, et ne requièrent pas tout ce cinéma (au sens technique & au sens figuré péjoratif).
Reste que Schadeberg doit bien signifier montagne de la désolation… et que des musiciens prénommés Gershwin et Garland, ça n’est pas rien non plus. J’ai bien « craqué » aussi pour le jeu tout en nuances de Jean Bolcato, le contrebassiste, qui avait une pêche de pandémonium et tenait la baraque de tous les belzébuths (d’autant que les quatre souffleurs du pupitre d’avant faisaient une jolie brochette de diablotins).
11:15 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Jazz, Ligérienne
lundi, 09 avril 2007
Pêchez des arêtes chez votre rétameur
Totalement rétamé : rien avalé de la journée, mal au bide, e tutti quanti. Raconterai plus tard, donc, cette superbe journée Traduire Bob Dylan. On peut tout de même dire que la superbe photo en contre-jour qui ouvre le récit de François Bon représente mes collègues Fabienne Toupin et Stephen Romer, accompagnés (dans le bureau 44) de quatre étudiants, dont Tony et Maud. Tony nous a éblouis en fin de journée avec ses guitare & harmonicas.
Donc, patraque. (Pas une fois cette année, et ça tombe toujours au plus mauvais moment.) Je n'arrivais pas à dormir, alors j'essayais de lire, mais j'avais mal aux yeux, aux os, usw. Will someone stop me / From thinking all the time, comme dirait M. (qui n'est pas, ici, l'agaçantissime fils de Louis Chedid).
En attendant de nouvelles dylaneries (voire d'autres rinaldo-camuseries ou aussi extended Pynchoniana), je voulais vous faire écouter "Lexicon", un morceau du quartette de David S. Ware, dont j'ai parlé il y a quelque temps (mais tout le monde observa alors un silence poli ou gêné ou les deux).

18:36 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Ligérienne, Jazz
dimanche, 25 mars 2007
Petit Faucheux, 22 mars 2007 : David elsewhere
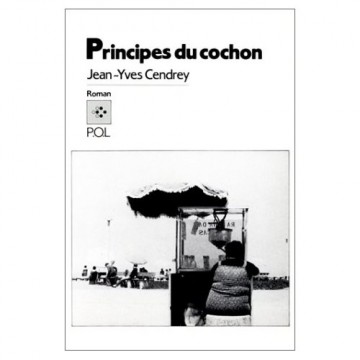 Cette fois-ci, je suis arrivé trop tard – mais quand même avec dix minutes d’avance – pour pouvoir m’asseoir derrière le photographe gesticulant (dont je devais m’apercevoir, quelque temps après, au cours du concert, qu’il a une odeur de sueur vraiment âcre, car il s’était assis sur une marche derrière ma place en bord d’allée, et, si je ne l’avais pas vu, mon attention fut attirée par une subite odeur de musc chaud que, me retournant, je ne manquai pas de lui attribuer).
Cette fois-ci, je suis arrivé trop tard – mais quand même avec dix minutes d’avance – pour pouvoir m’asseoir derrière le photographe gesticulant (dont je devais m’apercevoir, quelque temps après, au cours du concert, qu’il a une odeur de sueur vraiment âcre, car il s’était assis sur une marche derrière ma place en bord d’allée, et, si je ne l’avais pas vu, mon attention fut attirée par une subite odeur de musc chaud que, me retournant, je ne manquai pas de lui attribuer).
J’ai rêvassé en lisant la liste impressionnante des invités du festival Europa Jazz du Mans, lu les vingt premières pages – décidément c’est une habitude – d’un curieux roman, Principes du cochon de Jean-Yves Cendrey.
N’ayant, ce me semble, jamais entendu d’enregistrement du saxophoniste David S. Ware, je partais sans a priori, si ce n’est que je possède (et aime) deux disques du pianiste Matthew Shipp, qui l’accompagne en ce quartette. Aussi m’attendais-je peu au choc de ce concert exceptionnel. Jamais, même lors du concert de la Mingus Dynasty, à l’automne dernier, ou de la soirée consacrée à l’Instant Composers Orchestra en 2005, je n’étais sorti d’un concert organisé par le Petit Faucheux dans un tel état d’enthousiasme entre douceur et transe.
Il est difficile de parler de musique – d’écrire, mettre en mots une telle expérience, surtout lorsque, comme moi, on n’a aucune espèce de compétence. Suffirait-il de dire que pas une seconde les musiciens n’ont donné l’impression de faire du remplissage ? Non, car, si c’est déjà énorme, là n’était pas l’essentiel.
Dès l’entrée dans la salle bondée, le sax ténor de David S. Ware nous accueillait, posé au centre de la scène, sur le devant, et de l’instrument émanait déjà un je-ne-sais-quoi de rêveusement cosmique. Lorsque les quatre musiciens sont arrivés, la stature de David S. Ware marquait déjà l’entrée dans un autre monde. Otherworldly, as the English say. Il boite fortement, se déplace avec difficulté, mais jamais ne renvoie l’image de quelqu’un de diminué : au contraire, il semble le plus fort, dans tous les sens de l’expression.
Le quartette a joué quatre morceaux, plus un bis à couper le souffle. David S. Ware a annoncé les noms des musiciens juste avant le premier salut, pendant que le trio de ses acolytes continuait, sur la quatrième composition, de se livrer à des dialogues périlleux et envoûtants. En quittant la scène cette première fois, il a lancé : As we come in peace we go in peace. Après le bis, il a lancé : Namasté ! namasté ! J’ai su qu’il n’y aurait pas de ter.
 On pourrait dire – cela a dû être dit – que David S. Ware est un fils spirituel de Coltrane. Assurément, son jeu doit beaucoup au dernier Coltrane, celui des First Impressions et de Transition. Mais il y a là tout autre chose aussi : un désir de pousser plus avant certaines audaces ; un refus de l’élévation immédiate, de l’envol spirituel for the sake of it. Alors, on se dit que, si Coltrane jouait surtout sur les possibilités de l’air, David S. Ware joue de tous les éléments, et fait se rencontrer – dans son phrasé, dans ses déhanchements sonores – le feu et la terre, l’eau et l’air. Quelque bachelardien piqué de musicologie pourrait développer… Dans les influences, on sent aussi l’ombre bienveillante d’Ayler, mais à mille lieues des déconstructions savantes d’un Anthony Braxton (que j’admire aussi, dans un autre style).
On pourrait dire – cela a dû être dit – que David S. Ware est un fils spirituel de Coltrane. Assurément, son jeu doit beaucoup au dernier Coltrane, celui des First Impressions et de Transition. Mais il y a là tout autre chose aussi : un désir de pousser plus avant certaines audaces ; un refus de l’élévation immédiate, de l’envol spirituel for the sake of it. Alors, on se dit que, si Coltrane jouait surtout sur les possibilités de l’air, David S. Ware joue de tous les éléments, et fait se rencontrer – dans son phrasé, dans ses déhanchements sonores – le feu et la terre, l’eau et l’air. Quelque bachelardien piqué de musicologie pourrait développer… Dans les influences, on sent aussi l’ombre bienveillante d’Ayler, mais à mille lieues des déconstructions savantes d’un Anthony Braxton (que j’admire aussi, dans un autre style).
Mais il ne faut pas parler du leader saxophoniste seul. Déjà, ses temps de jeu sont inférieurs à ceux du pianiste, du contrebassiste ou du batteur, ce qui ne signifie pas qu’il s’épuise plus vite (il n’en donnait aucunement l’impression, en tout cas) mais que les modulations de son sax poursuivent leurs résonances en ramifications dans le jeu des autres musiciens. Matthew Shipp est un pianiste fabuleux, autant dire de légende en dépit de son jeune âge : à l’aise dans une multitude de modes de jeu (art de la ballade, tripotages de harpe à l’intérieur du piano et plaqués véhéments entre autres), il ne cède jamais à la facilité, ni ne roule des mécaniques. Chaque note, chaque cluster, chaque proposition se trouve là pour donner consistance à l’univers en création, pour lancer le batteur, tendre une ligne à son leader, entrer avec le bassiste dans un dialogue de cordes.
Que dire, alors, du contrebassiste, William Parker ? Dans les modes de jeu avant-gardistes (archet sul ponticello ou à l’extrême altitude, avec étirement des cordes), son instrument rendait des sons d’une grande pureté, ce qui, chez bien des contrebassistes experts, ne va pas de soi. Même sous les furies emportées énergiques du ténor, il laissait entendre ses propres envols, concomitants mais jamais simplement supplétifs.
Enfin, quoi qu’il porte, à peu près, mon prénom, j’ai été moins convaincu par le batteur, Guillermo E. Brown, plus enclin – à de rares moments toutefois – à la débauche gratuite, voire au m’as-tu-vuisme. Il faut dire, à sa décharge, qu’on aurait l’air vite pâle à côté de tels lascars, mais aussi que, dans tous les moments de dialogue (soit avec le bassiste soit – moment d’anthologie du troisième morceau – avec le pianiste, en litanies et répons), il livrait sa partie avec justesse et brio.
Aucune photo tourangelle pour accompagner ces quelques paragraphes ? * Il faudra que je me jette à l’eau (de toilette) et ose aborder le photographe pour lui proposer de m’en envoyer quelques-unes, moyennant paiement, à mon adresse électronique. Pour ce qui est de vous faire découvrir la musique de ce quartette, il me suffit de vous conseiller d’aller l’écouter en concert s’il passe près de chez vous, ou d’en acheter les disques.
* La photographie en noir et blanc de David S. Ware
qui illustre ce billet a été publiée par John Rogers sur FlickR.
12:10 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jazz, Ligérienne
samedi, 24 mars 2007
Que hume le jaseur…
Tiens ! je croyais l'avoir publiée en son temps, celle-ci :
9 mars. Sur l’album enregistré en 2000 par le quatuor de Jim Black, il y a une composition intitulée “Auk and Dromedary”. Ford Madox Ford n’appelait-il pas le roman qui l’a fait passer à la postérité, The Good Soldier, « my great auk’s egg » ? Ce sont bosses de dromadaire, seules éloignées, isolées. Je continue de préférer, encore et toujours, The Rash Act et Parade’s End.
Hier matin, au réveil, j’avais quatre livres en cours de lecture ; hier soir, deux seulement. Entre-temps, j’en avais fini trois, et commencé un autre. Cet autre est bientôt terminé, et j’en parlerai bientôt : il s’agit du récit de Michèle Laforest, Tutuola mon bon maître, préfacé par Alain Ricard.
Heureusement, d'ailleurs, car j'ai fini de lire le roman de Michèle Laforest il y a quinze jours, et je n'en ai toujours pas soufflé mot.
15:05 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Jazz, Landes, Afrique, Littérature, écriture
mercredi, 14 mars 2007
Petit Faucheux, 13 mars 2007
Cédric Piromalli / Patrice Grente / Pascal Le Gall
John O' Gallagher Trio
Huit heures et demie.
Je me suis assis derrière le photographe. À chaque fois, si je le peux, je m'assieds derrière le photographe, toujours le même photographe, qui gesticule, couvre son colossal objectif avec son écharpe ou son pull, et se contorsionne parfois à même le sol. Et lu trente pages de ce livre laconique acheté l'après-midi même. Lu en entendant le murmure des voix et la rumeur monter, comme arrivaient les spectateurs. D'ordinaire, je ne lis, ni n'écris. Me contente de regarder, observer aux alentours, écouter, ou quand je ne suis pas seul discuter. Ce soir lisant, je m'imaginais la scène en fonction de mes observations des autres fois. Devais être d'autant moins loin du compte que ce sont toujours peu ou prou les mêmes habitués ici. Une agglomération de 200.000 habitants, et toujours dans la salle de jazz de 200 places plus ou moins les mêmes visages.
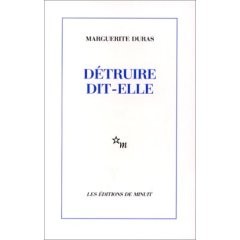
--- Dis, tu le connais, toi ?
--- Pas du tout.
--- Tout le monde le connaît pas du tout.
**************
Ce mercredi matin, les phrases d'hier soir recopiées, je veux tracer quelques signes pour fixer ce concert dans ma mémoire. J'étais déçu. Pas parce que ça n'était "pas bien", ou parce qu'un des deux sets était mauvais, non. Pour des raisons différentes, chaque set m'a laissé sur ma faim.


Piromalli (voir photo ci-contre) est un pianiste remarquable, qui, s'il a su montrer qu'il maîtrisait les facettes les plus classiquement virtuoses de son instrument, a surtout joué des poings, du dos des mains, brutalisant avec doigté son Steinway qui, tout en se demandant ce qui lui arrivait, déployait une vraie palette d'harmonies tumultueuses. (Voyez, je trouve quand même d'autres adjectifs.)
D'où alors vint ma déception ? du peu de résistance de mes oreilles, tout simplement. C'était trop intense, trop long, par rapport à la sursonorisation, travers de l'époque & surtout défaut récurrent du Petit Faucheux. À la pause (entr'acte ? entre-deux-sets ? mi-temps ?), j'ai mis trois bonnes minutes à me remettre les acouphènes en ordre de marche. Peut-être suis-je vieux jeu, un vieux râleur monotone, mais je ne vais pas au concert par hâte ardente de rapprocher le moment où je devrai porter un sonotone.
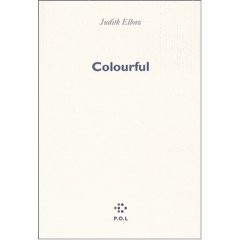
Pour ce qui est de la deuxième partie, elle était, quoique plus colorée, plus chromatique, franchement frustrante. John O' Gallagher est certainement un excellent saxophoniste, qui n'est pas sans rappeler Steve Lacy (ce qui, pour moi, est un compliment), mais il n'a rien à raconter. Rien de rien à dire. Toutes ses interventions se ressemblaient, et son phrasé toujours identique a fini par faire fuir la plupart des spectateurs avant même la fin du set. C'est dommage, d'ailleurs, car Jeff Williams est un très bon batteur, pas très inspiré, malheureusement, par la soupe fadasse de son leader.
Seul le contrebassiste, inconnu de moi, s'en tire with flying colours. Il s'appelle Masa Kamaguchi, ne doit pas être bien vieux, a déjà un CV long comme le bras, et sait (qu'il accompagne, métronome aux effets imprévus, ou qu'il parte en cavalier solitaire) faire ce qu'O'Gallagher a jeté aux orties : raconter, de ses cordes tendues, une histoire. Si Patrice Grente avait, au cours de la première partie, montré tout ce que l'on peut faire, en frénésie, d'une contrebasse, jusqu'à faire tomber son archet à trois mètres de lui et à manquer chuter lui-même, Masa Kamaguchi a, de ses doigts seuls, distillé des notes tenues, retenues, subtilement relâchées, toujours au point d'équilibre et jamais loin du point de rupture. Un musicien à suivre...
11:30 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Ligérienne, Jazz, Littérature, écriture
jeudi, 22 février 2007
Scrapple from the Apple
S'il faut reprendre, peu à peu, pied dans l'écriture,
ne faut-il partir du réel le moins tragique, le plus heureux ?
Ce midi, au Cap Ouest (où je n'avais pas remis les pieds depuis des semaines), tandis que j'attends mon plat du jour, une des habituées, assise sur un tabouret au zinc, fait remarquer qu'il y a un insecte au sol. Le frère du patron dit que c'est une punaise. Faut pas l'écraser, sinon ça pue. Il prend un sous-bock et, d'un geste prévenant, ramasse la punaise que, plus vivement, la porte de bois et de verre ouverte, il expulse. La punaise retombe sur le dos. De ma place, je la vois se démener. Je suis très impressionné par ses talents pour la reptation, dans cette inconfortable posture c'est rare. Je la regarde. Des secondes passent. Une éternité. Je finis par me décider, saisis un prospectus du Clos Lucé et sors, me penche, redresse la punaise que, assis de nouveau et scrutant le trottoir, je vois s'envoler.
À mon retour dans le bistrot, j'ai vu la jeune femme du comptoir me lancer un regard amusé. Le ridicule ne tue pas, et je sais que je n'étais pas pleinement ridicule. Je suis même rasséréné, car je ne supportais pas de voir la punaise se démener ainsi sans parvenir à se remettre d'aplomb.
Le miles gloriosus, lui, serait sorti, éméché, et l'aurait écrasée d'un coup de talon imbécile.
12:50 Publié dans Jazeur méridional, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Ligérienne
jeudi, 08 février 2007
Synesthésies / nostalgies
Parfois, quand je travaille, Pandora m'accompagne, et de son tonneau des Danaïdes où sans fin on puise sans s'épuiser, m'envoie des musiques que je ne connaissais pas avant. Ainsi, des différentes "stations" que j'ai créées, plusieurs, évidemment, sont principalement consacrées au jazz.
Sur la chaîne John Zorn, par exemple, se succèdent différents morceaux de différents groupes/ compositeurs/ interprètes, tout cela dans la joyeuseté du bazar imprévu. Tout d'un coup, j'entends des notes, un instrument indien, et, avant même de dire que je connais ce morceau, je revois le papier peint de notre studio, à Talence, en 1996 ; je marche le long des cours bordelais ; nous sommes, toi et moi, dans le bus qui nous conduit au cinéma. Dans la cuisine exiguë nous mangeons en discutant de tout et de rien. Je fais réparer cette maudite latte en verre de la fenêtre d'aération. Il fait grand soleil, chaud près du parc Peixotto. Allongés dans l'herbe, nous regardons des bambins près d'une poussette.
Je ne saurais pas retrouver le titre du morceau, mais je sais que c'est un album de John McLaughlin. Je n'ai guère dû écouter The Promise depuis ces années-là.
10:10 Publié dans Hors Touraine, Jazeur méridional, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Ligérienne, écriture
jeudi, 25 janvier 2007
Ce que dit le pagure Kenny Craig
Cavere, par le Zeena Parkins Pan-Acousticon, ça déménage ; méfiez-vous des cabots et plus encore des demoiselles qui les promènent. Il y a des livres à un euro à la Boîte à Livres de l'Etranger ; des livres qui valent le coup. Harpe et violoncelle, piano qui se disloque. Il doit faire moins cinq à Tours demain matin. Après une matinée passée à régler des subtilités d'emploi du temps, je vais aller faire le guignol au lycée Jean-Monnet, pour un déjeuner de travail (comme je crois qu'on dit). En revenant de la Poste, j'ai croisé une étudiante qui, me voyant le nez coulant, les yeux injectés, les mains violacées*, m'a souhaité bon courage pour mon rhume, ce qui était très gentil (mais l'hiver seul est coupable). Maudit soit ton nom, Salamine ! Un ami m'a écrit qu'il aurait bientôt, peut-être, un poste à Tours. * On se croirait dans Dracula, ou, allez savoir, dans les Récits de la Kolyma (où les crachats gèlent en vol). Formons des souhaits. À huit heures, sur le pont Mirabeau, la vitre côté conducteur a finalement accepté de se baisser**. Peasant Boy par le trio de Bob James, ce n'est pas mal non plus ; on est sur la route, maintenant, à regarder le rideau de pluie, les affaires empilées à l'arrière du camion (bâché, bien sûr). Dormez tous, je le veux. ** Je sais, il ne faudrait jamais démarrer sans avoir conscieusement raclé les vitres et dégelé l'ensemble des points de vision. Look into my eyes, not around the eyes, look into my eyes. Vous repartez au charbon, mais c'est l'engrais qui ici culmine.
10:45 Publié dans Jazeur méridional, Le Livre des mines, Moments de Tours, WAW | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Ligérienne, écriture
lundi, 22 janvier 2007
... die Mantis wieder im Magen...
Jeudi soir, au Petit Faucheux, première des trois soirées "Carte blanche à François Couturier". En première partie, duo et trio du pianiste avec le clarinettiste Jacques Di Donato et le violoniste Dominique Pifarély. En deuxième partie, sans le clarinettiste, violon et piano s'accrochaient aux mots chantés par le haute-contre Dominique Visse.
Si l'on excepte ce dernier, je connaissais les musiciens, dont je possède quelques enregistrements. La première partie était de l'ordre de ce que, pour rétorquer aux puristes du jazz (un paradoxe, cette expression), l'on appelle souvent "musiques improvisées contemporaines", mais la seconde était entièrement écrite, jouée sur partition, avec même trois lieder très académiques de Toru Takemitsu.
Peut-être était-ce le sérieux guindé des interprètes, leur système pileux, l'ambiance actuelle qui ne se prêtait guère à écouter un spectacle aussi avant-gardiste, ou encore l'impression d'assister à un concert tel que les ont mille fois parodiés les gens qui veulent se moquer de la musique contemporaine... toujours est-il que je n'ai pas accroché.
(Et dire que lors du précédent concert au Petit Faucheux (Paradigm + Riccardo del Fra et ses p'tits jeunes), je n'ai pas publié de billet, alors que j'avais tant aimé...)
Entendu ce soir-là (à vous de deviner laquelle des phrases ne provient pas des textes chantés par le haute-contre mais fut entendue lors de l'entracte) :
... plus d'air encore que l'air ...
... die Mantis wieder im Magen des Wald...
... comme par une dénudation de la montagne...
... toiser le bleu qui éraille...
... mais la deuxième partie, ça sera pareil ? ...
08:00 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Ligérienne, Jazz
vendredi, 19 janvier 2007
Ferraillons ferme

Il y a un moment, dans la septième partie du disque mythique d’Anthony Braxton For Alto, où le saxophone s’approche du son d’une whistling kettle, et tout ce qui suit, tout ce qui précède, justifie totalement cette stridence ponctuelle. Not so yesterday, mais tout le monde n’est pas Braxton.
*********************
Là, je reviens, lessivé, du S.I.L., qui ne s’appelle plus comme ça. Le Salon d’Information des Lycéens (comme naguère il s'appelait) se tient à Rochepinard, l’une des plus hideuses fertiles friches urbaines de l’agglomération tourangelle. Lessivé je suis, car brouhaha, et redire cinquante voire cent fois la même chose. Toutefois, en discutant avec l’étudiante qui nous aidait – et que je n’avais jamais rencontrée –, j’ai appris qu’un(e) collègue était surnommé(e) Capitaine Crochet, et, quoique je n’aie pas réussi à découvrir l’identité du ou de la collègue, l’idée que les étudiants donnent encore des surnoms aux professeurs, pratique pourtant en constant recul depuis trois décennies, m’a réjoui. Me reste à cogiter.
Entre-temps, une étudiante de troisième année est venue souffler à l'oreille de G.I. qu'il y avait des filles peu vêtues en pleine démonstration d'épilation au stand des formations d'esthéticienne. "Ta réputation, lui ai-je soufflé, n'est plus à faire." Comme j'apprenais, toujours par l'étudiante "cafteuse", qu'un autre encore de mes collègues était surnommé l'Obsédé, cela m'a surpris, car, étant donné le désarroi évident (voire les gloussements incrédules et puérils) des étudiants dès que, lors d'une analyse littéraire, l'on cherche à s'interroger sur les connotations sexuelles implicites d'un texte, je pensais que tous les enseignants de littérature passaient pour des obsédés.
*********
À l’aller, cinq chansons de Dylan, dans les confitures de circulation, et au retour deux seulement, filons sur le pont Mirabeau (embourbé ce matin, pas permis). Je ne fais pas les soldes, mais un beau pull coloré tout neuf m’est tombé tout rôti dans le bec. Même quand je mens, c’est vrai (titre de Stomy Bugsy, excusez la référence).
16:55 Publié dans Autres gammes, Jazeur méridional, Moments de Tours, WAW, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Ligérienne, Photographie, écriture
mardi, 16 janvier 2007
Out Right Now
La journée commence évasive, chaloupée, chancelant entre les embarcadères. Quelques frissons frustes qui parcourent l'échine, et le trottoir slalome doucement, comme si c'était le soir, tard, le pas incertain d'un qui aurait éclusé ses trois bouteilles de champagne (on ne lésine pas). Ansgar Ballhorn est tout ouïe, et, le casque vissé sur les oreilles, une cigarette aux lèvres, ne quitte des yeux ni les doigts fragiles du violoniste ni la balance des graves. À la marge, quelques grammes de gaz s'échappent du flambeau, mais c'est encore autre chose, quand le bois s'éveille et met au monde ses loups, ses monstres, des manteaux de brouillard. Bien sûr, il y aura d'autres ruses, dans le futur, mais ce ne sera jamais plus ces notes ténues non tenues, ces flûtes absentes, ce sentiment de râpé dans les brisements.
Oui, d'autres décalcomanies sonores, des forces souterraines. Aujourd'hui, l'épiphanie, comme en 1995, n'éveille pas de torpeurs malsaines.
18:00 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Poésie, Jazz, écriture
lundi, 15 janvier 2007
The Gig
Entends cette mélodie J'entends donc cette mélodie Je l'écoute me laisse absorber
Décrochages de piano Fusées cymbales Une des lignes a tout d'une carioca
..........................
Quand même tout cela est inclassable Cette mélodie l'écouter
Puis, je découvre que c'est The Gig dans la version originale de son compositeur Herbie Nichols, avec (peut-être) Max Roach à la batterie. Il y a quelques jours, j'ai découvert ce morceau tout à fait génial sur un album du trompettiste Dave Douglas avec son Tiny Bell Trio. Dois-je l'avouer (à ma courte honte (mais pourquoi courte, d'ailleurs ?)), je ne connais pas du tout Herbie Nichols, pianiste surtout actif dans les années cinquante. Eh bien, ça m'a l'air d'être un oubli à réparer de toute urgence.
En écoute : "I've Got My Love to Keep Me Warm" (version non datée de Dick Hyman, pianiste que je connais moins encore (très Erroll Garner quand même))
14:15 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jazz
mardi, 09 janvier 2007
Ni fée ni affaire
Ce matin, entre plusieurs rendez-vous et surveillances d'examen, j'ai réussi (dans l'université presque déserte (après un lundi peuplé, du matin jusqu'au soir, par les étudiants de troisième année de L.E.A.) et avant d'aller me faire doucher sans parapluie) à coincer l'oiseau Nico Nu, affairé à refaire son tableau vert (qu'à part moi j'ai depuis longtemps baptisé (sur le modèle de "l'escalier le formidable") "le vert-igineux") et à déposer un panonceau Interdit de cracher. Comme, contrairement à l'ami Simon, je ne me promène pas avec mon appareil photo sur mon lieu de travail, vous devrez vous contenter de mes mots... et d'attendre ce qu'en dira le Blog Oranginal, toujours sur le pont dès qu'il s'agit d'élucubrations niconuesques. Il se trouve aussi que j'ai rapidement engagé conversation avec l'artiste, après avoir pu admirer enfin de visu (et pas en photo, once again) ses premiers essais de signalétique, que je trouve très réussis, dans le genre loufoque propret.
Bien entendu, tout ce billet ne doit avoir ni rime ni raison pour ceux qui ne connaissent pas le premier mot de toute cette affaire, et à qui je ne saurais trop conseiller de lire les divers textes de Simon, marqués en lien ci-dessus.
En écoute : Wayne Shorter Quintet. "Speak No Evil" (Speak No Evil, 1964.)
Quel phrasé, quelle atmosphère en ténèbres & magie glorieuse, comme si un vieillard couvert de givre sentait renaître la vie à fleur de peau ! Ce n'est pas ça ici.
17:55 Publié dans BoozArtz, Jazeur méridional, Moments de Tours, WAW | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Ligérienne
samedi, 30 décembre 2006
Time’s Mirror / Train shuffle
Les remous du drap blanc qui va servir de nappe – lors d’un pique-nique pré-électoral – envahissent l’écran sans que l’on sache, le temps d’une ou deux pulsations, si l’action va désormais se transporter sur un navire, dans le ciel des anges, dans une fabrique d’édredons. Ce drap blanc qui frétille, tangue au gré des gestes gracieux de deux figurantes, représente aussi ces fausses mers de théâtre, comme, par exemple, dans la première scène de La Tempête, a lieu le naufrage. Mais aussi, comme tout cela ne dure qu’une poignée de secondes (nous n’aurions pas même le temps de passer sous le drap, la nappe, par jeu), cette image si brève – dans un film qui sait, par ailleurs, prendre le temps des descriptions, des cadrages savants, des démonstrations subtiles – est le miroir du temps, dans l’éclatement des cuivres qui fait suite à la lente et douce mélopée. La tempête après le calme, avec ces ondulations de la nappe, annonce aussi le bringuebalement du train d’enfer, entre deux ères, entre deux lignes, entre deux fenêtres, entre deux arcs-en-ciel. Duvet de plumes d’eider s’échappant d’un trombone folâtre.
10:15 Publié dans Ecrit(o)ures, Jazeur méridional, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jazz, Cinéma, Littérature, écriture
mardi, 07 novembre 2006
Pulcinella au Petit Faucheux, vendredi 13 octobre 2006
Il y a presque un mois, déjà, que j'ai écouté, ébloui, le quatuor toulousain Pulcinella faire son cirque et ouvrir le bal, au Petit Faucheux, avant la prestation du trio de Bojan Z. Je ne serais pas loin de dire que les quatre inconnus toulousains ont volé la vedette à l'immense Bojan Zulfikarpasic. Ce n'est pas peu dire, et je n'en suis pas loin, vraiment (!).
Je me sens plus loin, déjà, ma mémoire étant ce qu'elle est (à savoir : plus aussi vaillante qu'avant), du concert lui-même. Le quatuor (ou quartette) se compose de Ferdinand Doumerc (saxophones, flûte et direction), Frédéric Cavallin (batterie), de Jean-Marc Serpin (contrebasse) et de Florian Demonstant (accordéon). Le soir du concert, le batteur et le saxophoniste se sont relayés pour jouer du métallophone, instrument de prime importance dans le morceau intitulé Morphée, morceau qui est d'ailleurs repris en position centrale dans leur petit CD, Pulcinella Jazz délocalisé (2005), dont j'ai acheté deux exemplaires ce soir-là.
Ce qui m'a le plus frappé, ce soir-là, c'est l'humour, très nonsensical, des quatre larrons pince-sans-rire, et qui fait écho, avec une extrême sobriété, à la loufoquerie de leurs compositions. Toutefois, n'allez pas vous imaginer que les adjectifs loufoque ou farfelu qui me viennent sous les doigts sont péjoratifs. En effet, contrairement à la plupart des jazzmen français contemporains, qui ont pris soit le parti du sérieux avant-gardiste déconstructionniste, soit le parti de la musique de bastringue revisitée avec cocasserie, Pulcinella ne tranche jamais, et offre aux auditeurs étonnés des compositions savamment déstructurées et prodigieusement ludiques.

Bien entendu, leur humour tout à fait décapant est plus difficilement perceptible au disque, et peut-être même risque-t-il de passer inaperçu pour qui n'aura pas vu le groupe en scène. Par exemple, ils annoncent à tour de rôle les titres de morceaux avec un sérieux impeccable que dément aussitôt telle posture, telle attaque du saxophone, tel slap dingue du contrebassiste. Le plus impayable, de ce point de vue, est l'accordéoniste, Florian Demonstant, grand dadais tout raide qui joue de son instrument avec brio et maestria, tout en se tenant droit comme un if, au point de donner l'illusion que c'est un gamin anxieux qui va bientôt passer une audition de prime importance à l'Opéra de Paris. Cela est un jeu, monté de toutes pièces, et qui contribue joliment à l'effet de désaississement ou d'étrangeté que produit, sur le spectateur/auditeur, la musique que jouent ces lurons.
Des morceaux joués le 13 octobre et indisponibles au disque (ou sur leur site), je me rappelle Fungi, morceau en forme de champignon (allusion à Satie), mais je ne peux pas, en revanche, retrouver, dans ma pauvre mémoire, le titre (un mot-valise si je ne m'abuse) de la première composition, qui était très réussie. Il y avait aussi La danse des Gobelins (des goblins ?).
Quoi qu'il en soit, si ces quatre lascars passent près de chez vous, allez les écouter, car ils jouent, sans faux-semblants mais en respectant le pacte de la représentation et ses artifices, une musique très inventive et très belle.
16:16 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Ligérienne, Jazz
dimanche, 15 octobre 2006
Keith Jarrett, The Carnegie Hall Concert
N'ayant pas grand chose à ajouter aux nombreuses recensions parues ici, là ou encore ailleurs (pour ne pas dire elsewhere ni somewhere else)*, du dernier double album solo de Keith Jarrett, je me contenterai, avec le côté vétilleux et pisse-froid qui me caractérise (!), de faire remarquer que l'inclusion des applaudissements gâche beaucoup l'impression d'ensemble.
Tout d'abord, ces longues plages d'applaudissement (qui représentent tout de même un septième du deuxième CD!) font un contraste désastreux avec la musique : à des compositions & improvisations d'une grande subtilité succèdent le vacarme et la cacophonie les plus insupportables. Déjà, je ne vois guère l'intérêt de cela. Mais, de surcroît, il faut bien dire que cela renforce l'image d'un Keith Jarrett mégalomane : voyez, j'ai eu six rappels, et, quand je joue cinq minutes, on m'applaudit plus d'une minute... tous les spectateurs sont au septième ciel**, leurs vagissements en témoignent... Esthétiquement (entre autres) déplorable, donc.
Cela dit, la musique de Keith Jarrett est superbe, d'où l'impression de gâchis : on tombe d'autant plus bas, avec ces applaudissements, que l'on s'était élevé dans des sphères sublimes, suspendu au piano du maître.
* Je tiens à préciser que je ne suis pas le dénommé Delnieppe Roland qui se plaint aussi de la longueur des applaudissements sur la page consacrée à l'album sur Amazon France !
** Au septième ciel : on cloud nine. (That's a footnote for Simon.)
10:25 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Jazz
samedi, 14 octobre 2006
Bojan Zulfikarpasic Trio au Petit Faucheux
Cela faisait plusieurs semaines que j'attendais avec impatience ce concert du nouveau trio de l'admirable Bojan Z. J'avais pris mon billet longtemps à l'avance, et connaissais le disque Xenophonia depuis sa sortie, au printemps dernier. (Il se peut même que j'en aie parlé, ici ou dans mon autre carnet de toile.)
Il sera question, dans une autre note, de la première partie, par le quartet toulousain Pulcinella... une véritable révélation pour moi. (J'écris ce billet en écoutant leur disque, malheureusement un peu court, et vous invite d'ores et déjà à aller découvrir leur musique sur leur site.)
Après l'entr'acte, assez long pour permettre aux affamés de grignoter, aux ivrognes de boire et aux futurs cancéreux d'aller cracher leurs poumons dans la rue Léonard de Vinci (j'appartiens à au moins deux de ces catégories), Bojan Zulfikarpasic, Rémi Vignolo et Ari Hoenig ont gagné la scène, puis, au fil de leurs mélopées violentes et de leurs ballades revisitées, le coeur du public tourangeau. Je n'avais pas vu jouer Bojan Z. depuis un concert de son quintette (avec Vincent Mascart) en janvier 1998 à Creil. On voit que ça remonte ! À l'époque, Bojan Z. n'était pas devenu la coqueluche du Tout-Paris ni de la planète jazz, et j'ai passé quelques années à déguster ses albums (dont le meilleur, à mon sens, Koreni).
Il ne semble pas que Bojan Zulfikarpasic, Zulfikar-pacha, ait vraiment changé en huit ans, si ce n'est (mais, si cela était vrai, la nuance serait de taille) qu'il manifeste moins de plaisir à jouer, ou plus de professionnalisme dans la construction du concert, les enchaînements ou l'orchestration. Il était loin de jouer une musique d'amateur il y a huit ans, mais il jouait ses compositions sublimes avec une forme de fraîcheur très adolescente, qui semble faire un peu défaut maintenant... Mais je peux me tromper, et, comme je l'ai souvent écrit, je n'y connais rien.
Sur l'ensemble, c'était un très beau (et fort bon) concert. Ari Hoenig, le batteur, fait des ravages dans toutes les salles où il passe ; excellent technicien, il sait marier à merveille les exigences de la mélodie et les déferlements fous de ses peaux & cymbales. Rémi Vignolo est un véritable métronome humain, mais il est dommage que son leader ne lui laisse pas plus le loisir d'exprimer ses qualités de mélodiste, et que jamais la contrebasse ne devienne mélancolique, ce qui est l'un des charmes de l'instrument. Bojan lui-même, enfin, de dos au public, cerné de part et d'autre par ses claviers Fender Rhodes dont il tire des sons tantôt infernaux tantôt angéliques, fait preuve d'une maîtrise jamais prise en défaut, et tant dans ses compositions (dont une, inédite encore et sans titre, m'a fortement ému) que dans les reprises de standards (superbe The Mohican and the Great Spirit), sait encore surprendre. Bien fin qui devinera la couleur de son prochain album...
- Article de Thierry Giard sur Xenophonia.
- Site officiel de Bojan Z.
- Interview de 1999 (Jazz à Caen)
10:05 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jazz, Ligérienne
dimanche, 10 septembre 2006
Greg Szlapczynski, chant & harmonica à Montlouis, 10 septembre 2006
Le dernier album de Greg Szlapczynski, Varsovie, a été enregistré avec une formation légèrement différente (Johan Dalgaard à l’orgue Hammond et Sophie Bourdon à la basse) de celle qui a joué, sous un soleil quasi torride, en plein zénith à Montlouis.

Ses autres albums s’appellent Ternaire madness (1997), Gregtime (enregistré en concert, 1999), et La part du diable (2002).

La sono était beaucoup trop forte, mais, tant que les petits-maîtres qui organisent les festivals ou les professionnels des platines n'auront pas ruiné la santé de tous les amateurs de musique, je pense qu'ils ne s'estimeront pas heureux.

Merci quand même aux musiciens pour une jolie heure de blues.
19:32 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Ligérienne, Jazz
Fabien Mary Quintet, à Montlouis, 9 septembre 2006
Au Village gourmand, sous un soleil timide, se produisait hier soir le quintette de Fabien Mary, jeune trompettiste déjà fort d’une solide expérience et d’un joli palmarès.


Choix estimable, réhabilitation méritée, mais, à mon goût, l’interprétation était un peu stéréotypée : individuellement, les musiciens du quintette sont très bons, mais tous les titres avaient la même structure (exposition du thème et solos individuels), au point de donner le sentiment que les musiciens n’improvisaient jamais ensemble. Peu risqué et pas très inventif, mais je suis sûr que les amateurs de jazz « classique » (encore faudrait-il nuancer et définir ce terme) y ont trouvé leur compte. Il en faut pour tous les goûts…

Lors du concert, j’ai retrouvé une vieille connaissance, le Montlouisien le plus célèbre, j’ai nommé Simon, Monsieur Oranginal, bénévole au Festival, et son amie Marion (en robe orange). À défaut d’oser publier la seule photo que j’ai prise d’eux, je vous livre un gros plan sur le T-shirt du bénévole !

Cependant, Fabien Mary jouait, à la tête de son quintette (Thomas Savy au ténor, Yves Brouqui à la guitare, Florent Gac à l'orgue, Andrea Michelotti à la batterie), Tadd’s Delight, Delirium, Swift as the Wind, Mating call…
08:45 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Ligérienne, JAZZ, Jazz
samedi, 09 septembre 2006
Trio Viret Ferlet Banville, Montlouis, 8 septembre 2006
Hier soir, j’ai assisté, dans le cadre du Festival de Jazz de Montlouis, au concert du trio formé par Jean-Philippe Viret, Édouard Ferlet et Antoine Banville. Je connais un peu le premier, surtout par son travail avec l’Orchestre de ContreBasses (OCB), un de mes groupes préférés, et un peu Ferlet, le pianiste. Après coup, je me suis aperçu que, si le nom du batteur ne me disait rien, j’avais pourtant écouté, chez ma mère, un disque de ce trio.
Le concert a commencé vers sept heures et quart, après une petite séance consacrée à accorder le demi-queue Steinway L'Instrumentarium.

Cette musique m’a infiniment séduit, et le mieux est sans doute de vous inviter à la découvrir en concert ou en disque (trois albums enregistrés). Les trois musiciens ont joué, dans l’ordre, Ascendant Vierge (solo de contrebasse), Par tous les temps, Ping-pong, Une petite ballade, La part des choses, Les idées vagues et À plus d’un titre. En bis, ils nous ont offert Dérives et Docile, joli contraste de deux humeurs différentes.
Les titres n° 2 et 3 sont des compositions d’Edouard Ferlet, et je crois avoir compris que les autres étaient de Jean-Philippe Viret, auteur à tout jamais cher à mon cœur du superbe morceau Heureuse qui comme Ellis (OCB, Jeux dangereux, Musica Guild, 1995).
Par tous les temps : lyrique, poignante, comme la mer émouvante.
Ai-je pensé à la mer en raison du patronyme du batteur ? Il y aura désormais un trio de Banville : le poète (Théodore), le romancier (John) et le batteur (Antoine).
Les idées vagues : morceau très complet, où l’entente entre les trois larrons est la plus accomplie.
À plus d’un titre : Antoine Banville s’éclate, plus à l’aise, peut-être, dans l’extase.

Aphorisme de concert, dont la véracité ne se dément jamais : « Les gens veulent à tout prix applaudir. »
(Même quand un morceau n’est pas fini. Ne dit-on pas désormais couramment « aller applaudir Untel », et non plus « aller écouter Untel » ?)
Je ne cessais de penser, pendant le concert, au bref essai qu’Antoine Emaz consacre à l’expression de J.-M. Maulpoix, le lyrisme critique : « s’il s’agit d’un élan sans envol, je peux m’y accorder » (je cite très de mémoire). S’élancer, rechercher, créer même avec le sentiment du manque. (Tout de même, on croit souvent s’envoler, avec ce trio Viret-Ferlet-Banville.)
10:15 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Jazz, JAZZ, Ligérienne
lundi, 30 janvier 2006
Ernst Reijseger
Je viens d’écrire une brève note relative aux canapultes, ces curieux monstres lexicaux, et j’écoute le Double Trio (clarinettes de Sclavis, Angster et Di Donato ; cordes de Feldman, Reijseger et Dresser).
Je me souviens d’avoir vu, écouté et applaudi Reijseger, lors des Rencontres Internationales de Violoncelles de Beauvais (était-ce en 1999 ?). Je le connaissais déjà, pour ce disque du Double Trio, et pour le disque Rara Avis, où il joue avec Han Bennink et Michael Moore (pas le porc vulgaire, mais l’autre, le vrai : le grand saxophoniste) au sein de la formation Clusone 3.
À Beauvais, il avait sidéré et, je crois bien, décontenancé le public – la moindre de ses algarades extramusicales n’étant sans doute pas son geste d’aller fouiller dans la terre d’une affreuse et gigantesque plante en pot qui se tenait là, sagement, dans un coin de la scène du théâtre. D’un archet drolatique, il touilla le terreau d’un geste magistral, faussement gauche.
C’est aussi un remarquable musicien… mais vous ne trouverez pas, sur la Toile, l’anecdote de l’archet touilleur.
09:50 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (16)
samedi, 28 janvier 2006
Calgary
[En écoute : « Bosnia », de Mark Dresser, par le Double Trio (album Green Dolphy Suite. Enja, 1995. ENJ 9011-2 – un disque fétiche qui depuis longtemps m’accompagne).]
*******
Le Magazine littéraire du mois de février publie une partie de la fin inédite de Gros-Câlin, roman de Romain Gary qu’il publia sous le pseudonyme d’Emile Ajar (avant le coup de jarnac que constitua La Vie devant soi). Je n’ai pas lu ce roman, et ne prétends donc pas donner mon avis sur la version publiée, dont cette fin inédite n’est qu’une variante. Mais ce qui est patent, à lire ces quelques pages, c’est que cela ne va pas changer mon opinion, formée il y a longtemps en bâillant, que Romain Gary n’était pas un grand écrivain. Que de pauvreté ! que de fades redites !
Je crains que certains des lecteurs de ce carnet n’avalent leur chapeau, ne bondissent au plafond, avant de m’expliquer 1) pourquoi j’ai tort 2) qu’ils ne remettront plus les pieds en Touraine sereine*.
Soyons clairs : je ne demande qu’à avoir tort. Dois-je donner sa chance à Gros-Câlin, ou à tout autre Ajar/Gary ?
* … auquel cas je me prosterne et retirerai cette fâcheuse note**.
** Evidemment, ne l’écoutez pas : il n’en fera rien.
16:23 Publié dans Jazeur méridional, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (3)
mercredi, 25 janvier 2006
Seuls pharaons
Antonio n’aime pas beaucoup Zool. Que cherche-t-il, par ici, du bout des doigts ? Zool le fureteur, grillon du foyer et folle du logis. Antonio lit tout ce que l’on écrit sur eux : l’un qui s’entoure de musiciens aussi reluisants que lui (c’est tout dire) pour mieux creuser la solitude de ses harmonies intimes, et l’autre qui se place seul face au piano pour mieux peupler le silence de figurines, de compagnons de débauche ; l’un qui, latin, distille les chaleurs, tandis que l’autre, saxon, propose ses carnavals glacés. Des foutaises ! un foutoir de notes ! remballe !
Zool aime bien Antonio. Peut-être serait-il plus juste de dire qu’il aime bien quand il croise le regard agacé d’Antonio. « Tiens, il a l’air énervé » semble-t-il dire, d’un regard innocent et plein d’incompréhension naïve. Zool est un musicien de verdure, et Antonio hume, à pleins poumons, l’air de la nuit profonde.
Je prête l’oreille à Zool ; la toile blanche qu’il tend aux trous du vent, pectinée à peine de douces mouchetures, je l’entends claquer, flotter, blanchir les ombres. Il va sinuant si près du sol que sa musique envoûterait les cimes.
Tandis que je pianote, je prends garde de ne pas éveiller de vieux démons, de ne pas cogner trop vivement, je veux que les touches se suivent de façon harmonieuse, comme si je jouais la partition prodigieusement délicate de Zool. Comme si je jouais, dans mon coin, avec Ira et Jeff, je veux que les armes reposent en paix, sans colère, je galère laborieusement pour mentir en mots, tandis que je pianote.
Je prête l’oreille à Antonio, farouche, bondissant, coloriste et sang de feu. Vous, Zool et Antonio, l’alpha et l’oméga, les deux frères que je n’eus pas, je tends les bras vers vous, dompte le lion mélancolique, tire gentiment l’oiseau de sa noirceur pantomime, et je les présente l’un à l’autre.
Qu’ils s’aiment vraiment, profondément, effrontément… qu’ils s’aiment ou non, ce sont mes seuls pharaons.
07:00 Publié dans Ecrit(o)ures, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (14)
lundi, 23 janvier 2006
Anything goes (Cole, Caratini, Lazarus…)
Je crois que je n’aime guère la voix, ou le chant de Sara Lazarus.
Quel nom, pourtant !
Ce n’est pas tout ; l’habit ne fait pas le moine, ni la mine et la silhouette la grande chanteuse.
Le disque de standards de Cole Porter qu’elle a enregistré avec le Patrice Caratini Jazz Ensemble est un peu décevant. Qu’est-ce à dire ?
Ce sont souvent des airs que j’aime ; les orchestrations sont remarquables, de talent et d’originalité. Il me faut conclure que c’est la chanteuse qui gâche un peu le tout ; elle ne chante pas mal, mais d’une façon qui ne me plaît pas trop.
Les moments de splendeur sont assez nombreux pour faire de ce disque un opus au-dessus du commun. Pour n’en citer que quelques-uns : le final d’Anything goes ; la version dédoublée de Get out of town, avec une intro composée par Caratini, Quitte la ville ; les voltes survoltées qui parcourent la ligne mélodique de What is this thing called love ; enfin, le plus mémorable, peut-être, est cette version longue, langoureuse, ralentie, désarticulée, de My heart belongs to Daddy, à mille lieues des pépiements de midinette auxquels les interprètes réduisent généralement cette partition.
À coup sûr, Caratini connaît la musique, et ses solistes sont des musiciens dignes d’éloge et d’intérêt : le saxophoniste ténor Stéphane Guillaume (impressionnant sur Just one of those things), le pianiste (Alain Jean-Marie), le cor (François Bonhomme), le tromboniste (Denis Leloup), j’en passe… À signaler la présence discrète mais efficace de mon histrion préféré, le génial guitariste Marc Ducret.
…………………………
En écoute : « Miss Otis regrets » (Patrice Caratini Jazz Ensemble with Sara Lazarus. Anything goes. Le Chant du monde, 2002. 274 1142)
08:20 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1)
mercredi, 18 janvier 2006
Insight (John Taylor, piano solo)
Est-ce la glèbe où l’on s’enfonce, ou le grèbe qui, infidèle au lac, se prenant pour une alouette, s’élève jusqu’aux cieux ? Une mélopée vaguement asiatique – mais n’avons-nous pas laissé Gurdjieff dans son himalaya de sons fredonnés – se désenrubanne entre quelques lunaisons. Ma jument va l’amble, me préserve des cauchemars, tout bonnement. Bill Evans est aux cieux, une lune luisant à son œil comme un monocle ; près d’un mont, marmite grouillante aux résonances gaéliques, l’artiste s’incline sur son piano, en un namasté de toute beauté. (C’est le chant de chacun, mais ce n’est pas le mien.) Marcel Duchamp connaît son jour de gloire et se donne libre cours, mais c’est un Duchamp doux, pétri de Schubert, de Debussy, affairé à fourrer son nez dans les valises. Tout cela, c’est du cousu main, d’un vaillant petit tailleur et immense musicien.
En écoute : John Taylor. Insight. Sketch, 2003. SKE 333035.
07:10 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 17 janvier 2006
Steve Coleman & Five Elements : On the Rising of the 64 Paths
Ça commence comme un disque de Steve Coleman, puis ça dérive complètement, dérape, se détourne vers l’inattendu. Autant dire que c’est un disque typique de Steve Coleman.
Celui-ci, en un perpétuel balancement entre métaphysique et mathématique, ces deux dieux des musiciens depuis bien avant Johann Sebastian, a été en partie enregistré en concert à Amiens.
Il se compose de huit morceaux, plus une version très épurée – cachée en fin de disque – de Round About Midnight : six compositions originales du génial saxophoniste, et Dizzy Atmosphere, qu’on ne présente plus, selon deux configurations (la cinquième plage, qui dure 6’06”, et la septième, qui dure 7’07” – sûr que c’est exprès).
Ce qui surprend le plus, dans cet album de 2003, c’est la grande variété des tempos. On passe sans transition de la frénésie, l’emballement sans fioritures du premier titre, le presque éponyme 64 Paths Binding, à une ballade superbe, douce, veloutée, mousse sur le velours, intitulée Mist and Counterpoise, dont je me demande après vingt écoutes au bas mot, si ce n’est pas ma préférée.
Bien entendu, Steve Coleman n’a jamais caché son immense dette à l’égard de Coltrane, mais il semble, ici, prendre à contre-pied les arrangements les plus habituels du Maître : sur le premier morceau, par exemple, la basse paisible (Reggie Washington) se heurte à la folie de la flûte (Malik Mezzadri). L’hommage à Coltrane se ressent surtout dans le troisième titre, Call for Transformation, d’une complexité mélodique insensée et pourtant d’une telle évidence que l’on se lève, on danse au gré du vent, on s’allonge, on lorgne vers le sublime. Même les vocalises un peu outrées du flûtiste passent comme une lettre à la poste. (A foolish figure.)
Les recherches sonores de Steve Coleman le poussent à tourner toujours davantage autour d’un son, à se mettre en quête des spirales, vrilles, loopings, figures aériennes en sextette-escadrille. Cela est patent dans The Movement in Self et Eight Base Probing. A contrario, les deux versions de Dizzy Atmosphere sont une forme d’hommage à l’époque du bop, genre certes revisité, mais avec de nombreux tics qui résonnent de manière curieuse au sein de cet album si léger et aérien. Ce côté fugace, insaisissable, vient-il aussi de l’influence grandissante du trompettiste, Jonathan Finlayson, au jeu tour à tour chaloupé, furtif, heurté, formidable, puissant et vivace ? Je ne sais.
Enfin, c’est un disque dont il est difficile de se passer – impossible de se lasser ?
…………
Steve Coleman & Five Elements. On the Rising of the 64 Paths. Label Bleu, 2003.
10:25 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (3)
jeudi, 12 janvier 2006
Jazz de janvier : Print à Auxerre
Si des Auxerrois s’égarent de par ces pages (et qu’il soit bien dit qu’ils sont les bienvenus, d’autant qu’Auxerre est une très jolie ville, que je visitai à l’automne 2000, alors que ma compagne était enceinte de pas même un mois, et nous n’en savions rien encore (bon, il a fini de nous raconter sa vie, ç’ui-là ?)), qu’ils sachent que l’excellent quintette de jazz français Print leur rend visite ce vendredi 20 janvier. J’aurai – je l’espère – l’occasion de parler du seul disque que je connais de ce groupe vraiment novateur ; dans l’immédiat, cela me fait plaisir de faire leur promotion ès ces pages arrachées à la voilure carnétoilesque (mais qu’est-ce qu’il raconte ?).
Vendredi 20 Janvier
Théâtre d'Auxerre, Le Studio
Organisé par le Jazz Club Auxerre
Premier set
P R I N T- 5
Sylvain Cathala - saxophone ténor, composition
Stéphane Payen - saxophone alto
Fabian Fiorini - piano
Jean-Philippe Morel - contrebasse
Xavier Rogé - batterie (en remplacement de Frank Vaillant)
Deuxième Set
P R I N T + D' de Kabal
Sylvain Cathala - saxophone ténor, composition
Stéphane Payen - saxophone alto
Jean-Philippe Morel - contrebasse
Xavier Rogé - batterie (en remplacement de Frank Vaillant)
+
D' de Kabal (voix, texte)
********************************
Il n’y a pas d’heure indiquée, mais le mieux est peut-être de leur écrire. Vous pouvez même, de leur musique, écouter des échantillons de taille respectable sur leur site.
14:50 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 04 décembre 2005
Ô sur des ailes s'enfuir

Depuis deux heures, le quintette de Miles Davis (Live at the Plugged Nickel, 1965, disques 4 et 5), un bon fauteuil et la vie de famille, lire les cent premières pages d'Amriika, qui traîne sur ta pile de livres à lire depuis des mois, voire des années, oublier le monde, le travail, l'envie de s'enfouir, de disparaître, de n'être plus que cela, ici, là, l'envie de s'enfouir, plus travailler, trop de travail a fini par vaincre tes moindres pulsions, l'envie de s'enfouir, de s'enfuir - puis, tu te relies à Internet, compulsively indeed, et trouves là, dans ta boîte de réception, deux photographies que t'envoie ton père, au retour d'un de ses incessants voyages européens.

12:18 Publié dans Jazeur méridional, Lect(o)ures, Moments de Tours, Où sont passées les lumières? | Lien permanent | Commentaires (1)
mercredi, 30 novembre 2005
Duthu et Panossian au Duc des Lombards
J'ai oublié d'annoncer leurs "dates" de novembre ; aussi vais-je me rattraper en faisant un maximum de publicité pour le duo Panossian / Duthu, dont j'avais dit le plus grand bien dans ces colonnes
et qui se produit
ce 5 décembre
au Duc des Lombards.
Allez les écouter. Leur musique est admirable.
Par ailleurs, en cliquant sur la pochette de leur album, sorti le 17 octobre, vous pourrez accéder au site Web de leur label, Twotacoustic. Le disque est en vente chez Nocturne.
Pour ma part, je vais interrompre (temporairement, je l'espère) ma pratique bloguistique. Profitez-en pour relire l'une quelconque de mes 835 notes passées...
23:55 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (7)
samedi, 08 octobre 2005
Bayahibe (Pierre-Stéphane Michel Trio)
Mélancolie et frénésie. Non, ce n’est pas une antithèse, juste cette alliance de mots qui cherche à rendre hommage au beau trio formé par Pierre-Stéphane Michel, à la contrebasse, Bruno Ruder au piano, et Frédéric Delestré à la batterie. Frénésie et mélancolie, et comment ne pas songer, en écrivant ces mots, au quintil d’Apollinaire
Au lac de tes yeux très profond
Mon pauvre cœur se noie et fond
Là le défont
Dans l’eau d’amour et de folie
Souvenir et mélancolie
Bref… Les compositions du contrebassiste donnent lieu à des envolées soudaines, qui sont toujours un emballement de la douceur mélancolique, quand les moments où triomphent de subtilement tendres doigtés sont surtout des instants de frénésie contenue.
Mélancolie et frénésie. On les entend, tous trois (aussi pour les avoir vus en concert au off de Montlouis), se pencher sur leurs instruments, chercher des répons, là des réponses, jamais las de poser des questions, d’interroger, de tutoyer cet ivoire, ce bois, ces cordes, ces peaux.
Un boisé de contrebasse, un effleurement pianistique (les touches des pétales?), un balai caresse la caisse claire ou fait vibrer la branche comme du métal… Ce ne sont pas des métaphores. Les écoutant, je suis une écorce, une fleur, un rameau. Tour à tour et simultanément.
Découvrez ce trio, qui vaut le détour.
Bayahibe – Prod. 2004 Atelier Sawano – © 2004 Pierre-Stéphane Michel – ASF 037 – HM79
22:00 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1)
jeudi, 06 octobre 2005
Eternal child (Avishai Cohen, en duo avec Chick Corea)
Toujours enfant
Enfant à tout jamais
A mettre la porte sous la clef
A s’endormir à s’enrêver
S’enturbanner de chemins colorés
De pluies de grisailles factices
Et de lumières adventices
A tout jamais enfant
Toujours plus jamais grand
Dévorer les songes des autres
Ronger les ongles les peaux mortes
Et glisser grognon sous la porte
Une orange et un cercueil pour le vent
A toujours plus jamais enfant
15:55 Publié dans Ecrit(o)ures, Jazeur méridional, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (1)
Avishai Cohen : Lyla (Nocturne NTCD 343)
Vous souvient-il, bien-aimés et fidèles lecteurs, d’un quiproquo doublé d’une coïncidence tous deux jazzistiques, qui se produisit cet été en ce carnet de toile, à propos d’une mienne note consacrée à un disque du trompettiste Avishai Cohen, et ce au moment où, en vacances dans le Sud-Est de la France, Livy se rendait au concert d’un autre Avishai Cohen, bassiste, pianiste et chanteur, alors en formation trio?
Eh bien, cette histoire connaît un infime rebondissement, à faire se pâmer ceux qui, en nombre toujours grandissant, réclament à hauts cris que je tienne enfin ma promesse d’écrire un roman-feuilleton interactif (merci, la Jeune Divorcée), oui, un rebondissement, car ce mercredi, à la médiathèque de La Riche, j’ai emprunté Lyla, disque sorti en 2004 sous le nom du bassiste.
(Pour ceux qui n’auraient pas encore cliqué sur les six liens ci-dessus, sachez qu’ils ont pour seul but de gonfler artificiellement les statistiques du blog en augmentant le nombre de pages différentes consultées. Une sorte de Viagra carnétoilé, si vous voulez. Voyez à quoi j’en suis réduit.)
La musique de cet Avishai-là est bien séduisante, me fait penser à mon cher Leon Parker, dans son caractère polyrythmique et son inventivité constante, son croisement de modes de jeux et de genres musicaux multiples, sans qu’il y ait pour autant de dissolution de l’harmonie sonore, ou de la cohérence. La COHérENce est là*, n’en doutez pas.
Tout d’abord, Avishai Cohen est souvent présenté comme un bassiste qui a d’autres cordes à son arc. Hum, c’est vite dit. Si vous écoutez le solo de piano qui sert de centre à cet album, Structure in emotion, vous ne manquerez pas de remarquer que bien des pianistes de jazz aimeraient avoir ce touché, ce phrasé, cette suggestion de spectres, et aussi (comme accessoirement) ce talent pour la composition.
Les morceaux qui me convainquent moins (mais c’est plus lié à mes goûts et à mon indécrottable préférence pour le jazz acoustique) sont les morceaux où s’entremêlent échantillonnages électroniques, comme Handsonit, ou The Watcher, composition d’ailleurs signée Dr. Dre. Handsonit est un assez beau morceau toutefois, dans les solos de basse électrique, mais aussi les volées de trompettes (Diego Urcola et Alex Norris), et c’est certainement celui qui réjouira le plus les amateurs de St Germain, par exemple. Pour moi, la vraie beauté de la musique d’Avishai Cohen est ailleurs, et, sans aucun doute, dans Eternal child, duo entre le contrebassiste et un Chick Corea magistral, ou Ascension.
* Si je prolongeais le jeu de mots, je pourrais noter que Cohen crée est l’anagramme de cohérence. Mais je ne le fais pas, n’est-ce pas (prétérition?).
10:40 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1)
mercredi, 05 octobre 2005
L'auteur
L'auteur des textes de ce carnet de toile, unless otherwise specified, c'est moi... Assurément, cela me ferait plaisir d'avoir, de temps à autre, des remarques positives de la part des nombreux artistes que j'encense, et pas seulement des fort rares que je fustige. Si vous connaissez, chère Carole, Julien Duthu et Rémi Panossian, dites-leur en effet que je suis très admiratif de leur oeuvre, de ce disque de duo absolument splendide.
Pour ce qui est de la réaction de Yann Kerninon, je ne pense pas que l'on puisse me taxer de malhonnêteté, puisque j'ai justement critiqué le prière d'insérer en précisant que je n'avais pas lu le livre. Il s'agit donc d'une réaction à la présentation d'un livre. De même, si je vois annoncer un film "comique" avec Christian Clavier et Michaël Youn, je me doute, connaissant mes goûts, que je trouverais cela lamentable, et je ne cherche pas à voir le film. Cela s'appelle un pré-jugé, et même si les préjugés ont mauvaise presse et si une démarche intellectuelle profonde doit chercher à interroger les préconceptions, il existe aussi, bien souvent, une vérité des préjugés. En l'occurrence, mon pré-jugé se fonde sur une connaissance préalable du jeu des acteurs cités ci-dessus, ou, dans le cas de la présentation de l'ouvrage de M. Kerninon, sur une connaissance assez bonne de la critique littéraire et philosophique contemporaine, notamment américaine, pour laquelle les noms de Nietzsche, Deleuze, Heidegger ou Stirner ont valeur de tic d'écriture qui dispense souvent les universitaires de réfléchir. Cela étant posé, votre livre, M. Kerninon, échappe peut-être à ces travers, auquel cas j'aurai eu tort, et déjugerai mon pré-jugé.
11:30 Publié dans Jazeur méridional, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (3)
dimanche, 02 octobre 2005
Julien Duthu & Rémi Panossian : No End…
Il n’est de meilleure retenue, en musique, que de savoir distiller les moments, non de relâche, mais où “ça se lâche”. Le fil se tend brusquement, plus de retenue, plus de notes de sénateur. Dans la retenue comme dans la brusque intensification des sons, ce duo, formé d’un jeune contrebassiste et d’un jeune pianiste, excelle.
Il a fallu attendre le dernier mot, le verbe principal de la troisième phrase, pour lâcher le mot, laisser filer ce sens en embuscade : l’album No End… est tout simplement excellent. Je me suis laissé dire que ce duo avait charmé, enthousiasmé le public des Rencontres de Contrebasses de Caprbreton, en août, et cela ne fait pas de doute. En concert, une telle écoute, une telle entente, un tel mixte savant, suave, de tension retenue et de tendres détentes, cela doit vous aviver les oreilles, vous adoucir le cœur, et vous faire exploser de joie.
Il est peu d’épiphanies musicales, ou, s’il en est, souvent, elles réclament une attention soutenue ; ici, je le maintiens, rien de tel, et il serait aisé de dire qu’une telle musique ne saurait, en effet, avoir de fin, car elle connaît, en chaque instant, des ramifications insensées. Le final de L’exception devient la règle, par exemple, est remarquable de touché, dans le rendu des émotions, dans la vigueur des doigtés. On vit, on imagine, on se représente ces deux musiciens à l’œuvre, nous voici avec eux, presque contre les cordes, à nous voler dans les plumes. On s’envole avec eux, c’est vrai, je m’y plais, je plane dans ces cieux que leurs phrasés étendent à perte de vue comme autant d’aplats sur des toiles de brume.
Si je me lâchais vraiment, je pourrais écrire, cédant à une métaphore facile et rebattue, que le troisième morceau, Origines, m’a scotché. C’est tentant, mais je me retiens, tout de même. Les mots sont trop précieux, et les notes avec eux. Je retiens ce verbe, autant dire que je le conserve et ne lui cède pas. Origines, pourtant, déroulant le long ruban de ses scintillations, exige que l’on se plie, toutes affaires cessantes. Ecouter comme on danse. Ecoutez chaque fragment de chaque note, et c’est impossible, bien sûr. Le ruban virevolte, avance, une lumière qui refuse de se décomposer.
Sur Kessispass, je restais convaincu, après trois écoutes, que le contrebassiste, Julien Duthu, avait délaissé sa grande dame pour une basse électrique, et seul le nom du label (de la maison de production? je ne comprends rien à ces subtilités) des deux lascars, Two t’acoustic, m’amène à émettre des doutes : parvient-il vraiment à ce son avec une contrebasse acoustique frottée au plus près et au plus saccadé ? je croyais pourtant, avec mon admiration fanatique pour l’OCB, tout savoir des sons retors et trompeurs qu’u contrebassiste peut tirer de son instrument.
Septime et Hommage se répondent dans le plus superbe désarroi, la plus ravissante des extases. En d’autres termes, aussi, le disque invente un trajet qui conduit d’une musique aux accents modernistes, éloignée du jazz, à un jazz retrouvé, retenu par devers les cordes, et livré en bouquet final dans Poursuivant, sorte de chase intime, prolongé en un neuvième morceau « caché » où les amateurs de jazz plus classique retrouveront leurs repères, assez confondus et confus pourtant de ce manège affolant, subtil, doux, et beau.
A écouter : Julien Duthu et Rémi Panossian. No End… (c) Two t’acoustic, 2004. Nocturne 2005.
16:50 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (5)
Harmonia Mundi & Hatology
Ma mère a acheté hier une dizaine de disques de l'excellent label Hatology, pour la somme plus que modique de 7,50 euros pièce au magasin Harmonia mundi qui se trouve en haut de la rue Nationale. Elle m'en a offert deux, je ne sais pourquoi mais ce n'est jamais de refus. Il faisait beau hier, finalement, quoique venteux, et nous avons écouté, sur la place de Châteauneuf occupée exceptionnellement par un chapiteau, trois morceaux fort bien interprétés par les harmonies de Noizay, Fondettes et (ai-je cru comprendre) Saint-Ouen. Un peu de ringardise dans la "mise en scène", mais la construction des parties, la qualité des musiciens aussi, cela était indéniable. Passé le premier morceau, M. le Maire, son pain sous le bras, s'est éclipsé.
Quelques instants plus tôt, sur la place Plumereau, un saxophoniste qui n'était pas dans la première jeunesse cherchait à tirer des notes un peu suivies de son instrument. Some Day My Prince Will Come et les Feuilles mortes jouées avec des pauses de sept secondes toutes les huit notes, je vous le recommande. Mais l'atmosphère était détendue, les gens attablés aux terrasses heureux d'une de ces dernières journées à profiter de la relative douceur.
********************
En écoute: "Zweet Zursday", par le Monoblue Quartet et Lee Konitz (album Koglmann/Konitz. We Thought about Duke (1994). hatOLOGY 543)
10:22 Publié dans Jazeur méridional, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (1)
dimanche, 25 septembre 2005
Dimanche (de pelle à gâteau)
Après une soirée arrosée, avec trois collègues, dont l’une, Orléanaise en poste à Montpellier et qui vient de publier sa thèse, fêtait son anniversaire chez nous, et donc, sous l’effet (l’habitude perdue) des six ou sept coupes de champagne entrelardées de quelques verres de Marsannay, une nuit presque sans sommeil, & une journée mollassonne, avec un peu de travail tout de même (cours toujours), la gigantesque vaisselle, le ménage dominical, et fini de lire Train de nuit avec suspects de Yoko Tawada et Mastroianni-sur-Mer de l’inimitable Enrique Vila-Matas.
Aujourd’hui, comme c’était le jour des 20 kilomètres de Tours, il valait mieux ne pas chercher à s’aventurer dans les parages, ce qui faisait une autre bonne raison de rester un peu au calme.
Le vif plaisir, fauve, furieux, que je prends à lire toujours de nouveaux textes de Vila-Matas, comme lors (mais fort différemment) de ma lecture des Récits de la Kolyma, il y a un an et demi, c’est qu’il (Vila-Matas) ouvre sans cesse la croisée sur une bibliothèque infinie et baroque, universelle et bariolée.
Je manque en ce moment d’énergie pour sortir le nez, et même pour écrire. Même de la Toile je me tiens éloigné.
En écoute : Stir-fry (l’un de mes morceaux préférés de l’un de mes albums de jazz préférés, Let’s Hang Out du regretté et merveilleux tromboniste américain J.J. Johnson) – de quoi je ne me lasse jamais…
18:04 Publié dans Jazeur méridional, Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 20 septembre 2005
Kevin Mark, suite
Pour écouter des extraits de morceaux chantés par Kevin Mark sur son site officiel.
12:40 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (2)
dimanche, 18 septembre 2005
Jazz en Touraine : Esplanade Maurice Cullaz
La place où est installé le “village gourmand” du Festival Jazz en Touraine s’appelle Esplanade Maurice-Cullaz, en hommage à cet amateur de jazz et compagnon de route de nombreux musiciens, dont la voix est gravée sur le disque 3 d’Emmanuel Bex. Je suis assez content de la photographie que j’ai prise, qui laisse voir les formes des voitures derrière le drap orange, aussi de ce drap – aux couleurs de la ville, peut-être, mais, à coup sûr, du Blog Oranginal !
12:10 Publié dans Jazeur méridional, Sites et lieux d'Indre-et-Loire | Lien permanent | Commentaires (2)
samedi, 17 septembre 2005
Jazz en Touraine, un fragment du « off »
Nous avons passé, au « village gourmand » où se déroule le festival off de Montlouis, une après-midi agréable, quoique fraîche et menaçant constamment pluie.
Il semble y avoir eu quelques cafouillages, ou, à tout le moins, ce qu’un musicien a appelé «les luttes intestines du festival». En effet, le trio du contrebassiste Pierre-Stéphane Michel, que je n’avais jamais entendu, devait se produire à 15 h 30. Or, quand nous sommes arrivés au « village gourmand », le concert avait commencé; il s’est arrêté peu avant quatre heures, pour laisser place à la formation du guitariste Kevin Mark, qui s’était pourtant déjà produite au in l’avant-veille et n’était pas programmée.

Le plus triste, dans ce flottement, c’est que le trio de Pierre-Stéphane Michel proposait une musique mélancolique, douce, très travaillée, parfois violente et lancinante, bref un vrai trio de jazz avec trois musiciens de qualité résonnant dans une belle interaction – alors que le quintette du dénommé Kevin Mark était assez indigne de monter même sur le podium d’un radio-crochet. (J’exagère à peine; vous connaissez maintenant mon penchant pour l’hyperbole.)
Toutefois, ce blues mal dégourdi, espèce de sous-sous-Muddy Waters dénué d’invention, déroulant tous les clichés du genre sans avoir l’âme du blues, avait l’air de plaire au public. Les paroles étaient sans cette simple ironie si difficile à tenir et qui caractérise le genre, le guitariste-chanteur a une voix sans relief, et, comble des combles, la sonorisation écrasait complètement le jeu des deux saxophonistes, sauf, évidemment, sur certains (quasi-)solos. J’ai remarqué cette erreur de sonorisation dès le premier morceau. Or, ne voilà-t-il pas que le guitariste annonce au micro, à l’issue de ce premier morceau : “Can I have some more volume, and more for the drums as well?” Dans ce contexte, il allait s’avérer définitivement impossible d’entendre les saxos. On se demande bien pourquoi s’embêter à faire souffler ces deux braves garçons comme des perdus pour n’entendre que les roulements forcenés du batteur et les riffs (moyennement) déchaînés du guitariste (je ne parle même pas de la contrebasse)…

Ce désagrément mis à part, ce fut agréable : très jolie découverte du trio constitué de Pierre-Stéphane Michel, Frédéric Delestre et Bruno Ruder, dont je reparlerai prochainement (mais vous pouvez déjà vous procurer leur album, Bayahibe), A., mon fils, ravi, la menace de la pluie sous un ciel pétroléeux et attendrissant.

Je regrette de n’avoir pu aller à un ou deux spectacles du in, surtout Baptiste Trotignon, qui se produisait hier, dont je suis la carrière depuis lurette. Mais j’étais à Paris. L’année prochaine, peut-être, si l’équipe du festival se décide à programmer un peu plus de jazz, j’y assisterai vraiment. Cette année, il y avait de quoi faire fuir…
22:10 Publié dans Jazeur méridional, Sites et lieux d'Indre-et-Loire | Lien permanent | Commentaires (6)
vendredi, 02 septembre 2005
Kenny Werner : Beauty Secrets (1999)
Un. Je m’imagine sous une pluie fine, avec un être aimé qui me dévisage ; la pluie redouble, me défigure, mais cette face aimée reste sèche, inaccessible ; je ne reconnais pas le standard.
Deux. Cordes, pulsations, legato. A cette écoute, la tavelure de mes mains s’estompe, mes bras retrouvent le lisse de leur enfance, et je cours dans le bois ; m’arrêtant soudain au martèlement lointain d’un pic épeiche mélancolique. Sarabande des brindilles. Danse des fougères. De la poussière. Saveur de ton agilité, pianiste. Volte des vergnes. Fin abrupte.
Trois. Secrets de [la] beauté, un rien de suavité en trop.
Quatre. Je dévale les escaliers. Une voisine m’arrête. Elle me tend un baril de lessive. je dévalise la voisine.
Cinq. Brydon at this instant tasted etc.
Six. Cuivre, tu ouvres un chemin parmi les ronces, pour qu’y folâtre le piano.
Sept. “His intimate adversary” s’avère une mélopée. Je me suis égaré dans une grange silencieuse, comme une chambre sans échos.
Huit. lancinance. je me revois descendant Banbury Road, aux larges trottoirs. L’an si lancinant, que je nommai, dans une chanson d’alors, mon année bizarre, me revient aux oreilles à l’instar d’une nappe de brume fouettée en plein visage.
Neuf. Petit à petit, je me sens envahi d’une torpeur qui se mue en un visage, le tien, toi anonyme dame blonde, au visage radieux de blondeur, qui me sourit, enivrante, de ce recoin d’un club de jazz où…
Dix. … mais c’est ta voix qui s’élève, était-ce prévu, ce chant soudain d’une jeune Anglaise splendide, qui juste avant m’avait souri? Send in the clouds, dis-tu ou crois-je entendre. Tu es si tourmentée soudain, est-ce la comédie du désespoir mimé. Non, toi, lancée ainsi, hallucinante, ne peux mentir.
Onze. Est-ce moi qui chante maintenant ? Je m’éveille d’un rêve. Gravis les marches du même escalier, tes yeux ravis, un étoile haut dans le ciel, tes yeux dérobés, a le sourire désespéré de la belle aux pommettes douces, tes yeux ravis, et aux hanches superbes, larges, tes yeux d’envie. Gravis, gravis. je m’arrête sur le palier. Lessivé.
Douze. C’est le pianiste (mais lequel? ils se sont multipliés brisés comme en un kaléidoscope) qui désormais murmure un poème, qui sonne dans une langue inventée. Piano, contrebasse et violon suaves lancinants.
13:55 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 01 septembre 2005
Dave Holland Quintet : Not for Nothing
Ce n’est pas pour rien que ces initiales lascives, dans la langue anglaise, convoquent le nombre 99, qui est le signe de la proliférante unité (ou la singulière multiplicité) d’Allah, le nombre de ses noms.
Tu ne t’en soucies guère, et à juste titre, saxophoniste qui vagues en volutes sur cette ballade adoucie par les graves cordes du contrebassiste compositeur, Dave Holland.
De la quatrième plage, Shifting Sands, un chant s’élève, doux, fugace comme un vol de mésanges, et seul le solo du contrebassiste nous fait pénétrer de nouveau dans la forêt d’inquiétude, la sourde transe des précédents morceaux, et redonne un sens plus rugue au titre, à quelques notes de l’ensablement mélancolique, dont nous voici préservés, en dernier recours par le sax alto et le trombone.
Comme tu tournoies, enfin, virevoltes, musique des terres. What goes around. Comme enfin tu t’exaspères, oiseau effaré qui cherche la lumière.
Le trombone, tour à tour triste, ténébreux, nerveux, rêveur, à la grande et joyeuse verrière du quintette (Robin Eubanks fait ici penser aux meilleures soufflaisons du triple J, J.J. Johnson). Continuez de tournoyer, entre le souffle de la terre et la musique des sphères.
Je sais ce qu’il y a de singulier, pour moi, dans cet album: c’est peut-être le seul disque de jazz où le vibraphone joue une place aussi prépondérante sans que cela me tape sur les nerfs ou me gâche le plaisir que je pouvais avoir aux mélodies, aux développements, aux autres solos. Je n’irai pas jusqu’à écrire que c’est l’instrument que je préfère ici même, mais, au moins, il ne rompt pas l’harmonie, il la soutient souvent, la crée parfois… et c’est déjà beaucoup.
....................
* L'album sur le site du label ECM.
* Technical trivia.
* Présentation française deDave Holland.
15:11 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 27 août 2005
Brume *
Puisses-tu briser les ténèbres
Puisses-tu vaincre les soleils
Puisses-tu pétrir les lignages
Une flore s'esquissera
Aux trémolos de ton silence
Aux terreurs de tes souvenances
* en écoutant "Brume" (composition de Christophe Marguet)
13:35 Publié dans Ecrit(o)ures, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1)
jeudi, 25 août 2005
De la vanité des hommages?
J'ai consacré une petite heure à écouter un disque d'hommage à Nougaro, dont un ami m'avait fait une copie dans les Landes, et qui doit correspondre, peu ou prou, à la formation que mes parents avaient entendue à Capbreton l'an dernier (Eddy Louiss, Vander, qui encore?). Qu'importe, c'est vraiment du easy listening, encore que l'adjectif soit assez peu approprié, car voilà du "easy" qui fait grincer les dents, de la soupe avec des croûtons indigestes, aux antipodes du jazz, une musique compassée, précautionneuse, sans âme. Je n'aime pas Nougaro plus que cela, mais tout de même...
21:40 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (3)
jeudi, 18 août 2005
Sans écoute
Je me surprends (alors que je suis seul, pourtant, dans la grande maison de Hagetmau (mon beau-père parti chez le coiffeur en compagnie de R°°°, et C. à la piscine avec A.)) à ne pas écouter de musique, et à remarquer que, depuis que nous sommes hors Touraine (ce qui ne va plus tellement durer), la mention « En écoute », sur laquelle plusieurs notes écrites et publiées à Tours se refermaient, a disparu. C’est que, à Cagnotte, en nombreuse compagnie, il m’est arrivé d’écouter quelques morceaux d’un disque, mais pas pendant que j’écrivais; et à Hagetmau, en dépit des protestations de mon beau-père, qui ne m’en a pas découragé, j’ai quelque scrupule à écouter des disques, car mon beau-père, très amateur de jazz (au point qu’il possède sans doute un millier de vinyls et plusieurs centaines de disques compact), a radicalement cessé (et de manière irréversible) d’écouter de la musique dans sa maison, depuis la mort de son épouse, il y a quatre ans. Depuis quatre ans, l’habitude, pour moi, a été prise de me passer de musique ici, car je n’ai que rarement le réflexe d’écouter un disque, avec les écouteurs, par recours au lecteur de l’ordinateur.
Il y a aussi, peut-être, que le manque d’écho donné par les lecteurs de la communauté Jazz à mes notes (à l’exception notable du malentendu sur les deux Avishai Cohen) ne m’a pas incité à poursuivre coûte que coûte.
20:50 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1)
jeudi, 28 juillet 2005
Herbe de l'oublie
Mieux
mieux même
mieux même encore
Mieux que le déroulement du ruban en immortelle débandade
J'ai mes oiseaux
dans une cage à tous les vents
Toujours ils restent dans la cage
une vie passe en sarabande
Touché
coulé
un peu de vie s'espace autant que ta lèvre
veuille s'abreuver à la mienne
Un cadavre nous accompagne
mais il est plaisant de le voir
baguenauder dans les fossés
Son ombre jamais ne s'allonge
et il a le nez débusqué
par nos regrets
nos escapades
Et nos émeutes dans la joie
11:15 Publié dans Ecrit(o)ures, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 25 juillet 2005
« Rencontre » (Jeanneau/Celea/Renaudin)
Dans ce très bel album, je ne m’attarderai que sur la troisième composition, “Souhait” de Bertrand Renaudin, car j’ai le sentiment de la connaître déjà depuis longtemps, de l’avoir entendue… mais où ? sur un autre album de Renaudin, peut-être? J’aurais écrit aussi : reprise par le trio de Christophe Marguet; mais c’est une folle supputation. Je n’ai pas, ici, les sources et disques pour dûment vérifier.
Après une introduction très lancinante, au saxophone, rythmée d’un dialogue durable entre le contrebassiste et le batteur, suit un solo de Jeanneau, très enlevé, méditatif. Jeanneau est bientôt rejoint par Renaudin, qui lui donne la réplique, mais Jeanneau s’envole toujours plus haut, et c’est comme si le batteur insistait à donner une note plus chtonienne à cet échange inégal, brillant de ses roulements tandis que le saxophoniste, entre le vol ascendant de l’alouette et les voltes sprintées de l’autour, se gorge de sa propre puissance.
On sent ce souffleur pris de folie. Cymbales, toms l’encouragent. Le désespèrent, le poussent dans ses retranchements, lui mettent la voix à vif. Il vole, il s’envole… souffre-t-il ?
Il se tait. La contrebasse est là, qui mélodieusement, détachée, détachant quelques fleurons boisés sur le fond du silence criant de ses deux compagnons, encourage le saxophone à reprendre ses esprits; le souffle revient, les coups maraudeurs du batteur aussi, et l’alouette reste suspendue en l’air, tendue à quatre cordes, réconciliée avec l’autour, dansant avec lui.
06:00 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1)
vendredi, 22 juillet 2005
Sonny Rollins
Juste un lien pour signaler un joli article de Libération consacré à Sonny Rollins.
J'ignorais que Brecker fût atteint d'une leucémie: c'est, lui aussi, un géant du jazz.
15:15 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 21 juillet 2005
Rites de Jan Garbarek
De Jan Garbarek, depuis voilà dix ans, je ne sais précisément que penser. Parmi les premiers CD que j’ai achetés, aux alentours de 1994, il y avait son Visible World, dont nous avons assez aimé les volutes, C. et moi, avant de nous en agacer, après deux ou trois écoutes, et de décider que c’était presque de la soupe, du easy listening.
Peu de temps après, j’avais remis le couvert ; le disque qu’il a enregistré avec des musiciens indiens, Ragas and Sagas, est très bon, à mon sens, et sans doute parce que la quasi-totalité des compositions ne sont pas de lui, et qu’il n’est pas véritablement le maître d’œuvre de cet album.
Comme j’ai vu que mon beau-père avait, sur ses rayonnages, le double CD enregistré par le saxophoniste à Oslo en 1998 avec son groupe habituel (Brüninghaus, Mazur, Weber), je me suis décidé à lui donner une nouvelle chance. (Vraiment, que de magnanimité en moi !)
Or, le premier disque est conforme à mes précédents sentiments équivoques : les trois premiers morceaux ne déparent pas à la tradition de fond percussif peu varié avec volutes new age du saxophone imperturbable et immarcescible, puis, au moment où l’on se dit que c’en est trop, que vraiment, malgré les propos dithyrambiques d’Untel ou de Mr. Whatshisname, bien que Garbarek soit encensé de ci de là, eh bien, oui, c’est de la soupe, ou à peu près, eh bien, à ce moment précis, une composition de bon aloi, jouée avec originalité, me demande plus d’indulgence, et l’une des plages, enfin, parvient à émouvoir, pour s’achever sur Her wild ways, authentique composition de jazz jouée sans fioritures, avec panache et douceur, sans kitscherie superflue. Je me surprends à écouter Her wild ways trois fois de suite et à ne pas m’en lasser.
Toutefois, as inconclusive as all this may be, je pourrais conclure en écrivant que, par rapport à tant d’autres musiciens, Garbarek offre trop peu de pépites, parmi la glaise, et que, si c’est, incontestablement, un bon interprète, il ne vaut pas grand chose comme orpailleur. A foolish figure, comme dirait Polonius (j’aime bien citer Polonius).
Puisque je publie ces notes dans la communauté Jazz de H&F, j’aimerais avoir quelques réactions ou commentaires d’amateurs ou professionnels plus calés que moi, ou qui auraient entendu Jan Garbarek en concert.
15:20 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
Dr Avishai et Mr Cohen
Ce qui frappe en comparant cette note-ci, par moi écrite et relative à Avishai Cohen, et ce commentaire, écrit par Livy presque en direct du festival de Marseille, c'est qu'il y a une légère contradiction.
Eh bien, il y a deux Avishai Cohen: le trompettiste et le contrebassiste. Le plus insensé, dans cette histoire, c'est que, dans mon écoute du disque dirigé par le trompettiste, j'avais surtout été frappé par le jeu de son... contrebassiste (qui s'appelle John Sullivan).
Le site officiel du contrebassiste, c'est ici.
Plus d'informations sur le trompettiste? C'est là.
14:53 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1)
mercredi, 20 juillet 2005
François Jeanneau
Je découvre ce jour seulement le blog de l’excellent saxophoniste François Jeanneau, dont, du coup, j’écoute, en boucle, le seul disque en ma possession ici, Rencontre, en trio avec Bertrand Renaudin et Jean-Paul Celea.
Ce qu’il dit, sur son blog, des «experts» me rappelle, hélas, les prétendues expertises, commanditées par le Ministère de l’Education nationale, en matière d’équipes de recherche. Mêmes bureaucraties en tous points de la sphère…
17:55 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1)
mardi, 19 juillet 2005
En aveugle, Montréal Diary
18 juillet, 19 heures.
Comme des artistes divers se succèdent sur le lecteur multi-disques, je me demandais depuis quelques minutes qui était ce trompettiste dont je n’aimais guère le jeu, puis j’essayais de deviner ce qui, dans ces fioritures un brin je-m’en-foutistes, m’agaçait vraiment, et naturellement je m’exerçais en vain à l’exercice du “blindfold test”, me raccrochant alors de plus en plus au jeu du pianiste qui accompagne le trompettiste, et cela merveilleusement, avec un doigté, un sens aérien de la féerie pianistique, et me prenant à déplacer ce test en aveugle sur le jeu du pianiste, certain d’avoir un disque d’icelui.
Finalement, n’y tenant plus, au cinquième morceau, grandement admiratif du pianiste, ayant pris mon parti de ce duo (à mes oreilles) dissonant ou duplice, je me lève, je saisis le boîtier du disque placé en treizième position du lecteur, et découvre qu’il s’agit d’un duo Enrico Rava – Stefano Bollani. J’ai bel et bien un disque en leader du second, que j’adore, et déjà éprouvé de fortes réticences sur d’autres opus du premier, qui, décidément, me semble poseur, faussement nostalgique, toujours un peu à côté.
En écoute : « Le solite cose » (Rava/Bollani. Montréal Diary/B, Label bleu LBLC 6645, 2001).
……………
19 juillet, 9 heures
Deuxième écoute de Montréal Diary/B, plus convaincante. Les compositions, toutes de Rava, sont très convenables ; la première même, “Theme for Jessica”, est très émouvante, et d’une complexité chaloupée.
Je n’aime guère “Amore baciami” : faut-il y voir un lien avec l’omniprésence du trompettiste, dès lors que le pianiste est relégué à l’arrière-plan sonore ?
Sur “Bandoleros”, le dialogue fonctionne à merveille. Exacerbation des aigus du piano, faux enjouement de la trompette par menues syncopes, flourishfinal comme un chant de folie à la lune. Nul meilleur moyen de clore un disque, une écoute, aveugle ou non.
11:05 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 18 juillet 2005
NY-1 : Martial Solal
Le titre complet de cet album paru en 2003 sur le label Blue Note est NY-1 : Martial Solal Live at the Village Vanguard. C’est donc le énième de ces albums enregistrés dans le mythique club new yorkais, sur trois soirées de septembre 2001, dix jours après les attentats, comme ne peut s’empêcher de le faire remarquer l’auteur des notes de pochette (et comme je m’empresse de lui emboîter le pas !).
Pour ne pas aller par quatre chemins, Martial Solal est l’un des meilleurs pianistes de jazz français, et sans doute de l’époque, de la planète. Il a un sens de la mélodie et du rythme, mais aussi de l’harmonie lors de ses improvisations avec partenaires, qui ne court tout de même pas les rues, à ce degré. C’est, de surcroît, un compositeur que j’aime beaucoup, ce qui ne gâte rien.
Dans cet album, accompagné de François Moutin à la contrebasse et de Bill Stewart à la batterie, il alterne compositions personnelles (ou co-signées avec Claudia Solal, sa femme ?) et standards, dont Body and Soul, dont il donne une lecture, ou plutôt, pour parler sans métaphore, une écoute à la fois profondément originale et terriblement harmonieuse, fluide, douce aux oreilles. Il montre ainsi qu’il n’est pas besoin de démanteler un standard ni d’en disséminer les lignes mélodiques pour marquer l’histoire de ses interprétations. Cela ne signifie pas que je n’aime pas les versions disjointes ou les réécritures déconstructionnistes de tel ou tel standard ; il en est d’admirables ; mais il est aussi d’autres voies.
Je ne suis pas certain que ses deux comparses soient tout à fait à la hauteur de Solal ; ils ne lui font pas honte, et lui permettent de donner pleine mesure à ses touchés, d’élaborer de passionnantes expérimentations ; ils sont loin de lui tenir la dragée haute, voilà tout. Mais fort heureusement, le trio ne doit pas être un lieu d’émulation ou de bataille.
Mon morceau préféré est peut-être (après deux écoutes) la composition de Claudia Solal, Suspect Rhythm, qui figure en troisième position sur le disque.
21:50 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (4)
Festival de Marseille
La merveilleuse Livy me prie d'annoncer la tenue prochaine d'un festival jazz à Marseille.
Tous renseignements sur le site officiel.
18:20 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (4)
vendredi, 15 juillet 2005
Avishai Cohen, 2003
Je suis en train de découvrir, au moment même d'écrire ces lignes, le disque du trompettiste Avishai Cohen, The Trumpet Player, dont je ne connaissais pas même le nom... c'est dire si je ne me tiens plus, apparemment, au courant de l'actualité jazz.
Premier morceau ("The Fast", le jeûne, étonnamment peu économe pourtant) remarquable. Le troisième, "Dear Lord", mérite une mention spéciale pour les trémolos et convulsions douces du trompettiste lui-même. J'en dirai plus à l'issue d'une écoute complète, et avec du recul, mais ce qui me frappe surtout, c'est combien j'admire le jeu tout en nuances du contrebassiste, qui accompagne, déroule des serpentins subtils, et fait presque oublier, à de certains moments, son "leader".
Le nom du contrebassiste est John Sullivan.
18:40 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1)
dimanche, 10 juillet 2005
"Le Cercle" de Camel Zekri
Camel Zekri. Le Cercle. Tarbes : La Nuit transfigurée, 2004 (LNT 340122)
Ce n’est pas du « jazz », probablement, et sans doute serait-il préférable de parler de musiques contemporaines improvisées. Je ne suis pas certain d’être très convaincu par ce disque, même si je suis sensible à sa démarche, oui, à la façon de cheminer, péripatétiquement, sur les fils ténus du cercle, en funambule. Plusieurs morceaux «de transition» me paraissent tout à fait superflus. La présence de Daunik Lazro, que j’ai entendu à Tours en février dernier (ou était-ce début mars ?) dans deux formations très différentes, se fait lourdement sentir, tant dans la force et l’énergie qu’il donne, de son souffle même, que par la pesanteur, parfois, de son avant-gardisme à tout crin.
Avant-hier, Irène (anciennement ici V-ue, mais dont je change le pseudonyme tant pour le rendre prononçable aux internautes qu’afin de donner un équivalent sémantique hellénistique à son patronyme breton), qui nous recevait à déjeuner chez elle, a laissé supposer que je n’aimais pas la chanson, car les amateurs de jazz, en général, sont primordialement «branchés» ou «braqués» sur le jazz (my words, not hers). Les nombreuses références à des disques de jazz, depuis l’ouverture de ce blog, ainsi que ma participation à la communauté JAZZ de l’hébergeur, ont dû la guider sur cette fausse piste. Parmi les projets que je caresse, afin de donner à ce carnétoile un tour plus systématique, j’aimerais choisir chaque jour un disque que j’aime sur mes rayonnages et en donner un petit commentaire, afin de donner, éventuellement, l’envie aux internautes de se le procurer, by means foul or fair.
Je ne suis pas sûr d’avoir, jusqu’ici, donné envie à grand monde d’acheter Le Cercle. La musique y mêle rythmes divers (d’inspiration nord-africaine autant qu’avant-gardiste “occidentale”), riffs déments et lancinants de guitare et électroniques, chants mélopées ponctuant de leurs loops les circonvolutions sonores qui les combattent plus qu’elles ne les accompagnent.
Le plus curieux, peut-être, ou le plus furieux, est que les textes d’accompagnement sont, d’un certain point de vue, plus intéressants que la musique proposée, ce qui est gênant, tout de même : à quoi bon se réclamer des incontournables Deleuze et Guattari et circonscrire ainsi, par voie de conséquence, l’écoute ? La référence à Guillevic me gêne moins, car, en premier lieu, c’est un poète, et la rencontre du poète et du musicien est moins artificielle que la relation du compositeur à «la philosophie». De plus, j’aime beaucoup Guillevic, et, l’avouerai-je, c’est la présence du nom sur la quatrième de couverture du disque (c’est un livret, donc j’imagine que l’on peut employer cette terminologie) qui m’a incité à l’achat.
Je ressors de l’écoute de ce disque (troisième écoute, en ce moment même, une semaine après l’achat) sans grande envie de me procurer d’autres enregistrements des musiciens qui forment ce cercle, mais avec le désir de me replonger dans la lecture de Guillevic, ou d’en savoir plus sur cet Ayari Mondher, dont un extrait de l’ouvrage L’écoute des musiques arabes improvisées sert de note introductive, ou surtout sur le traité, qu’il cite, de Safiyyu d-Din ; les extraits de al-Sarafiyyah qui sont ici timidement, parcimonieusement proposés, m’ont rappelé mes chères années d’études, et les nombreuses lectures de textes soufis et d’essais sur le soufisme.
Ce qui me fait penser, pour passer du coq à l’âne et de bouc en brebis, que je n’ai toujours pas écrit, en une note, ce que je fais vraiment dans la vie (ce à la demande de Marione, mais aussi des milliers de “fans” qui se pressent aux grilles de ce blog comme, à minuit, dans les officines spécialisées de la décérébration, les adeptes qui, depuis des semaines, attendent la minute précise de la parution du dernier Harry Potter).
Je m’y attelle, et signale, en conclusion sans queue ni tête, à Jacques, que j’ai délibérément employé deux types de guillemets dans cette note. Si le cercle est vicieux, la boucle est bouclée…
Ou plutôt, non. Il est par trop injuste d’achever cette note sans écrire ici, autant à titre d’aide-mémoire personnel que pour atténuer quelques phrases trop rudes envers ce Cercle, que les trois plages intitulées “Partout dense”, “Ombre inverse” et “7073 1/2” sont remarquables, vraiment belles et stupéfiamment telles, qu’elles méritent à elles seules que l’on reprenne ce disque encore et encore.
13:00 Publié dans Affres extatiques, Autres gammes, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 07 juillet 2005
Tombeau de P.M. (sonnet)
---Peiné de cette figure austère,
Il s’accroche aux cordes de sa lyre.
Etonné de n’être cette pierre,
Roulant, fier, des cocards sans collyre,
---Rêve-t-il à ces sons qui le font
Entrer dans l’âge des colophons ?
---Même ne restant sourd aux prières,
Il s’accroche aux cordes de sa voix.
---Comme il, en ces temps de désarroi,
Hâle son front couleur de bruyère,
Etonné de n’être ce pavois,
Lui, de naître aux sursauts vifs du lierre
Où, l’arbre arraché, fier il s’empierre,
Terrible, métamorphosé, froid.
07:15 Publié dans Ecrit(o)ures, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 06 juillet 2005
In memoriam Pierre Michelot
J’apprends aujourd’hui le décès, dimanche dernier, de Pierre Michelot, monument du jazz français, contrebassiste remarquable, qui a accompagné les plus grands (Monk, Miles Davis, ‘Dizzy’ Gillespie aussi), et que nous avions entendu, en 2000, à Marciac, fort fatigué déjà, mais au mieux de ses cordes, avec René Urtreger et Daniel Humair, au sein de leur légendaire trio HUM.
Je n’ai pas de disque du trio, ni de Michelot en leader, mais je chercherai si je n’ai pas, dans ma discothèque, certaines plages où il figure.
En guise d’hommage, son nom se prête à un sonnet-acrostiche (inversé), que je publierai plus tard.
23:15 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (4)
mercredi, 29 juin 2005
OONA
Je suis en train d'écouter, pour la première fois depuis bien longtemps, un disque qui m'avait été offert à Noël 2000, à Hagetmau, Résistance poétique du Trio Christophe Marguet (Label bleu, 1996). C'est un disque qui m'a accompagné tout au long du premier semestre 2001, et en particulier dans certains moments difficiles, pendant que je finissais d'écrire ma thèse. La première composition, Oona prête à la rêverie. Ballade douce, entraînante, folâtre, elle célèbre Oona, c'est-à-dire, à mes oreilles maintenant, l'an OO, l'année du double O, du double oh, de la bouche ouverte en étonnement, de l'embrasement, de l'embrassade, de la fulgurance et de l'inquiétude passionnée, aux mélopées chaleureuses du sax. Composition érotique, pulpeuse, radieuse. De manière générale, je préfère, sur ce disque, les ballades, comme Recueillement ou Brume, aux compositions plus heurtées. Trio roi de l'envolée lyrique, fantômes du riot, de l'échauffourrée, que l'on s'imagine écouter sous les platanes près d'un cloître gothique, ou dans la chaleur touffue d'une salle enfumée.
09:05 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1)
mardi, 21 juin 2005
Ha Po Zamani
Ce qui m’attire, entre autres, dans cette chanson de Miriam Makeba, c’est qu’elle se prête fort bien au jeu de l’improvisation verbale. Je crains que ceux qui ne voient pas ce dont je parle ne comprennent pas grand chose à ce qui suit, mais enfin, le principe est simple, et ce jeu, d’ailleurs, n’a rien d’original, puisque Cavanna raconte, dans Les Ritals, qu’il s’y livre régulièrement, à partir de la chanson de Brel, Amsterdam.
Sur un air donné, l’on se surprend et se prend à improviser des paroles. Ce qui peut donner ceci, sur Ha Po Zamani :
Mon ordinateur je viens d’allumer
C’est branché
Zama !
Je ne sais pas encore ce que je vais y trifouiller
Quel taré
Zama !
Bon, voici de mon blog le fichier
Pour m’attirer
Zama !
Et je raconte un peu n’importe quoi c’est vrai
Enivré
Zama !
Etc.
Comme quoi les rappeurs, avec leur free style n’ont rien inventé, et je n’ai rien à leur envier, et je fais vibrer la fac quand je veux, d’abord !
En écoute : rien à voir : Present Past du Jaromir Honzak Quintet. Le jeu de Michal Tokaj au Fender Rhodes m’agace un peu, tout cela sonne un peu musique d’aéroport des seventies, mais il y a aussi quelques réussites. Le bassiste (et leader) est d’une subtilité de jeu qui sauve presque la mise.
J’ai une grande affection pour le morceau intitulé « Constant Struggle », qui me semble assez mal nommé d’ailleurs tant il s’y entend d’accord, de douceur, si lancinants soient les accents de la guitare (Christian Rover). C’est une très belle composition, qui doit beaucoup, dans sa tenue, à la basse de Honzak, bien sûr, et, dans sa retenue, au jeu mélopé, tourneboulé, doucement affolé, du saxophoniste, Piotr Baron.
(Il faut tout de même que je justifie un brin mon appartenance à la communauté JAZZ de HautEtFort.)
18:40 Publié dans Autres gammes, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 09 juin 2005
OCB
L'Orchestre de Contrebasses est l'une de ces formations inclassables, tout de même jazz, mais d'une manière si particulière qu'on ne peut pas vraiment dire, en écoutant leurs superbes mélodies et les mélopées affolantes qui s'échappent du bois et des cordes de leurs instruments, "c'est du jazz comme ci ou comme ça".
J'ai découvert ce sestet (je ne sais jamais si on peut dire "sextuor" pour une formation, ou si c'est réservé à une composition pour six instruments) vers 1998, avec l'album Jeux dangereux, l'un de leurs plus beaux.
Depuis, j'ai accumulé quelques-unes de leurs précieuses créations, mais, à mon grand dam autant qu'à mon dol, ne les ai jamais vus en concert, où, paraît-il, ils se transcendent; ça doit être quelque chose!
..........................
En écoute: "Ano Hini Kaeritai" (album Musiques de l'homme).
12:45 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1)